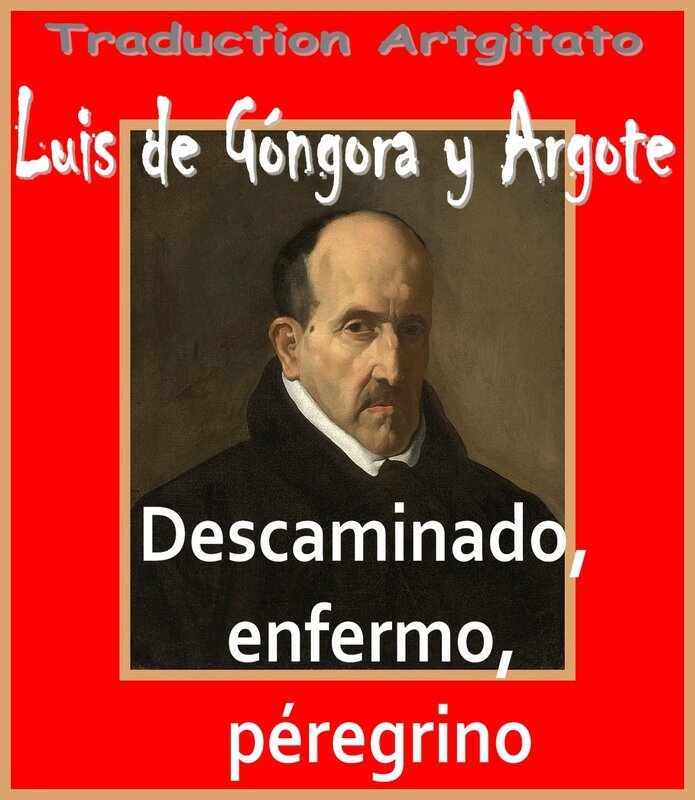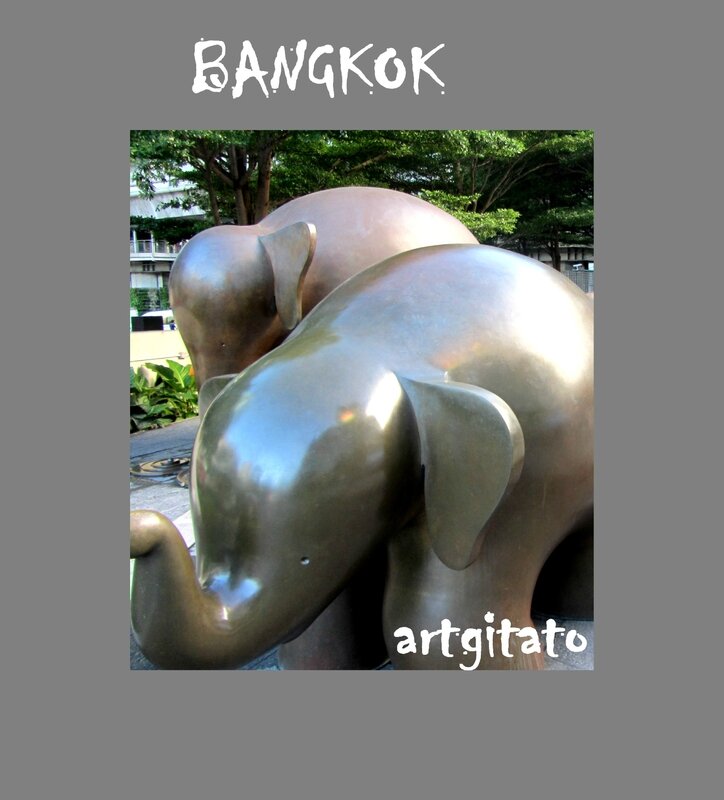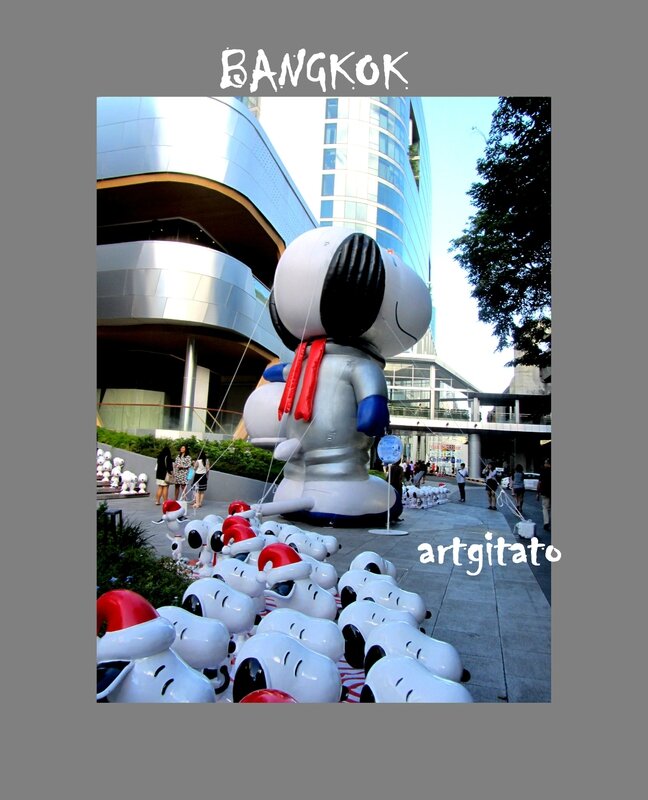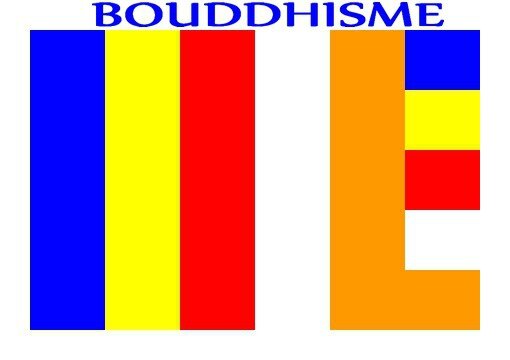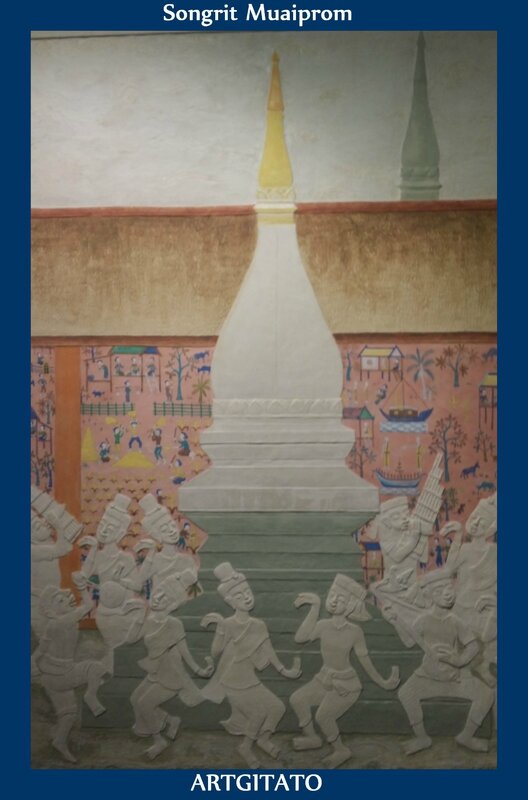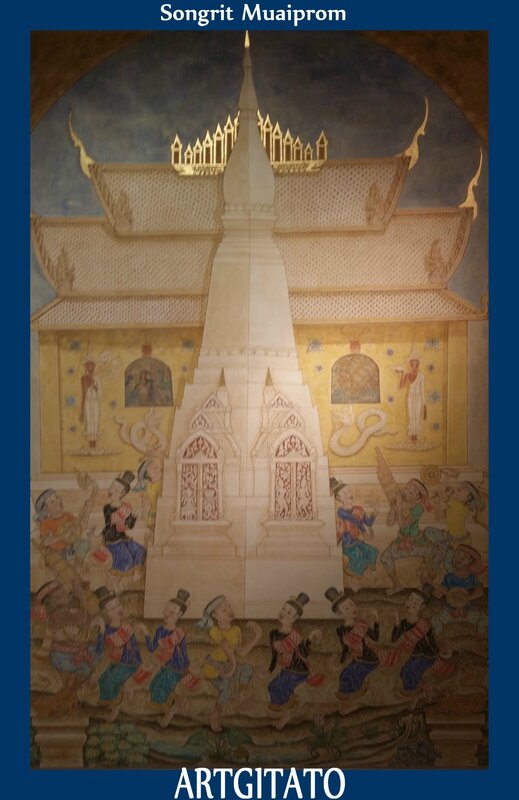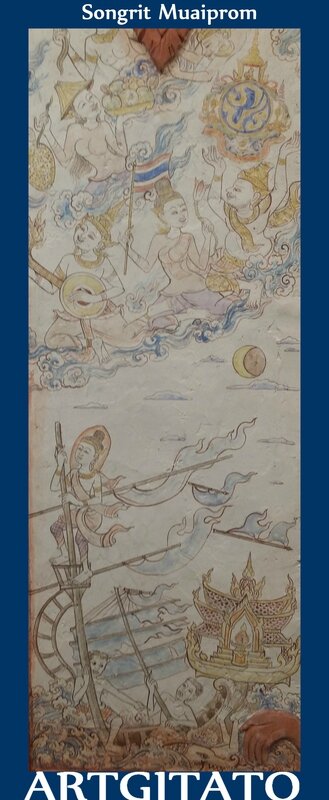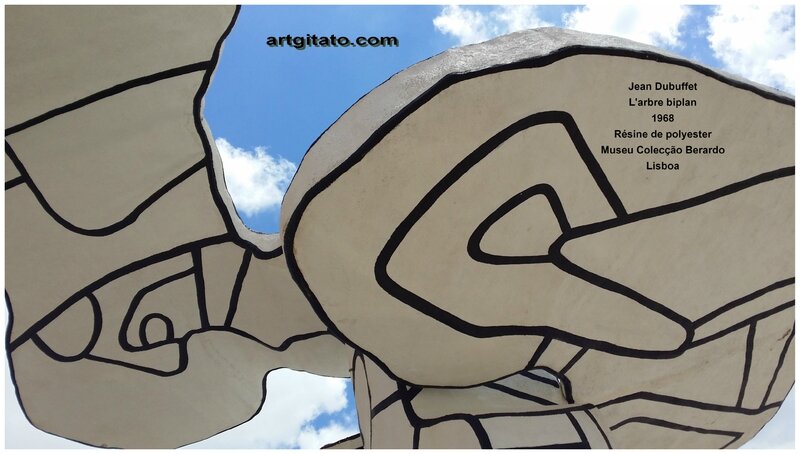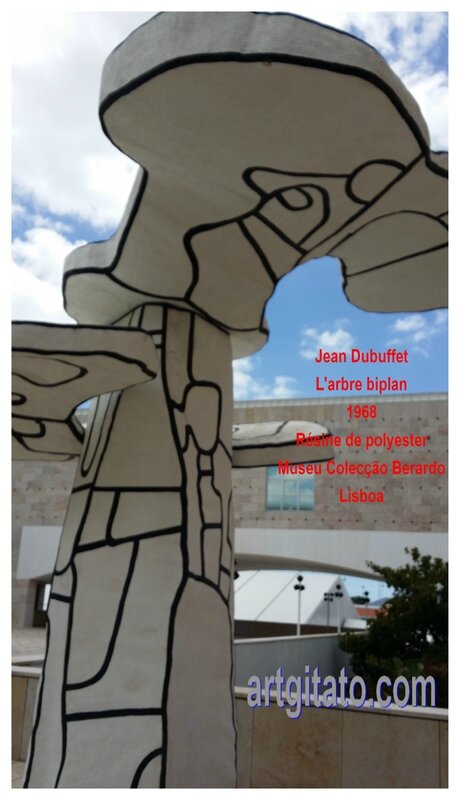Michel BOUVET
Affichiste

L’ART DUPLICITAIRE
ou la Question
du Vide & du Plein
L’affiche familière est là, face à nous, en pulsion.
Elle est toujours familière, passionnément. Elle doit se montrer. C’est sa raison d’être.
« L’homme y passe à travers des forêts de symboles Qui l’observent avec des regards familiers. » (Baudelaire, Correspondances). Elle glisse autour de nous pour mieux se montrer, pour mieux agripper, comme une liane sur son arbre. Elle nous guette, tel un fauve sur son territoire, La ville, La route, Le carrefour. Elle n’attend que le moment pour nous flécher, nous pénétrer. Elle sait capter toujours l’inconscient et l’esprit parfois. Attirer un instant de notre temps. Elle ne prétend pas fleureter avec le familier, elle est Le familier. Quoi de plus proche qu’une affiche. C’est notre décor. Notre pollution, même.
Elle devient ce familier décalé, un ailleurs qui nous attrape le regard.
Nous rentrons dans le règne des paradoxes. Le proche et le lointain. Le familier et l’étrange. L’affiche est là qui nous saute à la figure. Nous tort et nous essore. Nos yeux y portent souvent une attention particulière. L’affiche qui semble inoffensive veut faire vibrer en nous plus d’une corde. Du vertige à la panique des silhouettes insondables hantent alors nos lieux. Et le familier s’évapore. Définitivement.
Le dessin d’abord. Il est l’essentiel, la forme première des grottes aux murs de nos cités. D’une autre manière, l’image est vocale et olfactive. Elle s’offre comme la sensation pure, passive et offerte. Posée contre un mur ou un panneau. Elle ne survivra ni aux intempéries ni aux autres spectacles. Papillon qui se pose sur les parpaings et le gris des villes. Hegel parlait de la « supériorité » de l’art vis-à-vis de la nature. Par la nature-même de cet art, l’affiche rend l’art naturel, tellement présent.
Pour autant, cet art se doit d’être autre, différent ; l’affiche doit par nature se faire remarquer, sinon elle n’a plus lieu d’être. Faire tendre l’affiche vers ce naturel qui n’en n’est pas un. Faire tendre le cœur de l’affiche vers la question, c’est la tendre vers l’infini. L’infini des possibles. Rendre visible les possibles du questionnement ; entr’apercevoir un début de réponse. Car l’affiche en un sens répond. A une question par des multiples questions. Et attirer le voyeur vers la salle où l’imperceptible de l’interrogation pourra prendre forme.
L’affiche à la différence du tag est commanditée par un tiers. Elle est l’œuvre d’un compromis entre l’artiste et la salle de spectacle. Entre l’esprit et le périssable. Entre l’éternité et la poubelle. L’affiche finira en bouillie mais avant elle a fait vivre une idée et l’a enracinée du macadam à notre cerveau.
Alors que le mythe dévoile et que le rite voile, l’art balance entre ce que je vois et ce qui se cache. L’affiche dans la rue paraît évidente.
Elle pourrait être dévoilement. Mais son cœur ne se montre jamais.
C’est quand l’œil s’approche de l’intérieur qu’il n’a jamais été aussi loin, qu’il se retrouve si loin, dans le temps et dans l’espace. Plus l’œil se perd dans l’affiche, plus il s’éloigne et s’approche du spectacle vivant.
L’affiche nous montre ce qu’elle veut bien montrer. Uniquement. Pas plus et beaucoup plus que ça.
Si « la sonorité d’une phrase non prononcée emplit toute la scène » (Paul Claudel), c’est le non-dit de l’affiche qui emplit toute sa représentation. « Alors que la peinture est un art d’expression, l’affiche est un art de communication, mais dont la qualité réside dans sa capacité artistique le simple fait de communiquer. » (Michel Bouvet, Affiches Culturelles de Michel Bouvet) Une communication entre le mur et soi, entre l’Idée et une conscience.
Cassandre, le créateur d’affiche, a souligné que « la communication est un but en soi, l’affiche n’est qu’un moyen de communication entre le commerçant et le public, quelque chose comme le télégraphiste : il n’émet pas de messages, il les transmet ; on ne lui demande pas son avis, on lui demande simplement d’établir une communication claire, nette, puissante, précise. » C’est vrai de nombreux affichistes. Mais il y a les Mucha, les Koloman-Moser, Cassandre lui-même, Alain Weill, Kauffer ou Kirchner. Il y a plus près de chez nous, plus proche de nous, Michel Bouvet. L’homme qui illumine les affiches des théâtres depuis quelques décennies déjà. Un regard qui transparaît au-delà des commandes, des discussions et des choix du donneur d’ordres. Les artistes sont entrés dans l’affiche. Il faudrait donc distinguer les artistes publicitaires des artistes duplicitaires. Les premiers répondant à une commande et remplissant consciencieusement le cahier des charges. Les seconds, plutôt travaillant pour l’art et spectacle, et apportant une touche personnelle, à l’image de Michel Bouvet. La duplicité, entendue dans le sens de dédoublement ; le double de l’artiste répondant d’un côté à la raison de la commande et à l’irrationnel non de la séduction, mais d’une accroche, et de l’autre à l’histoire personnelle de l’artiste, sa formation, ses goûts.
Michel Bouvet a découvert sa vocation lors d’un voyage de l’autre côté du Mur, à Prague. Il a gardé de cette époque, les couleurs et les motifs. Comme il a su les emprunter à Mai 68, aux mouvements féministes, écologiques, des droits de l’homme, etc. Michel Bouvet est un affichiste totalement engagé. Il récupère de ces décennies d’art de propagande les outils et les traits pop art d’un Rauschenberg qu’il admire, voire plus près de nous des dessinateurs de Fluide Glacial. Les marteaux, les poings fermés, les yeux bandés, les sexes cloutés, une arme avec un svastika, etc. Michel Bouvet concentre sa création avec les festivals et les théâtres, lieux où sa voix peut-être vue.
Il prend de ces mouvements l’urgence d’une action et la lucidité du symbole. Il trouve l’évidence qui au préalable se refuse. L’évidence ne nie pas la complexité. Elle la dévie. Ainsi la complexité du regard qui peut nous aveugler est cachée. Les affiches de Bouvet ne scintillent pas, ne brillent pas, elles pourraient paraître ternes. « Pour moi, l’objectif d’une affiche ne doit pas être de séduire. La séduction d’une image apparaît lorsque le créateur commence à édulcorer, voire appauvrir le message d’une affiche au profit d’un aspect formel plus conforme à la bienséance, au goût commun de ses contemporains. Il n’y a pas de traces d’audace, d’irrespect ou de détournement dans une image séduisante parce que la démagogie ou l’intérêt commercial poussent à réduire les champs d’investigation de l’artiste et son esprit critique. L’affiche doit être le terrain de la remise en question des valeurs esthétiques dominantes, du questionnement de l’artiste face à la société et contribuer à la réflexion et à la curiosité des autres. » (Michel Bouvet, Affiches Culturelles de Michel Bouvet) Ces regards de l’affiche sont le plus souvent aveugles. Les yeux sont rares. Ils existent pourtant, francs comme ceux de l’homme enturbanné dans Djebels de Daniel Lemahieu, dans 1794 avec un portrait franc et droit de l’Abbé Grégoire (exposition Musée National des Techniques), Marylin pour la Saison 89/90 du Théâtre de Longjumeau. Mais ce sont des icônes à part entière. Le regard ne rajoute rien et n’enlève rien. Ce sont des mythes. Les expressions sont sans cela absentes. Dans le portrait de Monsieur Vitrac quand l’ombre mange les ¾ du visage. Dans les Yeux d’Encre (Spectacle d’Arlette Mamiand) l’homme à gauche, en négatif, a des yeux bleutés, aveugles. La femme à droite, les yeux bandés d’un rectangle bleu. Ni l’un, ni l’autre ne voient. Mais l’absence de leurs regards nous fait sentir le nôtre plus fort encore.
Dans Fragment (Mise en espace de Catherine Diverrès), l’affiche est aussi coupée en deux verticalement. A gauche, un regard serein, méditant, de femme, les yeux baissés ; à droite les yeux d’une sculpture de femme identique. La similitude dans la différence nous interpelle. Dans Danae Marguerite (Chorégraphie d’Hervé Jourdet) nous nous retrouvons avec deux personnes en chapeau et anorak. L’une nous tourne le dos quand l’autre semble nous regarder. Mais, en fait, elle se cache. Et le seul fait qu’elle ne souhaite pas être reconnue, nous attire encore plus. Dans Les Saisons de l’Europe, un arbre nous regarde au travers d’un masque. Un regard absent plus expressif encore. Dans La Dupe de Georges Ancey, les lunettes de la femme qui nous fait face sont rayées de sparadrap. Un jeu de dupe qui nous entraîne à savoir ce qu’il y a à penser. A connaître ce qui se cache derrière. A lever le doute en levant le voile. Dans le Don Juan de la Comédie de Genève, les yeux du séducteur sont devenus des bouches pulpeuses et langoureuses. Dans l’attente de ces désirs à voir, nous sommes là dans l’attente.
En fait l’affiche ne brille pas, elle réfléchit.
L’affiche de Michel Bouvet ne cherche pas l’individu mais le groupe. L’affiche n’a pas de voix à entendre, mais une musique ; elle doit donc nous couper le souffle. Un sexe de femme en pointe, un point d’interrogation pris dans le bois de l’instrument (Comment jouer ensemble ? Centre de Pratique Instrumentale des Musiciens Amateurs d’Île de France), une blanche alouette tranquille et blanche sur son feu de bois (L’Alouette d’Anouilh, aux Tréteaux de France) L’affiche de Bouvet met en question, elle cristallise. Moins qu’un résumé de l’œuvre, l’affiche pose la question que l’affichiste, fin lecteur, après deux à trois lectures du texte, se pose. Elle vient souvent d’une incompréhension ou d’une trop grande compréhension, ce qui revient au même.
Le dépouillement, la simplicité – revenir à l’objet, au concept.
Dans simplicité nous trouvons la vérité. Une pensée, attribuée à Lao Tseu, dit que : « Je n’ai que trois choses à enseigner: la simplicité, la patience, la compassion. Ces trois sont vos plus grands trésors. » Pour cela, il faut encore et encore élaguer. Sans pour autant devenir simpliste. Sans pour autant enlever du mystère. Comme l’artisan enlevant par couche fine le bois de la statue afin de lui donner l’expression juste. Une couche de trop et l’œuvre est dévoyée, trahie. Quoi de plus simple qu’un trait, qu’une ligne. Quoi de plus évident qu’un dessin. Plus direct. « Le dessin me paraît le point de départ nécessaire, inévitable. Car le dessin c’est avant tout : le vide et le plein, l’ombre et la lumière qui nous rendent intelligibles les formes. Le dessin est l’expression la plus remarquable de la simplicité, de l’unicité par le dépouillement de ses moyens et le caractère immédiat de sa forme (Matisse, par exemple). » (Michel Bouvet, Affiches Culturelles de Michel Bouvet)
Jacky Lavauzelle