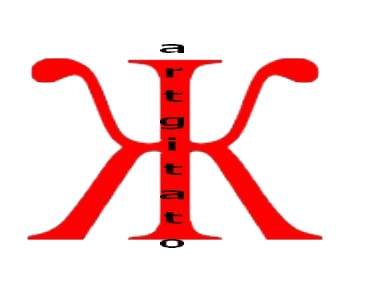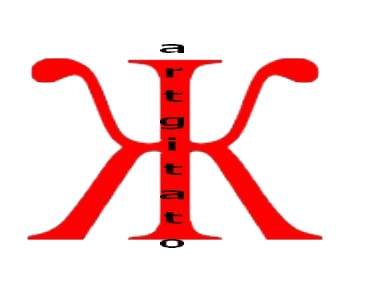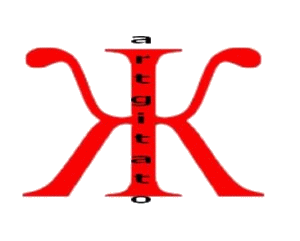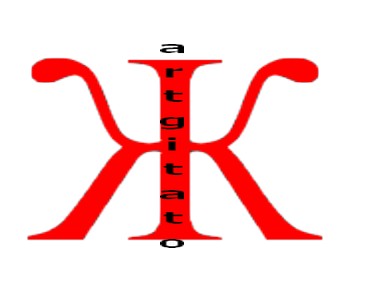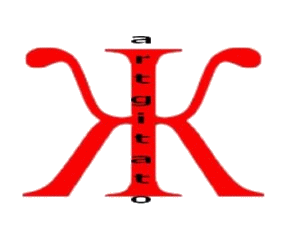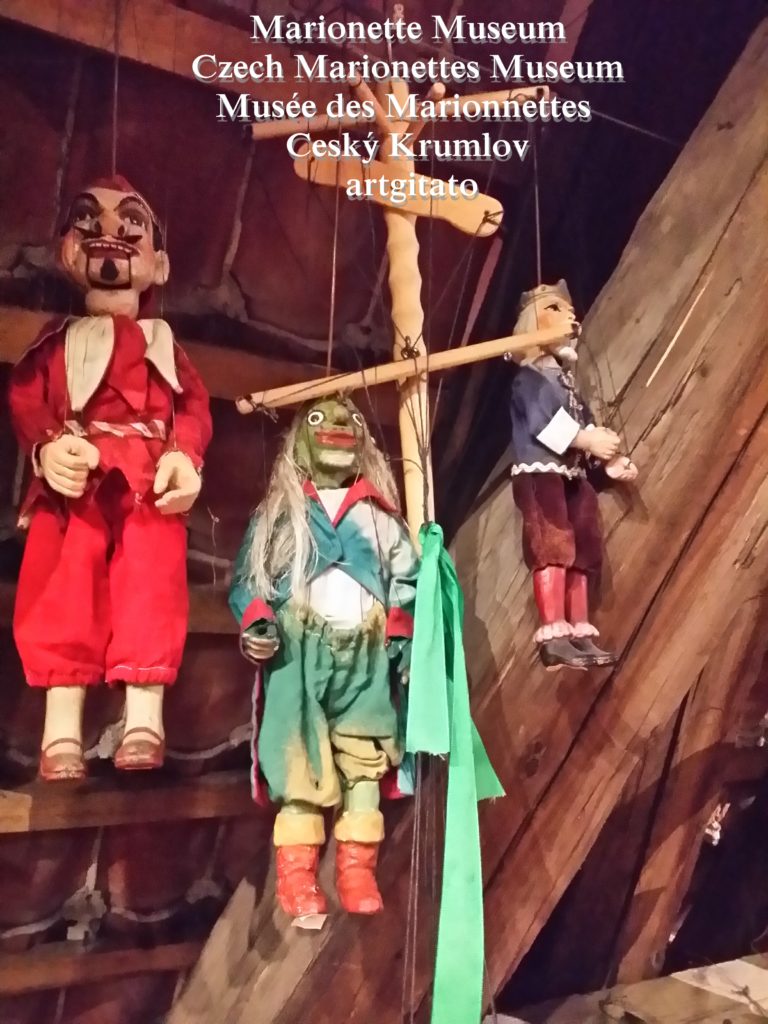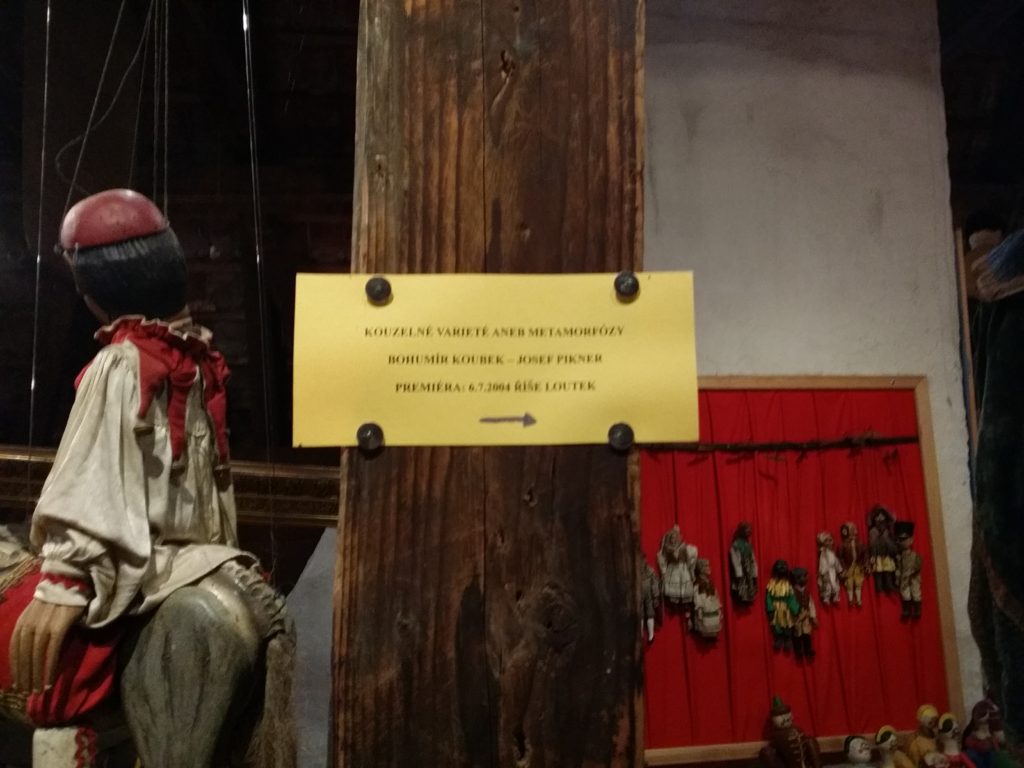NIKOLAUS LENAU
Poète Autrichien
Österreichische Dichter
1802-1850
&
SOPHIE von LÖWENTHAL
1810-1889

En arrière plan
Jean-Auguste-Dominique Ingres
Roger délivrant Angélique
1819
Musée du Louvre Paris
****
Le martyre d’un poète
Nicolas Lenau & Sophie Lœwenthal
Nikolaus Lenau & Sophie von Löwenthal
LE GENIE LYRIQUE DE LENAU
Il semble que la partie autrichienne de la littérature allemande ait surtout attiré l’attention de la critique française : car la littérature allemande a encore ses provinces, et le même esprit ne règne pas en Prusse et en Autriche, en Souabe et sur les bords du Rhin. L’Autriche a donné à l’Allemagne, au siècle dernier, deux grands poètes, le poète dramatique Grillparzer et le poète lyrique Lenau. M. Ehrhard a écrit sur Grillparzer un beau livre, qui a été traduit en allemand. Lenau a été l’objet de deux thèses de doctorat, celles de M. Roustan et de M. Reynaud, l’une plus biographique, l’autre plus philosophique, l’une et l’autre très étudiées et très approfondies en leur genre. Précédemment déjà, M. André Theuriet avait analysé, avec sa pénétration habituelle, le génie lyrique de Lenau ; il avait même accompagné son étude d’élégantes traductions en prose et en vers.
LE PRELUDE DE SA FOLIE
Aussi n’est-ce point sur les caractères de la poésie de Lenau que nous avons l’intention de revenir ; nous voudrions nous arrêter seulement sur un des derniers épisodes de sa vie, ses relations avec Sophie Lœwenthal, qui furent sinon la cause, ou l’une des causes, du moins le prélude de sa folie.
TOUTE SA PASSION ET TOUTE SON AMERTUME
Une partie des Lettres à Sophie avait déjà été insérée dans la copieuse et un peu confuse biographie de Lenau, faite par son beau-frère Antoine Schurz, et publiée en 1858. Plus tard, en 1891, le poète médecin Frankl retira des papiers de Sophie une série de billets que Lenau adressait à son amie après une visite ou une promenade, ou le matin au réveil, ou la nuit aux heures d’insomnie, ou encore en voyage, des billets qu’il lui remettait selon l’occasion, et auxquels elle répondait. C’est une sorte de conversation à distance, à laquelle il ne manque que les réponses, un journal intime dans lequel le poète déverse, avec une entière sincérité, toute sa passion et toute son amertume. Mais les deux publications, même celle de Frankl, offraient des lacunes.
VOIR CE QUI SE PASSAIT DANS L’ÂME DU PAUVRE POETE
Le professeur Edouard Gastle nous donne aujourd’hui un texte complet des confidences de Lenau ; il y joint des extraits d’un journal que Sophie rédigea pendant deux années de sa jeunesse. Enfin nous avons l’unique ouvrage de Sophie Lœwenthal, son roman qui jusqu’ici était resté inédit, et qui donne la mesure de son goût littéraire. Nous savons donc, sur son esprit et son caractère, et sur ses relations avec Lenau, tout ce que nous saurons jamais ; mais ce que nous savons suffit pour nous faire voir ce qui se passait dans l’âme du pauvre poète pendant ces années de martyre où sombra son intelligence.
I
LE DEMON DE L’INCONSTANCE
Au mois d’octobre 1833, Lenau revenait à Vienne, où il avait fait une partie de ses études. Jusque-là, selon sa propre expression, c’était « le démon de l’inconstance » qui avait déterminé sa carrière. Né à Csatad, en terre hongroise, mais de parens allemands, il avait vécu tour à tour à Pesth, à Tokay, à Vienne, à Presbourg, selon les besoins de sa famille, qui était pauvre ; et il s’était occupé successivement de philosophie, de droit, de médecine, même d’agronomie, sans fixer son esprit sur aucune étude spéciale. Puis il s’était affilié à la petite école poétique de Souabe, dont le siège principal était à Stuttgart ; il avait trouvé là une revue, le Morgenblatt, et un éditeur, Cotta. Après un voyage en Amérique, où il avait laissé ses dernières illusions et même une partie de sa fortune, il s’était encore, une fois arrêté à Stuttgart, où l’attachaient désormais de vives admirations et de chaudes amitiés. Enfin, toujours poussé par le même démon, il revenait à Vienne, son autre patrie littéraire, précédé cette fois d’une réputation qui s’étendait peu à peu à toutes les régions de l’Allemagne.
UN AIR DE NOBLESSE
Lenau avait trente et un ans. Il venait de publier son premier volume de poésies chez Cotta. Il s’occupait de la composition de Faust ; il entrait dans sa période de maturité féconde. Frankl, un des hommes qui l’ont le mieux connu, trace de lui le portrait suivant : « Lenau était petit et trapu ; il avait la démarche lente, presque paresseuse, et la tête penchée en avant, comme s’il eût cherché quelque chose par terre. Tous ses traits avaient un air de noblesse. Le front était pâle, large et haut, encadré de cheveux bruns, peu abondants, collés aux tempes. Dans les moments d’émotion, on pouvait voir une veine irritée courir de haut en bas sur ce front… Ses grands yeux bruns, sous l’empire de la passion, brillaient d’un feu sombre, puis, soudain apaisés, s’arrêtaient mollement sur celui avec lequel il s’entretenait de questions sérieuses concernant l’art et la vie. La bouche, largement fendue, plutôt sensuelle que noble, était ombragée d’une moustache ; il fallait que le menton fût toujours « lisse comme du velours. »
DES BOUFFEES DE FUMEE S’ECHAPPAIENT DE SES LEVRES
Le nez, qui tombait droit sur la bouche, était d’un beau dessin. Le vêtement était toujours simple et correct. Lenau n’éprouvait pas le besoin de parler, comme c’est souvent le cas chez les gens d’esprit capables de donner à leurs idées un tour artistique. Mais lorsqu’il était entraîné par un sujet qui le passionnait, il pouvait parler longuement, non sans énoncer de grandes pensées. La voix était alors lente et claire, les images frappantes, le tour original et incisif. Il aimait à faire des poses, quand il développait une idée, et des bouffées de fumée s’échappaient de ses lèvres, avant qu’il reprît son discours. Alors il accompagnait ses paroles d’un singulier mouvement des sourcils, qui se relevaient et se contractaient, et il roulait des yeux, comme s’il voulait, par cette mimique, souligner l’importance de ce qu’il disait… Il parlait un pur allemand, sans accent hongrois ni dialecte autrichien. » Ce portrait, tracé d’une main bienveillante et d’une main de poète, s’embellirait singulièrement si l’on interrogeait les femmes qui avaient connu Lenau à Stuttgart. « Le cœur me battait, dit l’une d’elles, comme dans l’attente des joies de la veille de Noël, lorsque j’entrai dans le salon où devait paraître Lenau. La maîtresse de maison me mena au-devant de lui, et je levai timidement les yeux sur cette belle tête, sur ce visage expressif… » Elle parle ensuite de « ce front noble, presque royal, » que sillonnent les rides de la pensée et de la passion, de ces yeux « dont elle a senti le regard jusqu’au fond de l’âme, » de ce qu’il y a dans tout l’être à la fois de doux et de puissant. Schwab assurait, au dire de sa femme, que ses poésies lui plaisaient mieux quand elles étaient récitées par Lenau. Justinus Kerner et Karl Mayer le consultaient et lui soumettaient leurs œuvres. Seul Uhland, l’écrivain le plus distingué de l’école, esprit ferme, lucide et pondéré, se tenait un peu à l’écart ; tout en reconnaissant le génie de Lenau, il était choqué de ses airs fantasques et des soubresauts de son humeur capricieuse.
LA MAISON HARTMANN-REINBECK
Le rendez-vous ordinaire du monde littéraire était la maison Hartmann-Reinbeck. Le conseiller Hartmann était un personnage considérable dans la ville ; il joignait la distinction de l’homme de cour à la bonhomie proverbiale du Souabe, il garda jusqu’à l’extrême vieillesse la lucidité de son esprit et l’affabilité de ses manières. Il avait reçu la visite de Gœthe, de Jean-Paul, de Schelling, de Tieck. L’aînée de ses quatre filles, Emilie, avait épousé George de Reinbeck, un veuf qui avait près de trente ans de plus qu’elle. Reinbeck était originaire de Berlin ; il avait d’abord enseigné l’allemand et l’anglais à l’École supérieure et au Corps des pages de Saint-Pétersbourg, et, à son retour de Russie, il avait été nommé professeur au gymnase de Stuttgart ; il dirigeait le Morgenblatt avec Haug. Ce qu’on remarquait le plus en lui, c’était la correction inaltérable de sa tenue, qui le rendait presque ridicule. Il avait de grandes ambitions littéraires, et il a rempli des volumes avec ses drames, ses nouvelles, ses récits de voyage, qu’on ne lisait déjà pas beaucoup de son temps, et qu’on ne lit plus aujourd’hui. Sa femme, en qui revivait la simplicité paternelle, lui était supérieure, quoiqu’elle n’ait jamais écrit que des lettres. « Tous ces gens, écrivait Lenau à son beau-frère Sohurz, vivent ensemble dans une même maison, qu’ils ont bâtie pour eux. et l’on ne saurait imaginer quelque chose de plus aimable >et de plus intime que cette vie commune. »
EMILIE DE REINBECK
Emilie de Reinbeck était la plus sage de toutes ces femmes qui s’empressaient autour du poète que l’on savait tourmenté d’inquiétudes chimériques et de maux réels. Elle était aussi la plus cultivée ; elle avait du talent pour la peinture ; elle partageait les promenades de Lenau, et souvent ils considéraient ensemble le même paysage, que chacun reproduisait à sa manière, l’un avec la plume, l’autre avec le pinceau. Emilie n’avait pas d’enfants ; elle avait huit ans de plus que Lenau, et elle lui voua une amitié qu’elle compare elle-même à l’amour d’une mère. « Tu sais, écrit-elle à Emma Niendorf, que c’est devenu un besoin pour mon pauvre cœur de consacrer à notre ami tout l’amour et toute la sollicitude que j’aurais voués à un enfant, si le ciel ne m’avait refusé ce bonheur. » Et ailleurs : « Dieu sait que sa santé physique et morale me tient à cœur, à tel point que je la lui assurerais volontiers par le sacrifice de ma vie. » Elle disait vrai. Ce sera Emilie de Reinbeck qui, plus tard, au détriment de sa propre santé et même au péril de sa vie, gardera le poète malade dans sa maison, jusqu’au jour où ses soins seront devenus impuissants.
II
UN HÔTE ASSIDU DU CAFE D’ARGENT
Lenau, pendant les séjours plus ou moins longs qu’il faisait à Vienne, ne pouvait manquer d’être un hôte assidu du Café d’Argent, où se rencontrait tout ce qui avait un nom dans les lettres et dans les arts. Là, dit Frankl, se faisaient et se défaisaient les réputations ; les débutants se mettaient sous l’œil des maîtres ; les œuvres manuscrites recevaient leur passeport pour l’imprimeur. On causait poésie, peinture et musique ; on se plaignait de la censure ; on parlait même politique à voix basse. Deux salles étaient réservées aux habitués ; ils trouvèrent un jour l’installation mesquine et voulurent se transporter ailleurs ; le garçon leur fit observer qu’ils ne pouvaient quitter un lieu où ils avaient journellement la perspective d’une couronne de lauriers : cette enseigne décorait, en effet, une boutique en face.
L’IRRESISTIBLE SOPHIE
Aux écrivains de profession se mêlaient des dilettantes, de grands seigneurs qui s’autorisaient de leur commerce avec les poètes pour faire eux-mêmes de la prose médiocre ou de mauvais vers, des fonctionnaires qui, selon l’expression de Platen, passaient leur matinée dans une chancellerie et le soir allaient faire un tour sur l’Hélicon. C’est probablement au Café d’Argent que Lenau se lia d’amitié avec Max Lœwenthal, qui l’introduisit auprès de sa femme, « l’irrésistible » Sophie.
FRANCOIS-JOACHIM KEYLE, LE PERE DE SOPHIE
Le père de Sophie, François-Joachim Kleyle, un Badois, après avoir terminé ses études juridiques à Vienne, s’était fait attacher à la maison de l’archiduc Charles, l’adversaire parfois heureux de Napoléon. Il était même entré si bien dans la confiance de l’archiduc, que celui-ci lui faisait écrire ses Souvenirs militaires sous sa dictée. Il fut nommé et enfin élevé à la dignité héréditaire de chevalier. Sans avoir une fortune considérable, il tenait son rang dans l’aristocratie viennoise, toujours friande de fêtes et de divertissemens. Il eut trois fils et cinq filles. On dit qu’il réunissait plusieurs fois par semaine ses filles pour leur faire des conférences sur l’histoire et les sciences naturelles. En même temps, la mère, personne toute pratique et très économe, les dressait aux soins du ménage. Sophie raconte dans son Journal que, dans un dîner, ce fut elle qui alla chercher le vin à la cave, prépara le café et se leva plusieurs fois de table pour assurer le service. En été, la famille se transportait à Penzing, aux environs de Vienne, où Kleyle avait une maison Lde campagne.
LA JEUNESSE DE SOPHIE
Dans le salon de sa mère, c’était Sophie qui attirait d’abord l’attention. Elle était plus gracieuse que belle. Elle avait la taille bien prise, des traits un peu lourds, des cheveux bruns qu’elle arrangeait en bandeaux, des yeux bleus, vifs et intelligens. Elle parlait bien le français, ce qui était l’ordinaire dans le grand monde viennois, et, ce qui était moins commun, elle écrivait bien l’allemand. Elle avait complété son instruction par des lectures ; elle avait du goût pour la poésie et la musique, et elle peignait des fleurs. Elle se mêlait volontiers aux conversations des hommes, et abordait alors les sujets les plus sérieux, sans affectation comme sans fausse honte. Elle aimait à recevoir des hommages, tout en sachant, avec une certaine grâce ironique, tenir les adorateurs à distance. Sensée avant tout, et même un peu raisonneuse, elle n’était pas incapable d’un mouvement de passion ou d’un élan d’enthousiasme, mais elle reprenait vite son empire sur elle-même. Elle eut, dans sa jeunesse, ce qu’on a appelé une passion, ce qui fut plutôt une amourette, à en juger par la manière dont elle en parle dans son Journal. Ce qu’on sait maintenant de ce court épisode de sa vie jette même un singulier jour sur son caractère.
LA LIAISON ENTRE SOPHIE ET LOUIS KOECHEL
Sophie avait quinze ans lorsqu’elle s’enflamma pour Louis Kœchel, précepteur des enfants du comte Grunne, qui était aide de camp de l’archiduc Charles. Kœchel était un homme instruit et un esprit original, botaniste distingué, en même temps que grand connaisseur en musique. Il avait donné à plusieurs reprises des marques d’attention à Sophie, et elle s’y était montrée sensible. Un jour, après une soirée passée au théâtre, elle écrit : « J’étais persuadée que Kœchel viendrait dans notre loge, et il vint en effet à la fin de la première pièce, une comédie insignifiante. Il était si gai, si aimable, qu’il m’en resta une impression agréable pour toute la soirée. A la sortie, comme nous regagnions notre voiture, il marcha à côté de moi et fut si animé que je lui demandai ce qui lui était arrivé d’heureux. « Que peut-il m’arriver de plus heureux, dit-il, que d’avoir passé une soirée en votre société ? » Ma mère m’appela : il s’inclina, avec une telle expression de joie sur sa figure, que je restai quelques instants à le regarder avant de pouvoir lui répondre. » Elle a cependant des doutes qui la tourmentent. Est-ce bien à elle, ou n’est-ce pas plutôt à sa sœur aînée que vont les préférences de Kœchel ? « Si j’étais seulement sûre qu’il m’aime, que je lui suis chère ! Il est vrai qu’il m’a quelquefois serré la main, qu’il m’a lancé des regards passionnés, mais il ne s’est jamais expliqué. O ciel ! donne-moi un signe qu’il m’aime, que je puis espérer ; sinon, fais-moi savoir le contraire, et je me détacherai coûte que coûte, j’entrerai en lutte avec mon cœur, et dans cette lutte je triompherai, je sens que j’en ai la force. »
« LA JOLIE MALIGNE » ET L’ORGUEIL FEMININ
Ce qu’elle craint le plus, c’est d’être méconnue, ou négligée, ou même quittée. Kœchel, dans une lettre intime qui est communiquée à Sophie, l’appelle un jour, d’un mot français, « la jolie maligne, » un mot qui pouvait être un compliment, et dans lequel elle voit une injure. « Me prend-il pour une poupée, écrit-elle, pour un jouet, l’amusement d’un instant ?… Malheur à la pauvre femme qui a pu s’attacher à un bonhomme de neige comme lui, qui a pu croire qu’un convive de pierre au festin de la vie pouvait éprouver un sentiment humain ! Ainsi moi aussi je me suis laissé prendre ? C’est délicieux ! Mais grâces soient rendues au Créateur, qui a donné à la plus faible de ses créatures une force pour se délivrer ! L’orgueil féminin, c’est l’aile qui me portera désormais. Les natures molles succombent, désespèrent, aiment éternellement et infiniment, et deviennent un objet de risée. Je veux être payée de retour, être aimée, ou du moins estimée. S’il ne peut m’aimer, il faudra qu’il m’estime. Oh ! comme cela bouillonne en moi ! Patience, ma fille, il faut dormir là-dessus, réfléchir, et prendre ensuite une résolution avec un esprit tranquille. » Elle prit le parti de s’ouvrir à sa mère, qui lui représenta que Kœchel était un parfait ami, mais « qu’elle était trop belle pour lui et qu’elle méritait mieux. »
LE PUR ET MAGNIFIQUE SPECTACLE DE LA NATURE
Dans ses moments d’anxiété, où elle doutait de son ami, où elle s’effarouchait dans son « orgueil féminin, » elle avait des accès de pessimisme, qui la disposaient déjà par avance à goûter la poésie de Lenau. « J’ai quinze ans, écrit-elle au mois de mai 1826. J’ai de bons et nobles parents, des frères et sœurs que j’aime et dont je suis aimée, et un ami qui m’est cher. Je mène une vie fort agréable ; mon temps est partagé entre le travail et le repos, entre les soins du ménage et le culte des arts. Dieu m’a donné un esprit capable de penser, un cœur sensible à ce qui est beau et bon. Je jouis sans trouble du pur et magnifique spectacle de la nature. Je respire l’air vivifiant de la campagne, et j’ai pour demeure la plus gentille cellule de l’univers. J’ai pour compagne une sœur qui est comme mon autre moi-même. Je n’ai aucun gros péché sur la conscience. Et pourtant je me sens souvent très malheureuse. D’où cela vient-il ? Je ne sais. Je pourrais rester des heures entières, le regard fixé devant moi, indifférente à tout ce qui se passe autour de moi, et pleurer. Alors j’aspire au tombeau, je me dis qu’il doit être doux de dormir sous la froide terre, et il me prend envie de descendre tout de suite dans ma chambrette obscure, loin de tout l’éclat qui brille sous le ciel. »
KOECHEL UN BONHOMME DE NEIGE SANS COEUR
Après la confidence que Sophie a faite à sa mère, les notes de son Journal deviennent plus rares. Kœchel se tient à distance. Il est probable que la conseillère lui a parlé ou lui a fait parler. Mais Sophie attribue sa réserve à l’indifférence, à la froideur. Ne l’a-t-elle pas déjà comparé à un bonhomme de neige ? « Kœchel est un homme excellent, cultivé, spirituel, mais il manque de cœur. Il peut être là toute une soirée sans s’approcher de moi, sans me parler. Je suis certainement, de toutes les personnes présentes, la dernière avec laquelle il se montre aimable. Quand nous sommes seuls, il est tout amour. Il suffit de la présence d’une tierce personne pour qu’il soit tout de glace. On dirait qu’il a honte de moi, qu’il craint de laisser voir aux gens ce qu’il est pour moi. Est-ce bien ? Cela peut-il me faire plaisir ? » Gela pourrait lui faire plaisir, si elle tenait uniquement à être aimée, comme elle ne cesse de le prétendre. Mais elle s’aveugle sur elle-même ; elle confond les besoins de son cœur avec les satisfactions de sa vanité. Si elle pouvait regarder au fond de son âme, elle verrait se dénouer insensiblement des liens qui lui pèsent par moments sans qu’elle s’en doute.
TOUT EST INUTILE
Elle recule cependant devant le pas décisif. « Se quitter est une triste chose. Je cherche dans tous les recoins de mon cœur mon esprit léger, ma philosophie : c’est en vain. Je dispute contre ma raison, qui m’abandonne honteusement : tout est inutile. J’ai éprouvé toute ma vie une horreur indicible, une crainte de mort devant ce mot : se séparer, se dire adieu. » La crainte de l’adieu définitif, alors même qu’intérieurement on s’est déjà quitté, devient chez elle un trait de caractère, et nous expliquera le long tourment qu’elle infligea plus tard à Lenau, et dont elle ne put s’empêcher de ressentir le contre-coup.
LE MARIAGE AVEC MAX VON LÖWENTHAL
Elle écrit enfin à Kœchel une lettre qu’elle-même qualifie de très dure : « Puisque vous me le demandez, et que moi-même je le trouve nécessaire, je vous répéterai mot pour mot, aussi bien que je pourrai, ce qu’a dit mon père. Si ces paroles vous chagrinent, comme je n’en doute nullement, si elles vous paraissent dures, peut-être même étranges, songez que je ne fais qu’écrire ce que le plus doux, le plus sage, le plus juste des pères a dit à sa fille qu’il aime, dans une heure du plus intime abandon. » Elle énumère ensuite les griefs de son père contre Kœchel et contre elle-même. Ils ont agi comme deux étourdis, mais Kœchel est le plus coupable. Qu’a-t-il à offrir à la femme qu’il épousera ? A-t-il jamais rien fait pour se créer une situation dans le monde ? Il est intelligent et capable ; il n’a donc pas à s’inquiéter pour lui-même. Mais quand on vit au jour le jour, quand on attend tout du hasard, on a tort d’attirer dans sa vie une autre personne et de « troubler la paix d’une famille honorable pour une amourette vulgaire. » Deux ans après, au mois de mai 1829, Sophie Kleyle épousa Max Lœwenthal. Elle allait, avoir dix-neuf ans, Max en avait trente. Elle le refusa d’abord, et finit par l’accepter sur les instances de ses parens ; elle n’avait point de dot. Max Lœwenthal devait faire bientôt une brillante carrière administrative ; il devint conseiller ministériel et directeur général des Postes et Télégraphes. Pour le moment, il rêvait la gloire poétique. Il avait fait jouer, dès 1822, sur le théâtre de Prague, une comédie imitée de l’anglais ; puis il avait publié, en plusieurs séries, ses impressions de voyage en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Suisse ; il avait écrit un drame, intitulé les Calédoniens, dans le goût d’Ossian ; enfin il recueillait ses poésies lyriques, éparses dans les revues, pour les faire paraître en volume. Plus tard, d’autres ouvrages, lyriques ou dramatiques, devaient encore sortir de sa plume. Lœwenthal était un de ces amateurs qui allaient, au Café d’Argent, respirer l’air des poètes ; au reste, un galant homme, très bien vu dans la société viennoise.
DONNER SON COEUR PARCE QU’AUCUN AUTRE N’EST LA
Pourquoi Sophie le refusa-t-elle d’abord ? On a pensé que c’était un dernier sacrifice qu’elle faisait au souvenir de Kœchel. Peut-être ne faut-il chercher la cause de son refus que dans certaines idées romanesques qu’elle s’était faites sur le mariage. Dans un cahier où elle prenait des extraits de ses lectures, quelquefois en les commentant et en les expliquant, on lit : « Le mariage, une situation faite pour la vie, qui ne changera jamais, au milieu des changements incessants de la nature humaine et des choses ; la nécessité de vivre dans le même lieu avec un autre ; l’obligation de mettre au monde des enfants… Les jeunes filles doivent avoir plus de répugnance pour le mariage que les hommes. » Et elle ajoute : « C’est précisément ce qu’il y a de lamentable, que des natures nobles soient obligées de donner leur cœur à des hommes médiocres, parce qu’aucun autre n’est là. »
En pareil cas, l’autre arrive toujours.
III
UNE DECHIRURE QUI S’ELARGIT SANS CESSE
Les premières impressions de Lenau, lorsqu’il fut introduit dans la famille Kleyle-Lœwenthal, ne furent pas de tout point favorables. Le 20 septembre 1834, il écrit à Emilie de Reinbeck : « Mercredi prochain, je suis invité à Penzing, où il me sera donné de voir en plein jour la fameuse Irrésistible. Naguère ce bonheur ne m’était échu qu’à la lumière douteuse du soir. Mme la conseillère, la mère de l’Irrésistible, est une femme d’humeur gaie. Le ton de toute la famille est celui de gens assez cultivés, mais, à ce qu’il me semble, portés de préférence vers la jouissance légère et mondaine. La femme de Lœwenthal me paraît en somme le membre le plus intéressant de cette très nombreuse maisonnée. Je crois que je me tiendrai bientôt à l’écart. » Deux jours après, il écrit à son beau-frère Schurz : « Mercredi j’ai dîné à Penzing chez Max. Lui et sa femme me sont très dévoués. Des gens excellents, distingués. Le dimanche d’après, j’ai fait avec eux une promenade à Nussdorf. Beau clair de lune ; navigation sur le Danube ; gai souper sur le balcon ; rentrée à minuit. Cela n’était pas mal. Mais, mon cher frère, l’hypocondrie pousse en moi des racines de plus en plus profondes. Rien n’y fait. Je sens en moi comme une déchirure qui s’élargit sans cesse. »
L’IRRESITIBILITE RESISTIBLE
Il continue cependant ses visites ; il ne parle plus de « se tenir à l’écart ; » il trouve même dans les soirées musicales de Penzing un apaisement pour son cœur inquiet : « J’ai passé quelques soirées agréables chez Lœwenthal et Kleyle, écrit-il à Emilie le 21 octobre. Un certain Mikschik a joué des morceaux de Beethoven avec une profondeur et une énergie rares. Je suis bien vu dans la maison, et les membres de cette nombreuse famille paraissent plus aimables à mesure qu’on les connaît davantage. Quant à l’irrésistibilité, il n’y a pas de danger. »
MON ESPRIT N’EST PAS CAPABLE DE TE FERMER LES YEUX SUR MON CORPS
Il parle trop de l’Irrésistible pour ne pas sentir déjà sur lui-même l’effet de sa puissance. Au mois de mai 1835, il s’établit à Hutteldorf, tout près de Penzing, pour terminer le Faust. Ses visites deviennent plus fréquentes, et il va sans dire que Sophie en est l’attrait principal. Enfin, après avoir passé l’hiver à Stuttgart, où le retenait l’impression de son poème, il revient en Autriche, et cette fois il demeure à Penzing même. Aux yeux de Sophie, il est surtout encore, à ce moment-là, un esprit supérieur, un maître en poésie, et même en musique et en peinture, car il lui a donné des leçons de guitare, et il lui a fait dans une lettre une dissertation en forme sur la peinture de fleurs. Elle consentirait bien à le voir toujours ainsi ; elle lui prêche la modération, le renoncement ; elle lui rappelle même la différence de leur âge, quoique Lenau fût plus jeune que Lœwenthal. « Mes traits vieillissants te gênent, dit-il dans un des premiers billets. Tu ne veux pas te l’avouer à toi-même, mais c’est ainsi. Tu y reviens à chaque occasion. Mon esprit n’est pas capable de te fermer les yeux sur mon corps.
LES PASSIONS ONT RONGE MA VIE
C’est actuellement, comme je te l’ai dit, mon dernier rayon de soleil. Après cela, mon cœur aura sonné le couvre-feu. Ce n’est pas délicat de ta part de me faire sentir constamment avec quelle générosité tu consens à oublier mon âge. Je suis plus vieux que mes années. Les passions ont rongé ma vie, et ma dernière passion plus que les autres. Ce n’est pas toi qui devrais m’en faire souvenir. Tu m’as fait rentrer en moi-même, et je ne sais si mon cœur osera jamais s’ouvrir à toi avec la même confiance. Je t’aimerai éternellement, mais j’enfermerai mon amour dans ma solitude automnale. »
Il faut croire que Sophie a changé d’attitude et qu’elle a pris à tâche de ménager la sensibilité ombrageuse du poète, car les billets suivants sont pleins d’un abandon sans réserve. Lenau, toujours poussé d’un lieu à un autre, est allé passer les mois chauds dans les Alpes autrichiennes. Il a commencé le Savonarole, sans que le travail avance beaucoup. La mélancolie, la compagne fidèle de sa vie, ne l’a pas quitté. « Voici bientôt venir l’heure de notre promenade habituelle. Pense à moi, quand tu arriveras près de notre banc. Je voudrais un jour avoir cette planche pour mon cercueil. O chère Sophie ! Il est sept heures, et l’obscurité se fait dans cette hutte alpestre. J’aurai ici de longues nuits. Que n’es-tu là ! Je suis très triste. » Et quelques jours après : « Je ne pourrai plus rester longtemps ici. Quoique le séjour soit aussi tranquille, aussi poétique que je puis le désirer, il vient une heure, vers le soir, où rien ne me satisfait plus, où je ne demande qu’à être auprès de toi. Quand je me promène dans ces belles régions montagneuses, et que je me perds dans leur aspect, ma pensée se reporte brusquement vers toi, et je me dis : « Que serait-ce de vivre ici avec toi ! »
UN PACTE POUR L’ETERNITE
Au mois d’août, il est de retour à Vienne. Va-t-il y trouver le bonheur ? Il y trouve bien Sophie, qui lui tend la main comme autrefois ; mais à côté de Sophie il y a Max, qui est son ami et qu’il ne veut pas trahir, et les parents, à qui sa conduite semble parfois étrange. Alors son imagination s’exalte. Plus il se sent à l’étroit dans la réalité, plus il s’élance d’un bond hardi dans le rêve. L’amour n’est-il donc fait que pour ce monde ? est-il même fait réellement pour ce monde ? « Tu as raison, écrit-il en janvier 1837, notre amour est un pacte pour l’éternité. Aussi longtemps que mon cœur ne sera pas desséché, ne sera pas mort, je t’aimerai ; et aussi longtemps que mon esprit ne sera pas éteint, je garderai ton souvenir. Le dernier effort de ma sensibilité, le dernier crépuscule de ma pensée ira vers toi, ô mon unique et incompréhensible amour ! Si les hommes savaient comme nous sommes heureux dans notre amour, ils n’auraient pas le courage de nous gêner. Un tel bonheur leur apparaîtrait comme un visiteur étranger sur la terre : loin de le troubler, ils le traiteraient avec un respect religieux. Mais leur intelligence est fermée, et l’étrange visiteur n’est pour eux qu’un aventurier bizarre. Qu’ils gardent leur manière de voir, qui ne dépend pas d’eux ; et nous garderons notre bonheur, qui ne dépend pas de nous non plus. Nous sommes saisis par le courant : il faut que nous suivions, il faut. » Et plus loin : « L’amour n’est pas fait seulement pour la propagation de l’espèce, mais aussi et surtout pour la vie éternelle des individus. Puisque l’un nous a été refusé, attachons-nous d’autant plus fermement à l’autre.
JE NAVIGUE EN HAUTE MER Où L’ON NE PEUT PAS JETER L’ANCRE
Tournons vers l’intérieur toute la puissance de notre amour ; trouvons en nous-mêmes la plénitude du bonheur, et convenons fidèlement du signe qui nous fera reconnaître un jour l’un à l’autre et qui nous aidera à nous retrouver. Je veux bien modérer un peu les éclats de ma passion ; je ne puis la dominer tout à fait. Je navigue sur la haute mer, où l’on ne peut pas jeter l’ancre. » Et encore : « Cette journée m’a appris une fois de plus ce que tu es pour moi. Pourquoi quelqu’un est-il venu troubler notre soirée ? Ce malheureux trouble-fête aura beau toute sa vie dépenser toute son amabilité pour moi, il ne pourra jamais me rendre ce qu’il m’a dérobé aujourd’hui. Crois-tu que je ne m’inquiète pas de voir glisser le temps qui nous est donné ? Je voudrais retenir chaque instant et le caresser et le supplier de ne pas passer aussi rapidement sur notre bonheur. Mais le temps est une chose froide et sans âme.
IL FAUT QUE L’ETERNITE SOIT BELLE AU-DELA DE TOUTE EXPRESSION
Autrement il s’arrêterait, fixé dans un ravissement de joie. Mais il fuit. Tu te couches, tu éteins ta lumière, et tu fermes tes yeux qui, une heure auparavant, se reposaient sur moi avec tendresse. Et pourquoi si vite ? Il faut que l’éternité soit belle au-delà de toute expression ; autrement, il ne vaudrait pas la peine de courir au-devant d’elle, loin de nos courtes joies, comme celle d’aujourd’hui. Pour le moment, je ne puis me représenter le ciel autrement que comme un séjour où tout ce qui est ici incertain et fugitif deviendra sûr et durable. »
DES EXTASES MUETTES
L’âme tendre et molle de Lenau se transforme sous la secousse amoureuse qu’il éprouve. Une religion nouvelle se greffe sur son amour. Le sceptique devient un croyant ; le pessimiste a des visions de bonheur. Tout ce qui végète et souffre doit un jour s’épanouir dans la joie : autrement l’amour éternel serait un leurre. « J’ai trouvé auprès de toi plus de garanties d’une vie éternelle que dans toutes les observations que j’ai pu faire sur le monde. Lorsque, dans une heure fortunée, je croyais avoir atteint le point culminant de l’amour et n’avoir plus qu’à mourir, puisque rien de plus beau ne pouvait suivre, je me faisais illusion à moi-même : chaque fois il venait encore une heure plus belle, où mon amour pour toi s’élevait encore. Ces abîmes de la vie, toujours nouveaux, toujours plus profonds, me garantissent sa durée éternelle. » Ces abîmes l’attirent ; il y plonge sans cesse des regards éblouis ; il a, même en présence de Sophie, des extases muettes. « Tu m’as souvent demandé : « A quoi penses-tu maintenant ? » Et précisément, dans les moments où j’étais le plus heureux, je ne pensais à rien du tout, mais j’étais absorbé dans mon amour, comme on s’absorbe en Dieu dans la prière.
TU ES MA REVELATION
L’amour n’a point de paroles, parce qu’il est supérieur à toute pensée… O Sophie, il faut que tu m’aimes comme ton meilleur ouvrage. Mes joies et mes espérances, qui étaient mortes, se sont relevées en s’appuyant sur toi ; elles ont pris une vie nouvelle et plus belle. Tu es ma consolation, le foyer où je me réchauffe. Tu es ma révélation ; je te dois ma réconciliation avec ce monde-ci et ma paix dans l’autre. » Sa religion, déclare-t-il, est devenue inséparable de son amour. Il ne peut penser à Sophie sans penser à Dieu.
LA VOLONTE DE DIEU
Il croit maintenant à un Dieu personnel. « Il est impossible que les forces rigides et insensibles de la nature produisent un être tel que toi. Tu es l’œuvre de prédilection d’un dieu personnel et aimant. » Il se sent uni avec Dieu dans un même sentiment : c’est le dernier degré de cette élévation mystique. « Je me suis réveillé cette nuit avec de délicieuses pensées pour toi. La volonté de Dieu sur nous m’est apparue tout d’un coup, claire comme le soleil. Notre amour n’est qu’une partie de son propre amour. » Et il ajoute mystérieusement : « Je t’expliquerai cela un jour. »
TON CORPS EST SI PLEIN D’ÂME
Cette métaphysique de l’amour avait d’autant plus besoin d’explication, qu’elle était d’un emploi difficile dans la vie. Lenau répète à satiété qu’il n’en veut qu’à l’âme de Sophie. Mais il n’avait pu s’empêcher de remarquer que celte âme brillait dans de beaux yeux, qu’elle mettait la grâce du sourire sur la bouche, et qu’elle répandait un charme sur tous les traits. Sa part dans la personne de Sophie était assurément la plus belle, mais pourquoi n’était-ce qu’une part ? « Ce serait pécher contre ton âme que de ne pouvoir me passer de ton corps, et pourtant ton corps est si beau et si plein d’âme en toutes ses parties, que je ne puis m’empêcher de penser que ton âme me serait plus intimement unie si l’on corps m’appartenait aussi. »
COMPARAISON AVEC GEORGE SAND
Cette idée le hante au milieu de ses plus pures effusions mystiques ; elle trouble ses nuits. La sensualité est la pente dangereuse du mysticisme. « Je viens d’avoir encore une nuit agitée. Je me suis réveillé en sursaut, avec la sensation que je t’avais tout près de moi ; je croyais te tenir dans mes bras, et je restai longtemps sans savoir où j’étais, sans savoir que j’étais seul. » A de certains moments, Lenau se rend bien compte de ce qui se passe en lui et du mensonge perpétuel dans lequel il vit. Il compare un jour Sophie à George Sand, il la trouve même plus grande que George Sand : on ne peut s’empêcher de le comparer lui-même, dans le dédale de sa fièvre amoureuse, à Alfred de Musset.
POESIE ET VIE
Ils voulurent l’un et l’autre faire entrer la poésie dans la vie ; ils furent brisés l’un et l’antre. « Mon sort, dit Lenau, est de ne pas tenir séparées la sphère de la poésie et la sphère de la vie réelle, mais de les laisser s’entre-croiser et se confondre. Étant habitué, dans la poésie, à m’abandonner aux élans de mon imagination, j’en use de même avec la vie, et il arrive que, dans des momens d’oubli, cette faculté que j’ai trop cultivée s’emporte, dévaste tout, détruit elle-même ses plus belles créations. Je suis, en général, un mauvais économe ; j’ai aussi, dans l’économie de mes facultés intellectuelles, trop peu d’ordre et de mesure. Tu as raison de dire : « Il n’y a rien à faire avec ces poètes. » Je suis un mélancolique ; la boussole de mon âme retourne toujours dans ses oscillations, vers la douleur de la vie. Peut-être que la religion et l’amour ne peuvent me servir qu’à transfigurer cette douleur. »
DE LA JOIE AU DESESPOIR
Il est sans cesse ballotté entre la joie de ce qu’il a obtenu, l’attente fiévreuse de ce qu’il désire encore, et le regret de ce qu’il craint de n’obtenir jamais. « C’est ainsi que l’amour me pousse d’une furie dans l’autre, des enivrements de la joie aux abattements du désespoir. Pourquoi ? C’est qu’à peine arrivé au but de la volupté suprême, si longtemps et si ardemment désirée, il me faut retourner en arrière. Mon désir, n’étant jamais satisfait, s’égare et s’exaspère, et se tourne en désespoir. Ma tendresse pour toi est si profonde que je ne veux pas t’enfoncer dans le cœur l’épine du repentir, et mon amour, éternellement en lutte avec lui-même, éternellement occupé à se diminuer et à se tourmenter, se déchire lui-même et devient une souffrance dont, en de mauvais moments, je souhaite d’être délivré à jamais. Voilà l’histoire de mon cœur. »
UN AMOUR IDEAL
On a voulu savoir jusqu’à quel point Sophie avait résisté, ou cédé, aux ardeurs pressantes du poète. Frankl rapporte que Lenau déclara solennellement au théologien Martensen, en 1836, que ses relations avec Sophie Lœwenthal étaient absolument pures. Ce qui était vrai en 1836, le fut-il encore les années suivantes ? Frankl n’hésite pas à appeler l’amour de Lenau pour Sophie « un amour idéal. » Mais ce qui rend son témoignage suspect, c’est qu’il a cru devoir supprimer, dans son édition, un assez grand nombre de passades qui pouvaient donner lieu à une interprétation contraire, et que le professeur Castle a rétablis. On est déjà un peu étonné de lire, à la date du 21 novembre 1837 : « Je suis comme toi. Que puis-je écrire ? Après une telle tempête de joie, agiter de faibles paroles, que serait-ce ? Mais conserve ce feuillet, afin que, dans une heure à venir, dans une heure lointaine, il te rappelle une heure passée, qui fut belle. Elle est passée. Ce fut une apparition divine. Mon cœur en tremble encore. Mon amour pour toi est inexprimable. N’oublie pas cette heure.
PORTER SON BONHEUR SOUS LE MANTEAU
Elle compense mille fois tout ce que nous avons souffert. Si tu n’as pu être entièrement à moi, j’ai cependant obtenu de toi plus que mes plus beaux rêves ne me laissaient-espérer. Que tu es riche ! Que ne peux-tu pas donner, puisque tu conserves encore autant ! » Mais en tournant quelques feuillets, on trouve le billet suivant : « Ma main tremble et mon cœur bat, au souvenir de tes derniers baisers. J’ai baisé ton lit, pendant que tu étais partie, et j’aurais voulu rester là, agenouillé. Le lieu où tu dors a quelque chose de si douloureusement doux ; c’est comme le tombeau de nos nuits, de nos chères nuits à jamais passées. O Sophie, ce que nous nous permettons, nos baisers s’évanouiront aussi ; mais cependant nous les avons eus, et ils se sont imprimés dans nos âmes pour toujours … » C’est après ces rares moments que le pauvre poète regrettait avec plus d’amertume de devoir « porter son bonheur sous le manteau, » quand il aurait voulu l’étaler à la claire lumière du soleil.
CAROLINE UNGER POITRINE DE BRONZE ET TALENT D’OR
Il essaya plusieurs fois de s’affranchir. Sophie ne lui venait pas en aide. Elle le calmait, aussi longtemps qu’elle le tenait sous son empire ; elle le retenait, dès qu’il faisait mine de s’éloigner. Elle jouait avec l’amour, comme elle avait fait au temps de sa jeunesse, sans penser que cette fois-ci le jeu était plus dangereux. Le 24 juin 1839, Lenau eut l’occasion d’entendre, dans une soirée, la célèbre cantatrice Caroline Unger, qui donnait alors des représentations à Vienne. Rossini la définissait ainsi : « Ardeur du Sud, énergie du Nord, poitrine de bronze, voix d’argent, talent d’or. » Quel effet ne devait-elle pas produire sur l’âme vibrante de Lenau ! Il fut emporté dans un délire d’enthousiasme. Dès le lendemain il écrivit à Sophie, qui était aux eaux d’Ischl : « Un sang tragique roule dans les veines de cette femme. Elle a déchaîné un orage chantant de passion sur mon cœur. Je reconnus aussitôt qu’une tempête me saisissait ; je luttai, je me défendis contre la puissance de ses accords, ne voulant pas paraître tellement ému devant des étrangers. Ce fut en vain : j’étais bouleversé et ne pouvais me contenir. Je fus pris alors, quand elle eut fini, d’une sorte de colère contre cette femme qui m’avait subjugué, et je me retirai dans l’embrasure d’une fenêtre. Mais elle me suivit, et me montra avec modestie sa main qui tremblait : elle-même avait frémi dans la tempête.
TOUT LE DESTIN TRAGIQUE DE L’HUMANITE ECLATAIT DANS SES CRIS DE DESESPOIR
Cela me fit oublier mon ressentiment, car je vis, ce que j’aurais dû penser d’abord, que quelque chose de plus fort qu’elle et moi avait traversé son cœur et le mien. » Le voilà encore une fois en lutte avec « quelque chose de plus fort que lui ; » il ne résistera pas. Cinq jours après, il entend la prima donna dans le Bélisaire de Donizetti. « C’est une femme merveilleuse, écrit-il. Jamais, depuis que j’ai descendu ma mère dans la tombe, je n’ai tant sangloté. Ce n’était pas son rôle qu’elle chantait, c’était tout le destin tragique de l’humanité qui éclatait dans ses cris de désespoir. Une douleur sans nom me saisit. J’en tremble encore. » Il ne pouvait manquer de la complimenter. Elle, de son côté, lui assura que l’effet qu’elle avait produit sur lui était son plus beau triomphe. Les jours suivants, il va la voir après le théâtre, il dîne chez elle, et il trouve que la grande artiste est en même temps une femme distinguée. « Elle est très aimable en société, écrit-il à Sophie, et elle a des attentions particulières pour moi : il faudra que tu la connaisses. »
UN PROJET DE MARIAGE
Mais Sophie ne tenait pas à la connaître. A la première lettre de Lenau, elle avait répondu qu’elle était malade. Puis elle lui avait demandé de venir à Ischl. Elle sentait que des hommages réciproques entre un poète et une cantatrice n’en resteraient pas là. Elle voyait se dresser encore une fois devant elle ce mot qui l’effrayait déjà dans sa jeunesse et lui inspirait « une indicible horreur : » l’adieu. Déjà, en effet, Lenau lui avait écrit qu’un projet de mariage était en train, que Caroline avait même fait les premières avances, qu’elle voulait le guérir, — elle aussi, après tant d’autres femmes, — de ses humeurs noires, lui rendre la paix, le réconcilier avec la vie ; que c’était maintenant à elle, Sophie, de montrer « de l’humanité, » de ne pas entraver le bonheur de deux êtres, et peut-être le sien propre. Sophie engagea Lenau à remettre le mariage au temps où Caroline serait libérée de ses engagements avec le théâtre, — pouvait-il, en effet, être le mari d’une comédienne ? — ensuite à vérifier sa propre situation financière, car il ne voudrait sans doute pas vivre aux dépens de sa femme. C’était gagner du temps. Dans l’intervalle, on fouilla dans la vie de la diva ; on glosa même sur son âge. « Elle avoue trente-cinq ans, est-il dit dans les Notices de Max Lœwenthal ; des gens bien informés lui en donnent trente-huit, d’autres même quarante. » Caroline disait vrai : elle n’avait que trente-cinq ans, étant née en 1805. Lenau se détacha peu à peu, ou se laissa détacher. Frankl raconte que, le 14 juillet 1840, il se précipita, sans se faire annoncer, dans l’appartement de Caroline, et lui redemanda, avec des gestes forcenés, ses lettres, qu’elle lui remit aussitôt, et qu’ensuite il redescendit l’escalier en dansant et en se félicitant du succès de son inutile stratagème. L’année suivante, Caroline Unger épousa le littérateur François Sabatier, le traducteur du Faust de Goethe ; elle se retira du théâtre, et passa ses dernières années dans sa villa près de Florence, où elle mourut en 1877.
DE BRUSQUES CHANGEMENTS D’HUMEUR
Les contemporains de Lenau rapportent qu’il simula plusieurs fois la folie : c’était un fâcheux symptôme et qui ne manquait pas d’alarmer ses amis. Il se plaignait de maux de tête et d’insomnies ; il avait de brusques changements d’humeur, des explosions de joie, suivies de lassitudes muettes ; une marche prolongée lui coûtait. C’est en cet état qu’il essaya de saisir une dernière fois le bonheur qui lui avait toujours échappé. Au mois de juin 1844, il avait accompagné les Reinbeck aux eaux de Bade.
LES FIANCAILLES AVEC MARIE BEHRENDS
Or, un jour, il se trouva placé par hasard, à table d’hôte, à côté de deux dames venant de Francfort : c’étaient Marie Behrends et sa tante. On lia conversation, et trois semaines après Lenau et Marie étaient fiancés. Marie avait trente-deux ans et demi ; elle appartenait à une famille distinguée ; son père, qui était mort l’année précédente, avait été sénateur et syndic de la ville. Sur son caractère, il n’y a qu’une voix ; elle était sérieuse, intelligente, capable de dévouement. Le sentiment qui la déterminait, c’était à la fois l’admiration pour le poète et une tendresse compatissante pour l’homme, qui semblait malheureux ; elle aussi voulait « le guérir. » Quant à Lenau, l’espérance lui rendait la santé. « Une paix joyeuse, que je ne croyais plus rencontrer ici-bas, s’est répandue sur ma vie, » écrivait-il à Emilie de Reinbeck. Il avait hâté les fiançailles, pensant que Sophie s’inclinerait devant le fait accompli. Lorsque à son retour il entra chez elle, elle le reçut avec ces mots : « Est-ce vrai ce que les journaux annoncent ? — Oui, répondit-il ; cependant, si vous le désirez, le mariage n’aura pas lieu ; mais je me tuerai ensuite. » Il revint à Stuttgart, fort ébranlé ; ses amis de Vienne lui avaient représenté que ses ressources n’étaient peut-être pas suffisantes pour fonder un ménage ; un traité qu’il venait de conclure avec le libraire Cotta n’était pas aussi avantageux qu’il aurait dû l’être. Ses lettres à Marie respiraient toujours la même tendresse. Mais les lettres de Sophie ne cessaient de le suivre ; elles l’agitaient, le tourmentaient, et il finit par demander à ses hôtes de Stuttgart de ne plus les lui remettre. Voici ce que raconte Emilie de Reinbeck : « Il me chargea d’écrire à cette femme et de l’engager à garder ses missives pour elle, aussi longtemps qu’il serait malade. Il avait, disait-il, une peur terrible de ses lettres et une grande répugnance pour ses déclarations passionnées. Elle avait été dévoyée, ajoutait-il, par la lecture habituelle des romans français, qui lui avaient perverti l’imagination. Elle entendait le posséder à elle seule et ne permettre à personne de tenir la moindre place dans son cœur. Elle ne faisait que critiquer tous ses amis à lui. Je devais insister auprès d’elle, l’engager à se ressaisir et à reporter son amour sur ses enfants. »
UNE PARALYSIE FACIALE
On sait le reste. Le 23 septembre, une paralysie faciale se déclare. Les jours suivants, l’état s’aggrave. Le malade ne dort plus, déraisonne, parle de voyager, fait des plans d’avenir. Dans la nuit du 12 au 13 octobre, il brûle les lettres de Sophie, celles d’Emilie de Reinbeck et d’autres papiers. Le 19, il se précipite sur Emilie, menace de l’étrangler, puis se jette à ses pieds et implore son pardon. Trois jours après, le fou étant devenu dangereux, on l’interne au château de Winnenthal. En 1847, comme on le trouve incurable, il est transporté à l’asile d’Oberdœbling, près de Vienne, où il attend huit années encore que la mort le délivre. Sophie vient tous les quinze jours à l’asile ; on lui entr’ouvre alors la cellule où est assis, muet et courbé, son ancien ami qui ne la reconnaît plus.
IV
LES ENFANTS DE SOPHIE
Sophie Lœwenthal, au temps de ses relations avec Lenau, avait déjà ses trois enfants, deux fils et une fille. L’aîné des fils, Ernest, fut tué à la bataille de Sadowa. Il combattait comme officier dans l’aile droite autrichienne, qui fut prise en flanc par la seconde armée prussienne. Zoé Lœwenthal épousa, en 1852, le baron de Sacken, et mourut dix ans après, âgée de quarante ans. Le plus jeune des enfants de Sophie, Arthur, est mort le 14 décembre 1905, après avoir mis ses papiers à la disposition du professeur Castle, qui en a tiré les deux publications qui font l’objet de cet article. « Ce livre, est-il dit dans la préface du plus important des deux volumes, ce livre lui appartient, non seulement parce que son nom est inscrit sur le titre, mais parce que chaque page est marquée de la droiture de son caractère, parce qu’il n’a pas voulu que des réticences craintives ou des arrière-pensées pusillanimes nuisent à la manifestation de la vérité. » Max Lœwenthal, l’époux de Sophie, n’a pas conquis la renommée littéraire qu’il ambitionnait. Ses ouvrages lyriques, épiques, dramatiques sont aujourd’hui oubliés, même son drame sur Charles XII, qu’il avait pourtant réussi à faire jouer sur le théâtre de la Hofburg. Mais ses services administratifs ont été récompensés par le titre de baron, qu’il a légué à ses descendants. Il est mort en 1872.
Sophie, plus sage que son mari, a écrit un seul roman, et, après l’avoir écrit, elle l’a mis dans ses archives, où sans doute il dormirait encore, sans le souvenir de Lenau, qui continue de planer sur l’auteur et le protège contre l’oubli.
LES MESALLIES : UNE TACHE SUR UN BLASON
Ce roman, intitulé Mésallié, est dirigé contre l’esprit de caste, plus puissant, paraît-il, en Autriche que partout ailleurs. On est mésallié non seulement lorsque, appartenant à la classe noble, on se marie dans la bourgeoisie, mais encore lorsqu’on épouse quelques quartiers de noblesse de moins que les siens. On est placé à un certain échelon social : en descendre, fût-ce pour les intérêts les plus sacrés, c’est déshonorer ses ancêtres et se dégrader soi-même, c’est imprimer une tache sur son blason. Et la qualification de mésalliance ne s’applique pas seulement à celui des deux conjoints qui descend, mais encore à celui qui s’élève ou semble s’élever. Deux sangs différents ne doivent pas se mélanger ; le mélange ne pourrait que les corrompre l’un et l’autre. Une jeune femme se dit mésalliée, parce qu’elle délaisse sa condition bourgeoise en épousant un comte. Une autre dit : « Je suis mésalliée ; la mère de mon mari était une demoiselle d’origine commune, sa grand’mère n’a pas de nom, tandis que de mon côté on pourrait remonter jusqu’au douzième degré sans trouver une tache. » Elle oublie que son père, le prince Rœdern, a épousé une bourgeoise. Le prince Rœdern a pour sa femme tous les égards d’un parfait gentilhomme, mais il a besoin de toute sa ténacité et de toute l’autorité de son propre caractère pour la faire agréer dans le monde où il l’a introduite. Ce qui ajoute à l’effet du récit, c’est que tous les membres de cette famille Rœdern sont essentiellement et foncièrement bons, sans que la bonté de leur nature ait pu détruire en eux la force du préjugé ; le père lui-même paraît par moments chanceler dans ses principes. Rœdern a deux filles ; toute leur diplomatie consiste à empêcher leur frère de suivre l’exemple du père en épousant leur cousine, la bourgeoise Ria, que pourtant elles aiment comme une sœur. Telles sont les données primitives du roman ; elles sont intéressantes et caractéristiques ; elles pouvaient donner lieu à d’heureux développements, si l’auteur avait voulu se contenter d’une intrigue naturelle, simple et serrée. Mais elle perd de vue à tout moment son point de départ, et s’égare dans des épisodes romanesques. Adalbert Rœdern, le fils du prince, rencontre dans le parc du château, à la nuit tombante, un inconnu qu’il prend pour un rival ; il le frappe du lourd pommeau de sa canne, et lui fait au front une profonde blessure, qui amène plus tard la folie ; il s’ensuit une séance en cour d’assises, où Ria sauve son cousin par une série de ruses dignes d’un juge d’instruction. Un banquier dispose de son héritage par un acte écrit de sa main ; après sa mort, on cherche en vain l’acte parmi ses papiers ; on finit par le trouver en rouvrant le cercueil, dans une petite cassette qu’une servante avait déposée sur la poitrine du défunt. Il est probable que l’auteur, si elle avait dû publier son roman, en aurait élagué ou redressé certains détails. Tel qu’il nous est donné aujourd’hui, il dénote de l’observation et contient des traits de mœurs intéressants, mais le plan en est fort décousu.
Sophie Lœwenthal est morte à Vienne le 9 mai 1889, dans sa soixante-dix-neuvième année. Elle a occupé la dernière partie de sa vie à élever les enfants de sa fille Zoé, à soutenir une salle d’asile à Traunkirchen, enfin et surtout à recueillir et à conserver tous les souvenirs de son poète, à suivre les publications qui se faisaient sur lui, et auxquelles elle collaborait parfois, soit par les renseignements qu’elle pouvait fournir, soit par la communication de pièces inédites. A l’heure actuelle, une édition complète des œuvres de Lenau, avec. les variantes des premières éditions, les essais de jeunesse et la correspondance, est encore à faire. Quand elle se fera, Sophie Lœwenthal y aura contribué pour une bonne part : ce sera son excuse, si elle en a besoin, auprès de la postérité.
ADOLPHE BOSSERT.
Le martyre d’un poète – Nicolas Lenau et Sophie Lœwenthal
Adolphe Bossert
Revue des Deux Mondes
Tome 37
1907
**