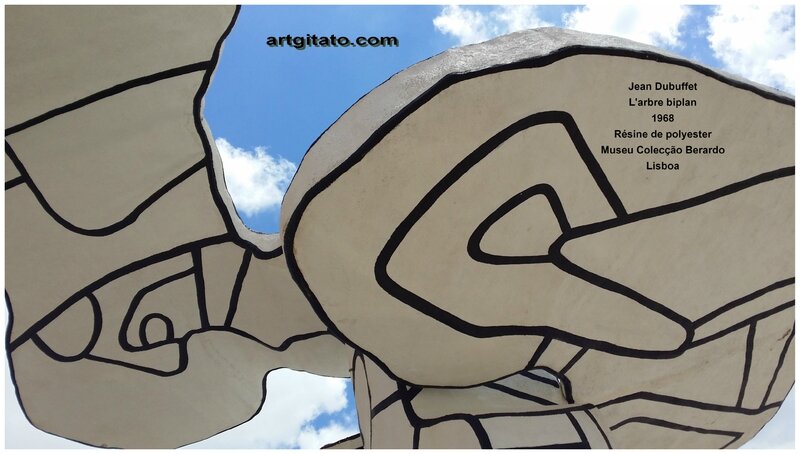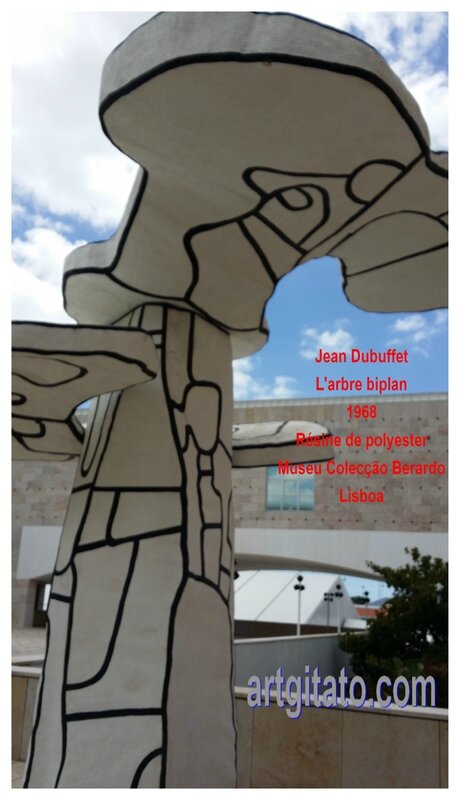Le Caravage
Michelangelo Merisi da Caravaggio
L’incrédulité de Saint Thomas
(vers 1603)
Le doute et la foi
Une impossible rencontre
Simone Weil, dans la Pesanteur et la Grâce, dans le chapitre consacré au malheur, nous disait : « Souffrance : supériorité de l’homme sur Dieu. Il a fallu l’incarnation pour que cette supériorité ne fût pas scandaleuse. ». Le Christ apporte son corps martyrisé devant les hommes. Sans supériorité, il est là, attendant le jugement. Sa plaie ouverte est le centre de tous les regards et de toutes les attentions. Il n’est plus divin, mais un homme parmi les hommes.
En deçà de la foi
David Salle voulait voir dans la peinture des corps un point de vue qui ne soit pas ordinaire. L’œuvre du Caravage participe à cette extraordinaire position de corps, d’une plaie et d’un doigt, du matériel et du spirituel, du doute et de la foi. Il n’y a pas d’obscénité dans cette pénétration, juste un moment où l’homme montre ses limites. L’acte est solennel, les visages en témoignent. Mais de la puissance des ces regards, s’évanouit la force du divin.
Les têtes se retrouvent en se rassemblant, comme dans une possible unité d’esprit. Quatre têtes, côte à côte, comme représentant le monde et ses quatre points cardinaux. En haut, les têtes, le divin, la réflexion, la raison, la foi ; plus bas, le corps, la plaie, le mal, la souffrance, le doute.
Les têtes sont là mais la stupeur ferme la bouche des personnages. Stupeur et attente. Est-ce possible ? Ce doigt qui pénètre, que révélera t-il ?
Loin d’apporter des réponses dans la hauteur de la foi, ce doigt ne montre rien et, en pénétrant, assèche le retour et limite les perspectives. Le doigt montre l’individu, le ‘Je’, qui se perd dans l’universel de ce corps.
La preuve par une insaisissable rencontre
Nous rentrons, par le doigt de Saint Thomas, dans l’insaisissable. Il voit la plaie, mais cela ne suffit pas. Il faut faire entrer un peu de sa chair dans la chair de l’autre, quitte à l’ouvrir à nouveau et à faire souffrir. La vérité serait-elle à ce prix ? Cette tentative semble réussir. Le doigt rentre, le corps du Christ s’ouvre. Plus que dans la proximité nous sommes dans l’être. Mais y sommes-nous vraiment. La chair qui s’ouvre laisse-t-elle passer la vérité ? Quelle vérité ? Que promet réellement cette rencontre ?
La proximité insaisissable
« « A aucun instant, écrit Hofmannsthal (Die Wege und die Begegnungen – Les Chemins et les Rencontres) le sensible n’est autant chargé d’âme, et ce qui est de l’âme aussi sensible que dans la rencontre. » Le corps lui-même s’y ouvre à l’inconnu qu’aucun sens pourtant ne nous donne et l’âme est elle-même inquiétée d’un obscur désir. La proximité est bien celle de l’insaisissable. Mais il semble que pour Hofmannsthal la rencontre soit vouée à la déception et que cet insaisissable meure avec l’infini qu’il portait en lui, lorsque nous tentons de le saisir … La rencontre promet plus que l’étreinte ne peut tenir. » (Jean-Louis Chrétien, l’Effroi du beau).
La rencontre du doigt se pensait comme l’ouverture et le commencement de la foi. Le toucher a accouché d’un banal assentiment ; oui, cela est vrai, la plaie est là, c’est certain, l’homme qui est là a survécu et alors ?
Le corps en s’ouvrant pour recevoir réduit la puissance pour ne retenir que l’anecdotique d’un ressenti dans la fugacité de l’instant.
Pas de sentimentalisme dans l’œuvre du Caravage, pas de moralisme non plus. Le fait est là, enfin !,devant Saint Thomas. Peut-être est-ce le Christ qui retient, peut-être aussi amène t-il le doigt pour le planter là dans la chair. Les yeux des trois hommes sont vissés devant cette fente béante, ne regardant qu’elle et oubliant l’homme dans sa gloire. Il y a comme une scène de marché où l’homme doit toucher la fraicheur du fruit avant de l’acheter en le palpant, le retournant, afin de s’assurer que son acte ne sera nullement regretté et son argent bien dépensé.
Pendant que la plaie apparaît, c’est le Christ qui commence à disparaître. La communication qui aurait dû se créer se perd dans cette chair ouverte, seulement ouverte.
L’éclairage de l’érotisme
Si le toucher limite la rencontre, elle ouvre le champ à un érotisme dans le sens de Francis Marmande : « l’érotisme est un éclairage. Mais il n’est pas seulement ce qui illumine : il est dans la conscience de l’homme ce qui met l’être en question. Sans doute l’éclaire t-il trop crûment. » (Le Journal Littéraire, n°2 p56).
Et cet éclairage Le Caravage l’apporte non pour Saint Thomas, qui après cette certitude retombera maladivement dans le doute, mais au spectateur. Il amène aussi ce que la chair à de triste et de maudite. Mais à ce titre, peut refonder une humanité nouvelle. « En un sens l’œuvre de chair apparut maudite aux premiers hommes. C’est même cette malédiction qui a fondé l’humanité. C’est elle qui l’a séparée de son contraire, l’animalité qu’elle regarde encore, à certains égards, avec une inconsolable nostalgie » (Georges Bataille, l’Erotisme)
La porte qui s’est ouverte par cette plaie n’a apportée qu’une simple réponse à Saint Thomas. Où en sommes-nous alors maintenant ?
« Nous sommes au point où l’amour est tout juste possible. » (Simone Weil, La Pesanteur et la grâce)
Jacky Lavauzelle