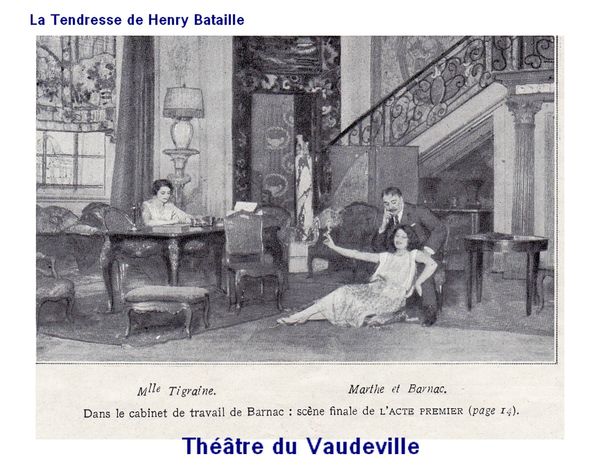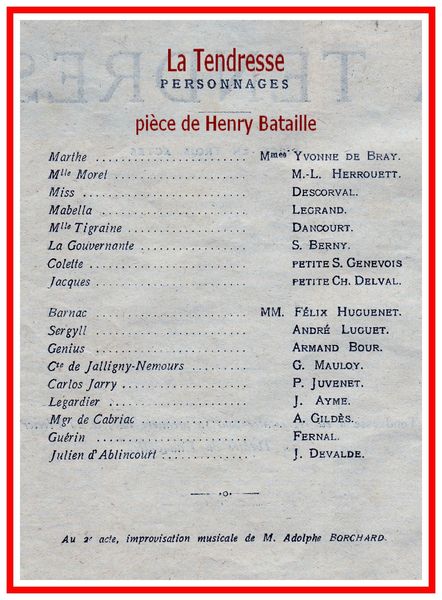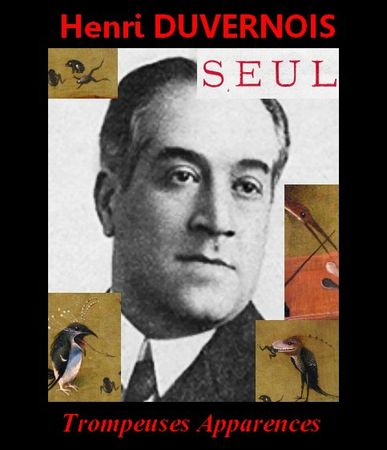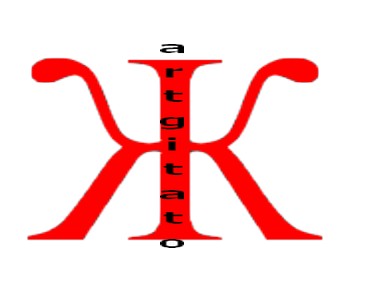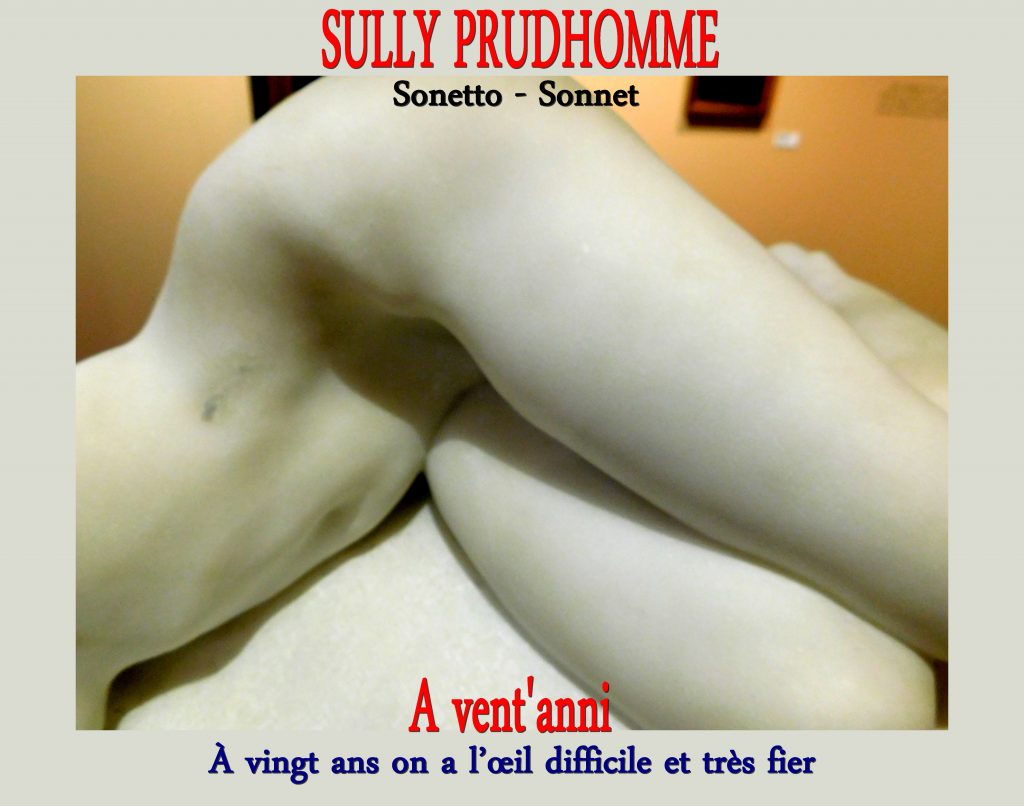Henri BARBUSSE
1873-1935
L’Enfer

Et le CHEF D’ŒUVRE a failli …
L’Enfer reste une œuvre amputée. Amputée d’un trop plein. Amputée d’une trop grande ambition. Quand Barbusse nous embarque en Enfer, il nous prend, totalement, carrément, dans le premier chapitre, à nous donner l’ivresse, la saoulerie de cette nouveauté artistique, à nous faire oublier le beau et nous faire découvrir le désir, à nous dissimuler les corps pour inventer le corps.
LA PLUME GONFLEE DE DESIR
Nous ne nous y attendons pas, nous partons dans un marathon sprinté de bout en bout, d’une plume qui gonfle et enfle. L’idée, c’est la faille, l’ouverture vaginale, le mur qui ne sépare plus. Le narrateur devient voyeur, tout puissant, divin. Le vide du néant se remplit. Et ce plein envahit la chambre, puis la ville et le monde. Il encercle nos cœurs de lecteurs dans le battement des rideaux et fait battre nos cils par les éclats de lumière de cette chambre d’à côté.
J’AI LE CERVEAU MALADE
Certains ont écrit des chefs d’œuvre inachevés, Barbusse a achevé, dans le sens de tuer, le sien. Partir aussi léger et arriver aussi pataud, presque crotté. Il est passé à côté des œuvres comme celles de Kafka ou de Céline, avec une même puissance, une même envie. Mais c’est un roman de jeunesse, écrit à trente-cinq ans, son premier roman et Barbusse a voulu tout mettre, de la poésie, de la littérature, de la philosophie, des sciences. Et à vouloir composer une œuvre unique, englobant le savoir, ce qu’il a failli faire, il a écrit une œuvre désormais quasiment oubliée. Une volonté de réaliser la somme que réalisera Céline en 1932 avec son Voyage. Il aurait pu créer ce voyage immobile au cœur de la faille. Un style novateur aussi, en cette année 1908, sept ans avant la parution de la Métamorphose de Kafka, avec un style descriptif très similaire. « Je reprends mon équilibre par un effort de volonté…Alors, j’entends un chant murmuré tout près de mon oreille. Il me semble que quelqu’un, penché sur mon épaule, chante pour moi, pour moi seul, confidentiellement. Ah ! une hallucination…Voilà que j’ai le cerveau malade… C’est la punition d’avoir pensé tout à l’heure. Je suis debout, la main crispée sur le bord de la table, étreint par une impression de surnaturel ; je flaire au hasard, la paupière battante, attentif et soupçonneux. Le chantonnement est là, toujours ; je ne m’en débarrasse pas. Ma tête se tourne…Il vient de la chambre d’à côté…Pourquoi est-il si pur, si étrangement proche… » A la nuance près que Kafka a su donner de la normalité à l’impossible et que Barbusse va donner de l’extraordinaire à la banalité.
Dans le rythme effréné, de ces rencontres visuelles et olfactives du début, nous nous heurtons, au tiers du roman, à une montagne, le chapitre VIII. Une montagne de discours, une suite de raisonnements grandiloquents dans un couple. Le roman continue de plus belle, verbeux et lourd, pesant, indigeste. Notre souffle est coupé. Désarçonnés, nous ne comprenons plus. Nous attendons la suite, grisés par le rythme précédent.
Nous nous pencherons donc sur la première partie du roman, époustouflante, généreuse et novatrice. Un roman à redécouper, à reprendre de fond en comble. Garder les sept premiers chapitres, le dernier, le dix-septième, et des dix chapitres intermédiaires en recomposer un ou deux. Un peu comme certains ont recomposé le Capital de Marx avec un sens de lecture, en précisant les articles les plus indigestes.
L’ANEANTISSEMENT DE LA LEGERETE INITIALE
Le roman entame une introspection qui dénature la volatilité et la légèreté du roman lui-même. « J’irai dans la terre », « je me plonge dans le détail », « je revois des faces dans le de profundis du soir, émerger comme des victoires suprêmes », Les questions aussi légères que : « la science…Qu’est-ce que la science ? Pure, c’est une organisation de la raison par elle-même ; appliquée, c’est une organisation de l’apparence » ; Des propos à base philosophique comme : « la méditation était la même chose que moi ; elle prouvait la grandeur de la pensée qui la pensait, et pourtant elle disait que l’être pensant n’est rien. Elle m’anéantissait, moi qui la créais ! »
UNE CHUTE INFINIE
L’ensemble dans un moment de chute qui n’en finit pas : « j’ai l’air de marcher ; mais il semble que je tombe. » Et toujours avec de nombreuses discussions interminables : « la conversation des invités se centralise en un petit clan où l’on baisse légèrement la voix ; on parle du maître de maison. » Des discussions irréelles, tellement lourdes dans le quotidien d’une conversation.
Mais les sept premiers chapitres sont d’une grâce et d’une majesté voluptueusement érotique. Quand nous prenons la barque de l’Enfer, Barbusse ne nous livre rien d’emblée. « L’hôtesse, Madame Mercier, me laissa seul dans ma chambre, après m’avoir rappelé en quelques mots tous les avantages matériels et moraux de la pension de famille Lemercier. » Nous sommes encore dans un roman réaliste du siècle passé. Quand arrive la chambre, la fameuse chambre, théâtre des observations, et nous montons dans notre cage.
LA CHAMBRE EST USEE
Le lieu ordinaire que constitue cette chambre n’a aucun charme, « la chambre est usée, il semble qu’on y soit indéfiniment venu. Depuis la porte jusqu’à la fenêtre, le tapis laisse voir la corde ; il a été piétiné, de jour en jour, par une foule…Cette chambre, on la retrouve à chaque pas. C’est la chambre de tout le monde. On croit qu’elle est fermée, non : elle est ouverte aux quatre vents de l’espace. Elle est perdue au milieu des chambres semblables, comme de la lumière dans le ciel, comme un jour dans les jours, comme moi partout. » Le narrateur va donner de ce lieu presque public une nouvelle dimension, il va découvrir le pouvoir de cet endroit, de sa magie, de sa spiritualité. Un lieu qui va transformer notre narrateur, personnage quelconque, « si chacun était comme moi, tout irait bien», en le divinisant. La nouvelle naissance aura lieu prochainement.
AU CONTACT DE L’HOMME, LES CHOSES S’EFFACENT
Le premier chapitre décrit le vide, le néant. Le néant des lieux comme du personnage. De l’ordinaire au rien. « Tout cela m’était inconnu ; comme je connaissais tout cela, pourtant : ce lit de faux acajou, cette table de toilette, froide, cette disposition inévitable des meubles et ce vide entre ces quatre murs… »
Le lieu s’est effacé, « au contact des hommes, les choses s’effacent, avec une lenteur désespérante. Elles s’obscurcissent aussi. » Le narrateur, aussi, semble être resté trop souvent, trop longtemps, au contact des hommes, passant du trop-plein de sa jeunesse, qui submerge de son être, au vide du temps présent. « Je me souviens que, du temps où j’étais enfant, j’avais des illuminations de sentiments, des attendrissements mystiques, un amour maladif à m’enfermer en tête-à-tête avec mon passé. Je m’accordais à moi-même une importance exceptionnelle ; j’en arrivais à penser que j’étais plus qu’un autre ! Mais tout cela s’est peu à peu noyé dans le néant positif des jours. Me voici maintenant… J’aperçois, dans le décor que la pénombre commence à envahir, le modelé de mon front, l’ovale de mon visage et, sous ma paupière clignante, mon regard par lequel j’entre en moi comme dans un tombeau. La fatigue, le temps morne (j’entends de la pluie dans le soir), l’ombre qui augmente ma solitude et m’agrandit malgré tous mes efforts, et puis quelque chose d’autre, je ne sais quoi, m’attristent. Cela m’ennuie d’être triste. Je me secoue. Qu’y a-t-il donc ? Il n’y a rien. Il n’y a que moi.»
REGARDER EN FACE LA DESTINEE
Dans cet effacement, cet appel du vide, la mort règne. La vie s’est enfuie par tous les espaces possibles, entre les lattes du parquet, comme dans les jointures des fenêtres, à chacun des carreaux. «Mourir ! L’idée de la mort est décidément la plus importante de toutes les idées. » Pourtant, le narrateur ne semble pas tenté par le suicide : « Je mourrai un jour. Y ai-je jamais pensé ? Je cherche. Non, je n’y ai jamais pensé. Je ne peux pas. On ne peut plus regarder face à face la destinée que le soleil, et pourtant, elle est grise. »
ME JETER ET ME MULTIPLIER
Ce qui fait résistance, ce qui freine le narrateur dans l’accomplissement d’un acte ultime, c’est l’attente, le désir d’un quelque chose, le rêve d’un amour passionné. Ce quelque chose qui pourrait illuminer la noirceur des lieux, de la vie et du monde. « Je n’ai pas de génie, pas de mission à remplir, de grand cœur à donner. Je n’ai rien et je ne mérite rien. Mais je voudrais, malgré tout, une sorte de récompense…De l’amour ; je rêve d’une idylle inouïe, unique, avec une femme loin de laquelle j’ai jusqu’ici perdu tout mon temps, dont je ne vois pas les traits, mais dont je me figure l’ombre, à côté de la mienne, sur la route. De l’infini, du nouveau ! Un voyage extraordinaire, où me jeter, où me multiplier.»
LA CHAMBRE VOISINE S’OFFRE A MOI, NUE
Le second chapitre sera celui de la découverte, celle de la faille, de la vie, d’un autre monde. Mais celle-ci vient à lui sous la forme d’une voix qui lui caresse l’oreille. Est-ce un rêve ? Est-ce les rêves de l’agitation nocturne ? A l’étonnement, « j’étouffe un cri de surprise », suivra la contemplation de ce nouveau monde. Le narrateur se découvre Christophe Colomb devant la première terre, roi mage rentrant dans la grotte de Bethléem. « En haut, près du plafond, au-dessus de la porte condamnée, il y a une lumière scintillante. Le chant tombe de cette étoile. La cloison est trouée là, et par ce trou, la lumière de la chambre voisine vient dans la nuit de la mienne…Je regarde…je vois…La chambre voisine s’offre à moi, toute nue…Elle s’étend devant moi, cette chambre qui n’est pas à moi…Dans le lointain, la table semble une île. Les meubles bleuâtres, rougeâtres, m’apparaissent de vagues organes, obscurément vivants, disposés là. »
LA DECOUVERTE DE LA TELE-REALITE
Cette simple et banale découverte va transformer sa vie, lui donner un but, un sens. Enfin, il possède quelque chose, il maîtrise. Il peut voir sans être vu. Il peut observer les autres dans leur banalité. Le narrateur vient de découvrir la téléréalité. Et comme la téléréalité, les personnages inintéressants vont prendre une autre dimension, une autre envergure.
QUAND LA MALEDICTION DEVIENT BENEDICTION
La première personne qu’il épie sera la bonne venant s’occuper de son ménage. Il vient de la croiser dans l’escalier. Plus qu’ordinaire, il la trouvait laide et crasseuse. La fente va changer sa vision. « Tout à l’heure, sur le palier, j’ai entrevu cette fille qui, pliée, frottait la rampe, sa figure enflammée proche de ses grosses mains. Je l’ai trouvée repoussante, à cause de ses mains noires, et des besognes poussiéreuses où elle se penche et s’accroupit…Je l’ai aperçue aussi dans un couloir. Elle allait devant moi, balourde, des cheveux traînants, laissant siller une odeur fade de toute sa personne qu’on sentait grise et empaquetée dans du linge sale. Et maintenant, je la regarde. Le soir écarte doucement la laideur, efface la misère, l’horreur ; change, malgré moi, la poussière en ombre, comme une malédiction en bénédiction. Il ne reste d’elle qu’une couleur, une brume, une forme ; pas même : un frisson et le battement de son cœur. D’elle, il ne reste plus qu’elle. C’est qu’elle est seule. Chose inouïe, un peu divine, elle est vraiment seule. Elle est dans cette innocence, dans cette pureté parfaite : la solitude. Je viole sa solitude, des yeux, mais elle n’en sait rien, et elle n’est pas violée. »
REGARDER SANS VOIR ET AVOIR CE QU’ON N’A PAS
Le pouvoir de la faille s’est d’embellir, de sublimer les choses. Barbusse utilisera donc les contradictions et les oppositions, l’union des contraires, l’inversion des valeurs et des codes dans la description afin de mieux rendre compte du bouleversement qui s’opère. « Cette lettre est dans le crépuscule, la plus blanche des choses qui existent…la lettre blanche pliée dans sa main grise…ils craignent la brusque apparition de quelque divinité, ils sont malheureux et heureux…Il semblait un de ces êtres doux, qui pensent trop, et qui font le mal…Et tout ce qui m’attire m’empêche de m’approcher…Il faut que je sois à la fois un voleur et une victime…leur union apparut plus brisée que s’ils ne s’étaient pas connus…Je passais deux jours vides, à regarder sans voir…Avoir ce qu’on n’a pas…Je comprends que beaucoup de choses que nous situons en dehors de nous, sont en nous, et que c’est là le secret… »
L’ODEUR DE L’AMOUR
Mais la découverte visuelle n’est rien, absolument rien sans la présence olfactive. Les fragrances qui viennent de la chambre amplifie et change la nature des choses observées. Et inversement, les situations ont des correspondances avec des parfums. « D’elle exhalait un parfum qui m’emplissait, non plus le parfum artificiel dont sa toilette est imprégnée, le parfum dont elle s’habille, mais l’odeur profonde d’elle, sauvage, vaste, comparable à celle de la mer – l’odeur de sa solitude, de sa chaleur, de son amour, et le secret de ses entrailles…Demi close, attentive, un peu voluptueuse de ce qui, d’elle, émane déjà de volupté, elle semble une rose qui se respire. On voit jusqu’aux genoux ses jambes fines, aux bas de fil jaune, sous la robe qui enveloppe son corps en le présentant bouquet…La chambre, tout en chaos, est pleine d’un mélange d’odeurs : savon, poudre de riz, senteur aiguë de l’eau de Cologne, dans la lourdeur du matin enfermé… »
RIEN
Mais à l’heure où nous découvrons la faille, le chaos semble reculer, le néant s’anéantir, et la nuit s’effacer. Mais le vide est et restera le plus fort, au bout du bout il sera le vainqueur. « Je crois qu’en face du cœur humain et de la raison humaines, faits d’impérissables appels, il n’y a que le mirage de ce qu’ils appellent. Je crois qu’autour de nous, il n’y a de toutes parts qu’un mot, ce mot immense qui dégage notre solitude et dénude notre rayonnement : Rien. »
Mais juste après ce RIEN, Barbusse termine par une dernière phrase qui illumine, qui ouvre. Mais une phrase où s’amasse notre existence, notre libre-arbitre, notre liberté et tout le poids de nos responsabilités : « je crois que cela ne signifie pas notre néant ni notre malheur, mais au contraire, notre réalisation et notre divinisation, puisque tout est en nous. »
CE QU’EST UNE FEMME
Revenons donc à notre émerveillement du début et reprenons notre odyssée. La naissance du sublime, la découverte de l’autre, mais surtout de la femme. Car après la bonne, déjà entourée d’un nouvel halo chargé d’étonnement et de merveilleux, arrive une jeune et belle femme. Viens la découverte, le dépouillement de ce corps, sa nudité. « Je reste là, tout enveloppé de sa lumière, tout palpitant d’elle, tout bouleversé par sa présence nue, comme si j’avais ignoré jusque-là ce que c’est qu’une femme. »
Mais avant la découverte de cette nudité, Barbusse décrit l’accouplement des ombres, « c’était plutôt mon ombre qui s’accouplait à la sienne », la découverte lente et enivrante de chacune des parties du corps, la tension sensuelle, sexuelle de l’observateur.
LE VENTRE COMME CRI
Dans le corps, Barbusse se focalise sur le ventre de la femme. « Un cri m’occupait tout entier : Son ventre ! Son ventre ! Que m’importaient son sein, ses jambes ! Je m’en souciais aussi peu que de sa pensée et de sa figure, déjà abandonnées. C’est son ventre que je voulais et que j’essayais d’atteindre comme le salut. »
Mais du ventre au sexe de cette femme, le chemin n’est pas loin et Barbusse, véritable serpent, s’y glisse sournoisement. « Mes regards, que mes mains convulsives chargeaient de leur force, mes regards lourds comme de la chair, avaient besoin de son ventre. Toujours, malgré les lois et les robes, le regard mâle se pousse et rampe vers le sexe des femmes comme un reptile dans son trou. Elle n’était plus, pour moi, que son sexe. Elle n’était plus pour moi que la blessure mystérieuse qui s’ouvre comme une bouche, saigne comme un cœur, et vibre comme une lyre. »
A travers cette faille, Barbusse nous amène dans la sexualité, mais aussi nous ouvre les portes de l’humanité toute entière, sur la piste qui part loin, tout là-bas, vers l’infini et au-delà. Comme cette pluie devenue immobile à force de trop tomber, comme ces êtres qui se regardent dos-à-dos et se comprennent. Mais de l’infini à la divinité, la route n’a pas besoin de raccourci. Nous partons loin, et comme nous l’avons vu, nous reviendrons à nous-mêmes, au cœur du Moi.
…
Jacky Lavauzelle
 Elle restera seule avec sa chanson fétiche dans la tête, « J’ai écrit une lettre à mon père , I’ve written a letter to Daddy ». Un père déjà mort, dans la chanson, « son adresse est au ciel » ; à qui elle dit « I love you ».
Elle restera seule avec sa chanson fétiche dans la tête, « J’ai écrit une lettre à mon père , I’ve written a letter to Daddy ». Un père déjà mort, dans la chanson, « son adresse est au ciel » ; à qui elle dit « I love you ».