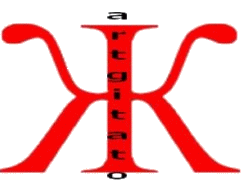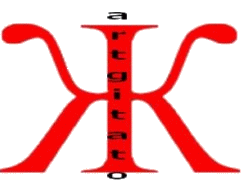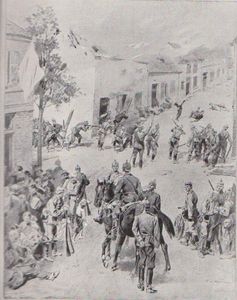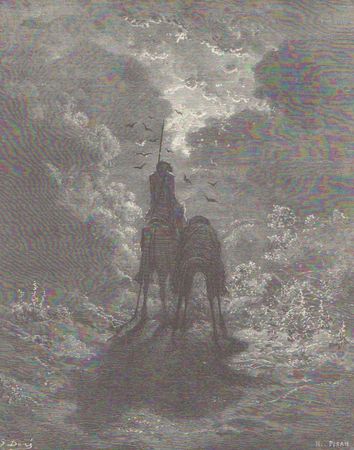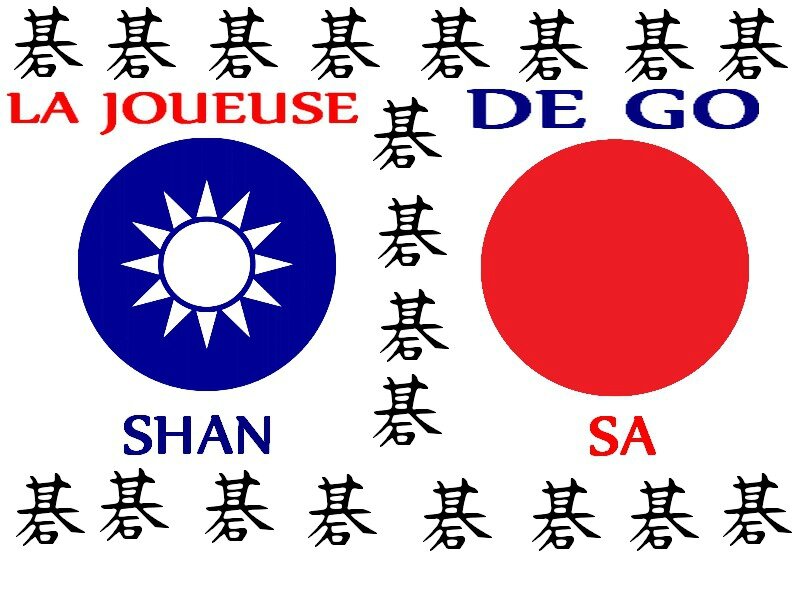[создатель современного русского литературного языка]
–
Œuvres choisies de Pouchkine, traduites par M. H. Dupont
Il en est de certains pays comme de certains hommes, dont la destinée est d’être soumis aux jugements les plus contraires, de se voir à la fois l’objet d’éloges excessifs et de critiques violentes, de ne trouver justice et modération nulle part. Tel est de nos jours le sort de la Russie. Les uns, voyant dans cet empire l’expression la plus puissante d’un principe que la France a répudié, tendent les bras à son gouvernement, fort indifférent à leur égard, et ne trouvent pas de formules assez pompeuses pour proclamer ses bienfaits. A les entendre, la Russie est le seul pays où règnent sans partage aujourd’hui l’ordre, la paix, le bien-être, le seul qui demeure fort et sage au milieu des secousses sociales dont le monde est ébranlé. Les autres, se jetant dans un excès opposé, ne voient dans la nation russe qu’un amas grossier d’esclaves courbés sous le knout d’un Tartare, lequel n’a d’autre loi que son bon plaisir, d’autre règle que son caprice. Cette dernière opinion est encore aujourd’hui la plus répandue, la plus généralement accréditée en Europe. En attendant que le grand redresseur de torts en cette matière, le temps, fasse prévaloir définitivement la vérité sur l’erreur, il suffirait d’un peu de réflexion pour découvrir ce qu’il y a d’exagéré dans ces jugements contradictoires. Une seule conviction résulterait, selon nous, d’un examen impartial de ces apologies et de ces attaques systématiques : c’est qu’un peuple qui depuis neuf siècles, à travers les vicissitudes les plus étranges, a donné les plus éclatants exemples de courage et de patriotisme, un tel peuple mérite d’être traité avec moins de légèreté.
Un fait puissant et terrible s’élève, nous le savons, entre l’Europe et l’empire des tsars. La Pologne accablée a mis la douleur et l’indignation dans toutes les âmes ; elle a réveillé toutes les colères contre ses ennemis. Ces sentiments sont nobles et légitimes, et il faudrait manquer d’entrailles pour ne pas les comprendre ; mais, sous l’influence d’une émotion généreuse, on oublie peut-être qu’envisagée des hauteurs historiques, la question de la Pologne échappe aux intérêts de la politique actuelle, pour ne laisser voir que la suite d’une guerre de peuple à peuple vieille de plusieurs siècles. Les Polonais commandèrent un jour au pied du Kremlin, où ils avaient amené un faux descendant des vieux tsars, insultant ainsi à la nationalité moscovite jusqu’en ses foyers. De là une haine mortelle vouée par les Russes à leurs fiers vainqueurs, de là une de ces vendetta corses qui ne se terminent que par l’extinction de la race ennemie. D’ailleurs, il est des accidents historiques dont il ne faut tenir compte qu’avec réserve, quand on veut apprécier sainement l’état d’un grand peuple. Or, la nation russe a son existence parfaitement indépendante de la politique extérieure de son gouvernement, et au lieu de la juger à priori et sans appel, suivant l’intérêt ou la passion, il conviendrait de remonter à son origine, de la suivre dans sa vie sociale, de pénétrer dans les secrets de sa vie domestique, d’étudier son caractère, ses mœurs, ses habitudes. C’est ce qu’on n’a pas suffisamment fait ; aussi peut-on dire que la Russie est restée, sous bien des rapports, inconnue à l’Europe, malgré les nombreux ouvrages que publient à l’envi des touristes de tout esprit et de toute condition.
On ne se fait pas une idée, dans nos pays de civilisation régulière, des éléments nombreux et opposés qui concourent à former ce qu’on pourrait appeler le tissu national de la race moscovite. Nous nous figurons, par exemple, qu’il n’existe que deux classes dans la société russe, les nobles et les esclaves, et nous croyons connaître les premiers pour avoir vu quelques Moscovites titrés promener à travers nos capitales leur inquiète curiosité, ou bien pour avoir rencontré dans le monde quelques-uns de ces élégants secrétaires d’ambassade dont une éducation spéciale a complètement transformé les manières et le langage. Quant aux esclaves, nous avons un modèle tout prêt : les serfs de notre moyen-âge. C’est se méprendre sur les uns comme sur les autres. En premier lieu, la noblesse russe, — depuis les familles qui remontent avec orgueil aux vieux boyards et se rattachent aux princes apanagés jusqu’aux dernières anoblies par quelques années de fonctions publiques, — se divise en une foule de classes, dont chacune a son centre d’action et de pensée, son caractère, ses mœurs et ses préjugés. En outre, l’espace qui sépare cette noblesse des hommes de la glèbe est comblé par plusieurs castes intermédiaires. Ce sont d’abord les petits employés du gouvernement, qui travaillent à s’anoblir, espèce de tiers-état craintif et mécontent. Après ceux-ci viennent les marchands, dont la corporation a acquis, sous le règne actuel, une importance manifeste et qui s’étend chaque jour davantage ; enfin, les bourgeois, dont l’existence se lie à celle des marchands, et qui ne tarderont pas à former avec eux une classe nombreuse et forte. Quant aux serfs, qui se montrent en dernier lieu, ce sont de véritables fermiers attachés au sol, auquel ils appartiennent, et dont ils partagent de diverses façons le produit avec les propriétaires. Ces différentes classes se subdivisent encore, se distinguent, se tranchent, si on peut le dire, en couches infinies, ce qui ne les empêche pas de se réunir, de former dans certaines circonstances un ensemble de parties parfaitement harmoniques. Alors les rivalités de caste et de rang, les jalousies, les ambitions, les mauvais vouloirs, si profonds et si vivaces qu’ils soient, tombent et s’éteignent pour faire place à un seul intérêt et à un seul sentiment : la nationalité.
Nous venons de prononcer un mot qui explique tout le travail intérieur de la Russie, tout son mouvement littéraire depuis quarante ans. Le bon sens moscovite sait que l’esprit de nationalité peut seul donner à la Russie une valeur et une force réelles en présence de l’Europe. Seulement on pourrait se demander comment il se fait qu’un sentiment aussi légitime, aussi généreux, ait pu passer depuis quelques années à l’état de système mesquin et puéril, comment il se fait qu’il ait cru s’anoblir par une affectation de dédain, nous allions dire de mépris, pour tout ce qui est étranger. Le mot de nationalité est devenu une espèce d’enseigne obligée, de mot d’ordre et de ralliement à tout propos invoqué. La Russie ne craint-elle pas que ces appels systématiques au sentiment national soient mal interprétés, et qu’on ne lui rappelle à ce sujet certains gentilshommes d’autrefois, qui mettaient sans cesse en avant la noblesse de leur blason dans la crainte, quelquefois fondée, qu’on n’y crût point assez ? Hâtons-nous de le dire, ce pavillon patriotique si complaisamment déployé à tous les vents n’est pour ainsi dire que le symbole nouveau d’un fait ancien, d’une réaction depuis longtemps préparée contre l’influence étrangère, et conséquemment, à plusieurs égards, contre la rénovation sociale imposée au pays par Pierre Ier. Encore aujourd’hui, il est une question qu’on ne se lasse point d’agiter : le fondateur de Saint-Pétersbourg a-t-il réellement servi sa patrie en la poussant violemment dans la voie européenne ? De là, mille discussions, mille controverses, qui ne sauraient aboutir, malgré quelques exagérations fâcheuses, qu’à une conciliation désirable entre la civilisation de l’Europe et l’influence renaissante de la vieille nationalité moscovite.
Après avoir vu pendant un siècle et demi la docile obéissance de la Russie à l’impulsion étrangère, il semble qu’on doive s’étonner de la voir se livrer actuellement à l’examen des principes de ce qu’on appelle sa régénération sociale. En y réfléchissant un peu, on sera obligé de convenir que cet examen même pourrait bien indiquer des progrès assez marqués, un développement de l’esprit national dont la Russie a de plus en plus conscience, et qu’elle est jalouse de faire reconnaître à ceux qui l’instruisirent. D’ailleurs, cette opposition nationale contre une civilisation acceptée forcément ou d’office, cet esprit assez confiant en lui-même pour croire qu’il aurait tracé son sillon de lumière sans le secours de l’Occident, cette révolte longtemps contenue contre un ordre de choses qui n’avait pas été choisi, tout cela correspond à ce qu’il y a dans le sentiment public en Russie de plus jeune et de plus ardent. Il ne faut pas chercher ailleurs les causes et le principe du mouvement littéraire qui se continue aujourd’hui dans cet empire, mouvement que nous voudrions apprécier non-seulement dans ses productions récentes, mais dans celles du poète qui le prépara et le dirigea. Ce poète, on l’a nommé, c’est Alexandre Pouchkine.
On sait que la littérature russe du dernier siècle était toute française et de cour, car, à l’exception de Lomonossoff, ce pauvre pêcheur d’Archangel qui devait être le Malherbe moscovite, et du prince Cantemir, célèbre par ses satires, elle n’avait rien qui fût national. C’était une gracieuse contrefaçon de la petite littérature de Versailles, dont le siège se tenait à l’Ermitage, cette solitude lettrée de la grande Catherine, où peu d’élus étaient appelés, même parmi les courtisans, mais dont tous les élus étaient gens d’esprit. Là un couplet du comte de Ségur, une épître du comte Schouvalof ou du prince Bélosselsky, étaient applaudis avec enthousiasme par les heureux et nobles habitués de l’impérial cénacle, au milieu duquel vint tomber un matin l’encyclopédiste Diderot, qui n’en changea ni l’esprit ni l’allure. Hors de ce cercle privilégié, les lettres marchaient d’un pas lent et boiteux. Le peu d’ouvrages qui se publiaient en Russie n’étaient guère que de faibles imitations françaises : la Pétréide de Kéraskoff ne vaut pas, à coup sûr, les fragments de Thomas qui nous sont restés sous le même titre ; ces pâles traductions du français n’étaient lues que parce qu’il n’y avait pas autre chose à lire. Quant à la littérature nationale, elle n’existait point encore, à moins qu’on ne veuille appeler ainsi quelques récits traditionnels, espèces de romans fantastiques, comme celui de Dobrine, l’enfant sans père, que les vieillards racontaient durant les longues soirées d’hiver à leur famille réunie autour du poêle de l’isba.
Cependant un nouveau siècle et un autre règne commencèrent. Les armées de la Russie, entraînées par les événements européens, passèrent les Alpes, et, en même temps que le ciel d’Italie éblouit leurs regards, le spectacle de la civilisation moderne, frappant tout ce qu’elles renfermaient de jeunes imaginations, leur ouvrit une longue perspective d’idées et de sentiments nouveaux. Plus tard, ces mêmes armées se trouvèrent transportées au sein de la France, et le contact immédiat de notre vie publique ne fut pas perdu pour quelques esprits que ce grand mouvement initia au rôle, à la puissance de la pensée. Après cette campagne, éternel sujet d’orgueil pour les Russes, l’empereur Alexandre, saisi tout à coup d’idées plus généreuses que politiques, rêva l’affranchissement de son pays. La jeunesse exaltée se livra en même temps à l’examen des plus hardies questions de réforme sociale. Une société secrète prit naissance et trama dans l’ombre un grand projet de révolution ; mais le temps, qui seul peut mûrir certaines œuvres, manqua à celle-ci : la nation demeura impassible devant la tentative du 14 décembre 1825. Seulement la Sibérie et l’échafaud y gagnèrent quelques victimes. Plusieurs familles eurent à gémir, et tout fut oublié, ou plutôt on n’oublia point, on attendit. Les esprits plus calmes comprirent qu’on avait fait une grande faute, et se renfermèrent dans la discussion des principes. Qu’on ne croie pas cependant, comme il serait naturel de se l’imaginer d’après l’esprit connu de l’autocratie, que le gouvernement russe fermât dès cet instant la voie aux idées progressives ; ce serait une erreur. Jamais la censure n’avait été plus indulgente, et il est douteux qu’on eût permis en Autriche ou à Naples la libre circulation des écrits qui s’imprimaient à Saint-Pétersbourg ou qui y arrivaient. Peu d’ouvrages se sont publiés en France à cette époque qui n’aient eu leur libre entrée en Russie. Cette indulgence du gouvernement s’explique par la transformation même qui s’était accomplie dans les esprits. De violent et de fiévreux, le mouvement était devenu paisible et régulier ; il avait quitté le terrain de l’action brutale pour entrer dans la voie des études sérieuses. Les idées politiques avaient d’abord cédé la place aux idées générales de droit public ; puis ce fut le tour des idées littéraires. On comprit que le nonce te ipsum du philosophe doit s’appliquer également aux nations, et qu’un peuple ne saurait arriver à la connaissance de lui-même sans passer par la littérature, cette introduction obligée à tant de choses. Ce fut donc vers la littérature que se tourna l’activité des intelligences.
C’était le moment où s’agitait en France le procès des deux écoles rivales ; le bruit de ce démêlé, auquel venait se joindre le bruit plus éclatant de la gloire de Byron, retentit sur les bords de la Néva, et les imaginations furent entraînées. La nouvelle école conquit d’abord toutes les sympathies. Des essais furent faits dans le sens de ses théories, et le public y applaudit. La jeunesse lettrée se mit à interroger curieusement le passé de son pays, qui lui offrit d’abord peu de richesses ; elle ne se découragea point et continua à fouiller les chroniques, à recueillir les traditions populaires. La Russie eut son historien dans Karamsine, et grace à son travail, malheureusement inachevé, sur les annales de l’empire, le culte de la nationalité put se retremper, se fortifier dans les souvenirs historiques. A partir de 1825 surtout, les salons de Pétersbourg présentèrent une physionomie singulièrement animée. De jeunes et ardens esprits y débattaient chaque soir toutes les théories dont l’influence féconde se faisait alors sentir en Europe. On examinait quel rapport pouvait exister entre ces théories et l’art national. Cet art, il ne s’agissait pas simplement de le raviver comme en France, mais de le faire naître, pour ainsi dire, en le demandant aux traditions et à l’histoire du pays. Le bruit des disputes françaises continuait à jeter ses incessans échos dans ces vives discussions. Comme l’Allemagne avait une large part dans nos études et nos sympathies, on était souvent amené à comparer entre eux les écrivains des deux pays, et, nous le disons à regret, ces comparaisons étaient presque toujours faites dans un esprit d’hostilité contre la France. Ces jeunes gens, dont les manières et le bon goût attestaient si clairement l’influence de nos mœurs et de nos écrits, se montraient le plus naïvement ingrats du monde, en se germanisant d’idées et d’opinions, de peur de paraître Français. C’était un parti pris, une sorte de mode ; pour paraître profond, il fallait dédaigner la France. Tout cela n’indiquait en définitive qu’un dépit mal déguisé. La France de Versailles, voire la France encyclopédique, avait long-temps régné à la cour ; l’éducation aristocratique avait été jusque-là, et n’a pas cessé d’être encore, sous bien des rapports, toute française. Il fallait mettre un terme à cette usurpation étrangère, il était temps de repousser les mœurs et les idées gauloises ; on était Slave avant tout ; les destinées de la Russie ne pouvaient s’accommoder de cette perpétuelle imitation. Par malheur, les aimables raisonneurs ne s’apercevaient pas que pour n’être point Français ils se faisaient Allemands.
Parmi les salons dont les nobles habitués prenaient alors une si vive part au mouvement intellectuel du pays, il en est ’un surtout qui mérite d’être distingué, car il eut dans ce réveil littéraire son rôle brillant et même sa réelle influence. C’est celui de Mme la comtesse de Laval, épouse d’un ancien gentilhomme français, femme d’esprit et d’imagination, animée d’un goût réel pour les arts et les lettres. L’élite de la jeunesse de Saint-Pétersbourg, reçue chez Mme de Laval, était présidée par Kasloff, le Nestor des écrivains russes, poète distingué, que son âge et sa cécité complète rendaient doublement vénérable. Là on voyait le comte Kamarovsky, auteur de vers français où se révélait un talent aimable, formé à l’école du chantre des Méditations et des Harmonies ; le prince Odoevsky, d’une des plus vieilles familles moscovites, esprit délicat et rêveur, partisan du mysticisme germanique, qui depuis lors a pris rang parmi les écrivains les plus estimés de la Russie ; M. Vénévitinoff, qui promettait un grand poète à sa patrie, et que la mort a prématurément enlevé. Quelques nobles vétérans de l’armée poétique venaient apporter leurs encouragements aux jeunes novateurs. Parmi ceux-là on distinguait Gnéditch, le traducteur d’Homère, et Kriloff, le La Fontaine russe, comme le nôtre plein de finesse, de verve gracieuse, de sens et de philosophie pratique. Le comte de Laval représentait, au milieu de ses hôtes, l’esprit français du XVIIIe siècle, l’esprit du prince de Ligne, et son scepticisme indulgent trouvait toujours une observation fine et railleuse à placer au milieu des plus chaudes discussions. Le spirituel vieillard opposait aux fougueuses sorties des jeunes écrivains les leçons, l’expérience et les traditions d’une époque dont il avait gardé le bon sens ironique aussi bien que la grâce exquise. Mais l’âme secrète de ces réunions, l’homme qui, bien qu’absent de Pétersbourg, dominait ces vifs débats, c’était Pouchkine. Le poète était l’ami de la plupart de ces jeunes gens, qui professaient pour lui une admiration sans bornes, un respect sans limites. Quand on avait assisté à ces réunions littéraires, où il était sans cesse question de lui, à propos d’une lettre reçue, d’un poème annoncé, où d’ardents disciples rapportaient et commentaient toutes les opinions du maître avec un juvénile enthousiasme, on ne pouvait se méprendre ni sur la valeur du poète ni sur la portée de son influence. La vie de salon était alors liée trop étroitement à la vie intellectuelle du pays pour qu’on ne vît dans les éloges accordés à Pouchkine par tant de voix unanimes que l’expression d’une sympathie passagère et d’un engouement mondain. Il fallait bien reconnaître là plus que l’opinion d’une coterie. Évidemment l’esprit national émancipé ne voyait pas seulement dans Pouchkine un grand poète ; il voyait en lui sa propre personnification, il se reconnaissait et s’admirait dans un homme de génie.
Ainsi, le mouvement, commencé d’abord sur le terrain politique, s’était porté sur le terrain littéraire. Cette transformation de l’esprit national avait été secondée par l’élite de la société russe, et les salons étaient devenus, à Pétersbourg, une noble arène où les plus hautes questions de poésie et d’art étaient soulevées et débattues. L’homme qui dirigeait ce mouvement, qui le personnifiait, était Alexandre Pouchkine. L’appréciation de ses écrits est donc en quelque sorte l’appréciation même de la littérature russe contemporaine dans ses débuts, dans sa jeunesse féconde et dans sa période la plus récente.
I.
Dans les pays d’ordre et de discipline militaire, l’indépendance de certains esprits dégénère quelquefois en une susceptibilité ombrageuse, intraitable. Leur imagination, excitée par mille entraves, les emporte à travers les champs d’une liberté impossible, renversant ou brisant dans sa course toutes les barrières que les mœurs, la bienséance et la morale tenteraient de lui opposer. Tel se présente Pouchkine au début de la vie. Le sang africain de son aïeul, pour être mêlé dans ses veines au sang moscovite, n’avait rien perdu de sa chaleur native. Ennemi du travail et de la réflexion, impérieux, léger, versatile, Alexandre Pouchkine rachetait ces défauts par les nobles élans d’une nature généreuse et passionnée. Dans ses traits mêmes, on reconnaissait, avec l’empreinte de la race africaine, tous les signes d’un caractère indomptable. Il avait la tête forte et le front ombragé d’une forêt de cheveux épais et crépus. Son nez, recourbé en bec de vautour, était brusquement aplati par le bout, ses lèvres étaient proéminentes ; mais le regard vif et impérieux donnait à l’ensemble de sa physionomie une singulière expression de grandeur et de fermeté. Mieux encore que le regard, la parole animée et brillante faisait dans Pouchkine reconnaître le poète.
On comprend qu’il n’était pas donné à une nature semblable de se plier à la vie disciplinée et laborieuse de l’école. Entré en 1811 au lycée de Tsarkoe-Sélo, Pouchkine passa à lire en cachette Goethe et Voltaire le temps qu’il eût dû consacrer aux études classiques. Déjà il s’exerçait à l’épigramme et rimait quelques essais poétiques fort applaudis de ses condisciples ; la supériorité de son esprit et l’énergie de son caractère se révélèrent à la fois durant les sept années qu’il passa à Tsarkoe-Sélo. Subjugués par l’ascendant de cette vive intelligence, ceux qui entouraient Pouchkine acceptèrent sans trop d’opposition les prétentions de son caractère despotique, et le poète s’accoutuma ainsi de bonne heure à la domination et à l’indépendance. Bientôt sa renommée naissante franchit l’enceinte du lycée, pour le précéder dans les salons qui allaient s’ouvrir devant lui. Les relations de son père avec les écrivains célèbres de cette époque, Karamsine, Dmitrieff et Joukovski, ne furent point étrangères à cette précoce réputation. Les vers de l’écolier étaient reçus avec les plus vifs applaudissements, et, lorsque le jeune auteur se présenta dans le monde, les applaudissements redoublèrent. Ce fut une véritable ovation, et, l’on pourrait dire, le triomphe avant la victoire.
Quelle était cependant la valeur réelle de ce jeune homme, sorti à peine de l’école, d’où il ne rapportait aucune des études qui, dans nos pays de civilisation latine, sont la condition presque indispensable des succès littéraires ? Pouchkine ne savait rien des littératures anciennes ; quant aux littératures modernes, elles ne lui étaient connues que par quelques auteurs qu’il avait lus à la dérobée. L’histoire n’avait laissé dans sa mémoire que des faits généraux et vagues ; toutes ses connaissances étaient incomplètes : rien, dans son esprit, de lié, de tissu, de coordonné ; mais ce jeune homme avait une imagination ardente, une intelligence merveilleuse, quoique éclairée de mille clartés confuses, un génie moqueur, une verve satirique : il était poète, poète né pour la lutte plutôt que pour la rêverie. Le monde l’accepta ainsi. Pouchkine lui paya sa bienvenue par une sorte de dithyrambe patriotique sur les derniers succès des armées russes et la glorification de l’empereur Alexandre ; après quoi, laissant la poésie venir à ses heures, il ne songea plus qu’à se plonger dans les plaisirs. Les fêtes du monde furent bientôt impuissantes à le satisfaire : il lui fallut l’orgie nocturne, bruyante, effrénée, le jeu avec ses émotions puissantes et fiévreuses, les duels, qui sont aussi un jeu, et qui, pour lui, variaient la monotonie de l’autre. Il aimait les duels : était-il averti par un pressentiment secret, et voulait-il se familiariser avec ce terrible hasard qui devait un jour lui être si fatal ?
La violente nature de ce jeune homme ne tarda pas à se trahir au milieu des salons par d’imprudents discours. Quand une question d’émancipation politique était agitée en sa présence, le chantre de l’empereur Alexandre devenait un tribun dont l’éloquence hardie faisait trembler ses amis pour sa liberté. La Muse ne le visitait plus que pour lui inspirer des chants d’indépendance qu’on ne retrouve point dans ses œuvres, mais que la mémoire des contemporains a retenus. Les craintes de ses amis ne tardèrent pas à se justifier. Pouchkine reçut l’ordre de quitter Pétersbourg. Les provinces méridionales de l’empire lui furent assignées comme lieu de résidence.
En voyant une peine si sévère infligée à Pouchkine pour quelques déclamations irréfléchies, on serait tenté de partager une opinion qui a souvent entretenu le public français dans une fâcheuse indifférence à l’égard des poètes russes. On croirait volontiers qu’il y a incompatibilité entre le gouvernement absolu et le libre épanouissement d’une imagination poétique. La réputation de Pouchkine n’est encore arrivée jusqu’à nous que comme un écho affaibli, et n’a été acceptée qu’avec réserve : nous venons de dire pourquoi. On a posé en règle que la liberté est indispensable au développement de la poésie, et dès-lors on répugne à croire qu’un grand poète ait pu naître et s’épanouir sous le ciel de la Russie. Est-il besoin pourtant de faire remarquer que la poésie, dans son essence supérieure et divine, échappe complètement à l’influence d’une forme plus ou moins libérale de gouvernement ? Pouchkine et Mickiewicz chantèrent tous deux sur une terre privée d’indépendance ; qui oserait dire que leur imagination fut moins maîtresse d’elle-même, moins dégagée de toute entrave grossière que celle du chantre de Harold ? Qui oserait affirmer que leurs poèmes respirent moins vivement que ceux de Byron le sentiment de la liberté et de la dignité humaines ?
Lorsque Pouchkine se vit en présence de cette sévère et puissante nature de l’antique Chersonèse, qu’il aperçut le Caucase à la cime souveraine, que ses regards se perdirent à l’horizon de ces steppes sans fin où l’on voit passer les chameaux des caravanes comme aux déserts de l’Arabie, alors le poète connut de nouvelles émotions. Ce fut pour lui un moment de recueillement profond et solennel ; s’interrogeant pour la première fois dans la solitude, il sentit ce qui manquait à son esprit encore inculte ; il appela au secours de son âme chagrine et désabusée l’étude et la réflexion. Jusqu’alors son génie n’avait obéi qu’à une fougueuse effervescence, à des colères subites et à des passions soudaines ; d’admirables instincts poétiques avaient donné à ses premiers accents la verve, la puissance et l’harmonie ; mais le flot de ces inspirations pouvait se tarir, si des études sérieuses n’en venaient entretenir et purifier la source. Pouchkine recommença donc son éducation lui-même. Il écrivait des lieux de son exil : « J’ai appelé dans la solitude le paisible travail et le goût de la réflexion. Le temps est à moi, et j’en use selon ma volonté ; mon esprit est devenu l’ami de l’ordre ; j’apprends à retenir mes pensées, je cherche à réparer en liberté le temps perdu : je me mets en règle avec le siècle. » Comme l’intelligence de Pouchkine était vive, cette éducation fut bientôt terminée. Alors l’inspiration lui arriva de nouveau, mais riche, abondante, et toute pénétrée de la chaleur du ciel qui rayonnait sur sa tête, tout étincelante des reflets de ses splendides horizons. On eût dit que le génie du poète avait retrouvé sa patrie dans cette terre méridionale et reconnu sa famille dans ses rudes habitans. Aussi imprima-t-il un cachet d’originalité locale remarquable aux trois poèmes qu’il composa dans ce temps-là : la Fontaine de Baktchisaraï, inspiré par le palais en ruine d’un ancien khan de Crimée ; le Prisonnier du Caucase, dont le sujet est emprunté à l’un de ces mille épisodes que fait naître chaque jour la guerre du Caucase, et les Bohémiens, que lui dicta la vue d’une de ces peuplades errant dans les plaines de la Bessarabie.
Dans ces trois poèmes, c’est une muse presque orientale qui se révèle. L’éducation européenne avait nourri l’esprit de Pouchkine sans lui enlever son originalité. L’auteur des Bohémiens resta toujours sans émotion devant les souvenirs classiques, et ne put leur demander des sujets d’inspiration sans laisser voir aussitôt une excessive infériorité. Si pendant cet exil il se rappelle qu’Ovide fut comme lui exilé aux mêmes lieux, sa muse reste froide et déclamatoire ; mais lorsque, obéissant à son génie, il décrit les mœurs libres et pittoresques de l’aoul (village circassien), ou traduit avec une verve sauvage les discours passionnés de la fille des Bohêmes, alors cette muse prend la taille des muses antiques et se fait admirer. On chercherait en vain dans ces poèmes écrits au pied du Caucase l’influence de notre littérature européenne avec ses sentiments délicats, ses passions retenues, ses élans de convention. Tout y est dédaigneux de notre bon goût, hardiment sacrifié à la vérité d’une nature que nous ignorons. Quelques-uns ont voulu trouver dans ces premiers poèmes une imitation de Byron. Ceux-là comprenaient mal la muse de Pouchkine. Byron, pair de la Grande-Bretagne, avait tracé des types empruntés à son imagination, et qu’il orientalisa à peu près comme aurait fait un habile costumier ; Pouchkine, descendant du nègre Annibal, peignit des types réels, des types vivants, qu’il voyait partout autour de lui ; puis il les anima de ses propres passions, qui étaient aussi les leurs, c’est-à-dire brûlantes, jalouses et cruelles. Or, si cette individualité tout orientale de Pouchkine se trouve portée quelque part à sa plus haute expression de vérité, c’est sans contredit dans le poème des Bohémiens.
Savez-vous d’où sortit cette race nomade,
Nation dont partout erre quelque peuplade,
Hommes au teint de cuivre, à l’œil noir, dont la peau
Se durcit à travers les trous d’un vieux manteau ;
Qui traînent après eux leurs bruyantes familles ;
Vendant selon les lieux leurs poignards ou leurs filles,
Mais ne campant jamais aux mêmes bords deux fois ?
Car leur plus grand besoin, à ces tribus sans lois,
C’est d’errer, de franchir steppe, désert aride,
Plaines ou monts, suivant qu’un caprice les guide,
Faisant le plus de mal qu’ils peuvent aux chrétiens.
Demandez-leur d’où vient leur race de païens,
S’ils sortirent des murs de Thèbes la divine,
De l’Inde, ce vieux tronc où pend toute racine,
On bien s’il faut chercher leur source, qu’on perdit,
Parmi les Juifs de Tyr, comme eux peuple maudit ?…
Ils l’ignorent. Pour eux, les temps sont un mystère ;
Comme l’oiseau des airs, ils passent sur la terre.
Qu’ont-ils besoin de plus, et que leur fait, au fond,
Qu’ils viennent de l’aurore ou du couchant ? Leur front
A pour toit le ciel pur où brillent les planètes ;
Pour lit, le bord du fleuve ou des mers inquiètes :
Et puis ils ont leurs chants, le soir, devant leurs feux,
Leurs chants d’amour, ardents, libres, impétueux,
Qui donnent au plaisir les accents du délire
Et demandent le bruit du fer au lieu de lyre.
Tels sont les Bohémiens de Pouchkine. Le camp d’une de ces peuplades nomades venait de se livrer au sommeil ; les feux s’éteignaient ; la lune, montée sur l’horizon, éclairait de ses blanches lueurs un vieillard assis devant des charbons fumants qu’il ranimait. Ce vieillard attendait le retour de sa fille, la jeune Zemphirine, attardée ce soir-là dans la campagne. Elle paraît bientôt, accompagnée d’un étranger qu’elle présente à son père. « Mon père, lui dit-elle, je t’amène un hôte. Je l’ai rencontré derrière un tertre dans le désert, et l’ai engagé à passer la nuit dans notre camp. Comme nous, il veut vivre en liberté ; la loi le proscrit, mais je serai son amie. Il se nomme Aléko ; il me suivra partout où je voudrai. » C’est bien là le langage d’une passion naïve et qui ne connaît pas d’obstacles. Zemphirine avoue son amour comme elle avouerait le plus innocent caprice ; elle parle d’Aléko comme elle parlerait d’un oiseau, d’une gazelle favorite. On devine la réponse du vieillard. L’étranger est reçu dans la tente, et devient l’heureux époux de l’alerte jeune fille. Deux ans se passent. Aléko est toujours amoureux de Zemphirine, lorsqu’un matin, celle-ci, auprès d’un berceau, se met à chanter une étrange chanson d’amour. La jalousie entre au cœur de l’époux ; il se plaint au vieillard : celui-ci lui rappelle quelles sont les mœurs des tribus bohémiennes et lui raconte sa propre histoire. La femme qu’il avait épousée, la mère de Zemphirine, l’a quitté, lui aussi, après avoir vécu un an sous sa tente, pour suivre un jeune Bohémien. On comprend qu’Aléko ne se laisse point désarmer par ce récit : le proscrit européen ne saurait partager la résignation philosophique du vieillard ; il surprend Zemphirine à un rendez-vous.nocturne, et frappe les deux amants. Le jour se lève ; la foule des Bohémiens entoure le meurtrier et ses victimes. Les femmes s’approchent pour baiser les yeux des morts ; puis, lorsque les cérémonies funèbres sont terminées, le père de Zemphirine aborde Aléko, qui regarde en silence : « Quitte-nous, homme orgueilleux, lui dit-il ; nous sommes sauvages, nous n’avons besoin ni de sang ni de soupirs, mais nous ne voulons pas vivre avec un assassin ! Tu ne comprends point la vie nomade, tu ne veux de liberté que pour toi ; ta vue nous ferait horreur ! Nous sommes timides et bons, tu es méchant et audacieux. Va, pars, que la paix t’accompagne ! »
Ainsi finit le poème de Pouchkine. Tel qu’il est, il offre un ensemble dont l’unité est parfaite ; ce n’est qu’un épisode, si l’on veut, plutôt qu’un tableau complet et largement tracé ; mais le poète a su mettre dans cette composition tout ce qu’il nourrissait en lui de sauvage indépendance et de désirs effrénés. Il y peint la vie nomade, aventureuse, bruyante et passionnée des Bohémiens, avec une complaisance qui trahit à son insu ses sentiments les plus intimes. Lorsque Zemphirine, au matin de son amour, témoigne à Aléko la crainte qu’il ne regrette plus tard le séjour des villes, le poète épanche tout ce qu’il a de colère et d’indignation contre les hommes des cités
« Si tu savais, si tu pouvais comprendre l’esclavage des villes, où l’on étouffe ! Là, les hommes sont entassés, sans pouvoir respirer jamais ni la fraîcheur du matin ni les parfums du printemps. Ils rougissent de l’amour vrai ; ils s’étourdissent, trafiquent de leurs pensées, se courbent devant des idoles, tendent la main, demandant de l’or et même des fers. Qu’ai-je quitté ? les tourmens de la trahison, la tyrannie des préjugés… – Mais on y trouve des palais magnifiques, reprend la Bohémienne, de superbes tissus, des jeux, des plaisirs, des festins… les parures des femmes y sont riches… – Qu’est-ce que la joie et le bruit des villes ? Là où l’amour n’est point, peut-il y avoir du plaisir ?… Quant aux femmes dont tu parles, tu l’emportes sur elles toutes !… »
Il est facile de reconnaître dans ces expressions le sentiment d’un cœur indompté qu’irrite l’esclavage et que blessent les préjugés de la civilisation. Ce sentiment était celui de Pouchkine. Il s’est étourdi dans les orgies, il a cherché dans des transports passagers un semblant d’amour qui a sans cesse trompé son cœur avide d’amour, et pourtant ce cœur n’est point encore mort aux passions réelles ; c’est pourquoi, s’il maudit les villes, ce fier exilé, avec lequel Pouchkine s’est identifié tout entier, accepte sans hésiter la destinée des Bohèmes, cette destinée qui lui donne avec une liberté sans frein l’amour d’une jeune et belle compagne. Le dénoûment des Bohémiens ramène encore d’une façon saisissante l’expression de cet étrange mépris pour la société civilisée. La morale de ces tribus sauvages, qui laisse aux passions une liberté complète, n’est pas rapprochée sans intention de la morale inflexible qui verse le sang de la femme adultère. Dans ce poème, où respire le culte passionné de la vie indépendante, ce sont des Bohémiens qui repoussent l’homme des villes au nom d’une clémence infinie comme leur liberté même.
Qu’on ne cherche point dans les Bohémiens ces préoccupations de systèmes et d’écoles qui agitaient alors l’Europe littéraire. Pouchkine avait adopté sans arrière-pensée l’existence que lui avait faite son exil. Il vivait un peu de la vie de ces peuplades, dont il retraçait avec tant d’énergie les mœurs aventureuses. Aussi cette vie, qui avait pour lui le double charme de l’indépendance et de l’inattendu, l’avait-elle rendu complètement indifférent à tout le reste. La politique était morte dans sa pensée. Que voulait-il ? La liberté ? Il l’avait trouvée telle que son âme la demandait, ou telle qu’il la fallait à sa nature inquiète. Quant à la liberté politique, à l’émancipation de son pays, il pensa sans doute que le temps n’était pas encore venu, et il ne s’en occupa plus. Il est même à croire qu’il eût complètement oublié les bords de la Néva, s’il n’y avait laissé des amis qui s’intéressaient à son sort, qui lui écrivaient, et auxquels il envoyait le fruit de ses inspirations. C’est ainsi que les trois poèmes qu’il avait composés en Bessarabie furent successivement publiés à Saint-Pétersbourg et accrurent sa célébrité. Le poète sut d’ailleurs mettre à profit les cinq années qu’il passa dans cet exil, soit à errer sur les grèves du Pont-Euxin, dont il aspirait avec bonheur les brises vivifiantes, soit à s’égarer parmi les vallons parfumés de l’antique Tauride, soit à fatiguer ses chevaux à travers les steppes herbeuses de la Russie-Blanche. Il lut, il médita, il apprit à contenir, à dominer ses pensées.
Ce fut en 1824 que Pouchkine quitta le lieu de son exil, et en 1826 qu’il rentra complètement en grâce. Revenu à Pétersbourg, il se lança avec plus de fougue que jamais dans le tourbillon des orgies nocturnes. Ces tristes fêtes laissaient le poète pâle, inquiet, mécontent, insatiable surtout de bruit et de renommée. Le bruit et la renommée ne lui manquèrent pas. Ses vers, à peine échappés de sa plume, étaient répétés d’un bout à l’autre de l’empire. Cependant il finit par se lasser même de la gloire : à peine avait-il trente ans, et il se sentait arrivé au découragement, au dégoût. Que se passa-t-il alors dans son esprit ? Quelle fut la cause de la brusque révolution qui s’opéra en lui ? Céda-t-il aux conseils d’une sagesse vulgaire ? ou bien son âme s’ouvrit-elle simplement à l’un des rayons de cet astre impérial devant lequel il ne saurait y avoir de glace en Russie ? Quoi qu’il en soit, la société apprit un matin qu’Alexandre Pouchkine, ce poète si jaloux de son indépendance, avait reçu le titre de gentilhomme de la chambre. Dès cet instant, son esprit d’opposition changea d’objet : la polémique littéraire devint le canal par lequel s’épancha sa verve satirique. Une seule fois encore, son humeur inquiète devait l’arracher à cette existence nouvelle et doucement occupée. Pouchkine désira retourner en Asie. Il partit et prit la route du Caucase, qu’il allait revoir, mais cette fois en poète officiel qui suit une armée victorieuse. Il poussa, avec les troupes russes, jusqu’à Erzeroum. Au retour de ce voyage, un dernier changement se prépara dans sa vie : le poète railleur, l’homme blasé qui ne croyait plus à rien, vit une jeune fille et crut à l’amour. Son âme avait un moment retrouvé la sérénité, si l’on en juge par une lettre où il dit que le souvenir de son ami Delvig, dont il pleurait la perte, était le seul nuage qui vînt alors jeter une ombre sur sa limpide existence. Il offrit sa main à la jeune fille qu’il aimait. Devenu gentilhomme de la chambre et père de famille, le poète vit commencer dans son existence littéraire une période heureuse et féconde. Pendant l’automne de 1831, de nombreux ouvrages attestèrent l’activité constante de l’imagination qui avait créé les Bohémiens. Pouchkine termina d’abord son bizarre poème d’Onéguine. La curiosité de son esprit se partageait à la même époque un peu capricieusement entre les littératures antiques et les littératures étrangères. Parmi les études où se révèle cette double tendance, on remarque l’Hôte de pierre, Mozart et Salieri, le Festin durant la peste, l’Épître à Licinius, la Fête de Bacchus, et un morceau sur André Chénier, avec qui on a voulu lui trouver de l’analogie. Le poète russe n’a cependant de l’antiquité grecque et latine qu’un sentiment assez confus. Pouchkine a beau épuiser les couleurs pour décrire le triomphe de Bacchus, les transports des nymphes échevelées, le bruit des thyrses et des tambours ; il a beau flétrir, dans son Epître à Licinius, la dépravation de Rome : on peut signaler dans ses vers quelques allusions contemporaines à son pays, mais à coup sûr la Grèce et Rome n’ont qu’une faible part à revendiquer dans ses inspirations. Ce n’était guère à la lyre qui avait célébré la Fontaine de Baktchisaraï, à la lyre qui devait célébrer Boris Godounoff et Poltava, d’imiter les accords de Pindare et de Juvénal. Ce poète de race africaine, qui s’épanouissait au milieu d’un peuple slave, connaissait mal et goûtait peu la littérature mesurée et savante des vieilles civilisations latines. Pouchkine partageait d’ailleurs en ceci la prévention de son pays. Les langues et les littératures classiques sont généralement négligées en Russie, malgré les efforts des hommes qui sont à la tête de l’instruction publique. Nous aurions tort, à cet égard, de juger les Russes trop sévèrement et à notre point de vue. Notre civilisation, à nous, est toute latine, nous pouvons même ajouter qu’elle est un peu grecque. C’est de la langue latine que sort notre langue, du droit latin que sort notre droit, des municipes latins que sortent nos communes : il est donc naturel que l’étude de la latinité forme la base de notre éducation ; mais qu’y a-t-il de semblable en Russie ? Ce pays est séparé de l’antiquité classique par plus de huit siècles de mœurs et d’éducation slaves ; sous Pierre Ier, une civilisation nouvelle, d’origine étrangère, lui arriva brusquement, d’abord d’Allemagne, ensuite de France ; en l’acceptant, il accepta les langues française et allemande sans s’inquiéter des influences grecque et latine qu’elles avaient subies. Cela est parfaitement naturel. La seule langue classique des Russes est la langue slavone, c’est la langue de leurs premiers aïeux, la langue de leur culte, la langue d’où celle qu’ils parlent est sortie, comme la nôtre de la latine. C’est ce qu’ils répondent lorsqu’on leur reproche de négliger les langues anciennes.
Ce n’est pas seulement à l’antiquité, c’est aussi, nous l’avons dit, aux littératures modernes que Pouchkine demandait quelquefois des inspirations. Nous avons nommé quelques-uns de ces essais ; on comprend qu’il n’y faut point chercher ses vrais titres littéraires. Voyez, entre autres, l’Hôte de pierre (don Juan) : le don Juan de Pouchkine est fort peu espagnol, c’est un Russe qui joue au Castillan ; la gaieté de Leporello est forcée, et l’amour de dona Anna n’inspire aucune sympathie. Le seul don Juan possible pour Pouchkine, c’était le héros de son poème satirique d’Onéguine, car Onéguine, c’était Pouchkine lui-même, c’est-à-dire l’homme blasé, non pas celui de notre vieille Europe : celui-là est, comme elle, vieux d’expérience ; la vie n’est plus pour lui qu’un fruit desséché dont il a exprimé le dernier suc, qu’un livre sans secrets, dont il a lu la dernière page ; son intelligence est blasée comme son cœur ; l’abus du raisonnement a tué la raison dans son esprit. Onéguine est au contraire l’enfant d’une civilisation naissante ; c’est le jeune Russe que de rapides et trop faciles plaisirs ont bientôt enivré ; l’écorce du fruit a suffi pour porter le trouble dans ses sens. Il a pris notre dévorante civilisation à la surface, et, parce qu’il en est ébloui, il ferme les yeux et la nie. Les plaisirs ont détruit sa santé, dévoré l’héritage de ses ancêtres : il nie les plaisirs. Son cœur s’est flétri avant de s’épanouir sous le soleil fécond d’un amour honnête, la pensée même s’est desséchée dans son cerveau : il nie l’amour, il nie la pensée ; en effet, tout cela désormais est mort pour lui, et, s’il veut encore se procurer une émotion, il faut qu’il tue son meilleur ami. La commotion sociale avait été grande et brusque au temps de Pouchkine ; elle avait jeté une fermentation fébrile dans tous les esprits. Les passions montaient à la surface ; s’échappant ensuite par les pentes faciles du plaisir, elles arrivaient à l’excès. De là le dégoût, la satiété ; de là l’ennui d’Onéguine, ou plutôt de Pouchkine, car le héros de son étrange poème, nous le répétons, était sa personnification la plus parfaite.
Les poèmes de Boris Godounoff et de Poltava contrastent singulièrement avec Onéguine. Boris Godounoff est un drame historique, dont le terrible épisode du faux Dmitri a fourni la donnée. Cette œuvre est conçue dans le système de Shakespeare ; mais, comme elle n’était point destinée à la représentation, l’auteur s’attacha moins à l’effet dramatique de l’ensemble qu’à l’effet et au caractère de chaque scène en particulier. Ce qui frappe dans Boris Godounoff, c’est l’inspiration nationale, c’est la puissance de reproduction historique, et la vérité de ces rudes figures dans lesquelles revit le vieux génie moscovite avec toute son énergie et son âpreté sauvage. L’ambition joue dans ce drame le rôle de la fatalité antique ; c’est elle qui domine et entraîne tous les personnages, depuis ce tsar qu’un crime a mis sur le trône, jusqu’au jeune moine Otrépieff dont le caractère est grand comme les projets, jusqu’à Marina, cette belle Polonaise, qui connaît l’imposture de son amant et lui reste dévouée par intérêt. Où trouver une plus vivante expression de cette sombre époque qui vit tant de révolutions et tant de meurtres se succéder au pied du Kremlin ? Poltava est, comme Boris Godounoff une œuvre que domine une pensée nationale ; mais le titre de Poltava convient-il réellement à ce poème ? N’est-ce pas plutôt Mazeppa qu’il devrait se nommer ? Mazeppa est en effet le héros du récit. Il n’est point ici question de la légende lithuanienne, du Mazeppa si magnifiquement chanté par lord Byron et Victor Hugo, de ce jeune page amoureux qu’une vengeance inouie attache à la croupe d’un étalon sans frein. Le page, dans l’œuvre de Pouchkine, a revêtu la pelisse d’un hetman de l’Ukraine ; c’est aujourd’hui un vieillard souverain, à la tête haute et blanche, au front plissé sous des rêves d’ambition, et pourtant ici comme dans le poème de Byron il s’agit d’une histoire d’amour. Le riche, le puissant Kotchoubey, l’ancien ami de l’hetman, avait une fille qui était « la reine des fleurs de Poltava. » Marie faisait la joie et l’orgueil de son père. Toute la jeunesse de l’Ukraine l’avait poursuivie de ses hommages et s’était vu dédaigner. Cependant, lorsque Mazeppa vint à son tour lui offrir sa main et que la mère de la jeune fille eut repoussé le vieillard avec mépris, Marie pâlit et pleura. Quelques jours plus tard, elle avait disparu. On ne tarda pas à apprendre qu’elle avait suivi l’hetman. Kotchoubey pourrait aisément armer tout le pays contre le ravisseur de sa fille ; il aime mieux dénoncer au tsar Pierre les vues ambitieuses de Mazeppa, qui nourrissait effectivement le projet de secouer la suzeraineté de la Russie. Un jeune Cosaque, dont Marie avait dédaigné l’amour, se charge de porter la lettre accusatrice ; mais le tsar estime trop l’hetman pour croire à une dénonciation, et c’est à Mazeppa lui-même qu’il renvoie l’écrit de Kotchoubey. A la vue de ce papier, Mazeppa rugit de fureur ; toutefois, habile et rusé, il impose bientôt silence à sa colère, et adresse au tsar une longue épître pleine de protestations hypocrites, pour demander la tête de son ennemi. Cette demande lui est accordée. L’amour de Marie, la fille de Kotchoubey, gêne seul la vengeance de Mazeppa, car Marie n’a pas cessé de l’aimer follement. Mazeppa sait profiter de cette aveugle passion, et, dans une scène dialoguée, que le poète a merveilleusement conduite, il arrache à l’imprudente l’assurance qu’entre son père et lui, s’agît-il de mort, elle ne balancerait pas. Cet aveu obtenu, le supplice de Kotchoubey est décidé. Le lendemain, l’échafaud se dresse dans la plaine. Pendant la nuit qui précède ce jour, Marie est réveillée par sa mère, qui, baignée de larmes et suppliante, vient lui demander d’intercéder en faveur de la victime livrée à la vengeance de l’hetman. D’abord Marie ne comprend pas ; mais, lorsque la vérité a frappé son esprit, elle pousse un grand cri et perd connaissance. Cependant le soleil s’est levé : la plaine est couverte de cavaliers qui entourent le lieu du supplice. Le peuple accourt, comme pressé d’assister à une fête. Bientôt paraît un char qui s’arrête devant l’échafaud. Kotchoubey en descend pour monter les marches fatales. Quelques moments se passent, et la foule se retire en silence. Tout à coup l’on voit accourir deux femmes éperdues et couvertes de poussière ; l’une d’elles est jeune et belle ; elles arrivent trop tard : déjà l’hetman est rentré dans son palais. Il demande Marie à ses serviteurs ; aucun d’eux n’a vu la jeune femme, et on la cherche en vain.
Cependant le temps est arrivé pour Mazeppa de jeter le masque, de donner carrière à son ambition impatiente. Dans ce suprême moment, le vieillard prévoit les désastres qui se préparent et sa ruine certaine ; mais la fatalité le pousse. Il prend les armes contre le tsar, et c’est le tsar qui triomphe à Poltava. Charles XII est en fuite, et le prince de l’Ukraine, vaincu comme lui, galope à ses côtés à travers les steppes désertes. Tout à coup ce dernier s’arrête brusquement ; il se trouve devant une habitation trop connue, et vient d’en voir sortir une jeune femme. Cette femme est folle ; c’est Marie. Elle a tout oublié excepté son amour pour Mazeppa, à qui, aveuglée par la démence, elle parle longtemps sans le reconnaître. Après ce triste entretien, l’hetman rejoint le roi de Suède et passe la frontière avec lui.
On voit ce qu’il y a d’historique dans ce poème et ce qu’il y a de romanesque ; on voit aussi la faute où le désir de rappeler une grande victoire des Russes a jeté Pouchkine ; l’orgueil national a été cette fois pour lui un mauvais conseiller. Quoi qu’il en soit de ce défaut, que le goût russe ne condamne pas, le poème de Poltava renferme assez de beautés originales pour mériter une place parmi les chefs-d’œuvre de Pouchkine. C’est une heureuse création que celle de ce vieillard ambitieux et cruel, espèce de figure homérique aux passions africaines. On sent néanmoins que le développement manque à cette œuvre ; les péripéties en sont trop hâtées ; le poète semble pressé d’arriver au terme de sa course. En général, l’imagination de Pouchkine, toujours ardente, se fatiguait aisément et s’affaissait dans les œuvres de longue haleine ; ainsi doit s’expliquer, selon nous, ce que laissent à désirer ses premières compositions.
Les littératures jeunes ne savent mettre en scène que des passions simples et pour ainsi dire à l’état primitif ; ignorantes qu’elles sont des nuances, des distinctions, des analyses fines et délicates, elles les peignent à larges traits et toujours sans mélange ; aucun combat de sentiments opposés, rien qui fasse contrepoids à l’entraînement instinctif. Telle est un peu l’antiquité. S’il est question d’amour,
C’est Vénus tout entière à sa proie attachée ;
s’il s’agît de vengeance, c’est la coupe ou le poignard des Atrides, et, si les poètes veulent adoucir tant d’horreur, ils inventent la fatalité. A ce point de vue, Pouchkine aussi est antique ; seulement il se passe de la fatalité. La fatalité ici, c’est l’aveuglement de la passion, c’est l’amour de Zemphirine, la haine de Kotchoubey, la vengeance de Mazeppa. La littérature russe, telle que Pouchkine la représente, est encore étrangère à l’analyse philosophique, mais tout y est jeune, ardent, impétueux ; l’expression même participe de cette rudesse primitive. L’auteur de Poltava a su ressaisir et transporter dans son style toute l’originalité de l’ancienne poésie slave. La littérature russe doit à Pouchkine d’avoir repris possession de cette grâce et de cette naïveté toutes nationales qu’elle avait perdues sous l’influence de l’imitation étrangère. N’oublions pas non plus que le poème de Poltava, comme celui de Boris Godounoff, en ouvrant l’histoire nationale, cette source féconde, à l’imagination des poètes, confirmait les jeunes théories, désormais victorieuses, et déterminait solennellement pour ainsi dire, l’entrée de la littérature russe dans les voies nouvelles de sa destinée.
C’est particulièrement dans les poésies légères de Pouchkine, dans ses ballades slaves, dans toutes ces fantaisies adorables, que se trouvent répandues avec une profusion royale les qualités d’originalité exquise qui feront à jamais de cet écrivain mi des grands maîtres de la poésie russe ; c’est également dans ces pièces détachées qu’il faut chercher la seconde et peut-être la plus brillante expression de la nationalité de sa muse. Ici les vers de l’auteur de Poltava roulent sur les sujets les plus variés, et forment dans leur ensemble un faisceau d’arabesques dont les mille détails sont autant de petits chefs-d’œuvre. Le poète a su y mettre en relief, avec un bonheur infini, tous les trésors et toutes les graces de sa langue. Il faut se rappeler que la nation russe est bien jeune encore, plus jeune même en poésie qu’en politique. Elle est restée fidèle à ses vieilles traditions, et on retrouve dans ses mœurs une foule de superstitions charmantes. De tous les peuples de race slave, ce sont peut-être les Russes qui, dans leur vie sociale comme dans leur langue, ont gardé le plus pieusement le culte des antiques origines. De là ces récits où le merveilleux joue un si grand rôle, et que le peuple écoute aussi sérieusement que jadis le calife bercé par les merveilleux récits de Sheherazade : le conte du Roi Saltan, celui de la Reine et sept héros, du Coq d’or, du Pécheur et le petit poisson, etc. Il y en a qui n’ont ni fées, ni magiciens, et qui n’en sont pas moins fantastiques ; voyez celui de Boudris et ses trois fils. Ce Boudris fait venir ses trois fils et les envoie chercher fortune à la guerre ; l’un doit aller à Novogorod ravir aux Russes leurs roubles et leurs pierres précieuses ; l’autre doit aller enlever aux Prussiens leur ambre parfumé et leur drap clair ; le troisième enfin doit aller faire la conquête d’une jeune et belle Polonaise. Les trois frères partent ; Boudris attend leur retour. Les jours, les mois se passent, et ses fils ne reviennent pas. Il les croit morts. Enfin, aux premières neiges, voici le premier de retour. Son manteau enveloppe une lourde charge. Le second survient bientôt, chargé comme son frère. Le troisième paraît à son tour avec une charge égale. Or, ce n’étaient point les roubles de Novogorod, ni l’ambre de la Prusse, qu’ils apportaient ; c’étaient, avec une jeune et belle Polonaise, deux autres jeunes et belles Polonaises. Boudris prit son parti ; il invita ses amis à trois noces.
Il n’est pas un chant national qui n’ait, en Russie, une note mélancolique, pas une mélodie qui ne renferme un soupir ou une larme. Il en est de même de la poésie populaire, de celle qui demande ses inspirations aux croyances publiques, aux mœurs les plus intimes du foyer domestique. Or, cette larme, ce soupir, cette note mélancolique, acquièrent sous la plume de Pouchkine un charme d’une douceur infinie. Nous allons essayer de traduire littéralement deux ou trois de ces morceaux. Le parfum d’une liqueur précieuse ne saurait se perdre tout entier en passant dans un autre vase.
LE PETIT OISEAU
« J’obéis avec respect à la bonne vieille coutume : voici un petit oiseau auquel je rends son libre vol au retour du printemps. Et maintenant je suis devenu accessible à la consolation. Pourquoi murmurerais-je contre Dieu, lorsque j’ai pu rendre la liberté à l’une de ses créatures ? »
Le peuple russe croit généralement au démon familier. Il n’est pas un paysan qui ose révoquer en doute la présence invisible, mais réelle, de cet être fantastique et bienfaisant qui protège mystérieusement et avec amour sa maison et son jardin. Cette croyance superstitieuse a quelque chose d’antique et de touchant. Voici le morceau qu’elle a inspiré à Pouchkine :
LE DÉMON FAMILIER
« Invisible protecteur de ma paisible campagne, je te conjure, ô mon bon démon familier ! garde mes champs, mes bois, et mon petit jardin sauvage, et la modeste demeure de ma famille ! Fais que les froides pluies, que les vents tartifs d’automne ne ruinent point mes champs, et que les neiges bienfaisantes couvrent à temps l’humble engrais de mes terres. Ne quitte point, gardien secret, le vestibule héréditaire ; frappe de crainte et de faiblesse le voleur nocturne, et de tout mauvais regard préserve mon heureuse petite maison. Rôde autour de ses murs comme une inquiète patrouille ; aime mon jardinet et la rive des eaux dormantes qui le baignent, et ce potager commode avec sa petite porte délabrée et son enclos mal joint. Aime le vert penchant des collines, et les prairies que foule mon errante paresse, et la fraîcheur des tilleuls, et la voûte bruyante des érables : ils ne sont point étrangers à l’inspiration. »
Nous citerons encore la bizarre et gracieuse ballade de la Naïade. Pouchkine a laissé deux poèmes qui portent ce titre. Le premier est une sorte de drame auquel la mort l’empêcha de mettre la dernière main.
Il y est question de l’amour d’un prince pour la fille d’un meunier, de l’abandon de celle-ci, qui, de désespoir, se précipite dans les flots du Dniéper où elle est changée en naïade, de la folie de son père et des remords du prince. Le second est la ballade qu’on va lire.
LA NAÏADE
« Sur les bords d’un lac, caché dans une sombre forêt, s’était réfugié un moine, dont la vie se passait dans des pratiques austères, le travail, la prière, le jeûne. Déjà le saint vieillard creusait sa fosse avec une humble pelle, et ne s’adressait à ses divins patrons que pour leur demander la mort.
« Un jour, au seuil de la porte de sa chaumière affaissée, l’anachorète priait Dieu. La forêt commençait à s’assombrir, le brouillard s’élevait sur les eaux, et l’on voyait à travers les nuages la lune rouler avec lenteur dans le ciel. Le moine porta ses regards sur le lac.
« Il demeura éperdu… et douta un instant de lui-même. Les ondes bouillonnent, se calment, bouillonnent encore, et soudain, légère comme une ombre du soir, blanche comme la neige matinale des collines, une femme aux pieds nus en sort, et, silencieuse, vient s’asseoir sur le rivage.
« Elle regarde le vieux moine en secouant ses tresses humides. Le saint ermite, tremblant d’émotion, contemple ses beautés. Elle, cependant, l’appelle de la main, lui fait de rapides signes de tête ; puis, semblable à une étoile qui file, elle disparaît dans les eaux dormantes.
« Cette nuit le morne vieillard ne dormit point, et le jour suivant il oublia de prier. Toujours, devant lui, involontairement il voyait l’ombre de l’étrange jeune fille. Les bois se revêtirent encore de ténèbres, la lune s’éleva sur les nuages, et, de nouveau, belle et pâle, la nymphe apparut sur la surface de l’eau.
« Elle regarde le vieillard en lui faisant signe de la tête ; elle feint en souriant de l’embrasser de loin, puis se joue sur les ondes qui rejaillissent autour d’elle, rit, pleure comme un enfant mutin, appelle le moine en soupirant avec tendresse : « Moine, moine, viens à moi, viens à moi… » Et soudain elle se plonge dans les ondes limpides, et tout rentre dans le silence.
« Le troisième jour, l’ermite passionné vint s’asseoir sur les rives enchantées et attendit la jeune fille ; mais l’ombre enveloppa les bois, l’aurore chassa les ténèbres de la nuit, et l’on ne retrouva plus le moine. Seulement de petits garçons aperçurent sa barbe grise qui flottait entre deux eaux. »
Pouchkine et le mouvement littéraire en Russie depuis 40 ans
Charles de Saint-Julien
Revue des Deux Mondes
Œuvres choisies de Pouchkine, traduites par M. H. Dupont
T.20 1847