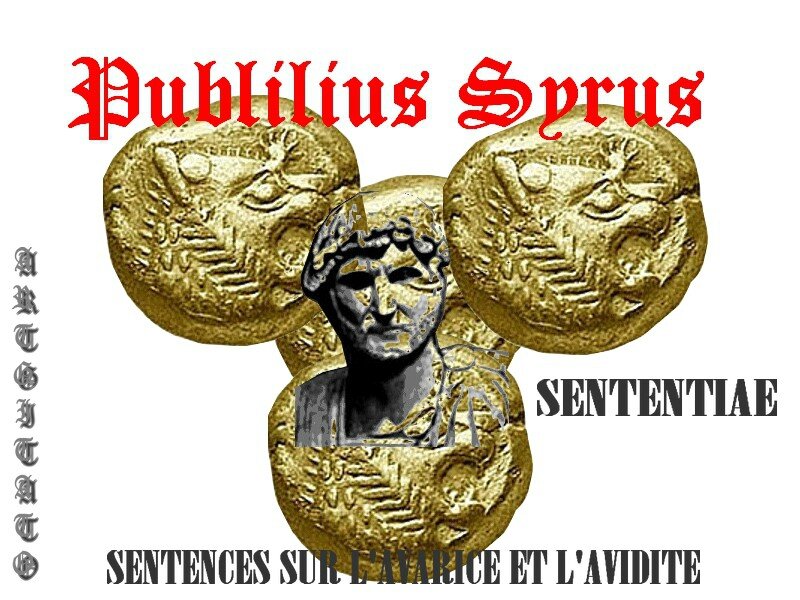ALFRED HITCHCOCK
LE SUSPENSE ET LE CRIME
PRENNENT TOUJOURS DE LA HAUTEUR

ALFRED HITCHCOCK
1899-1980
L’IMPORTANCE DE LA HAUTEUR DANS L’OEUVRE D’ALFRED HITCHCOCK
Jacky Lavauzelle
« En vérité, je me trouvais sur le rebord de la vallée d‘abîme douloureuse qui accueille un fracas de plaintes infinies. Elle était noire, profonde et embrumée ; en fixant mon regard jusqu’au fond, je ne pouvais rien y discerner » (Dante, L’Enfer, Chant IV, trad. Jacqueline Risset)
L’ESCALIER, LA RAMPE ET L’ASCENSEURLa montée ou la descente de l’escalier accélère le suspense, c’est un des « condensateurs d’émotion ». Souvent, c’est la mort que l’on retrouve au bout.La référence reste encore la descente de l’escalier du Cuirassé Potemkine d’Eisenstein. Souvent imitée (Les Incorruptibles de Brian de Palma), jamais égalée et encore moins dépassée. En termes de puissance évocatrice, il reste inimitable. Cependant, dans presque tous ces films, Hitchcock s’en sert afin de les structurer. De nombreux films reprennent les mêmes techniques filmiques. La scène comme la rencontre de James Cole (Bruce Willis) dans la demeure du père de Jeffrey (Brad Pitt) dans L’Armée des douze singes, de Terry Gilliam, en est un bel exemple. Jeffrey commence son ascension ainsi : « Attention ! Mesdames, soyez très prudentes ! Cet escalier est dangereux ! ». L’utilisation dramatique est 100% hitchcockienne. La preuve, James et la psychiatre, le docteur Kathryn Railly (Madeleine Stowe), se retrouvent ensuite dans un cinéma où l’on projette trois films d’Hitchcock. Ce sont Vertigo et Les Oiseaux qui passent dans la salle. Juste après Kathryn change de coiffure à la manière de Marnie… Dans la scène de l’escalier, en vélocité et non en tension, l’élève dépasse le maître.Nous voyons l’évolution si nous comparons avec un de ses films les moins inspirés,M et Mme Smith, avec la dextérité des Enchaînés. Pour le premier, Hitchcock lui-même avoue : « Je ne comprenais pas le genre des personnages qu’on montrait dans ce film, donc je photographiais les scènes telles qu’elles étaient écrites » (Entretiens avec F. Truffaut). Pas d’escaliers dans le film, juste une succession de scènes, d’entrées et de sorties d’ascenseur. Il s’agit, il est vrai d’une comédie légère qui ne nécessitait aucunement le poids et la présence de ce décor. Son absence démontre en contre-point toute l’importance qu’il lui accorde dans toute narration dramatique. L’escalier, la musique et la mort. Prenons le début du film. Vue générale de la campagne. Une indication sur un panneau : « Applegarth Farm ». Balayage du paysage. Une route. Une ferme. Un paysan monte l’escalier. A la fenêtre, le maître des lieux, le riche fermier Samuel Sweetland (Jameson Thomas), qui regarde au loin, l’air absent. La musique, rapide et forte, contraste avec la tranquillité et l’aspect bucolique et pastoral du lieu. La musique parle d’un malheur que nous ne voyons pas ? Les chiens de chasse sentent que quelque chose ne va pas et montent l’escalier pour s’installer à la dernière marche. Vue des pieds du paysan. Descente lourde et triste dans l’escalier. Vue du maître toujours à sa fenêtre. Dans sa chambre, derrière lui, quatre femmes entourent son épouse dans ces derniers moments.L’escalier et la rencontre. La fulgurance. Quand il choisit enfin sa servante, Aramintha (Lilian Hall Davis), il la présente aux deux dames qui, revenant sur leur décision, acceptent désormais la main de Samuel. Aramintha a été la plus rapide. Quand elle se présente aux deux autres, elle trône en haut de l’escalier et rejoint son homme le plus rapidement possible. « Rapide comme l’éclair, le Seigneur ne donne aucun avertissement quand il infuse un peu de bon sens dans le cœur d’un homme. » Lors du repas de noce au moulin, le dernier à monter l’escalier est Philip, rongé par son amour impossible pour Kate. Ces derniers pas sont lourds et tranchent avec la fête. La rambarde le retient comme si la chute n’était pas loin. C’est Pete qui revient le chercher pour le ramener dans la fête. Il le ramène dans le jeu et le positionne en face de Kate. L’ambiance reste lourde. Pete s’en aperçoit : « Hé César ! Ce n’est pas un enterrement, c’est un mariage ! ». Il ne voit pas qu’il s’agit de son enterrement symbolique. Le père : « Le mariage est une institution des plus honorables. Un châtiment attend ceux qui ne respectent pas les vœux sacrés. Les rouages de l’œuvre de Dieu tournent lentement ».Chantage (Blackmail, 1929) : L’escalier, le désir et la mort.Après sa dispute avec son fiancé, l’inspecteur Franck Weber (John Longden), Alice White (Anny Ondra) se fait raccompagner par un artiste peintre (Cyril Ritchard).Nous montons avec eux. Pendant qu’ils montent, la caméra filme en ascenseur. Montée directe vers la mort. Il arrive à sa porte, « L’antre du Lion ». Il referme la porte derrière elle et tire les rideaux. La biche est dans la tanière. Elle se rassure en voyant par la fenêtre la ronde d’un policier. Elle s’amuse à peindre sur une toile vierge. Elle dessine une tête. Lui, en lui prenant la main, finit en dessinant le corps nu d’une femme. « – Coquin ! ». Viens l’essayage de la robe. Je veux. Je ne veux plus. « -Est-elle assez grande pour moi ? ». A quelques mètres, elle se déshabille. Lui derrière le paravent, ronge son désir en jouant et en chantant au piano. Elle se montre enfin à lui en ballerine. « – Vous ne m’avez pas dit comment vous me trouvez ? – Merveilleuse ! –Je n’arrive pas à la fermer ! – Je vais régler ça ! –Je ne peux pas la fermer jusqu’en haut. – Ce n’est pas grave ! – De quoi ai-je l’air ? » Il lui descend les bretelles. Reviens pour en descendre une autre paire. La remonte. La prend par la taille. Lui met les cheveux en arrière. Et elle s’étonne qu’il l’embrasse. Elle le repousse. « -Je ferai mieux de partir ! ».Junon et le Paon (Juno and the Paycock, 1930) : L’escalier – La Mort – La religion.Elle entame la descente la descente. Le noir de la tenue se fondant dans le noir du fond de l’escalier. « Sacré Cœur de Jésus crucifié, prends notre cœur de pierre et donne-nous un cœur en chair. Débarrasse-nous de cette haine meurtrière et donne-nous Ton amour éternel. »L’Homme qui en savait trop (The Man Who Knew Too Much, 1934): Le Royal Albert Hall. Le concert. Jill Lawrence (Edna Best), la seule rescapée de la famille, au centre. Son regard parcourt circulairement le derrière de la scène. La caméra filme par-dessous l’ensemble des balcons. La mort ne peut venir que de là. La caméra passe. Aller et retour. La caméra maintenant s’arrête à chaque balcon. Là, un vide. Là, un rideau qui bouge. Retour sur Jill. Caméra par-dessus. Le criminel est là. Un canon sort du rideau. Plan sur la tribune officielle. La cymbale se prépare. Un cri. De l’autre côté, les criminels écoutent : « C’est fait ! Pourquoi ce cri ! » . Le rendez-vous manqué avec la mort. Elle ne tardera pas à revenir. Les Trente-neuf marches (The 39 Steps, 1935) : Le final au music-hall se joue sur trois niveaux. En bas, avec le public, les innocents, Pamela (Madeleine Carroll) et le comédien canadien accusé à tort, Richard Hannay (Robert Donat). Sur la scène, niveau médian, Monsieur Mémoire (Wylie Watson) qui a mémorisé l’ensemble des documents scientifiques sur un moteur d’avion silencieux pour l’ennemi. Et au balcon, le professeur Jordan (Godfrey Tearle), chef d’un réseau d’espionnage et le futur meurtrier de Monsieur Mémoire. Sur les 3 lieux, nous avons 3 niveaux de responsabilité, de l’innocence à la culpabilité aggravée. Mais la dernière scène, une des plus puissantes, est celle de la fin de Sir Hemphrey dans les cordes du bateau dans lequel il s’apprêtait à prendre la fuite. Acculé, oppressé, il n’a plus que la possibilité de se retrouver dans les cordes à monter de plus en plus haut. « – Descendez ! Vous n’avez aucune chance ! – Je serai en bas avant vous, donnez-moi une corde ! Un spectacle, vous l’aurez ! Place à Pengallon ! » En se jetant du haut du mas, justice est à nouveau faite.L’ennemi, en fuite, se réfugiera dans le moulin, seule hauteur visible de ce paysage désolément plat. Huntley et la caméra joueront avec l’escalier circulaire pour échapper, dans si peu d’espace, aux criminels.La tension sera à son paroxysme, quand Joan Fontaine descendra radieuse le grand escalier avec la robe de Rebecca à la rencontre de Maximilien (Laurence Olivier), en croyant lui faire plaisir : « – Qu’est-ce que vous faites ? – Mais c’est la peinture dans la galerie. Qu’ai-je fait ? Allez-vous changer ! Mettez n’importe quoi d’autre. Pourquoi restez-vous plantée-là ! » L’Ombre d’un doute (Shadow of a doubt, 1943)
-
-
- Rebecca (1940) : Un grand escalier au cœur du château de Manderlay. A partir d’un son puissant et continu, la nouvelle Madame de Winter (Joan Fontaine) va commencer l’ascension de l’escalier, lentement, pour pénétrer dans la chambre sanctuarisée de Rebecca. Elle y retrouve la terrible et effrayante Madame Danvers, la gouvernante (Judith Anderson), qui finira de la désarçonner complètement : « Parfois dans les couloirs, il me semble sentir sa présence. Ce pas léger et rapide. Je le reconnaîtrais entre mille. Il n’y a pas qu’ici, mais partout dans la maison. Je crois l’entendre à cet instant. Pensez-vous que les morts reviennent ? Restez ici pour vous reposer et écouter la mer. C’est tellement reposant. Ecoutez-la ! Ecoutez la mer ! ».
-
- Correspondant 17 (Foreign Correspondent, 1940) : L’escalier, la fuite et l’esquive – La pluie et la mort. En montant le grand escalier droit, Van Meer (Albert Bassermann) n’aura aucune chance d’échapper à la mort qui sort de l’appareil photographique. Il sera tué, à bout portant, sous la pluie avant que Huntley Haverstock (Joël McCrea), le journaliste américain, ne le retrouve.
- La Taverne de la Jamaïque (Jamaica Inn, 1939) De nombreuses scènes ont lieu soit dans l’escalier étroit, à gauche après la porte, de la Tarverne de Joss Merlyn (Leslie Banks), le chef des brigands ou dans le grand escalier noble du grand organisateur de la truanderie maritime, Sir Humphrey Pengallan (Charles Laughton). Dans le premier, on jette les malles, on assassine, on traîne les traîtres pour les pendre. Dans le second, on fomente, on opère en stratège. Du haut de son grand escalier, Sir Humphrey traite le quotidien. « -Elle était charmante, Chaldwick – Le boucher est venu réclamer son dû –Quelle occupation ! Il faut bien vivre ! »
- La police encercle les criminels. « Pourquoi ? C’est la routine ! Va frapper à la porte ! Quand ils ouvriront, regarde s’il y a un escalier par où s’engouffrer ! » Un policier arrive à la mort qui est abattu sur le coup. A la fin de la fusillade, le père arrive à s’échapper et à récupérer sa fille. Dans l’escalier, Bob (Leslie Banks) est touché par un tir du tireur d’élite (Franck Vosper). Il s’écroule sur la rambarde et tombe… Les héros ne meurent jamais à la fin du film. La chute est réservée aux criminels et autres bannis de la société.
-
- Le pendant de la scène de ‘la Vierge’ descendant l’escalier, sera celle du traitement de Juda. Les républicains viennent chercher le fils Boyle, Johnny. Ils savent qu’il a trahi. Il doit payer. Johnny connaît le sort qui lui est réservé. La descente sera la dure pente vers sa fin. « -Allez viens, John Boyle. On te cherche. Y a des gens qui veulent te parler. On t’a enfin ! –Je suis malade, je ne peux pas. Que voulez-vous ? – Bouge-toi. On a du chemin à faire et on a peu de temps. – Que me voulez-vous ? Je suis un ancien camarade. – Tancred aussi était ton camarade, mais tu l’as oublié en le dénonçant aux types qui l’ont exécuté. On n’a pas de temps à perdre. Emmène-le ! T’as un chapelet ? – Un chapelet ? Pourquoi me demandez-vous ça ? –Marche ! Marche ! » Ils le portent jusque dans l’escalier et le traîne. « Vous ne tueriez pas un camarade ? Regardez mon bras ? Je l’ai perdu pour l’Irlande ! – Le pauvre Tancred a perdu sa vie pour l’Irlande ! –Sacré Cœur de Jésus, ayez pitié de moi. Sainte Vierge, priez pour moi, restez avec moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, Sainte Vierge, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pêcheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. » Ils ont fini de descendre l’escalier. Ils sortent dans la rue. Plus tard, on ramènera le corps criblé de balles à sa mère.
- L’enterrement du jeune Tancred. Nous passons de l’appartement des Boyle, joyeux à l’idée d’hériter d’une fortune qui tombe au bon moment dans l’Irlande appauvrie des années 20, à l’escalier où Mme Tancred va rejoindre l’enterrement de son fils. Nous passons d’une pièce où les Boyle, Junon (Sarah Allgood), le Capitaine (Edward Chapman), leur fils Johnny (John Laurie), Joxer, un ami de bar (Sidney Morgan) et une amie, font la fête, boivent et chantent à l’espace de l’escalier, sombre, étriqué et noir, envahi par la mort. « -Tais-toi, Jack, ne mets pas encore le disque. C’est Madame Tancred. J’ai oublié qu’on amenait le corps à la chapelle. Je vais lui donner un peu de lumière. » Elle ouvre la porte. Escalier noir. Mme Tancred descend devant un groupe de femmes en deuil. « – Dieu est bon et les républicains ne seront pas toujours dehors. – Que m’importe qu’ils soient dedans ou dehors ! Cela ne ramènera pas mon fils chéri de la tombe. – Venez d’abord boire une tasse de thé, Mme Tancred. –Je ne peux pas Madame Boyle. Je le rejoindrai bientôt. Il est mort noblement. –Et nous l’enterrerons comme un roi. – Je vivrai donc comme une indigente. Que sont mes douleurs de l’avoir mis au monde à côté de celle que je connais aujourd’hui en l’enlevant du monde pour le mener à sa tombe ? Je l’ai vu naître, je le verrai partir. – Que Dieu vous aide. Il vous faut un châle, il fait froid. Je vais en chercher un. –Je n’ai plus de chez moi. Il était mon seul enfant. Dire qu’il est resté par terre toute une nuit étendu le long d’un chemin de campagne désert avec sa tête, sa tête chérie que j’ai embrassée et caressée, baignant dans un ruisseau ! Mère de Dieu, ayez pitié de nous. Oh ! Sainte Vierge, où étiez-vous quand mon fils a été criblé de balles ».
-
-
- Lui, bouillant, pendant qu’elle se rhabille, veut continuer à jouer, le coquin ! La partie n’est pas encore sifflée. Il jette sa robe, pour que, en petite tenue, elle parcourt la pièce. Le lion ne dort pas encore. « –S’il vous plait. Rendez-la-moi ! – Venez la chercher ! » Il la prend par la taille « -Ne faites pas l’enfant ! – Laissez-moi ! » Vision du policier qui passe. Cri. Le rideau bouge. La main d’Alice cherche à attraper quelque chose. Gros plan sur le couteau. Le rideau bouge de moins en moins. Plus de mouvement. Une main d’homme en sort brusquement. Il est mort. Elle se rhabille. Efface la signature qu’elle avait mise sur le tableau. Sort. Vision de l’escalier. Vision complète d’en haut de tous les étages. La descente se fera lente. Vue sur les chaussures et les jambes d’Alice. Le désir n’est plus celui de Crewe, mais celui d’Alfred, du spectateur-voyeur. Marche après marche. Petite musique lente d’accompagnement. Elle sort doucement et redescend les quelques marches devant l’entrée. Une ombre de chapeau d’homme apparaît derrière elle. Elle n’était pas seule. Elle marche tel un zombie. Vue sur ses jambes sur le trottoir. Chaque main qui se tend lui rappelle le mort. Il fait jour. Les chaussures que l’on voit n’ont plus de talons. Le désir est véritablement parti.
- La scène du meurtre de Mr Crewe (Cyril Ritchard) par Alice White (Anny Ondra) est une des plus belles d’Hitchcock, et nous retrouverons tous les ingrédients dans la plupart de ses autres films. Déjà, devant la porte, la discussion évoque le désir et la peur. Tous les sous-entendus et la montée inévitable du désir. Elle joue aussi avec le sien, et ne cesse de l’émoustiller. « -Avez-vous déjà vu l’atelier d’un peintre ? – Non, mais j’aimerais bien ! – Montez donc voir le mien ! – Une autre fois. – Pourquoi pas maintenant ? – Il est tard ! –Avez-vous peur ? – Bien sûr que non ! – Alors, pourquoi pas maintenant ? –Non, je ne peux pas. Merci beaucoup. Je dois rentrer – Vous avez peur. – Certainement pas. Ce n’est pas un homme qui va me faire peur ! – C’est bien ce que je pense depuis le début. – Quelle heure est-il ? – Pas très tard ! Venez ! Où est le mal ? – Nulle part pour l’instant. De plus, une femme sait toujours si elle peut faire confiance à un homme. – C’est vrai. Me faites-vous confiance, Alice ? Je peux vous appeler Alice ? – Si vous voulez ! – Venez ! ». Il ouvre la porte d’entrée. La referme. Sourire. Il regarde vers le haut. « –J’habite au dernier étage ! » Vue sur un immense escalier qui prend tout l’écran. Il regarde son courrier. Il doit la laisser pour voir la concierge un instant. « -Montez donc ! – D’accord ! » Elle commence la montée seule. Il la rejoint.
- Les policiers débarquent dans un immeuble. Un escalier à gauche. Il mènera à un homme couché. Il sera immobilisé rapidement.
- Le positionnement des trois personnages, après la noyade. Après son suicide, Kate est jugée. Philip, devenu juge de l’Île de Man, trône au-dessus de tous. Il détient le pouvoir. Pete, toujours ignorant l’amour que se portent ses deux amis, est là, la défendant. Il se retrouve au-dessus de la salle, en position intermédiaire. Sa parole compte. Kate, elle se retrouve au niveau de la salle. Elle attend le jugement. Accusation de Philip par le père de Kate. Philip descend de son fauteuil de juge et l’explication avec Pete se fait au même niveau. Ce n’est plus le juge qui parle, ce sont des amis qui règlent leur différend.
- The Manxman (1929) : Dans la scène de la promesse avant son départ de l’Île de Man, Pete Quilliam, le marin (Carl Brisson) parle à Kate Cregeen (Anny Ondra). Celle-ci est à sa fenêtre. Pete est juché sur les épaules de son meilleur ami Philip Christian (Malcolm Keen), l’avocat. Il l’écrase. Trois niveaux. Kate, au-dessus de tous, a le pouvoir. Pete attend sa parole, sa promesse. Elle maîtrise la scène et en joue. Pete, lui, attend, dans une position inconfortable et déstabilisatrice. Il domine Philip, mais la situation peut, avec peu de chose, s’inverser. Pour le moment Philip sert d’échelle. Il baisse la tête. Son heure n’est pas arrivée. Il n’a plus qu’à attendre.
- Champagne (1928) : L’escalier dans le bateau occupe la scène centrale. Tout commence par une danse autour de table. Nous sommes dans une organisation stricte et socialisée. Tout à coup les visages sont inquiets. Les premiers se ruent dans l’escalier. L’ordre se dissipe. Tous se ruent tels des animaux dans l’immense escalier. Celui-ci est devenu rivière sauvage drainant des individus comme des rondins. Peu après, l’héroïne, Betty (Betty Balfour), alors que le bateau est pris dans la houle, descend l’escalier, comme une ivrogne, suivie, peu après par son ami. Le garçon de salle qui descend avec assurance, contraste avec les deux amants. Les tares de la société s’y reflètent.
- L’escalier et l’esquive. Le temps long. Nous retrouvons Samuel en visite chez la veuve Windeat (Louise Pound). Il s’installe en bas et en face de l’escalier. La veuve, en apprenant sa visite, s’affaire à finir sa toilette. Elle l’observe par l’entrebâillement de la porte, en haut de l’escalier. Dès qu’il se retourne, elle se cache. Hésitations. Robe coincée dans la porte. Longue attente. Gestes d’énervement et d’impatience de Samuel. L’attente devient trop longue. La rencontre ne sera pas concluante.
- Laquelle des Trois ? (The Farmer’s wife, 1928). Il y a dans ce film muet de très nombreux ingrédients hitchcockiens que nous reverrons tout au long de sa filmographie.
-
- Les escaliers sont la colonne vertébrale du film et souvent son point culminant dans la montée de l’angoisse et du suspense. La caméra doit utiliser un autre champ que le simple gros plan et un angle toujours décalé et donc déstabilisant. Les rythmes ne sont jamais les mêmes et varient. La montée n’est pas nécessairement la plus lente. Elle peut être leste et rapide (L’Etau). Et inversement, quoi de plus lent et intense que la descente finale des Enchaînés. Enfin, il s’agit souvent d’escaliers majestueux, torsadés. Ils sont le symbole même de la virtuosité d’Hitchcock. Là où son art opère en plénitude.
- L’escalier hitchcockien est planté dans un hall gigantesque bardé de colonnes immenses. Il est soit en face, majestueux, généreux, soit sur la droite après la porte de l’entrée. Dans ce cas, il sera étroit, raide, nerveux. Bien entendu, il existe un bon nombre de variantes, parfois bien différentes…
- L’élévation : régression ou ascension ?
- 1er temps. L’appel au criminel se fera à partir de l’escalier de la maison. La jeune Charlotte (Theresa Wright) va faire venir le loup dans la bergerie. Le loup, c’est son oncle Charlie Oakley (Joseph Cotten). Dialogue avec sa mère : «- Maman, je vais dans le centre envoyer un télégramme. – Qu’y a-t-il de si important ? – Je songe à quelqu’un qui va tous nous secouer, il va nous sauver la vie ! – Comment ça, nous sauver la vie ? – Il s’est trouvé à point nommé à chaque fois que le besoin s’en est fait sentir. Maman, quelle est l’adresse d’Oncle Charlie ? – L’adresse de Charlie ? Tu n’as pas l’intention tout de même de lui emprunter de l’argent ? – Bien sûr que non ! —Et puis, il n’a que nous au monde ».
- 2ème temps : Le premier doute. Charlotte apporte de l’eau à son oncle. Elle est dans l’escalier. Pénombre. La caméra reste en contrebas. Musique angoissante. Les ombres des barreaux de la rampe rayent le mur. Quelque chose va arriver derrière la porte. Elle rentre et aperçoit le morceau du journal que son oncle a voulu cacher. Elle prend le morceau de la poche de la veste. « Rappelle-toi que je t’ai dit que tu n’as aucun secret pour moi…Il y avait quelque chose à propos de toi dans le journal, il y a un article te concernant ». L’oncle se rue sur elle et attrape l’article tout en tordant le poignet de sa nièce. Le « Je ne cherchais pas à te faire mal !», « des ragots ! » ne pourront plus dissiper le doute de Charlotte.
- 3ème temps : La confirmation des soupçons. Deux journalistes veulent faire un reportage sur une famille moyenne américaine, en fait, il s’agit de policiers qui enquêtent sur l’oncle. Joseph les laisse ensemble et monte à l’étage. Les policiers veulent le suivre, mais sont coincés dans leur enquête. Lui, écoute. Ceux-ci doivent trouver un prétexte pour le suivre et monter à l’étage. « – On pourrait jeter un coup d’œil là-haut, peut-être ? Vous nous montreriez ! » Les deux suivent Charlie dans la montée. « Je ne vois pas ce que vous allez trouver de passionnant ». La caméra recule. « Y a-t-il un escalier extérieur ? Je vous parie que votre oncle est sorti ! ». Arrive ensuite l’oncle qui, photographié contre son gré, demande à récupérer les pellicules. La manière de faire de l’oncle questionne à nouveau Charlotte : « Je ne pensais pas que ça l’embête à ce point ! »
- 4ème temps : la fausse pause. Le criminel aurait été retrouvé dans le Maine. Il est sur le perron. Charlotte est en bas. L’oncle rayonne. Il est sauvé. « J’ai une faim de loup aujourd’hui ! Je sens que je vais bien déjeuner ! » Pourtant, quand il monte l’escalier, il sent que quelque chose ne va pas. Elle est restée en bas. La caméra reste avec Charlie. Il sait qu’elle sait. La plongée de la caméra annonce un meurtre à venir.
- 5ème temps : Charlie passe à l’action. Il fait beau. Charlotte va faire des courses. En descendant l’escalier, elle tombe et se rattrape de justesse. Passage de Charlie. Sa mère arrive. «- J’ai manqué une marche. Je me suis rattrapée à la rampe ! – Chérie ! Tu aurais pu te tuer ! ». La nuit arrive. Charlotte examine la marche douteuse à la lampe torche. Elle a bien été sabotée. En remontant, elle voit l’oncle accoudé à la rampe. « – Quand vas-tu te décider à partir ! Quand vas-tu t’en aller ! – J’ai envie de m’installer ici ! – Je ne veux plus de toi, ici. Pars ou je te tuerai de mes mains ! As-tu compris ce que j’éprouve pour toi ! »
- 6ème temps : le temps du départ. Alors que tous sont réunis, sauf Charlotte, l’oncle est le héros de la journée. Il s’apprête à porter un toast. Charlotte descend. Il voit de suite qu’elle porte la bague qui peut le perdre à n’importe quel moment. Gros plan sur la bague. Il change de suite son discours et annonce son départ. Elle a gagné. « Je verrai toujours dans cette maison un havre de paix ! »
- 7ème temps : l’épilogue – La chute. Dans le train, une bagarre a lieu entre l’oncle et sa nièce. Il attend que le train prenne de la vitesse pour la jeter et la tuer à coup sûr. Juste avant, dans un léger mouvement qui ressemble à un pas de danse, elle attrape le rebord de la porte. Déséquilibré, l’oncle se jette sur le train qui arrive en face. Il est mort en emportant son secret. Sa mère n’en sera rien.
Dans la Maison du Docteur Edwardes (Spellbound, 1945) : C’est en montant l’escalier que la tension s’accélère. La première fois avec le docteur Edwardes (Grégory Peck) : raie de lumière sous la porte. La deuxième fois, quand Constance Petersen (Ingrid Bergman) s’apprête à rendre visite au docteur Murchinson (Léo G. Carroll), le véritable assassin.
Grégory Peck descendra de l’escalier avec son rasoir entre les mains. « Le voilà donc qui descend rien et je vois qu’il est dangereux rien qu’à sa manière d’être ».
La descente tue. Mais il s’agit parfois d’un accident. « Maintenant, je me souviens. Dans mon enfance, j’ai tué mon frère. Je ne l’ai pas tué, c’était un accident ! » (Grégory Peck). On le voit descendre en se laissant glisser sur une rambarde en pierre ; en poussant son frère avec ses pieds, il le projette sur les pointes de la barrière.
Les Enchaînés (Notorious, 1946) : Le premier doute survient vraiment dans la descente à la cave. Devlin (Cary Grant) et Alicia (Ingrid Bergman) sont surpris dans leur fouille de la cave par l’arrivée de Sebastian (Claude Rains). Une ombre dans l’escalier, juste le temps de refermer la porte. Ils sont vus. Impossible de fuir. Changement de stratégie : ils s’embrassent. Sebastian n’est pas dupe quand il s’aperçoit qu’une clé manque au trousseau. Le temps des représailles est arrivé. La caméra, à son habitude dans ces moments là, s’élève très haut et fait un plan d’ensemble. Les excuses d’Alicia ne changeront rien. « – Je m’excuse pour ce qui s’est passé, Alex – Oh, ma chérie, c’est à moi de faire des excuses, je me suis conduit comme un collégien. – Tu ne m’en veux plus ? – Pas du tout, j’ai déjà oublié cette scène ridicule ! – Merci. Est-ce que tu montes ? – Non. Dans un moment. Je vais dans mon bureau voir le docteur Anderson (Reinhold Schünzel). » . Juste après avoir récupéré la clef manquante, qu’Alicia a remise ensuite dans le jeu de clés, il redescend examiner la cave et découvre que le dépôt d’uranium a été découvert. Il est perdu. Il faut à tout prix qu’il fasse disparaître Alicia. Il revient devant l’escalier. La caméra l’attend tout en haut. Elle le suit dans sa montée. Ils se retrouvent tous les deux en haut des marches. Le visage est fermé et dur. Le sort d’Alicia est scellé.
Après sa rencontre avec Devlin sur le banc d’un jardin de Rio et déjà sous l’emprise de drogues, Alicia rentre dans son immense demeure. Après la scène de la tasse de café où elle s’aperçoit que Sebastian et sa mère sont réellement en train de l’empoisonner, elle cherche à partir. Elle arrive dans le hall. Le flou succède aux images plus ou moins nettes et stables. La porte, le hall et enfin l’escalier. Cet escalier interminable tel un roc incontournable. « Aidez -moi à la monter dans sa chambre ! ».
Sa chambre à l’étage sera sa prison et presque son tombeau. Sauvée in-extremis par l’arrivée de son prince Devlin qui la sortira des griffes du mal. Toute la scène est filmée dans une extrême lenteur. Une des plus belles scènes du cinéma. Montée de Sebastian, vu à travers les colonnes de l’escalier. La caméra passera d’un personnage à l’autre. Le visage de Sebastian montre la lutte intérieure. Doit-il parler ou se taire. Sa peur se lit sur son visage. Devlin le comprend très bien qui en joue : « Est-ce que vous désirez que je leur raconte tout ? Vos amis seront ravis d’être au courant ! …Vous savez ce qu’ils ont fait à ce cher Emile. Dois-je vous le rappeler ! Si vous êtes courageux, allez-y, dîtes à vos amis qui elle est !» Une fois la porte franchie, les marches de l’entrée sont encore là. C’est la crucifixion de Sebastian. Il se retrouvera seul en pâture à ses anciens amis. Devlin attentionné avec Alicia : « Courage ! Il ne reste que quelques mètres à faire ! Respirez profondément ! », sera inflexible avec le nazi : « Pas de place pour vous, Sebastian ! Inutile d’insister ! » Sa mort est proche, il le sait. Ses ‘amis’ l’attendent : « Alex ! Voudriez-vous venir ! J’ai à vous parler ! »
Le Procès Paradine (The Paradine Case, 1947) : 1er escalier, les prémisses du mal. Celui de la maison des Keane. A droite, majestueux. Il pleut. Anthony Keane (Gregory Peck) retrouve sa femme Gay (Ann Todd) dans l’escalier. Elle vient à sa rencontre. Ils montent à l’étage. La pluie reste toujours un élément négatif chez Hitchcock. Gay le nettoie, le sèche de cette pluie qui le colle, comme lui colle déjà à la peau la personnalité de Maddalena Paradine (Alida Valli). Elle insiste dans ces propos comme pour se persuader elle-même : « Je suis contente que tu la défendes ! »
- 2ème escalier : L’emprisonnement de Keane. Celui de la prison de S.M. Escalier à droite, sévère et resserré. Anthony retrouve Maddalena. Il se fera prendre dans ses filets.
- 1er escalier : La confusion. Vue du haut de l’escalier. Keane et Gay rentrent. Keane, troublé, ne peut pas monter. «- Tu ne montes pas te coucher ? – Pas pour le moment ! – Tu as vu Madame Paradine ? Comment est-elle ? – Etonnement séduisante ! Je pense que ce serait ton avis. – Je ne crois sûrement pas ! – Comment ça ? – A cause de ce qu’elle m’a fait perdre ! –Pourrais-tu me dire de quoi tu parles ? – Si tu ne te rappelles pas, ce n’est pas à moi de te le dire ! – Le voyage que je t’avais promis pour l’anniversaire nous le ferons quand même, ma chérie, peut-être même avant que l’affaire soit jugée ! »
- 1er escalier : La crise. Arrivée de Keane pendant la nuit. Il monte l’escalier plongé dans les ténèbres. Les ombres des barreaux rayent le haut de l’écran. Une lumière sous la porte. Gay ne dort pas. « Nous devions partir ! Je ne t’ai jamais vu dans cet état »
- 3ème escalier : La confrontation. Keane arrive dans la maison de campagne de Hindley Hall. Grand escalier classique et droit à droite. Au rez-de-chaussée, musique douce. La pièce préférée du Colonel Paradine. « Attendez-là, M Keane, je vais ouvrir les volets, la vue est belle. » Puis, ils montent à l’étage, pour voir la chambre de Maddalena. « Je vais vous montrer le premier étage. C’était la chambre de Madame. » Dès la première marche qui monte à l’étage, la musique change de tonalité et devient angoissante.
- 4ème escalier : Le jugement dernier. Maddalena s’apprête à rentrer dans la salle d’audience et à affronter l’hostilité prévisible des jurés et du juge Lord Horfield (Charles Laughton). Une caméra l’attend en haut d’un escalier raide et sévère.
Le Grand Alibi (Stage Fright, 1950) : Dans la voiture, Jonathan Cooper (Richard Todd) raconte à son amie, Eve Gill (Jane Wyman), la tragédie qui vient de se produire. « C’est Charlotte Inwood (Marlène Dietrich) ! Elle a de gros ennuis, très graves. J’étais dans ma cuisine, on a sonné à la porte et j’ai descendu voir qui c’était. » La caméra montre la scène. Jonathan se retrouve devant un escalier, très raide et étroit, menant à son entrée. Ouverture de la porte. Deux jambes de femmes. C’est Charlotte qui apparaît. Un mélange d’érotisme et de mort traverse cette scène. « – Johnny, tu m’aimes ? Dis que tu m’aimes ! Je crois qu’il est mort. Je suis sûr qu’il est mort ! Je ne voulais pas le faire ! –Qui est mort ? – Mon mari ! Nous nous sommes disputés à cause de toi ! Il était ignoble ! » Ils commencent à monter l’escalier. « -Tu sais ce qu’il était capable de dire. Il m’a d’abord frappé. J’ai saisi un objet. J’étais hors de moi, tant j’avais peur. Oh ! Qu’est ce que je vais devenir ? – Ma chérie, il faut te calmer ! Il n’est peut-être pas mort ! » Elle se retrouve en haut de l’escalier. Elle se tient au mur.
Un peu plus tard, nous le retrouvons dans la maison du crime. Il ouvre la porte. A gauche, un grand escalier torsadé. Bien sûr, c’est à l’étage. Il referme la porte et entame avec crainte son ascension. A mi-hauteur, il se retourne. Aucun bruit, personne, il peut continuer. Il retrouve le corps. Un cri. La femme de chambre est au fond qui le regarde. Fuite. L’escalier est survolé. La femme de ménage reste en haut, comme la caméra, qui regarde le fuyard. A-t-il été reconnu ?
Chez lui, il prépare sa valise. Un coup de sonnerie. En écartant le rideau, il voit deux hommes, certainement des policiers. Il remet la valise à sa place, arrive en haut de son escalier. Hésitation. Il revient prendre la robe ensanglantée d’Eve et la glisse sous son tricot. En bas la porte s’ouvre sur deux flics. « Jonathan Cooper ? Nous sommes de la police ! Peut-on avoir un entretien avec vous ? » Les policiers regardent cet escalier. Jonathan en profite pour se faire la belle en refermant la porte subrepticement. Cette attitude rend plus complexe l’histoire et enrichit la narration.
La fuite le conduira à l’Ecole Royale d’Art Dramatique, où le jeu des escaliers lui permettra encore une fois d’échapper aux inspecteurs. Croisements, évitements, substitutions. Ce sera le même lot quand Eve s’introduira dans la maison pour être embauchée, comme remplaçante, auprès de Charlotte qui ne se connaissent pas. Arrivée dans la maison. Elle est suivie par l’inspecteur Wilfred Smith (Michael Wilding), qu’elle a précédemment rencontré. Elle ne veut pas qu’il la remarque. Quand l’inspecteur rentre, on aperçoit une ombre en haut de l’escalier. Eve se présente à Charlotte qui essaie sa robe de deuil comme un mannequin. Elle entend que Charlotte, loin de soutenir Jonathan, l’accuse…Dès que les policiers partent, Eve les suit du haut de l’escalier.
La scène finale du Théâtre mélange les propos décalés de Charlotte et ceux des policiers qui poursuivent encore Jonathan. Les propos se croisent et rendent presque fortuite et irréelle la course et la poursuite du criminel. La caméra commence d’abord à filmer la salle tout en haut, à côté d’un haut-parleur. La caméra, se positionne encore une fois comme un prédateur qui attend sa bête pour s’abattre de toute sa vélocité. Arrive Jonathan, qui bien sûr profite d’un moment d’inadvertance pour s’échapper. « -Toutes les sorties sont fermées ! Même les sorties de secours ! Où mènent les escaliers ? Pourquoi veux-tu aller sur le toit ? Il a pu se faufiler et monter par l’escalier de secours ! » « – Tout va très mal pour moi (Charlotte) ! » « – Tu l’as vu ? Il est déjà loin ! » « – Vous aimez les chiens ? Moi j’avais un chien. Il me détestait, et, à la fin, il me mordait. A la fin je l’ai fait abattre ! (Charlotte) » « – Je parie qu’il est loin à l’heure qu’il est ! Je jurerai l’avoir vu dans le couloir ! »…
Enfin, Jonathan, caché avec Eve, lui avoue être le meurtrier. Eve s’aperçoit enfin qu’il est fou. Elle est à deux doigts de devenir sa prochaine victime. Elle se sauve et relance la poursuite. Acculé dans la salle, Jonathan ne peut plus fuir. Le rideau métallique qui s’abat sur lui ne lui laissera pas d’autre alternative que la mort.
L’Inconnu du Nord-Express (Strangers on a Train, 1951): Le champion de tennis Guy Haines (Farley Granger) armé d’un pistolet, rentre dans la maison du père de Bruno (Robert Walker). C’est la nuit. La torche illumine les rayures sur le papier, symbolisant l’escalier. Il faudra passer par le couloir et rejoindre la chambre. Guy arrive en bas de l’escalier. Un molosse au milieu de l’escalier apparaît. La caméra passe de Guy au chien. Grognements. La montée sera lente. Marche après marche, la caméra arrive au chien. Le chien lui lèche la main. La première étape est passée. Il peut entamer la deuxième partie plus simple de l’ascension. Ce n’est pas le père de Guy qu’il trouve dans le lit, mais Guy lui-même. L’arme change de main. Bruno tient Guy. Guy sort de la chambre et se dirige vers l’escalier, suivi par Bruno. A mi-étage, arrêt. Il regarde Bruno et opère la deuxième partie avec plus de lenteur. Nous sommes dans l’attente imminente du crime, mais rien ne vient. Fausse alerte. « Ne craignez rien ! Je ne vais pas tirer sur vous. Ça réveillerait ma mère. J’ai plus d’un tour dans mon sac. Je connais des moyens plus efficaces, beaucoup plus ». Nous devrons donc attendre un peu.
Dans la scène finale du manège, le vertige, objet central du film, symbolisé dans les cercles de plus rapides du manège fou, se transforme en mouvements verticaux. La lutte entre les deux protagonistes, Guy et Bruno, est d’abord filmé dans l’accélération par rapport aux spectateurs. Puis la lutte s’isole du monde extérieur et reste cantonnée au seul manège. L’extérieur est flou et devient donc invisible. La caméra se fixe sur les sabots, les têtes et les mouvements des barres. Tout semble piétiner les deux lutteurs. Ils sont au sol. Mais c’est Bruno, incarnation du mal, qui a le dessus. La rotation semble s’être suspendue jusqu’à ce que le manège soit arrêté brusquement. Alors celui-ci éclate et se disloque, arrêtant la musique même dans la frayeur ultime. Le vertige aussi. Les combattants se verront séparés. Le calme reprendra ses droits, ainsi que la justice.
La Loi du silence (I confess, 1953) : Acquittement de Logan. Il se retrouve sur le perron du palais de justice devant une foule hostile et haineuse. Il regarde le ciel et respire. Il va falloir rejoindre la voiture qui l’attend et traverser cette masse. Celle-ci le coince contre le véhicule, comme pour l’étouffer.
Il casse un carreau de la voiture. Alma Keller (Dolly Haas), envahie par la culpabilité, se jette aux pieds de Logan, dans l’attente de son pardon.
Son mari, Otto (O.E. Hasse) paniqué, la tue. Alma donnera son mari dans un dernier souffle à l’inspecteur Larrue (Karl Malden). La rédemption aura bien lieu.
Fenêtre sur cour ( Rear Window, 1954). La vision par derrière. Voir ce que l’on ne voit pas, ou que l’on ne doit pas voir. Le derrière de la façade, la cour, nous montre la structure, la colonne vertébrale de cette communauté. Une multitude de petits escaliers de secours sont reliés entre eux, mais personne ne communique. Ils ne relient que du vide. C’est un ensemble de solitudes, plus ou moins acceptées, un ‘Cœur solitaire’, un artiste incompris, une danseuse courtisée par une bande de chasseurs, des disputes conjugales, un meutrier… L’escalier devrait donner du lien, faire que quelque chose reste envisageable, possible entre les êtres. L’escalier, ici, n’est pas celui du crime habituelle chez Hitchcock, il est philosophique, presque métaphysique. Les gens sont là, regroupés, dans un si petit espace. Jeff Jeffries (James Stewart) regarde l’étendue du désastre.
Une chanson sort d’une des fenêtres : « Te voir, c’est t’aimer. Et je te vois partout dans le lever du soleil, dans le clair de lune, où que je regarde, tu es toujours là. Te voir, c’est t’aimer, et je te vois tout le temps, sur un trottoir, sous un porche, dans les escaliers solitaires que je gravis.»
Le chien est descendu par une corde, dans un panier. Il sera retrouvé mort. C’est l’amour que l’on a voulu tuer : « Vous ne connaissez pas le sens du mot ‘voisin’. Les voisins se parlent, se soucient de la vie, de la mort d’autrui. Pas comme vous. Comment peut-on être assez lâche pour tuer un gentil petit chien sans défense ? La seule créature du voisinage qui était capable d’aimer ! Vous l’avez tué parce qu’il vous aimait ? Juste parce qu’il vous aimait ? ».
La seule fois qu’un de ces escaliers est utilisé, c’est quand Lisa (Grace Kelly) visite l’appartement du meurtrier, Lars Thorwald (Raymond Burr). La montée est vécue d’une manière intense par Jeff à la fenêtre de son appartement. La montée finirait par la mort de Lisa sans l’arrivée in-extremis des policiers. Comme la chute finale de Jeff. Ce sont les policiers qui freineront sa chute. La chute mortelle ne concerne que les assassins, jamais les victimes, surtout à la fin du film.
Ce drame a rapproché nos voisins. Le soldat Stanley retrouve sa danseuse, l’artiste solitaire trouve une oreille attentive…Et quelques notes discordantes arrivent. Déjà.
Mais qui a tué Harry ? (The Trouble With Harry, 1955) Quand le Meurtre vient d’en-dessous.
Ici, Hitchcock se parodie lui-même. Une campagne joyeuse du Vermont aux couleurs jaune de l’automne. Un enfant, Arnie (Jerry Mathers) joue à la guerre avec une arme en plastique. Il tombera, lors de sa ‘guerre’, sur un homme mort : Harry. Comme s’il s’agissait de sa victime. La parodie change ici la donne hitchcockienne. Elle l’inverse. La mort d’habitude fait peur. Elle a lieu sous la pluie, sous une musique angoissante et à l’étage. Là, nécessairement, tout est inversé. Aucun habitant ne semble affecté par le cadavre, au contraire, il est là, comme un rocher sur lequel on butte, on palabre. La découverte se fait par le petit garçon. Dès le début, sans aucun crescendo. Tout le monde se croit coupable, personne ne l’est. L’homme est au sol, tranquille, au raz des pâquerettes. Même les chaussettes à bout rouge nous font penser à un lapin ou à un clown. Lors de l’enterrement, les propos échangés entre l’artiste, Sam Marlowe (John Forsythe), et le vieux monsieur, le Capitaine Albert Wiles (Edmund Gwenn) sont pour le moins cocasses : « -Un coin agréable ! –D’où il verra le couchant. –Et où il sera au chaud. –Je l’envie presque ! – Il y a de la place pour deux. – Merci, mais une autre fois ! ». Les rares vues intérieures n’ont aucun escalier, et la plupart des scènes ont lieu sur les terrasses. Le ciel n’est enfin plus menaçant. Il fait bon mourir au soleil.
Mais pour le moment, il s’agit d’un accident. Seulement d’un accident. Après l’enterrement par Sam et le Capitaine, le doute survient. « –Je n’ai tiré que trois balles, une pour l’écriteau, une pour une boîte en fer … -…Et une pour Harry ! – Non ! Une pour le lapin ! Donc, je n’ai pas tué Harry ! Vous alliez me faire passer pour un assassin. Venez m’aider ! – Si vous ne l’avez pas tué, pourquoi le déterrer ? De toute façon, vous vous êtes incriminé. Expliquez-donc à la police pourquoi vous l’avez enterré sans l’avoir tué ! … – C’est un instrument contondant ! – Alors ? – Nous voilà mêlés à un meurtre ! ». La terre a transformé l’accident en crime. Le maléfice vient d’en-dessous.
Sueurs Froides (Vertigo (1958)
La plus grande des frayeurs et son cheminement vers la mort. Scottie (James Stewart) raconte à Judy-Madeleine (Kim Novak) dans l’escalier : «Je vais te parler de Madeleine. Là ! C’est là que je l’ai embrasée pour la dernière fois… J’ai entendu des pas dans l’escalier. Elle montait dans le clocher. J’ai essayé de la suivre, mais, je n’ai pas pu monter. Je n’ai pas pu aller jusqu’au bout… Madeleine, maintenant, monte ! Monte Judy ! Je te suis … Je n’ai pas pu aller plus loin, mais toi tu as continué…C’est elle qui est morte ! Sa véritable épouse. Pas toi ! Tu étais son sosie, c’est ça ? Elle était morte…Il lui avait brisé la nuque pour ne prendre aucun risque. Quand tu es arrivée, il l’a jetée, mais c’est toi qui as crié. Pourquoi as-tu crié ? L’arrêter ? Pourquoi crier, alors que tu m’avais si bien trompé ?… On va monter jusqu’au lieu du crime ».
La Mort aux trousses (North By Northwest, 1959) : Après l’escalade de la villa Vandamm, un jeu s’opère entre le haut et le bas. D’abord Roger (Cary Grant) opère l’escalade de la partie métallique. Arrivé à l’étage, il écoute les deux espions ennemis, Leonard (Martin Landau) et Philip (James Mason).
Eve (Eva Marie Saint) est montée à l’étage supérieur. Léonard a découvert la machination de Roger et du Professeur (Léo G ; Carroll) : le revoler était chargé à blanc. Eve a trahi, il faut l’éliminer. « Tout sera plus facile quand nous serons en haute altitude…et au-dessus de la mer ». Pendant la phrase, la caméra s’élève et prend de l’altitude, pour arriver au-dessus des deux têtes. Roger doit donc maintenant avertir Eve que sa vie est en danger. Il faut pour cela monter à l’étage.
Deuxième escalade, celle du mur de pierre. Arrivé à l’étage, c’est Eve qui est descendue. Pour l’avertir, Roger inscrit quelques mots sur une boîte d’allumettes et la jette de l’étage. C’est Léonard qui la ramasse et la repose dans le cendrier sans y prêter plus d’attention. Enfin, Eve lit le message. Il faut absolument qu’elle remonte. « J’ai dû oublier mes boucles d’oreilles là-haut, je reviens tout de suite. » Les voilà réunis. « Quoi qu’il arrive, ne monte surtout pas dans cet avion ! » Les trois partent. Léonard resté dans la maison est aperçu pas le reflet de l’écran de télévision. Ce retard ne fera que renforcer l’attente et accroître un peu plus l’angoisse.
Psychose (Psycho, 1960): C’est dans la maison et tout en haut de l’escalier que le détective Arbogast (Martin Balsam) se fera tuer. Viendra ensuite le couple Lila, la sœur de Marion, (Vera Miles) et Sam Loomis (John Gavin) et le dénouement avec la rencontre de la mère dans la cave. Le jeu avec les escaliers, la recherche, le croisement renforce encore la tension.
Avant, quand Norman monte voir sa mère et la sort de la chambre, la caméra s’arrête tout en bas de l’escalier.
Elle laisse monter Norman qui monte presque en dansant. Il parle à sa mère. Alors la caméra lentement opère son ascension.
Elle monte haut, au-dessus même de la porte de la chambre et va se nicher tout en haut du plafond, laissant apparent l’ensemble de l’escalier où nous pourrons voir, sans voir, Norman et sa mère, pour la première fois.
Pas de Printemps pour Marnie (Marnie, 1964): Lors du vol du coffre-fort Rutland, Hitchcock jouera avec l’escalier et la chaussure de Marnie (Tippi Hedren).
La scène du bateau est plus représentative de l’utilisation des niveaux par Hitchcock dans la montée de l’angoisse et de l’action. Après la scène où Mark Rutland (Sean Connery) dévoile Marnie, celui-ci se réveille seul dans sa chambre. Musique douce et calme. Il met sa robe de chambre et sort dans le couloir. La musique s’accélère. Il monte un étage. Dès la première marche, accélération du tempo. Son de plus en plus fort. Il regarde la mer et les remous des vagues. Il monte à nouveau un escalier.
La musique accélère encore. A nouveau un coup d’œil sur la mer. Rien. Il remonte encore une fois une rambarde. Tout au bout du couloir, il retrouve Marnie dans la piscine en train de se noyer. Descente rapide. Il saute et la sauve. In extrémis.
Le Rideau déchiré (Torn Curtain, 1966) : l’utilisation des marches et des escaliers a lieu dans les changements de décor ou lors des prises de contact avec les membres de l’organisation anti-communiste π. Ainsi le Professeur Michael Armstrong (Paul Newman), pour tromper la vigilance de son ’ange-gardien’, Herman Gromek (Wolfgang Kieling) utilise t-il le bruit des pas et les multiples escaliers dans le Musée de Berlin. La voie est libre pour rejoindre ses amis dans la campagne berlinoise.
Dans le bâtiment de l’Université des Sciences-Physiques de Berlin, le Docteur Koska (Gisela Fisher) utilise le croche-pied dans l’escalier. Jambe de femme. Croche-pied. Michael s’affale de tout son long. Il reprend connaissance dans un lit d’infirmerie. « -Je ne comprends pas pourquoi je suis tombé – Je vous ai fait un croche pied ! – Qui êtes-vous ? – Je suis le Docteur Koska. – Une femme ? – Mon mari enseignait les mathématiques. D’où le signe π pour notre organisation. Nous aidons les gens à quitter cet endroit charmant. »
Le comité scientifique – l’interrogatoire. Celui se passe dans une salle avec les tables en escalier. Les quatre ‘inquisiteurs’ sont devant lui et le responsable en chef et alter-ego de Michael, le Professeur Gustav Lindt (Ludwig Danath), trône loin, au-dessus d’eux. L’interrogatoire commence. « Première preuve de votre bonne foi : où en sont vos expériences relatives aux missiles gamma cinq ? ». Interruption. Les autorités recherchent Gromek. La tension monte. Le temps lui est compté. Il va falloir faire vite.
Le bureau de poste. La fuite est permise grâce à l’intervention de l’exubérante dame au chapeau, la comtesse Kushinska (Lila Kiedrova). C’est elle qui dans l’escalier attrape le fusil mitrailleur du policier et l’entraîne dans sa chute. Celle-ci permettra enfin la fuite de Michael et de Sarah (Julie Andrews) vers la Suède.
L’Etau (Topaz, 1969) : La scène de la mort de Juanita (Karin Dor). Son amant cubain, Rico Parra (John Vernon), après les aveux des Mandoza sous la torture, prend d’assaut l’hacienda de Juanita. Elle apparaît en haut de l’escalier. Elle descend lentement de l’escalier. Nous savons que le drame est proche. Les militaires découvrent qu’il s’agit bien du quartier général des espions. « -Donc, c’était vrai ! Je dois me faire une raison. Ainsi tu as travaillé contre nous, contre ce que nous édifions. – Parce que tu as fait de mon pays une prison – Non ! Tu ne peux pas en être juge. Pas toi ! Toi, tu n’aurais pas dû me faire ça. Me duper, lutter contre moi. –Tu es comme les autres ! – Aussi, nous allons devoir te traiter comme nous avons traité les Mandoza. Nous allons te faire avouer tous les traitres à notre cause et tout ce que tu as pu faire. Et nous y parviendrons ! Ce qu’on va affliger à ton corps, ce beau corps ! ». Il la tue. Juanita tombe. Caméra en hauteur. Sa robe violette s’étale sur tout le carrelage comme une immense tache de sang.
La mort de l’économiste Henri Jarré (Philippe Noiret). François Picard (Michel Subor), gendre d’André Devereaux (Frederick Stafford) est envoyé comme journaliste chez Henri Jarré. Il arrive dans le hall. Regarde subrepticement l’ascenseur et prend l’escalier. Un grand escalier comme les aime Hitchcock et où la caméra peut se poster haut. Ce large escalier qu’il parcourt en toute vitesse. Un drame se prépare. Discussion avec Jarré, qui découvre que François n’est pas journaliste et qu’il est découvert. Ses heures sont comptées. Deux hommes rentrent dans le bureau pendant que François téléphone à André. La communication se coupe. André et sa fille, Michèle (Claude Jade) accourent. Ils montent le même escalier magistral et trouve la porte ouverte. Par la fenêtre, Michèle aperçoit un corps gisant sur le toit d’un DS. Nous pensons qu’il s’agit du corps de François défenestré. Descente rapide de Michèle et d’André. Le corps qui gît est celui du grand commis de l’Etat travaillant pour l’OTAN, Henri Jarré.
La disgrâce de Jacques Granville (Michel Piccoli). Ouverture du grand bureau. La caméra recule. Vue d’ensemble. La caméra opère une ascension lente jusqu’au plafond. Les officiels s’écartent de Jacques. Il se retrouve seul. La caméra descend comme si elle avait trouvé sa proie. Elle s’abat tranquille sur sa victime. Elle le cadre sur le côté gauche, ce qui renforce son isolement. Il est pris. Il le sait. « Les américains préfèrent, Jacques, que vous ne soyez pas présent. Je vous expliquerai plus tard ! ». Vue suivante sur l’extérieur de la maison de Jacques. Un coup de feu. Il vient de se donner la mort.
Frenzy (1972) : Le tueur, Robert Rusk (Barry Foster), entraîne Babs Milligan (Anna Massey), l’amie de Richard Blaney (Jon Finch) : « Venez habiter chez moi, je pars pour quelques jours. Vous avez peur de moi ? – Avec les hommes, on ne sait jamais… – Vous, c’est différent, vous avez la vie devant vous… C’est là, au premier étage (Ils montent) Vous savez … Vous êtes vraiment mon type de femme ! » . La porte se referme. Retour arrière de la caméra. Silence total. Descente très lente. On entend à nouveau des pas de la rue. La caméra traverse la route. Agitation des passants et des voitures. La caméra fixe la façade de l’immeuble et le premier étage où le crime a lieu.
Avant le déroulement final, nous suivons Robert d’un côté, qui vient de s’évader de l’hôpital et l’Inspecteur Oxford (Alec McCowen) : « Je me suis souvent demandé s’il s’était jeté du haut de l’escalier pour se tuer ou pour aller à l’hôpital. Maintenant, je sais… » Retour sur Robert. Devant son immeuble. La montée de l’escalier se fera lentement encore. La mort est là qui peut encore attendre. La main gauche caresse fermement la rampe tandis que la main droite serre fiévreusement la manivelle. Le couloir et l’escalier sont plongés dans la pénombre. La mort est à nouveau là-haut, dans la chambre, dans le lit. Le véritable tueur et l’innocent inculpé se retrouvent enfin.
Complot de famille(Family Plot, 1976) : L’utilisation de l’escalier central permet de cacher Georges (Bruce Dern), le chauffeur de taxi à la recherche de sa compagne Blanche (Barbara Harris), la fausse voyante. Blanche a été kidnappée par le couple Arthur (William Devane) et Fran (Karen Black). Elle se retrouve prisonnière dans la cache du sous-sol. C’est le lieu où se retrouvent toutes les personnes kidnappées, en attente de rançon. C’est le domaine du caché, de l’oubli, de l’invisible, de l’inconscient. Au niveau supérieur, se cachent les diamants. Ils se retrouvent en plein milieu du passage. A la vue de tous, comme composants du lustre. Le vrai et le faux se mélangent. Mais le visible est aussi tout-à-fait invisible. Fran et Arthur : «- Où as-tu mis le diamant, chéri ? – Là où tout le monde peut le voir ! – Ce n’est pas vrai ? – Si, je t’assure ! – Ça ne me dit pas où tu l’as caché ». En même temps, il monte au dernier étage, lieu des désirs. « J’ai des fourmis partout…Il faudra que tu me tortures pour que j’avoue (où sont cachés les diamants) – C’est ce que je vais faire dans quelques instants ».
L’ascenseur est un lieu neutre, souvent décoratif. Il est dans la verticalité pure. L’ascension est directe, trop rapide, ne se pliant pas à la règle de progressivité lente de l’action et du suspens. Il reste une protection, une coquille. La tension vient plus de l’extérieur que de l’intérieur. Il n’est pas en soi un vecteur de destruction, mais plus souvent d’apparitions, notamment celle du réalisateur lui-même.
Dans La Mort aux trousses (North by Nortwest, 1959), l’ascenseur désinhibe l’action et le suspens. Le publicitaire Roger Thornhill (Cary Grant) se retrouve dans un ascenseur bondé avec les deux tueurs. Sa mère, Clara Thornhill lance une boutade : « alors, messieurs, vous essayez vraiment de tuer mon grand garçon ? »Un sourire forcé va finir en fou rire généralisé jusqu’à la descente de Roger qui échappera encore une fois au danger imminent. Dans l’Etau, l’ascenseur sera regardé avec mépris et l’escalier sera préféré.
M et Mme Smith (1941) : l’ascenseur suit les trépidations de notre héros, David Smith (Robert Montgomery) qui court après sa femme Anne (Claire Lombard). L’ascenseur reste léger, sans pression, juste utile pour quelques sourires et grimaces.
Même utilisation dans Champagne.
LE CIEL, L’ORAGE et LES OISEAUX. DES LARMES ET DES LAMES
Le ciel est-il toujours du bon côté ?
Un ciel chargé, un temps pluvieux, comme des larmes qui coulent sur l’écran, sont annonciateurs d’un crime à venir. La nature est rarement reposante. Elle est souvent menaçante. L’homme doit toujours se battre contre des éléments souvent impitoyables.
Junon et le Paon (Juno and the Paycock, 1930) : Dans un quartier de Dublin, le Capitaine Boyle (Edward Chapman) parle à son ami Joxer (Sidney Morgan) de son expérience maritime en ces termes : « C’était les bons vieux jours, Joxer. Rien alors n’était trop dur ou trop lourd pour moi…J’ai vu des choses, Joxer, que nul homme ne devrait mentionner s’il connaît son catéchisme ! Quand on m’attachait à la barre avec un épissoir dans la furie du vent et un océan démonté, je pensais alors que chaque minute pouvait être la dernière ! Et la mer soufflait, soufflait, s’enflait…Je regardais souvent le ciel en me posant la question : C’est quoi les étoiles ? Une fois en regardant, je me demandais aussi : C’est quoi la lune ? »
Un peu plus loin, le même rapport mer-mort : « J’ai pensé à m’acheter un petit coin près de la mer. J’aimerais que l’endroit qui a été mon berceau devienne aussi ma tombe. La mer m’appelle toujours. »
L’Homme qui en savait trop (The Man Who Knew Too Much, 1934) : La secte d’Abott (Peter Lorre) qui capture la jeune Betty Lawrence (Nova Pilbeam) sont des adorateurs du soleil. Il s’agit du Tabernacle du Soleil. Le soleil a ici l’odeur du fanatisme et de la mort. Il diffuse la couleur noire du crime et de la haine.
Secret Agent (1936) : les bombardements viennent du ciel. C’est le bombardement qui se substituera au meurtre qu’allait commettre Le ‘Général’ (Peter Loore) et qui conduira au déraillement du train. Peu après l’assassinat au sommet de la montagne : « Accident. Une coïncidence. Le ciel est toujours du bon côté ».
Sabotage (1936): Après la mort de Stevie (Desmond Tester) l’enfant dans l’explosion du bus dans le cœur de Londres à 13h45, que l’on suivait tout au long de sa dernière course par les horloges de la ville, Sylvia Verloc (Sylvia Sidney) complètement effondrée se retrouve avec les enfants à regarder un dessin animé. Nous voyons des oiseaux amoureux sur un arbre. Un autre corbeau noir arrive subrepticement avec son arc et terrasse son adversaire d’une flèche qui le blesse mortellement. Ce dernier tombe de tout son poids. Sylvia ne va pas tarder à tuer Carl Verloc (Oskar Homolka).
M et Mme Smith (1941) : La foire, les parachutes et la pluie réunis Anne Smith (Carole Lombard) et son ami (Gene Raymond), et il ne se passe rien. Petite comédie hitchcockienne, où le maître suit son sujet sans faire sentir sa patte. Dialogue ras de terre contrastant avec la panne des parachutes qui les laissent seuls toute la nuit : « -Je n’ai jamais été aussi heureuse de ma vie. C’est merveilleux ! Je me sens libre ! Ils veulent nous faire croire qu’on est en panne. Pourquoi ne font-ils rien ?…Si David éternue deux fois de suite, il se met au lit avec quatre bouillottes et du brandy et un bonnet rouge en laine sur sa tête. Dès qu’on sera descendus, on ira chez vous ! » Le maître avait certainement pris froid pendant le tournage.
Les Enchaînés (Notorious, 1946) : L’avion qui transporte Devlin (Cary Grant), Alicia (Ingrid Bergman) et leur chef (Louis Calhern) survole Rio. Une mission périlleuse attend Alicia. En attendant, elle apprend une mauvaise nouvelle : la mort de son père. « Je n’aurais jamais cru avoir tant de peine. Lorsque j’ai appris il y a quelques années ce qu’il faisait, j’ai vécu des moments affreux. J’ai souhaité passionnément sa mort ! Maintenant, je me rappelle ce qu’il a été pour moi. Il a été autrefois un bon père et je veux oublier ce qui s’est passé depuis le temps que je l’aimais. Que cette histoire finisse et qu’on en parle plus ! » Cette information a lieu dans l’avion, où le mouvement est limité. La mort de son père, engage un peu plus Alicia dans sa mission. Les visages se rapprochent, pour presque se toucher. La hauteur devient un accélérateur romantique. Les baisers entre Delvin et Alicia, se feront toujours sur des hauteurs paradisiaques. Le premier baiser, à côté d’une falaise. Temps calme et musique langoureuse. Le second et le troisième, sur un balcon de l’hôtel surplombant la plage. A chaque fois, cette petite hauteur sur un décor carte-postale, claire et aérée, ajoutera une densité par opposition à la pesanteur de la deuxième partie, à l’étage de la maison d’Alexander Sebastan (Claude Rains).
La Corde (The Rope, 1948) Le plus intérieur des films d’Hitchcock et où logiquement le ciel ne devrait pas apparaître. Et pourtant, il apparaît aux deux moments capitaux du film. La mise à mort et le dénouement.
La caméra de quitte pas l’intérieur de l’appartement où Brandon Shaw (John Dall) et Philip Morgan (Farley Granger) commettent leur crime. Leur camarade David Kentley (Dick Hogan) se retrouve étrangler sous nos yeux complices. Pourtant, le générique s’ouvre d’abord sur la rue, en pleine lumière. La caméra braque une maison ordinaire de New York, comme accroché dans le ciel. Nous attendons. La caméra vise. Le crime, c’est certain, se passera là-bas. Mouvement circulaire, léger. Nous nous retrouvons sur le balcon d’en face. En réalité, nous sommes au plus près du crime et des criminels. Juste un rideau. Juste un cri. Le temps est compté. «-Il faut vérifier si… – Pas tout de suite, attends une minute. Philip, on n’a pas beaucoup de temps. C’est l’obscurité qui joue sur tes nerfs. Personne n’aime le noir. » Brandon tire les rideaux. Nous apercevons le ciel de la ville, remplit de gratte-ciels.
A la fin du film, Rupert Cadell (James Stewart) aura découvert le corps par les propos et les incohérences surtout celle de Philip, tout-à-fait bouleversé et au bord de la crise de nerfs. Rupert, en possession de l’arme de Brandon, ouvrira enfin une fenêtre et tirera 3 coups de feu dans le ciel de New-York, comme pour extérioriser toute sa colère. Comme s’il venait de perdre trois de ces élèves ? Vient aussi pour lui le temps de sa responsabilité.
Les amants du Capricorne (Under Capricorne, 1949): Le domaine de Charles (Joseph Cotten), le Minyago Yugilla, « Pourquoi pleures-tu ? » sert de respiration au récit. Il a toujours une couleur qui annonce la suite du récit. Un bleu sombre, la première fois qui s’oppose à la blancheur de la maison blanche du gouverneur ou à celle de la Banque. Le ciel montre la tension déjà qui règne au cœur même du domaine et anticipe l’action à venir. Le ciel lourd, les orages et les éclairs annonceront ainsi les luttes internes.
La Mort aux trousses (North by Northwest, 1959) : Le générique se passe sur la paroi entièrement vitrée d’un gratte-ciel de New-York. Affairement et grouillement. Qui sera choisi dans cette multitude. La voix qui sort de l’ascenseur sera celle là, celle du publicitaire débordé Roger Thornhill (Cary Grant). Ce qui va lui arriver va bientôt le submerger.
Une des scènes les plus connues, la rencontre en pleine campagne avec l’agent fantôme Kaplan. Paysage immense et plat. Roger est sur la gauche de l’écran. Effet de solitude renforcé. Au fond, un champ de maïs à peine perceptible et ne cassant pas la monotonie. Une première voiture que suit un nuage de poussière. Fausse alerte. Une autre voiture passe en trombe avec une tempête de poussière. Dans le champ, en face, une voiture arrive. Elle s’arrête et laisse sortir un homme. C’est certainement lui. La voiture repart. Ils sont face à face. L’ouverture de la veste de Roger, fait penser à un duel à venir entre deux cow-boys. Il traverse et s’approche. Ce n’est pas Kaplan. Celui-ci prend le bus. A nouveau seul. Mais le bruit de l’avion et les propos du paysan sur le traitement des récoltes l’interpellent. L’avion s’approche. La course commence et les tirs aussi. Il se réfugie dans un champ de maïs, aussitôt pulvérisé par un insecticide irrespirable. Enfin, un camion arrive. En tentant de l’arrêter, il risque de se faire écraser et se retrouve dessous. L’avion qui continue sa course s’écrase dans la cuve inflammable et explose. Le tueur, encore une fois est sa propre victime.
Dans Psychose (Psycho, 1960), le film s’ouvre sur une vue générale de Phoenix Arizona. La caméra est lente qui part de la gauche et va sur la droite. Nous surplombons la ville. Puis, la caméra zoome sur une série d’immeuble. Elle semble chercher. Elle part légèrement sur la gauche. Un immeuble est choisi. La caméra avance et pénètre sous le store dans le noir de la chambre. Nous trouvons Marion Crane (Janet Leigh) dévêtue, sur son lit. Ce n’est pas une caméra, mais un oiseau de proie qui a choisi sa prochaine victime.
Il pleut quand Marion trouve le motel sur la route au milieu de la nuit. La pluie, comme l’eau de la douche, est annonciatrice du drame proche. Deux lumières, tels deux yeux énormes, sont visibles dans la maison au-dessus du motel Bates, dans la nuit. La maison par sa hauteur et sa monstruosité domine par le motel et tout le paysage.
Les oiseaux empaillés, morts-vivants, entourent Marion lors de sa discussion avec Norman Bates (Antony Perkins). Il s’agit essentiellement d’oiseaux de proie. Au milieu, Marion, fragile comme un moineau dans le nid de l’aigle. « Vous mangez comme un oiseau – Vous en savez quelque chose. – Pas vraiment. Mais l’expression ‘manger comme un moineau’ est vraiment mensongère. Parce que les moineaux mangent vraiment beaucoup…Pour moi, seuls les oiseaux ont l’air bien, parce qu’ils sont passifs de leur vivant…C’est plus qu’un passe-temps. Ce n’est pas pour passer le temps, c’est pour le remplir…Les gens ne réussissent jamais à fuir, nous sommes tous prisonniers, pris au piège et nous n’arrivons pas à en sortir ».
Tous les crimes auront lieu à partir de la maison. Même celui de Marion qui se passe sous la douche du motel Bates. Norman, avant de l’assassiner au couteau, remonte dans la maison pour se changer et changer de personnalité. En redescendant sur le motel, il foudroiera sa proie. Le couteau ne pénètre pas d’un coup. Le couteau se plante comme s’il s’agissait de griffes ou de coup de bec. La proie après l’attaque n’est pas encore morte. Elle est laissée à son propre sort, à se vider seule en attendant la mort.
Les Oiseaux (The Birds, 1963) : les oiseaux se battent tels des avions d’attaque sur leurs ennemis, les humains, cloués au sol. La violence des attaques aériennes fait contraste avec le côté placide des oiseaux quand ceux-ci sont autour de la maison sur la terre. Ils sont toujours agressifs, mais ils ne tuent plus.
Pas de printemps pour Marnie (Marnie, 1964) : Scène de la chasse à courre, où Marnie (Tippi Hedren) part dans un galop effréné, affolée par les gilets rouges des chasseurs, suivie par Lili (Diane Baker). Hitchcock annonce l’accident de Marnie et la mort du cheval par une montée fulgurante dans le ciel, où tout semble s’immobiliser, puis va sur les pattes du cheval en plein galop avec un gros plan. Nous sommes embarqués par l’accélération foudroyante. Nous savons que plus rien ne pourra l’arrêter.
L’orage, par deux fois, joue un rôle clé. La première fois, dans le bureau de Mark (Sean Connery) où Marnie, affolée par l’orage, se laissera embrasser, pétrifiée par la peur. Ensuite, lors de la rencontre finale avec la mère de Marnie (Louise Latham). Elle découvrira enfin l’origine de son traumatisme, où enfant, elle va tuer le marin qui lutte avec sa mère. « Tu ne vas pas pleurer pour un petit orage ! »
Le Rideau déchiré (Torn Curtain, 1966) : Le générique passe dans un étrange brouillard où défilent les protagonistes contrits, souffrants, apeurés, voire haineux. D’emblée le ton est donné.
Dans l’avion qui l’emmène à Berlin-Est, le professeur Michael Armstrong (Paul Newman) s’aperçoit que son amie, le docteur Sarah Sherman (Julie Andrews), au fond de l’appareil, n’a pas été dupe et l’a suivi contre son gré. Le regard froid qu’il lui lance et ses propos ne font rien pour briser la glace. « Que fais-tu ici ? Ne reste pas avec moi. Ne me parle pas ! Reprends le premier avion ! Rentre en Amérique ! Compris ? ». Elle pleure. Brouillard. Ouverture de la porte. Vision froide de l’entrée de l’aéroport de Berlin-Est. Caméra au-dessus de l’escalier d’embarquement. Elle reste en haut de l’escalier, avec Sarah totalement désespérée. La séparation est consommée. Elle n’entamera sa descente qu’une fois le discours de bienvenue terminé et le départ de Michael.
Enfin, la scène du débarquement en Suède des valises où sont cachés Michael et Sarah sur le quai. La ballerine allemande (Tamara Toumanova), toujours écartée mais toujours présente tout au long du film, s’aperçoit que le passeur parle aux paniers d’osier. Ceux-ci sont en l’air, au-dessus de la mer, tenus par le filin d’une grue. Ils sont à deux doigts de la liberté, mais aussi très près de la mort. « Ces paniers contiennent des passagers clandestins ! Des espions ! Armstrong et son assistante ! Ramenez ces paniers ! Vite ! Tirez sur ces paniers ! Ramenez-les ! ». Mais les bons ne chutent jamais et ne meurent jamais. Pas si près du but.
Frenzy (1972): L’ouverture du film se fait du ciel. On survole Londres. Lente descente oblique. Musique gaie. Nous arrivons sur la Tamise. Tower Bridge s’ouvre à nous. Nous allons vers un attroupement lors d’un discours officiel sur des promesses d’une Tamise plus propre. Le corps nu d’une femme étranglée par une cravate flotte. Les gens n’écoutent plus les palabres politiques. La mort les attire. Les pas de Jack l’Eventreur ne sont pas si loin.
.Le toit d’une maison, le sommet d’une tour ou le clocher d’une église
Le toit d’un bâtiment est le refuge ultime de l’assassin ou du coupable en fuite, il représente l’action poussée à son paroxysme. La mort rode toujours dans les parages.
Chantage (Blackmail, 1929) : La scène de la poursuite finale a lieu sur le toit du British Museum de Londres. Le maître chanteur Tracy (Donald Calthrop) est poursuivi par trois policiers. Après avoir monté plusieurs escaliers, le voilà au stade ultime, le dôme. Il ne peut plus aller plus loin. Il n’est pas coupable du crime, juste maître-chanteur. La situation qu’il maîtrisait, lui échappe maintenant. Il recule, crie son innocence. « Ce n’est pas moi que vous voulez ! C’est lui ! » Il montre l’Inspecteur Franck Weber (John Longden). C’est trop tard. Il recule. Le toit en verre s’effondre sous son poids.
L’Homme qui en savait trop (The Man Who Knew Too Much, 1934) : La fille, Betty Lawrence (Nova Pilbeam), qui a été enlevée à Saint-Moritz, a réussi à s’évader grâce à son père, Bob Lawrence (Leslie Banks). La maison est entourée de policiers armés. La fusillade a déjà fait plusieurs victimes. Le gang de la secte est décimé. Pourtant, leur meilleur tireur (Franck Vosper) est encore là et la poursuit. Visible de tous les tireurs et pourtant inatteignable, malgré les ordres : « – descendez-le ! – Impossible, je tuerai l’enfant ! ». Un coup de feu pourtant partira. Net et définitif. C’est sa mère, Jill Lawrence (Edna Best). Le corps du criminel tombe. Justice est faite.
Secret Agent (1936): juste après leur arrivée dans la montagne, la découverte du premier meurtre. Le ‘Général’ (Peter Lorre) et l’agent secret Ascenden (John Gielgud) se réfugient en haut du clocher et le mort est vu d’en haut avec une vue plongeante.
Correspondant 17 (1940): Le soi-disant garde du corps veut tuer Johnny Jones (Joel Mc Crea) en haut d’une tour alors qu’il lui demande d’admirer les beautés de Londres, tout en ayant un œil sur l’ascenseur qui descend avec les derniers visiteurs.
Dans la Maison du Docteur Edwardes (1945): le rêve fait par Grégory Peck : « Après, il était sur un toit en pente en haut d’une grande maison ; c’était l’homme à la barbe. Je lui ai crié de faire attention, alors il a passé par-dessus bord, lentement, sans que ses pieds touchent par terre. Ensuite, j’ai rêvé que le propriétaire, celui qui était maqué, se cachait derrière une grande cheminée, une roue à la main. Il a laissé tomber la roue. Tout d’un coup, je courais, j’ai entendu des battements sur le toit au-dessus de ma tête. Il y avait une paire de grandes ailes, les ailes me poursuivaient et elles m’ont rattrapé quand je suis arrivé en bas de la descente. »
Vertigo – Sueurs Froides (1958) : John Fergusson (James Stewart) dans la poursuite d’ouverture du film sur les toits de San Francisco annonce déjà le drame à venir. Ce n’est pas lui, héros du film, ni le truand (le ‘mal’ est très rarement victime des hauteurs), mais un flic qui cherche justement à l’aider. Suit la discussion avec son amie (Barbara Bel Geddes) : « La nuit, je revois cet homme qui tombe du toit. J’essaie de le rattraper et… – Ce n’est pas ta faute ! – C’est ce que tout le monde me dit. Je souffre d’acrophobie, ce qui me donne le vertige. M’en être aperçu à un tel moment ! – Seul un autre choc pourrait t’en débarrasser – Tu ne vas pas replonger d’un toit pour le savoir ! »
C’est sur le toit du monastère que Madeleine-Judy (Kim Novak) finira après s’être jetée par l’ouverture du clocher après la chute de la véritable épouse de Gavin Elster (Tom Helmore).
- Entre toit et montagne : le château de Manderley (Rebecca)
Le Château de Manderley nous apparaît pour la première fois dans la nuit, sous un clair de lune. Le château a tout d’une vieille montagne décharnée. Nous savons déjà que ce sera le lieu du drame. Hitchcock nous montre son côté naturellement sauvage après l’incendie. « La nature avait repris ses droits, s’imposant petit à petit au chemin avec ses longs doigts fermes. Inlassablement se déroulait ce filet de terre, autrefois notre allée. Enfin, apparut Manderley. Mystérieux et silencieux. Le temps n’avait pu altérer la symétrie parfaite de ces murs…Je ne voyais plus qu’une coquille vide. Aucun murmure ne s’échappait de ces murs ».
- La montagne et la falaise
La montagne décharnée est le lieu où se manifeste la violence des passions et des règlements de compte à l’abri des regards indiscrets.
L’Homme qui en savait trop (The Man Who Knew Too Much, 1934) : Le générique s’ouvre sur des prospectus de la Suisse, pour des vacances à la montagne. La dernière sera la bonne : « Saint Moritz – Partez en vacances en Suisse ». Le crime aura donc lieu dans les hauteurs enneigées. Nous nous retrouvons pendant une épreuve de descente de ski. La caméra tout en haut de la piste. Vue des spectateurs. Le skieur est parti, il s’agit de Louis Bernard (Pierre Fresnay). Un chien s’échappe de la surveillance d’un spectateur et se retrouve en plein milieu. La fille court pour le récupérer. Peur de Bernard qui s’affale sur la piste aux pieds des autres spectateurs. Bernard l’a échappé belle, pas pour longtemps. La montagne est souvent meurtrière.
Une scène de danse, comme souvent chez Hitchcock. Une détente avant la détente. Le coup part de la montagne. D’en haut. Louis Bernard ne ressent rien. Dans un premier temps. Une trace rouge sous sa veste. Il s’écroule. « Un impact de balle ! Elle a été tirée de l’extérieur ! »
Les 39 marches (1935): Richard Hannay (Robert Donat) cherchant à échapper aux policiers dans la montagne écossaise. Il se retrouve seul au milieu d’une montagne décharnée. Hitchcock peut ainsi varier les rythmes dans la poursuite et la rendre haletante. Montée lente. Encerclement des forces de l’ordre. Accélération rapide dans la descente, presque burlesque. Traversée lente et périlleuse du torrent. Nouvelle accélération après le pont où la pancarte indique ‘Alt-na Shellach’. Puis la descente jusqu’à se retrouver dans la gueule du loup, dans la maison du professeur Jordan (Godfrey Tearle).
Secret Agent (1936): Le Général (Peter Lorre) se fait un plaisir de tuer celui qu’il pense être l’espion allemand tout au sommet de la montagne, en le poussant dans le vide.
Jeune et innocent (1937): le film s’ouvre sur la dispute d’un couple. Le mari s’écarte et se retrouve au-dessus de la mer en furie et sous la pluie. La scène suivante montre la femme morte, ramenée par les flots sur la plage. Le jeune Robert Tisdall (Derick de Marney) qui la découvre du haut des rochers est aussitôt soupçonné :« J’ai vu le corps de la falaise. Je suis descendu mais je ne savais pas si elle était morte ou inconsciente ».
La Taverne de la Jamaïque (Jamaica Inn, 1939) Le Ciel, la mer et la mort. Un long message se déroule afin d’informer le spectateur : « ‘Seigneur, nous te prions, non afin que tes naufrages surviennent, mais afin que tu les guides près des côtes de Cornouailles au bénéfice de ses habitants qui sont dans la misère’. Ainsi se formulait une vieille prière cornouaillaise du début du XIXème siècle. Mais dans cette région sans loi de l’Angleterre, avant que les brigades des Grandes Côtes ne soient instaurées, il existait des gangs qui, en vertu du pillage, provoquaient délibérément des naufrages, entraînant les vaisseaux vers leur perte sur les cruels récifs des sauvages côtes de Cornouailles ». Le texte se déroule près de récifs sous une mer démontée. A l’arrivée du bateau pris dans les rochers, une bande de pillards descend de la colline et achève au couteau les derniers rescapés. « Emportez tout ça vers les collines ! Retournez aux collines ! ». Les pillards s’en vont. La caméra reste là, qui filme le ciel nuageux avec une légère éclaircie. Le rayon de lumière dans cette Cornouailles terrifiante sera la jeune Mary Yellard (Maureen O’Hara) venue rejoindre sa tante Patiente (Marie Ney), elle-même mariée avec le terrible chef des pillards de la mer Joss Merlyn (Leslie Banks).
Plus tard Mary se retrouvera avec James Trehearne (Robert Newton) poursuivis, par la bande à la solde de Joss, au fon d’une grotte près de la mer. Les pillards seront au-dessus et eux deux au niveau de la mer. Le niveau le plus bas : les victimes, et au-dessus : les criminels. Malheureusement, ils perdent le canot qui s’en va dans la mer. Les voilà à la merci des tueurs. La discussion entre James et Mary, qui pour le moment ne s’aiment pas encore : « Regardez ! La marée descend et il fera nuit quand elle remontera. On ne peut pas rester ici sans la barque. Il va falloir courir. Faites confiance à une femme ! Ça oui, vous m’avez sauvé la vie ! – J’espère que vous en ferez autre chose à l’avenir –Peine perdue pour un type comme moi ! Un contrebandier et un traître. En effet, y-a-t-il de l’espoir ? »
Dans le pillage final, Mary est prisonnière et regarde impuissante les préparatifs. Elle arrive néanmoins à échapper à la vigilance de son gardien. Elle remonte la colline, là où la lanterne doit être montée et servir pour tromper le bateau. Survient la bataille inégale que Mary entame avec l’un d’entre eux. Le bandit, déséquilibré, tombe de la falaise. Le mal désarçonné.
Rebecca (1940): C’est du haut d’une falaise à Monte-Carlo que Maximilien, regardant la mer démontée, est prêt à se jeter dans le vide. Là se fera la première rencontre avec sa future femme (Joan Fontaine) : «- Non ! Arrêtez ! – Qu’est-ce que vous avez à crier ? – Je ne voulais pas être impolie, mais, j’ai cru…-Continuez votre balade. Ne restez pas là à crier ! »
M et Mme Smith (1941) : en tant que comédie, tout est inversé. La montagne devient prétexte à David Smith (Robert Montgomery) pour récupérer sa femme Anne (Carole Lombard) des bras de son ami (Gene Raymond). Presque toute l’action se passe à l’intérieur du chalet.
Dans la Maison du Docteur Edwardes (1945): « C’est le blanc qui lui fait peur, la neige et ses traces…Les traces de ski sur la neige, l’horreur qu’elles lui inspirent…Le toit en pente, le versant d’une montagne »
Vertigo (1958): Quand Madeleine (Kim Novak) se jette à côté du Pont de San Francisco. Elle se jette sans hauteur. Sans chute réelle. John-Scottie (James Stewart) n’aura aucun mal à la récupérer et à rentrer dans la machination de son ancien camarade de collège Gavin Elster (Tom Helmore). L’absence de chute montre la volonté de tromper Scottie et de maquiller un suicide.
Mort aux trousses (1959) : Après avoir été forcé de boire, Roger (Cary Grant) se retrouve ivre dans sa voiture. Nous sommes sur le bord escarpé de la mer. La route est sinueuse. La voiture démarre et Roger a le réflexe de jeter dehors l’espion qui cherche à le tuer. Nous sommes partis pour une course entre le vide et les feintes. Les voitures se frôlent et les pneus crissent. La voiture ne s’arrêtera qu’une fois en plaine, et Roger sera ‘protégé’ pour un temps.
La poursuite sur le Mont Rushmore. Après avoir réussi à prendre la statuette et à échapper à Léonard (Martin Landau) et à Philip Vandamm (James Mason), Roger (Cary Grant) et Eve (Eva Marie Saint) se retrouvent arrêtés par un portail massif. Une seule alternative : la forêt. Un seul côté pour fuir. « -Pas de ce côté-là ! C’est le monument ! – Qu’est ce qu’on va faire ? – Descendre. Ils arrivent ! Nous n’avons pas le choix ». La situation même périlleuse, n’empêche pas l’humour. « Si par miracle nous en réchappons, je te ramènerai à New-York en wagon-lit, chérie ! Tu es d’accord ? ». Le bilan sera lourd. Mais encore une fois, ce sont les deux ennemis, Léonard et Philip qui en seront les victimes.
Complot de famille (1976) : Arrivée en montagne. Nous savons déjà qu’un drame se prépare. Blanche (Barbara Harris) et Georges (Bruce Dern) s’arrêtent prendre un café sur la route. Le tueur (Ed Lauter) à la solde d’Arthur (William Devane) et de Fran (Karen Black) coupe le câble de liquide de freins pendant la pause. « – Pourquoi tu fonces comme ça, Georges ? Y a pas le feu ! Ralentis un peu ! Ralentis, tu entends ! Tu veux nous tuer ? – Je ne sais pas ce qui se passe. C’est l’accélérateur qui est coincé ! Pour l’amour de Dieu, Georges, ne fais pas l’imbécile. Ralentis ! ». L’accident sera évité de justesse. Passe le tueur qui se propose de les prendre dans sa voiture. Refus. Il part, fait demi-tour et revient pour les écraser. Manque de chance, une voiture arrive en face. La voiture du tueur saute dans le vide et explose. L’arroseur arrosé.
- LA LENTE MONTEE ET LA FULGURANCE DE LA CHUTE
La montée de l’escalier, de la montagne ou la traversée d’un toit s’avèrent toujours périlleux. A chaque moment la chute est possible. Plus la pente est raide, plus la respiration devient haletante et profonde, plus les temps d’arrêt sont nombreux et longs. C’est dans cet espace que le suspense peut s’installer au mieux. Il est dans son élément. Chaque détail devient important quand chaque pas peut entraîner la chute. Plus il y a de hauteur, plus l’irrémédiable est au rendez-vous.
Ensuite la montée oblige la caméra à se désaxer, à ne plus être à hauteur du sujet. De par sa position, parfois elle le domine, parfois elle renforce l’ombre et le transforme. En tout cas, la réalité du moment est nécessairement autre, étirée ou ramassée.
Enfin, la véritable chute fait souvent bon ménage. Les bons ont le plus souvent des chutes déguisées ou salvatrices (cf. Le Rideau déchiré). Elle envoie par contre vers la mort les criminels, les nazis, les espions à la solde de l’ennemi. Sans aucun espoir de retour. La chute est avant tout morale.
« Montagne des grands abusés, Au sommet de vos tours fiévreuses Faiblit la dernière clarté. Rien que le vide et l’avalanche, La détresse et le regret ». (René Char, Les Matinaux, Pyrénées)
Jacky Lavauzelle