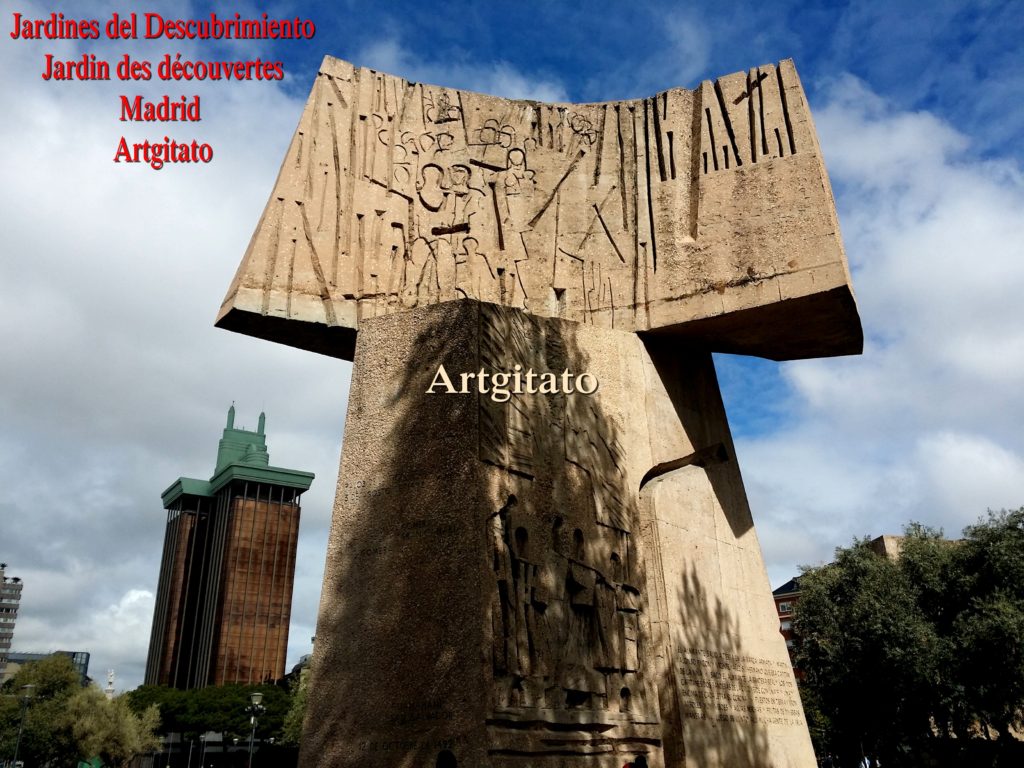Madrid – Мадрид – 马德里
戈雅普拉多博物馆雕像
Francisco Goya Museo del Prado
Francisco Goya Madrid
——
Photo Jacky Lavauzelle
*
FRANCISCO GOYA MADRID
Statue de Francisco Goya devant le Musée du Prado
Estatua de Francisco Goya Museo del Prado
Statue of painter Francisco Goya, Museo del Prado
Статуя Франсиско Гойи Музей Прадо
戈雅普拉多博物馆雕像
FRANCISCO GOYA MADRID 
FRANCISCO GOYA MADRID 


FRANCISCO GOYA MADRID 

FRANCISCO GOYA MADRID 
FRANCISCO GOYA MADRID 
FRANCISCO GOYA MADRID 
GOYA VU PAR THEOPHILE GAUTIER
« Francisco Goya y Lucientes est le petit-fils encore reconnaissable de Vélasquez, Après lui viennent les Aparico, les Lopez ; la décadence est complète, le cycle de l’art est fermé. Qui le rouvrira ?C’est un étrange peintre, un singulier génie que Goya ! Jamais originalité ne fut plus tranchée, jamais artiste espagnol ne fut plus local. ― Un croquis de Goya, quatre coups de pointe dans un nuage d’aqua-tinta en disent plus sur les mœurs du pays que les plus longues descriptions. Par son existence aventureuse, par sa fougue, par ses talents multiples, Goya semble appartenir aux belles époques de l’art, et cependant, c’est en quelque sorte un contemporain : il est mort à Bordeaux en 1828.
Avant d’arriver à l’appréciation de son œuvre, esquissons sommairement sa biographie. Don Francisco Goya y Lucientes naquit en Aragon de parents dans une position de fortune médiocre, mais cependant suffisante pour ne pas entraver ses dispositions naturelles. Son goût pour le dessin et la peinture se développa de bonne heure. Il voyagea, étudia à Rome quelque temps, et revint en Espagne, où il fit une fortune rapide à la cour de Charles IV, qui lui accorda le titre de peintre du roi. Il était reçu chez la reine, chez le prince de Benavente et la duchesse d’Albe, et menait cette existence de grand seigneur des Rubens, des Van Dick et des Vélasquez, si favorable à l’épanouissement du génie pittoresque. Il avait, près de Madrid, une casa de campo délicieuse, où il donnait des fêtes et où il avait son atelier.
Goya a beaucoup produit ; il a fait des sujets de sainteté, des fresques, des portraits, des scènes de mœurs, des eaux-fortes, des aqua-tinta, des lithographies, et partout, même dans les plus vagues ébauches, il a laissé l’empreinte d’un talent vigoureux ; la griffe du lion raie toujours ses dessins les plus abandonnés. Son talent, quoique parfaitement original, est un singulier mélange de Vélasquez, de Rembrandt et de Reynolds ; il rappelle tour à tour ou en même temps ces trois maîtres, mais comme le fils rappelle ses aïeux, sans imitation servile, ou plutôt par une disposition congéniale que par une volonté formelle.
On voit de lui, au musée de Madrid, le portrait de Charles IV et de la reine à cheval : les têtes sont merveilleusement peintes, pleines de vie, de finesse et d’esprit ; un Picador et le Massacre du 2 mai, scène d’invasion. Le duc d’Ossuna possède plusieurs tableaux de Goya, et il n’est guère de grande maison qui n’ait de lui quelque portrait ou quelque esquisse. L’intérieur de l’église de San-Antonio de la Florida, où se tient une fête assez fréquentée, à une demi-lieue de Madrid, est peint à fresque par Goya avec cette liberté, cette audace et cet effet qui le caractérisent. À Tolède, dans une des salles capitulaires, nous avons vu de lui un tableau représentant Jésus livré par Judas, effet de nuit que n’eût pas désavoué Rembrandt, à qui je l’eusse attribué d’abord, si un chanoine ne m’eût fait voir la signature du peintre émérite de Charles IV. Dans la sacristie de la cathédrale de Séville, il existe aussi un tableau de Goya, d’un grand mérite, sainte Justine et sainte Ruffine, vierges et martyres, toutes deux filles d’un potier de terre, comme l’indiquent les alcarazas et les cantaros groupés à leurs pieds.
La manière de peindre de Goya était aussi excentrique que son talent : il puisait la couleur dans des baquets, l’appliquait avec des éponges, des balais, des torchons, et tout ce qui lui tombait sous la main, il truellait et maçonnait ses tons comme du mortier, et donnait les touches de sentiment à grands coups de pouce. À l’aide de ces procédés expéditifs et péremptoires, il couvrait en un ou deux jours une trentaine de pieds de muraille. Tout ceci nous paraît dépasser un peu les bornes de la fougue et de l’entrain ; les artistes les plus emportés sont des lécheurs en comparaison. Il exécuta, avec une cuiller en guise de brosse, une scène du Dos de Mayo, où l’on voit des Français qui fusillent des Espagnols. C’est une œuvre d’une verve et d’une furie incroyables. Cette curieuse peinture est reléguée sans honneur dans l’antichambre du musée de Madrid.
L’individualité de cet artiste est si forte et si tranchée, qu’il nous est difficile d’en donner une idée même approximative. Ce n’est pas un caricaturiste comme Hogarth, Bamburry ou Cruishanck : Hogarth, sérieux, flegmatique, exact et minutieux comme un roman de Richardson, laissant toujours voir l’intention morale ; Bamburry et Cruishank si remarquables pour leur verve maligne, leur exagération bouffonne, n’ont rien de commun avec l’auteur des Caprichos. Callot s’en rapprocherait plus, Callot, moitié Espagnol, moitié Bohémien ; mais Callot est net, clair, fin, précis, fidèle au vrai, malgré le maniéré de ses tournures et l’extravagance fanfaronne de ses ajustements ; ses diableries les plus singulières sont rigoureusement possibles ; il fait grand jour dans ses eaux-fortes, où la recherche des détails empêche l’effet et le clair-obscur, qui ne s’obtiennent que par des sacrifices. Les compositions de Goya sont des nuits profondes où quelque brusque rayon de lumière ébauche de pâles silhouettes et d’étranges fantômes.
C’est un composé de Rembrandt, de Watteau et des songes drolatiques de Rabelais ; singulier mélange ! Ajoutez à cela une haute saveur espagnole, une forte dose de l’esprit picaresque de Cervantès, quand il fait le portrait de la Escalanta et de la Gananciosa, dans Rinconete et Cortadillo, et vous n’aurez encore qu’une très imparfaite idée du talent de Goya. Nous allons tâcher de le faire comprendre, si toutefois cela est possible, avec des mots.
Les dessins de Goya sont exécutés à l’aqua-tinta, repiqués et ravivés d’eau-forte ; rien n’est plus franc, plus libre et plus facile, un trait indique toute une physionomie, une traînée d’ombre tient lieu de fond, ou laisse deviner de sombres paysages à demi-ébauchés ; des gorges de sierra, théâtres tout préparés pour un meurtre, pour un sabbat ou une tertulia de Bohémiens ; mais cela est rare, car le fond n’existe pas chez Goya. Comme Michel-Ange, il dédaigne complètement la nature extérieure, et n’en prend tout juste que ce qu’il faut pour poser des figures, et encore en met-il beaucoup dans les nuages. De temps en temps, un pan de mur coupé par un grand angle d’ombre, une noire arcade de prison, une charmille à peine indiquée ; voilà tout. Nous avons dit que Goya était un caricaturiste, faute d’un mot plus juste. C’est de la caricature dans le genre d’Hoffmann, où la fantaisie se mêle toujours à la critique, et qui va souvent jusqu’au lugubre et au terrible ; on dirait que toutes ces têtes grimaçantes ont été dessinées par la griffe de Smarra sur le mur d’une alcôve suspecte, aux lueurs intermittentes d’une veilleuse à l’agonie. On se sent transporté dans un monde inouï, impossible et cependant réel. ― Les troncs d’arbre ont l’air de fantômes, les hommes d’hyènes, de hiboux, de chats, d’ânes ou d’hippopotames ; les ongles sont peut-être des serres, les souliers à bouffettes chaussent des pieds de bouc ; ce jeune cavalier est un vieux mort, et ses chausses enrubannées enveloppent un fémur décharné et deux maigres tibias ; ― jamais il ne sortit de derrière le poêle du docteur Faust des apparitions plus mystérieusement sinistres.
Les caricatures de Goya renferment, dit-on, quelques allusions politiques, mais en petit nombre ; elles ont rapport à Godoï, à la vieille duchesse de Benavente, aux favoris de la reine, et à quelques seigneurs de la cour, dont elles stigmatisent l’ignorance ou les vices. Mais il faut bien les chercher à travers le voile épais qui les obombre. ― Goya a encore fait d’autres dessins pour la duchesse d’Albe, son amie, qui n’ont point paru, sans doute à cause de la facilité de l’application. ― Quelques-uns ont trait au fanatisme, à la gourmandise et à la stupidité des moines, les autres représentent des sujets de mœurs ou de sorcellerie.
Le portrait de Goya sert de frontispice au recueil de son œuvre. C’est un homme de cinquante ans environ, l’œil oblique et fin, recouvert d’une large paupière avec une patte-d’oie maligne et moqueuse, le menton recourbé en sabot, la lèvre supérieure mince, l’inférieure proéminente et sensuelle ; le tout encadré dans des favoris méridionaux et surmonté d’un chapeau à la Bolivar ; une physionomie caractérisée et puissante.
La première planche représente un mariage d’argent, une pauvre fille sacrifiée à un vieillard cacochyme et monstrueux par des parents avides. La mariée est charmante avec son petit loup de velours noir et sa basquine à grandes franges, car Goya rend à merveille la grâce andalouse et castillane ; les parents sont hideux de rapacité et de misère envieuse. Ils ont des airs de requin et de crocodile inimaginables ; l’enfant sourit dans des larmes, comme une pluie du mois d’avril, ce ne sont que des yeux, des griffes et des dents ; l’enivrement de la parure empêche la jeune fille de sentir encore toute l’étendue de son malheur. ― Ce thème revient souvent au bout du crayon de Goya, et il sait toujours en tirer des effets piquants. Plus loin, c’est el coco, croque-mitaine, qui vient effrayer les petits enfants et qui en effraierait bien d’autres, car, après l’ombre de Samuel dans le tableau de la Pythonisse d’Endor, par Salvator Rosa, nous ne connaissons rien de plus terrible que cet épouvantail. Ensuite ce sont des majos qui courtisent des fringantes sur le Prado ; ― de belles filles au bas de soie bien tiré, avec de petites mules à talon pointu qui ne tiennent au pied que par l’ongle de l’orteil, avec des peignes d’écaille à galerie, découpés à jour et plus hauts que la couronne murale de Cybèle ; des mantilles de dentelles noires disposées en capuchon et jetant leur ombre veloutée sur les plus beaux yeux noirs du monde, des basquines plombées pour mieux faire ressortir l’opulence des hanches, des mouches posées en assassines au coin de la bouche et près de la tempe ; des accroche-cœurs à suspendre les amours de toutes les Espagnes, et de larges éventails épanouis en queue de paon ; ce sont des hidalgos en escarpins, en frac prodigieux, avec le chapeau demi-lune sous le bras et des grappes de breloques sur le ventre, faisant des révérences à trois temps, se penchant au dos des chaises pour souffler, comme une fumée de cigare, quelque folle bouffée de madrigaux dans une belle touffe de cheveux noirs, ou promenant par le bout de son gant blanc quelque divinité plus ou moins suspecte ; ― puis des mères utiles, donnant à leurs filles trop obéissantes les conseils de la Macette de Régnier, les lavant et les graissant pour aller au sabbat. ― Le type de la mère utile est merveilleusement bien rendu par Goya, qui a, comme tous les peintres espagnols, un vif et profond sentiment de l’ignoble ; on ne saurait imaginer rien de plus grotesquement horrible, de plus vicieusement difforme ; chacune de ces mégères réunit à elle seule la laideur des sept péchés capitaux ; le diable est joli à côté de cela. Imaginez des fossés et des contrescarpes de rides ; des yeux comme des charbons éteints dans du sang ; des nez en flûte d’alambic, tout bubelés de verrues et de fleurettes ; des mufles d’hippopotame hérissés de crins roides, des moustaches de tigre, des bouches en tirelire contractées par d’affreux ricanements, quelque chose qui tient de l’araignée et du cloporte, et qui vous fait éprouver le même dégoût que lorsqu’on met le pied sur le ventre mou d’un crapaud. ― Voilà pour le côté réel ; mais c’est lorsqu’il s’abandonne à sa verve démonographique que Goya est surtout admirable ; personne ne sait aussi bien que lui faire rouler dans la chaude atmosphère d’une nuit d’orage de gros nuages noirs chargés de vampires, de stryges, de démons, et découper une cavalcade de sorcières sur une bande d’horizons sinistres.
Il y a surtout une planche tout à fait fantastique qui est bien le plus épouvantable cauchemar que nous ayons jamais rêvé ; ― elle est intitulée : Y aun no se van. C’est effroyable, et Dante lui-même n’arrive pas à cet effet de terreur suffocante ; représentez-vous une plaine nue et morne au-dessus de laquelle se traîne péniblement un nuage difforme comme un crocodile éventré ; puis une grande pierre, une dalle de tombeau qu’une figure souffreteuse et maigre s’efforce de soulever. ― La pierre, trop lourde pour les bras décharnés qui la soutiennent et qu’on sent près de craquer, retombe malgré les efforts du spectre et d’autres petits fantômes qui roidissent simultanément leurs bras d’ombre ; plusieurs sont déjà pris sous la pierre un instant déplacée. L’expression de désespoir qui se peint sur toutes ces physionomies cadavéreuses, dans ces orbites sans yeux, qui voient que leur labeur a été inutile, est vraiment tragique ; c’est le plus triste symbole de l’impuissance laborieuse, la plus sombre poésie et la plus amère dérision que l’on ait jamais faites à propos des morts. La planche Buen viage, où l’on voit un vol de démons, d’élèves du séminaire de Barahona qui fuient à tire-d’aile, et se hâtent vers quelque œuvre sans nom, se fait remarquer par la vivacité et l’énergie du mouvement. Il semble que l’on entende palpiter dans l’air épais de la nuit toutes ces membranes velues et onglées comme les ailes des chauves-souris. Le recueil se termine par ces mots : Y es ora. ― C’est l’heure, le coq chante, les fantômes s’éclipsent, car la lumière paraît,
― Quant à la portée esthétique et morale de cette œuvre, quelle est-elle ? Nous l’ignorons. Goya semble avoir donné son avis là-dessus dans un de ses dessins où est représenté un homme, la tête appuyée sur ses bras et autour duquel voltigent des hiboux, des chouettes, des coquecigrues. ― La légende de cette image est : El suenho de la razon produce monstruos. C’est vrai, mais c’est bien sévère.
Ces caprices sont tout ce que la Bibliothèque royale de Paris possède de Goya. Il a cependant produit d’autres œuvres : la Tauromaquia, suite de 33 planches, les Scènes d’invasion qui forment 20 dessins, et devaient en avoir plus de 40 ; les eaux-fortes d’après Vélasquez, etc., etc.
La Tauromaquia est une collection de scènes représentant divers épisodes du combat de taureaux, à partir des Mores jusqu’à nos jours. ― Goya était un aficionado consommé, et il passait une grande partie de son temps avec les toreros. Aussi était-il l’homme le plus compétent du monde pour traiter à fond la matière. Quoique les attitudes, les poses, les défenses et les attaques, ou, pour parler le langage technique, les différentes suertes et cogidas soient d’une exactitude irréprochable, Goya a répandu sur ces scènes ses ombres mystérieuses et ses couleurs fantastiques. ― Quelles têtes bizarrement féroces ! quels ajustements sauvagement étranges ! quelle fureur de mouvement ! Ses Mores, compris un peu à la manière des Turcs de l’empire sous le rapport du costume, ont les physionomies les plus caractéristiques. ― Un trait égratigné, une tache noire, une raie blanche, voilà un personnage qui vit, qui se meut, et dont la physionomie se grave pour toujours dans la mémoire. Les taureaux et les chevaux, bien que parfois d’une forme un peu fabuleuse, ont une vie et un jet qui manquent bien souvent aux bêtes des animaliers de profession : les exploits de Gazul, du Cid, de Charles Quint, de Romero, de l’étudiant de Falces, de Pepe Illo, qui périt misérablement dans l’arène, sont retracés avec une fidélité tout espagnole. ― Comme celles des Caprichos, les planches de la Tauromaquia sont exécutées à l’aqua-tinta et relevées d’eau-forte.
Les Scènes d’invasion offriraient un curieux rapprochement avec les Malheurs de la guerre, de Callot. ― Ce ne sont que pendus, tas de morts qu’on dépouille, femmes qu’on viole, blessés qu’on emporte, prisonniers qu’on fusille, couvents qu’on dévalise, populations qui s’enfuient, familles réduites à la mendicité, patriotes qu’on étrangle, tout cela est traité avec ces ajustements fantastiques et ces tournures exorbitantes qui feraient croire à une invasion de Tartares au XIVème siècle. Mais quelle finesse, quelle science profonde de l’anatomie dans tous ces groupes qui semblent nés du hasard et du caprice de la pointe ! Dites-moi si la Niobé antique surpasse en désolation et en noblesse cette mère agenouillée au milieu de sa famille devant les baïonnettes françaises ! ― Parmi ces dessins qui s’expliquent aisément, il y en a un tout à fait terrible et mystérieux, et dont le sens, vaguement entrevu, est plein de frissons et d’épouvantements. C’est un mort à moitié enfoui dans la terre, qui se soulève sur le coude, et, de sa main osseuse, écrit sans regarder, sur un papier posé à côté de lui, un mot qui vaut bien les plus noirs du Dante : Nada (néant). Autour de sa tête, qui a gardé juste assez de chair pour être plus horrible qu’un crâne dépouillé, tourbillonnent, à peine visibles dans l’épaisseur de la nuit, de monstrueux cauchemars illuminés çà et là de livides éclairs. Une main fatidique soutient une balance dont les plateaux se renversent. Connaissez-vous quelque chose de plus sinistre et de plus désolant ?
Tout à fait sur la fin de sa vie, qui fut longue, car il est mort à Bordeaux à plus de quatre-vingts ans, Goya a fait quelques croquis lithographiques improvisés sur la pierre, et qui portent le titre de Dibersion de Espanha ; ― ce sont des combats de taureaux. On reconnaît encore, dans ces feuilles charbonnées par la main d’un vieillard sourd depuis longtemps et presque aveugle, la vigueur et le mouvement des Caprichos et de la Tauromaquia. L’aspect de ces lithographies rappelle beaucoup, chose curieuse ! la manière d’Eugène Delacroix dans les illustrations de Faust.
Dans la tombe de Goya est enterré l’ancien art espagnol, le monde à jamais disparu des toreros, des majos, des manolas, des moines, des contrebandiers, des voleurs, des alguazils et des sorcières, toute la couleur locale de la Péninsule. ― Il est venu juste à temps pour recueillir et fixer tout cela. Il a cru ne faire que des caprices, il a fait le portrait et l’histoire de la vieille Espagne, tout en croyant servir les idées et les croyances nouvelles. Ses caricatures seront bientôt des monuments historiques. »
Théophile Gautier
Voyage en Espagne
charpentier, 1859
pp. 89-124
Chapitre VIII
*******
FRANCISCO GOYA MADRID







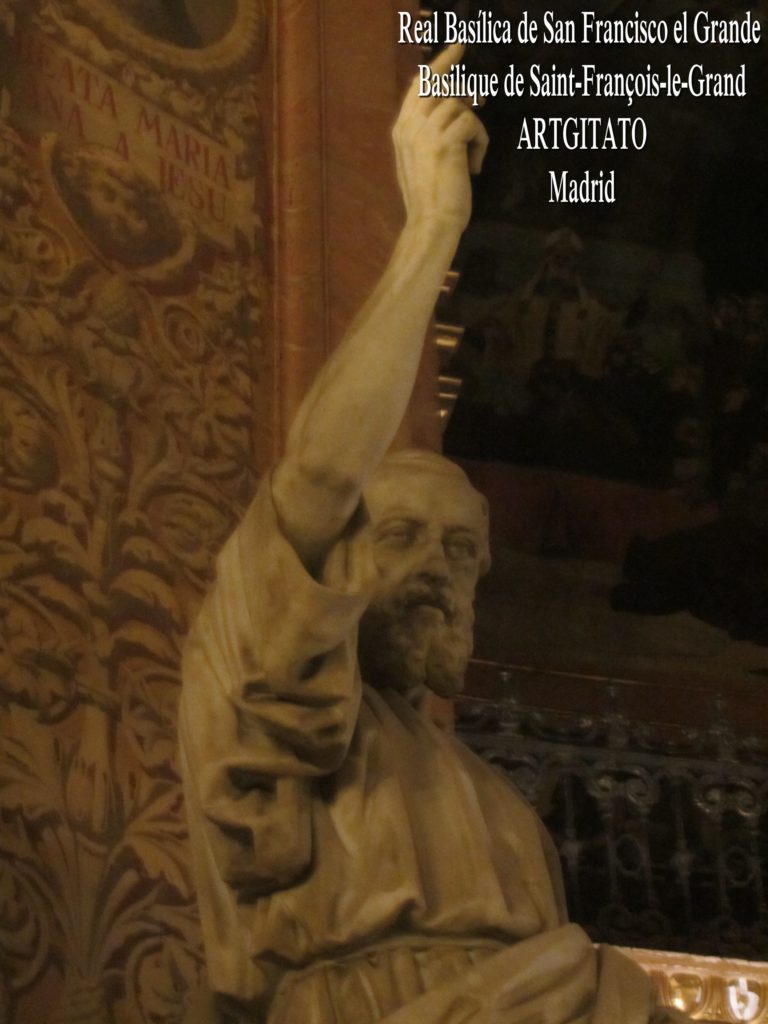






 Intérieur de la coupole
Intérieur de la coupole