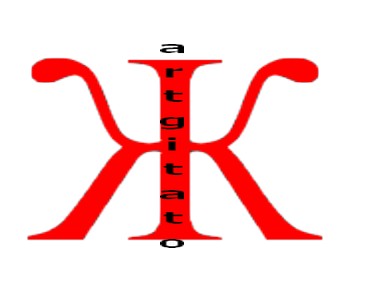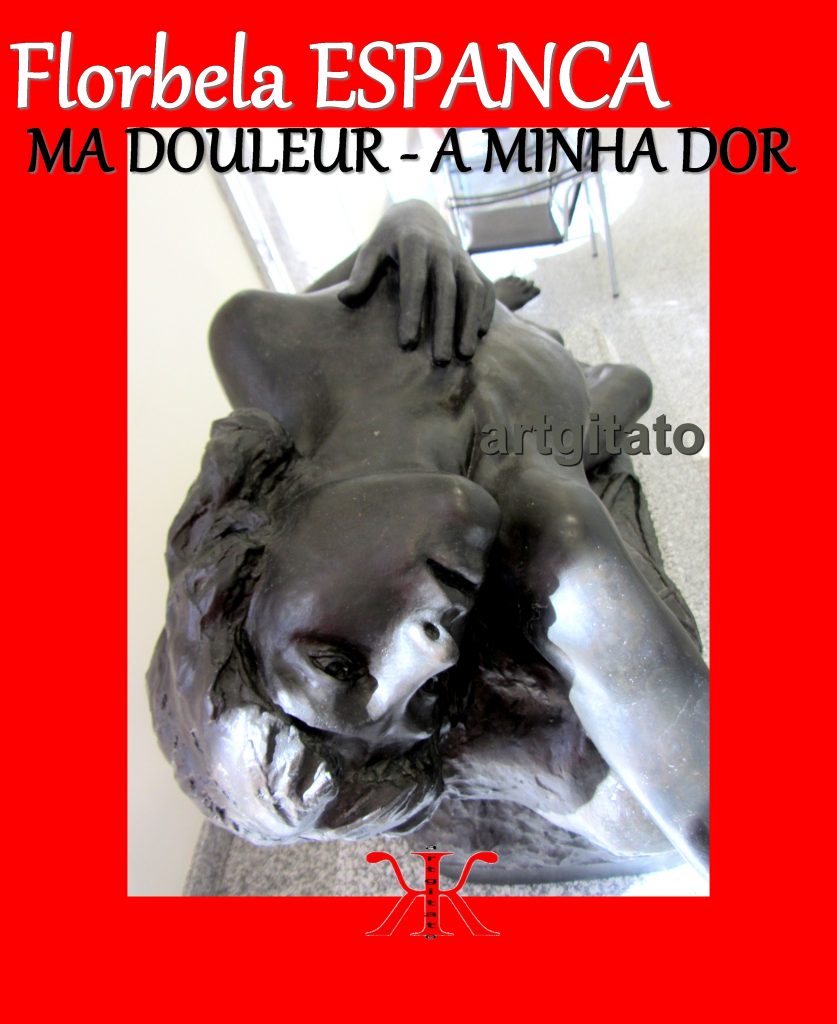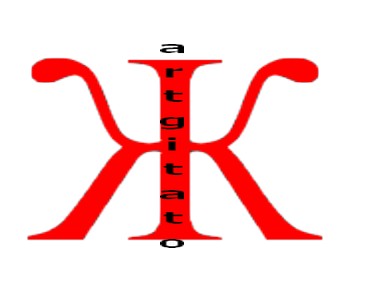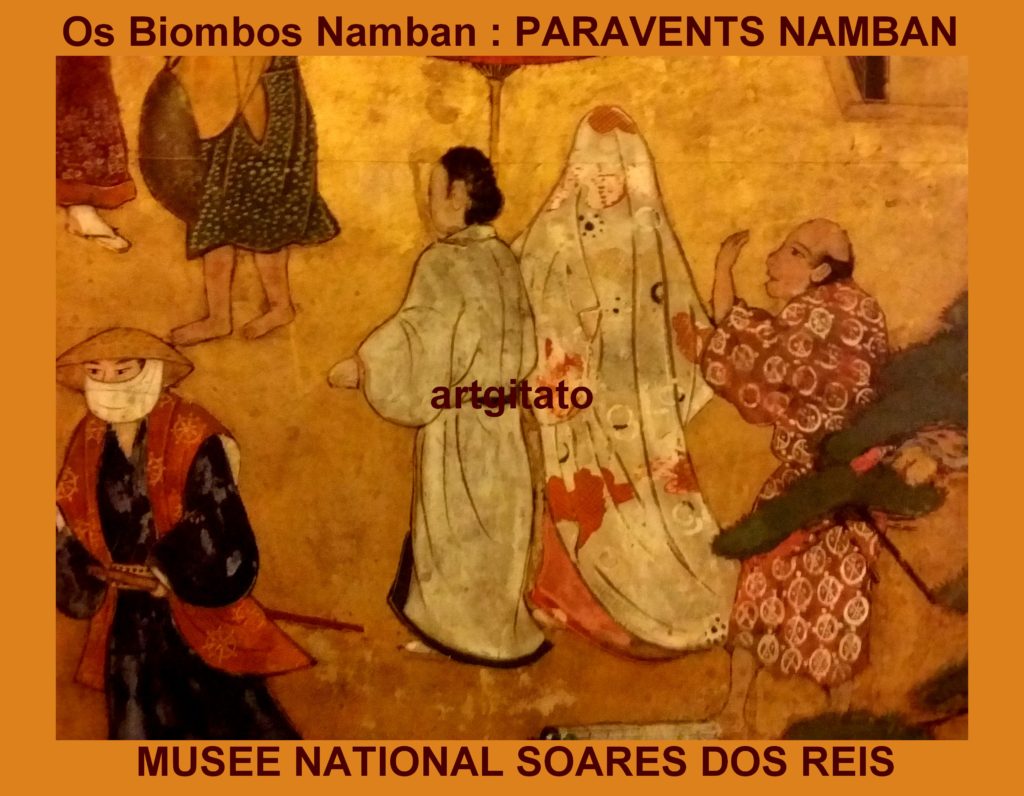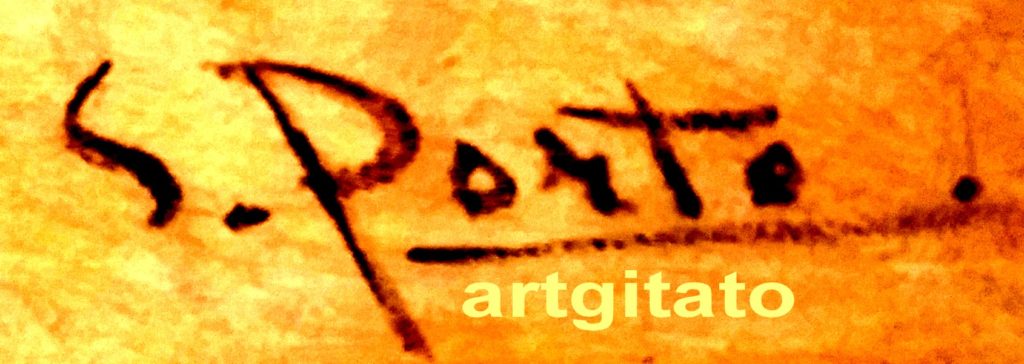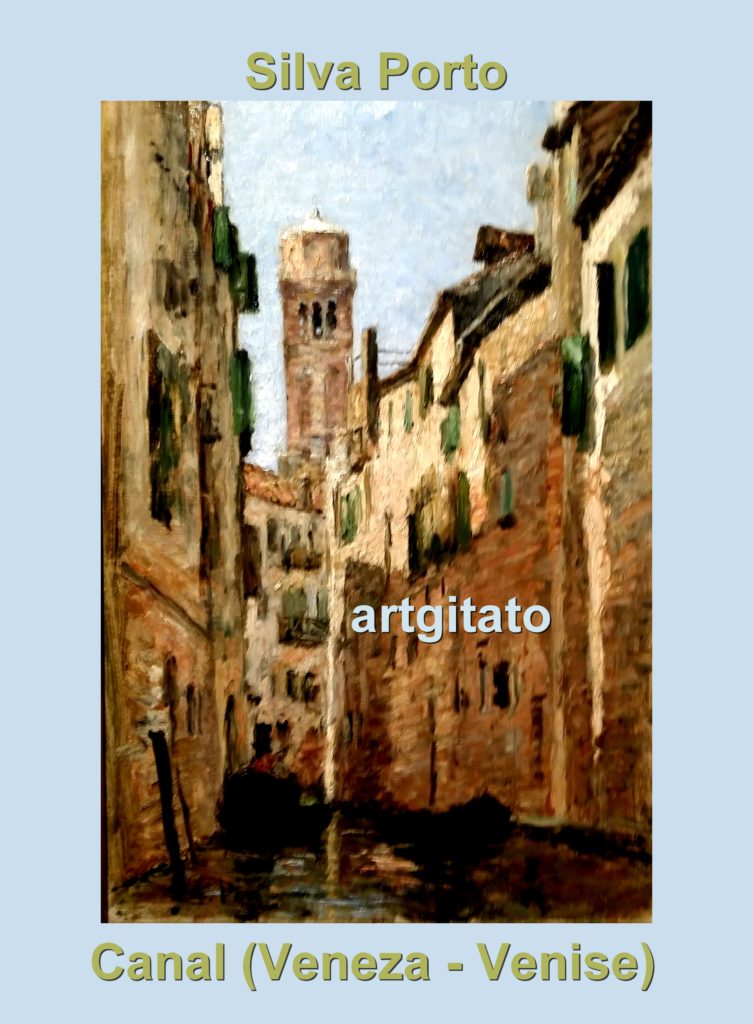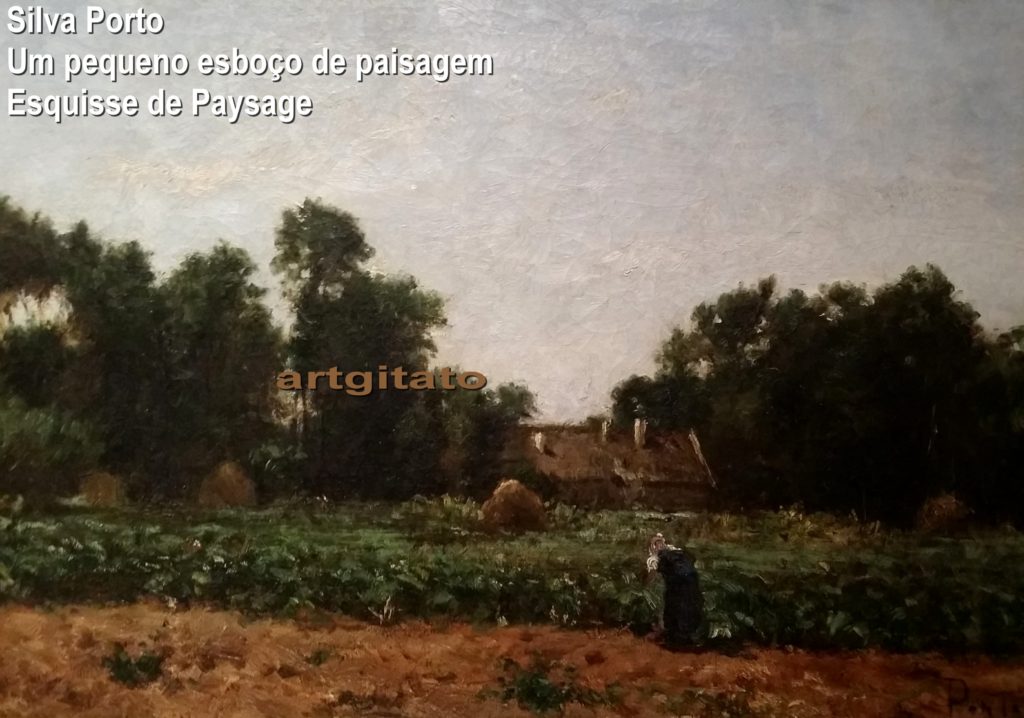Assinatura – Signature de Joãn Marques de Oliveira
Photo Jacky Lavauzelle
Joãn Marques de Oliveira
João Marques de Oliveira
LE PEINTRE DE LA DELICADEZA
o pintor da delicadeza
23 août 1853 Porto – 9 octobre 1927 Porto
23 de Agosto de 1853 Porto – 9 de outubro de 1927 Porto
****
Busto de Marques de Oliveira
António Soares dos Reis
Assinada e datada
Signé et daté
1881
Bronze


*********
Retrato de António Soares dos Reis
Portrait d’António Soares dos Reis
Marques de Olivera
Assinada e datada
Signé et daté
1881
Óleo sobre tela – Huile sur Toile

*********
Silva Porto a pintar
Silva Porto peignant
Assinada e datada
Signé et daté
1875
Óleo sobre tela – Huile sur Toile

**
Paisagem
Paysage
Assinada e datada
Signé et daté
1883
Óleo sobre Madeira – Huile sur bois

**
Areinho
Assinada Signé
1881-1882
Óleo sobre Madeira – Huile sur bois

**
Auto-retrato
Auto-portrait
Óleo sobre Madeira – Huile sur bois

**
Céfalo e Prócris
Céphale et Procris
Assinada e datada
Signé et daté
1879
Óleo sobre tela – Huile sur Toile


*
Κέφαλος καὶ Πρόκρις
Le Mythe de Céphale et Procris
par Mallarmé
PROCRIS, MYTHE GREC ET LATIN
Procris est la fille d’Érechthée, roi fabuleux d’Athènes, et de Hersé. Cet Érechthée ou Érichtonios (car les deux noms n’en sont qu’un) est regardé comme le fils d’Héphaïstos et de Gê, la terre : il naquit ayant la forme d’un serpent, et Athéné l’éleva. Son enfant, Procris, être d’une beauté merveilleuse, gagna l’amour de Céphale, qui la trouva sur le mont Hymète ; venant, lui, du rivage blanc d’Eubée. Mais Éos fut jalouse de voir Procris mariée à Céphale ; elle tenta Céphale, et le fit douter de la foi de son épouse. Céphale, parti, revint sous un déguisement (comme Sigurd, dans le conte Volsung, revient vers Brunehilde), et gagna l’amour de Procris par ce changement de forme. Procris découvrant la ruse, s’en fut en Crète ; elle y resta dans un profond chagrin, jusqu’à la visite d’Artémis, qui lui donna la lance ne manquant jamais son but et le chien qui toujours dépiste sa proie. Procris, avec cette arme et le limier, revint à Athènes, et sans cesse triompha dans les chasses. Son mari, que ce succès remplit d’envie, demanda la lance et le chien, mais elle refusa de les lui céder autrement qu’en retour de son amour. Céphale lui donna cet amour, et découvrit immédiatement qu’il avait devant lui sa première femme, Procris. Craignant encore la jalousie d’Éos, Procris dans la chasse se tenait près de Céphale, mais la lance de celui-ci la transperça, cachée par un fourré. Le prince, navré de cette mort, quitta Athènes et aida Amphitryon à débarrasser ses terres de bêtes nuisibles : puis, voyageant à l’Ouest, il atteignit le cap Leucade, où sa force l’abandonna, et il tomba dans la mer.
Origine de cette histoire. Elle est issue de trois simples phrases, dont l’une disait « le soleil aime la rosée », tandis que la seconde dit « le matin aime le soleil » ; la troisième ajoutait que « le soleil est la mort de la rosée ». Un détail nous le prouve : on appelle Procris l’enfant d’Hersé, mot qui, même en grec, signifie « rosée » ; et le nom de Procris lui-même vient d’un mot grec signifiant « scintiller ». Éos, encore, est la déesse de l’Est ou du matin ; et Céphale, un mot qui veut dire la «tête » du soleil.
Poursuivons et traduisons. Comme le soleil regarde de grand matin la rosée, Céphale de même gagne l’amour de Procris en sa première jeunesse : cependant l’amour de l’aurore pour le soleil se change en la jalousie qu’Éos ressent de Procris. Mais chaque goutte de rosée réfléchit le soleil ; on disait pour cela de Procris qu’elle accorda son amour à Céphale, restant à travers son changement toujours le même. Elle meurt de la lance d’Artémis qui représente les rayons du soleil quand il gagne de la force et sèche la rosée. Céphale donne cette mort involontairement, tandis que la jeune femme s’attarde dans un fourré (lieu où la rosée persiste longtemps), juste comme Phoïbos ou Phœbus perd Daphné, et comme Orphée est séparé d’Eurydice. Toujours, ayant tué son épousée, Céphale doit voyager à l’occident, comme Héraclès, Persée et d’autres héros. Comme eux il peine pour les autres ; et, comme eux, meurt, au loin, dans l’Ouest, après sa tâche accomplie.
Stéphane Mallarmé
Les Dieux antiques
J. Rothschild, éditeur, 1880
pp. 188-190