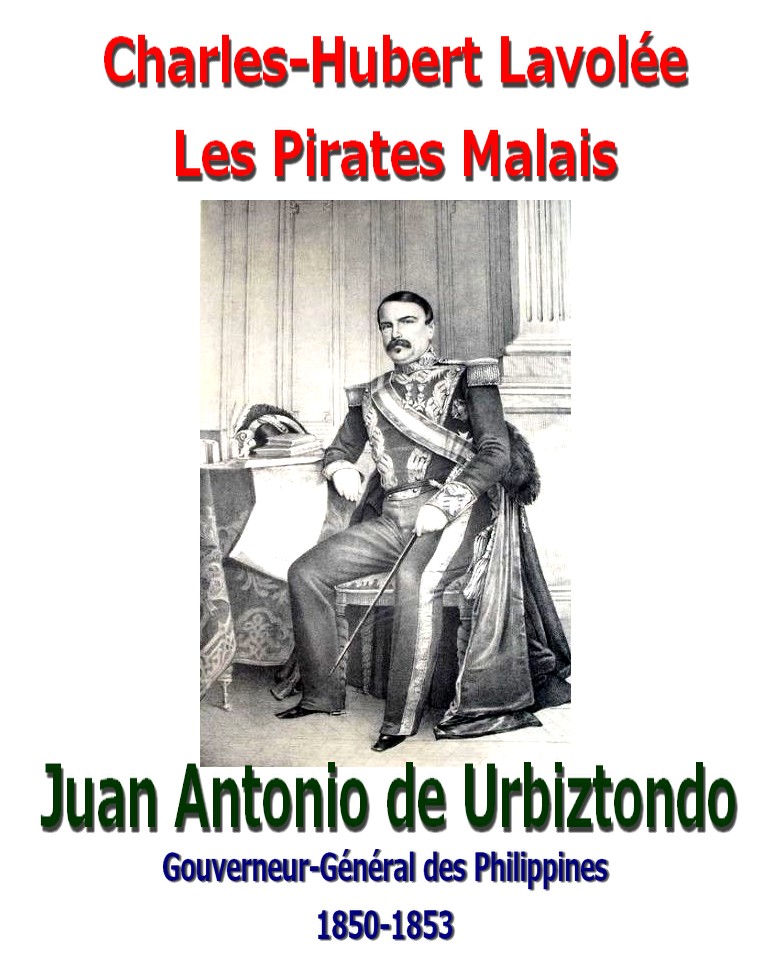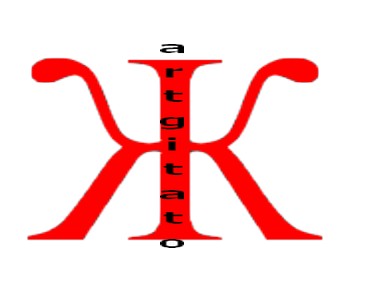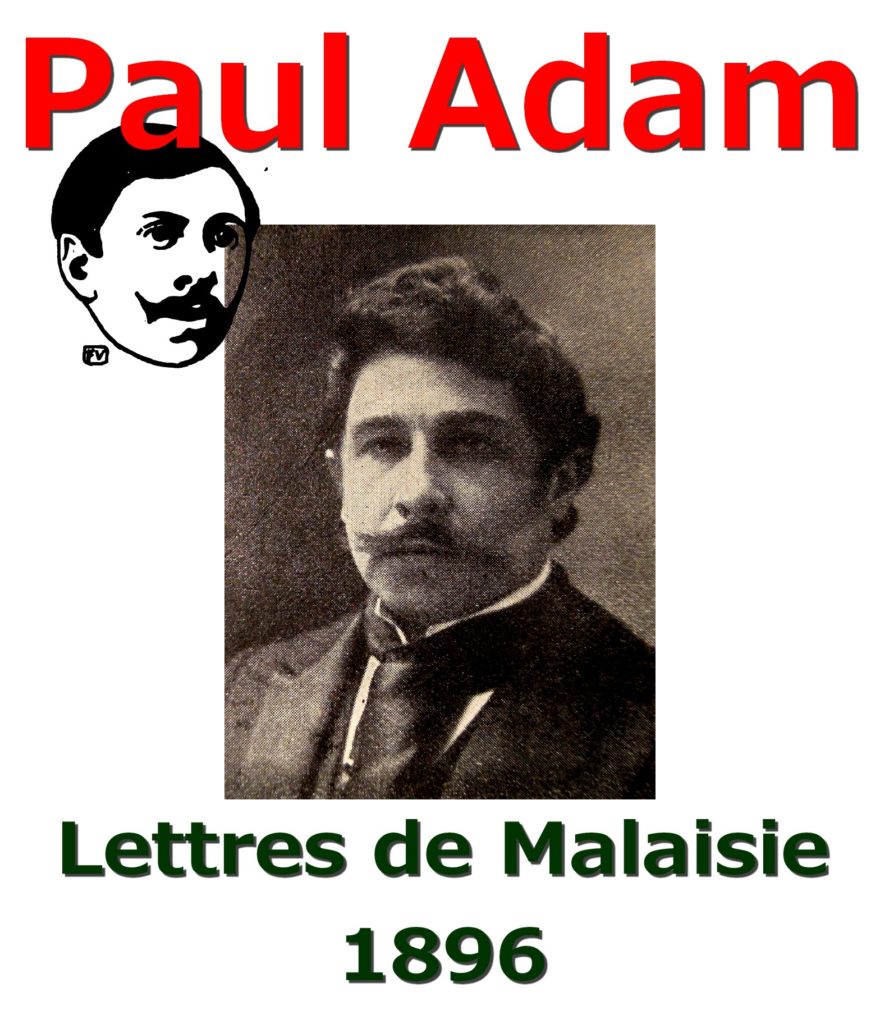Charles Hubert LAVOLEE
né en 1823
Ecrivain & administrateur
LES PIRATES MALAIS
1853
La Revue des Deux Mondes
LES PIRATES MALAIS
Il se fait à Singapore un grand commerce d’armes de guerre. Le voyageur qui entre dans l’un de ces vastes bazars où les négociants anglais entassent les produits les plus variés de l’industrie européenne, remarque avec surprise, à côté des pacifiques ballots de draps et de cotonnades, un assortiment de lances, de fusils, de canons, etc., exposés pour la vente. Poudre, balles, boulets, affûts, rien n’y manque ; c’est un véritable arsenal où chacun peut s’armer à prix fixe. Ce trafic que les gouvernemens d’Europe soumettent d’ordinaire, et non sans raison, à une police très rigoureuse, est parfaitement libre dans le port franc, de Singapore. L’administration britannique ne s’en préoccupe que pour inscrire sur les registres de la douane les quantités d’armes et de munitions qui entrent et qui sortent. — Si vous demandez à qui se vendent toutes ces armes, on vous répondra qu’elles trouvent leur principal débouché dans les îles de la Malaisie et à bord des milliers de caboteurs ou pros qui fréquentent la rade de Singapore. Aussi lit-on régulièrement, dans les récits des croisières entreprises contre les pirates par les navires de sa majesté britannique, que les fusils et les pierriers conquis sur l’ennemi portent la marque anglaise. Singapore serait-il donc l’arsenal où s’approvisionnent les pirates ? – Précisément. Il y a bien, dans le nombre, d’honnêtes capitaines qui, à la veille de s’aventurer dans les parages malsains de l’archipel, jugent à propos de compléter leurs moyens de défense, parfois aussi les souverains de Siam, de Cochinchine, de Bornéo, achètent de fortes cargaisons de fusils pour se procurer l’innocent plaisir d’armer leurs troupes à l’européenne ; mais ce qui demeure avéré, c’est que les pirates sont, pour les bazars de Singapore, d’excellentes pratiques, et que les négociants anglais, trop discrets pour s’enquérir des intentions de leurs acheteurs, exploitent sans le moindre remords cette riche clientèle. Quant au gouvernement, on sait qu’il a pour principe de ne point intervenir dans les transactions des particuliers ; il laisse donc faire. Cependant la Grande-Bretagne poursuit impitoyablement les pirates ; elle les attaque sur terre et sur mer, au milieu des détroits de l’archipel et sur la côte même, de Bornéo : de temps à autre, ses vaillants officiers de marine, vont reprendre entre les mains des forbans les armes sorties des bazars de Singapore. L’honneur national est sauf et la civilisation est vengée !
Il serait assurément beaucoup plus simple de refuser aux tribus malaises les munitions qu’elles achètent si commodément dans l’arsenal britannique et d’exercer sur ce genre d’affaires une active surveillance ; mais le commerce n’y trouverait plus son compte, et que diraient les partisans du free trade ? De quel droit priverait-on les usines de Birmingham des commandes qui leur sont faites, et les Malais des marchandises qu’ils demandent ? A chacun son rôle ; s’il y a des pirates, cela regarde les navires de sa majesté. Il faut ajouter que l’on trouve encore en Angleterre et dans l’Inde un certain nombre d’incrédules à l’endroit de la piraterie. Dans le parlement, M. Hume accuse, au moins une fois l’an, le rajah Brooke d’avoir inventé les pirates de Bornéo, afin de justifier la prise de possession du district de Sarawak et les combats livrés aux tribus voisines ; à Singapore même, les marchands d’armes seraient tout prêts à certifier l’honnêteté de leurs clients malais, qui paient comptant. Quoi qu’on ait pu dire, la mer et les détroits de la Malaisie n’en sont pas moins aujourd’hui, comme par le passé, infestés de pirates, dont il faut incessamment surveiller les manœuvres et corriger les méfaits.
N’est-il pas singulier qu’en plein XIXe siècle, alors que la civilisation dispose de tant de ressources et s’empare si vite, grâce à la vapeur, de toutes les régions du globe, il y ait encore, à l’extrémité de l’Asie, des bandes de forbans qui tiennent bravement la mer ? Il semble que ces vestiges de barbarie auraient dû depuis longtemps disparaître devant le pavillon européen, qui sillonne, sans relâche toutes les routes de l’archipel asiatique. Déjà, à plusieurs reprises, l’Angleterre, la Hollande, l’Espagne et même la France ont infligé aux Malais de rudes leçons. Cependant la piraterie résiste : à peine chassée sur un point, elle reparaît sur un autre ; elle se multiplie par l’extrême mobilité de ses escadres, bloque les détroits, pénètre au fond des baies, remonte les fleuves ; elle a son organisation particulière pour la course et pour le combat, ses points de rendez-vous et de ravitaillement, ses marchés pour la vente du butin. Ce n’est point seulement une habitude, encouragée longtemps par le succès et l’impunité ou entretenue par de sauvages instincts ; c’est une véritable industrie, une profession traditionnelle, à laquelle se livrent des tribus entières. Comment s’étonner dès lors que les croisières européennes aient tant de peine à lutter contre de pareils ennemis ? Les Malais, qui s’accommodent si bien de leur métier de pirates et qui ont pris dès leur enfance le goût de cette vie aventureuse et nomade, ne se laisseront pas aisément persuader qu’ils doivent préférer la paisible culture d’un champ de riz. Ils mourront comme ils ont vécu, et la guerre que la civilisation leur déclare aujourd’hui ne peut être qu’une guerre d’extermination. Que l’on se rappelle combien il a fallu expédier d’escadres sur les côtes d’Afrique pour châtier les pirates barbaresques. Il y a à peine trente ans que la Méditerranée est libre ; en 1816, lord Exmouth a trouvé à Alger plus de mille esclaves chrétiens.
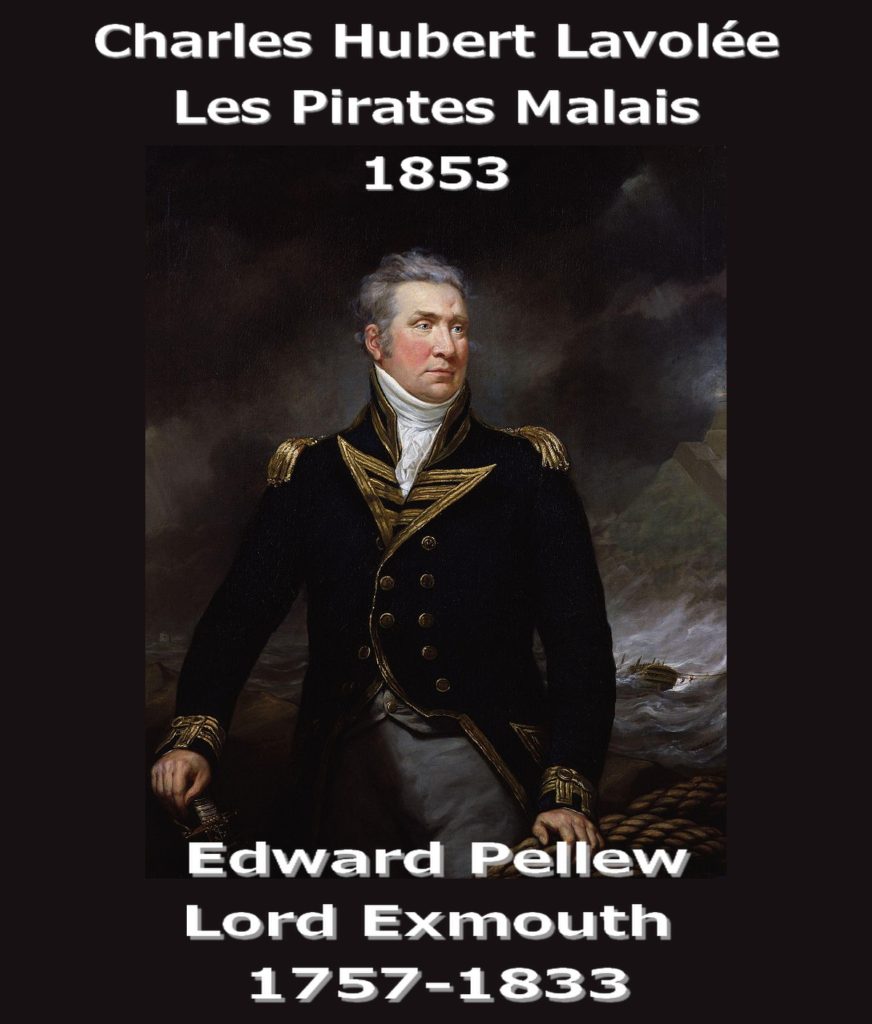 C’est seulement depuis 1830 que la piraterie a complètement disparu. Les Malais ne seront pas moins tenaces, et ils ne désarmeront que le jour où le pavillon européen, flottant sur toute l’étendue de leurs côtes, les aura chassés définitivement de leurs repaires.
C’est seulement depuis 1830 que la piraterie a complètement disparu. Les Malais ne seront pas moins tenaces, et ils ne désarmeront que le jour où le pavillon européen, flottant sur toute l’étendue de leurs côtes, les aura chassés définitivement de leurs repaires.
Les navires européens sont rarement attaqués par les pirates : encore faut-il que les capitaines fassent bonne garde et qu’ils aient sans cesse leurs canons chargés ; malheur à ceux qui se laisseraient surprendre en temps de calme ! Les Malais sont très agiles à l’abordage, et une fois sur le pont, ils se rendent bientôt maîtres du bâtiment. Quant aux navires échoués ou naufragés sur leurs côtes, c’est une proie facile, et le pillage s’effectue avec une dextérité prodigieuse. L’équipage est massacré, la cargaison enlevée, l’eau-de-vie bue sur place : en pareil cas, les tribus les plus inoffensives sentent s’éveiller en elles l’amour du butin, et elles font cause commune avec les pirates, sauf à leur disputer ensuite les dépouilles de l’ennemi. Ces sinistrés, il est vrai, sont peu fréquents, et l’on pourrait citer, dans toutes les mers, des exemples de cruautés commises par les indigènes sur les équipages naufragés. Ce sont principalement d’ailleurs les barques malaises et les innocentes jonques chinoises qui excitent la convoitise des pirates. Lorsque la navigation est peu active, ceux-ci débarquent, et vont dans l’intérieur envahir les tribus qui se livrent à l’agriculture ; ils détruisent les plantations, pillent les cases, emmènent la population en esclavage ; puis, remontant sur leurs pros, ils partent vers une autre, île où le butin est vendu au profit de la bande. On comprend que de semblables pratiques entravent le développement des échanges réguliers et l’exploitation des richesses naturelles du sol. Le commerce européen en souffre par contre-coup, et dès lors il semble rationnel qu’indépendamment des intérêts de la civilisation et de la morale, l’intérêt mercantile ait déterminé les divers gouvernemens à rétablir dans ces parages voisins de leurs établissemens coloniaux la sécurité des communications et des affaires.
Sir James Brooke, ou si l’on aime mieux le rajah Brooke, a pris une grande part, et une part très honorable, à la répression de la piraterie. Après s’être installé à Sarawak comme souverain indigène, il a installé l’Angleterre à Laboan, dont il a été nommé gouverneur au nom de la reine Victoria. Rajah, il est parvenu à introduire des habitudes d’ordre et de travail parmi les tribus soumises à son pouvoir absolu ; gouverneur de Laboan, il a disposé des bâtiments de guerre anglais pour diriger à propos de fréquentes expéditions contre les Sakarrans et les Serebas, les plus incorrigibles pirates de Bornéo. En 1843 et 1844, le capitaine Keppel, commandant la frégate Dido, a vigoureusement concouru à l’œuvre entreprise par le rajah Brooke, et il a publié à son retour un livre intéressant dont la Revue a rendu compte. Appelé, de 1846 à 1848, à remplir sur le Maeander la même mission, il vient de compléter dans un second ouvrage les renseignement qu’il avait déjà recueillis sur Bornéo et les tribus de l’archipel. M. Henry Keppel s’est fait ainsi l’historiographe de la piraterie asiatique, et il a levé un coin du voile qui cache encore aux yeux de l’Europe la vie intime des populations malaises.
Les Serebas, qui tiennent une grande place dans les récits du capitaine Keppel, se composent de deux éléments que l’on retrouve médaillés dans la plupart des tribus qui habitent la côte nord-ouest de Bornéo, — L’élément malais pur et l’élément dayak. — Les Malais n’ont point d’origine bien connue ; ils sont un jour descendus de leurs pros sur le littoral de Serebas, et après avoir accepté pendant quelque temps la suzeraineté du rajah de Johore, qui au XVIIe siècle était tout puissant dans ces mers (le descendant de ce fameux rajah vit aujourd’hui fort tranquillement près de Singapore avec une rente de 100,000 francs que lui paie la compagnie des Indes), ils se déclarèrent indépendants et exercèrent librement leur métier de forbans. La population malaise de Serebas ne compte pas plus de quinze cents combattants ; mais ce sont des hommes intrépides. Quant aux Dayaks, qui représentent l’élément indigène, ils sont beaucoup plus nombreux et forment plusieurs villages. Dans l’origine, ils se contentaient de chercher querelle aux tribus voisines et ne couraient point la mer. Peu à peu ils s’engagèrent comme rameurs à bord des pros malais ; ils apprécièrent les avantages d’une industrie qui leur procurait aisément de belles parts de prises, et ils devinrent à leur tour d’excellens pirates : c’est une profession qui n’exige pas un long apprentissage. L’association des Dayaks avec les Malais modifia profondément les mœurs de la piraterie. Les Malais n’avaient en vue que le butin, et ils épargnaient la vie de leurs captifs qu’ils allaient vendre comme esclaves sur les marchés de l’archipel. Les Dayaks, au contraire, faisaient surtout la chasse aux hommes ; il leur fallait des têtes. Dans ces tribus primitives, un jeune homme ne pouvait décemment aspirer à la main d’une jeune fille sans présenter à sa fiancée, dans la corbeille de noce, une tête d’ennemi. Ainsi les uns pillaient, les autres tuaient, et la piraterie malaise, secondée par les sanglants caprices des amours dayaks, devint cruelle ; de là les massacres nombreux qui désolèrent presque périodiquement les détroits et les côtes de Bornéo. Aujourd’hui tous ces forbans sont parfaitement équipés : ils ont le kris et la lance qu’ils savent manier avec une habileté merveilleuse, et les armes à feu qu’ils peuvent depuis vingt ans acheter à Singapore : ce sont les seuls emprunts qu’ils aient faits jusqu’ici à notre civilisation.
On nomme pros ou praws les embarcations des Malais, et bangkongs celles des Dayaks. Ces bateaux portent en moyenne trente-cinq hommes, et sont armés d’un canon à l’avant. Les pros de guerre, moulés par les principaux chefs, ont vingt à trente mètres de longueur et trente bancs de rameurs ; ils sont surmontés d’une espèce de terrasse où se tiennent les combattants. Les bangkongs sont généralement moins longs ; ils tirent moins d’eau et sont mieux taillés pour la course ; ils glissent si rapidement sur l’eau, que par une nuit obscure on ne saurait distinguer le bruit de leur sillage ni deviner leur approche. Dans une escadre de pirates, Les pros, avec leur artillerie et leur nombreux équipage, représentent en quelque sorte les vaisseaux de ligne, et les bangkongs, plus légers et plus vites, remplissent l’office d’espions pour découvrir l’ennemi et d’éclaireurs pour diriger la route. Les rôles sont donc très régulièrement distribués quand une balla ou flotte de pirates (et parfois la flotte dépasse cent bateaux) entreprend une croisière sur la côte.
Lorsque le Mœander se munira à Bornéo en 1849, les Serebas, qui commençaient à oublier le passage de la frégate Dido, préparaient avec les Sakarrans une nouvelle expédition. On avait ramené captif à Sarawak un jeune Malais arrêté en mer sur une petite barque qui s’en allait à la dérive. Cet indigène, qui appartenait à la tribu des Serebas, avoua très naïvement qu’étant embarqué sur une balla, il était descendu à terre pour s’y procurer le plaisir de couper quelques têtes [to procure a few heads for his private gratification), et qu’à son retour il avait trouvé la flotte partie ; il s’était alors déterminée à prendre un canot pour remonter la rivière, mais le courant l’avait entraîné. Le prisonnier fut remis en liberté sous caution. — Quelques jours après, on fut informé que la balla des Serebas venait d’entrer dans la rivière Sadong et qu’elle y commettait les plus affreux ravages. Les pirates avaient fort habilement choisi le moment de la moisson, alors que les hommes sont répandus dans les champs et que les femmes et les enfants restent seuls dans les cases ; Le pays fut complètement ruiné. À cette nouvelle, le rajah Brooke arma sa flottille indigène de cinquante-cinq pros, embarqua dix-huit cents hommes, convoqua ses auxiliaires dans les tribus voisines et se mit en campagne ; mais les pirates, dont la police est toujours admirablement servie, s’étaient dérobés à sa poursuite, et cette démonstration demeura à peu près sans résultat.
Cependant, on supposait avec raison que les Serebas et les Sakarrans, leurs alliés, dont les ballas réunies comptaient plus de deux cents pros, ne se tiendraient pas pour battus. On équipa à Sarawak une nouvelle flottille qui fut renforcée par le Royalist, la Némésis, par les embarcations de l’Albatros, et placée sous le commandement de capitaine Farqubar. On bloqua les embouchures des rivières Serebas et Kaluka, où l’on savait que les pirates venaient de pénétrer, et l’on attendit l’ennemi au retour. Dans la nuit du 31 juillet, la balla fit son apparition. Dès qu’elle fut signalée, toutes les embarcations de la croisière, échelonnées sur un espace de près de dix milles, se disposèrent pour l’attaque, qui eut lieu à l’entrée de la rivière Serebas. Les pirates voulurent forcer le passage : ils furent immédiatement assaillis par un feu bien nourri qui partait de toutes les directions. La confusion, augmentée par l’obscurité de la nuit, se mit dans leur flottille ; une centaine de leurs pros furent coulés ou échouèrent, et on évalue à cinq cents le nombre de leurs morts ; les survivants s’échappèrent à force de rames ou se réfugièrent dans les jungles du rivage, qui leur offraient un abri presque inaccessible.
C’était un coup terrible porté à la tribu des Serebas ; cependant il fallait que la leçon fût complète, et on résolut de pousser une reconnaissance sur tous les points de la côte qui étaient d’ordinaire fréquentés par les pirates. On savait d’ailleurs que plusieurs pros, détachés de la grande balla, avaient opéré une diversion dans la direction de Sambas, pillé une colonie chinoise, et visité même l’embouchure de la rivière de Sarawak. La flottille commandée par le capitaine Farquhar et par le rajah Brooke remonta donc le Sercbas ; mais, après une courte navigation, on dut laisser au mouillage la Nemesis et les pros de fort tonnage pour ne garder que les embarcations légères. Un petit steamer, le Ranee, conduisait la marche. Arrêté brusquement par un tronc d’arbre qui se trouvait en travers de la rivière, il fut drossé par le courant et ne tarda pas à échouer ; le mécanicien lâcha la vapeur, qui, en s’échappant de la chaudière, produisit le sifflement accoutumé. Cet incident jeta l’effroi parmi les indigènes, qui ne s’expliquaient pas d’où pouvait venir un tel bruit : les uns se jetèrent à l’eau en désespérés pour nager vers la terre ; les autres, plus résignés, invoquèrent pieusement Allah ! Bref, ce fut une épouvante, une confusion impossible à décrire, et les Anglais eurent toutes les peines du monde à rassurer leurs braves alliés.
De distance en distance, les pirates avaient essayé de barrer la rivière avec des troncs d’arbre que l’on coupait à coups de hache afin d’ouvrir la route. On débarquait alors quelques détachemens pour protéger les travailleurs contre les attaques des jungles. Ces différentes manœuvres exigeaient une grande prudence. Les Malais, cachés à quelques pas de la rive sous d’épaisses touffes de broussailles, saisissaient au passage les hommes qui restaient en arrière de la bande, et partout où il y avait un sentier praticable, ils avaient imaginé de ficher en terre une foule de petits pieux extrêmement pointus qui entraient sous la plante des pieds et causaient souvent de cruelles blessures. Malgré ces difficultés, l’expédition s’avança à une assez grande distance dans l’intérieur, et elle châtia plusieurs tribus avant de revenir a l’embouchure de Serebas, où elle retrouva la Némésis.
Le 9 août, toute l’escadre se rendit à Bejang. Cette ville est habitée par la tribu des Milanows, qui, pour se soustraire aux déprédations des pirates, s’est avisée de construire ses cases sur pilotis à quarante pieds au-dessus du sol. Ce n’est pas tout : chaque case, armée comme une forteresse, contient une provision de pierres destinées à servir de projectiles, et lorsqu’il parait un pro suspect à l’horizon, les femmes s’empressent de préparer de l’huile bouillante pour en asperger au besoin les assaillants. Du reste, cette singulière tribu des Milanows, si prudemment juchée dans ses demeures aériennes, n’est point tout à fait sans reproche : un jeune homme de la tribu qui avait accompagné l’expédition fit sa rentrée au milieu des siens en rapportant avec orgueil une tête fraîchement coupée, et il reçut de ses compatriotes, surtout des femmes, un accueil enthousiaste.
Après avoir rassuré les Milanows, l’escadre de Sarawak visita la rivière Kanowit, dont les rives sont habitées parles Sakarrans et par d’autres tribus qui ont constamment fourni leur contingent à la piraterie. Lorsqu’elle se présentait devant un village, les chefs accouraient à la rencontre des officiers anglais, et ces forbans dont les cases étaient, suivant l’usage, décorées de trophées humains, se défendaient très énergiquement de toute complicité avec les Serebas : à peine avouaient-ils qu’il pouvait bien se trouver dans une population aussi nombreuse quelques jeunes têtes folles avides de butin et d’aventures. À les en croire, ils étaient pour l’établissement de Sarawak de fidèles alliés et les meilleurs voisins du monde. Sir James Brooke avait trop d’expérience pour se laisser duper par ces tardives protestations ; mais il pensa qu’il suffisait pour le moment d’admonester les pirates et de leur prouver que les Anglais sauraient, en cas de récidive, les atteindre à plus de cent milles dans l’intérieur des terres. La flottille remit donc à la voile pour Sarawak, où elle rentra triomphante le 24 août, après une croisière d’un mois. Elle venait de détruire complètement la plus formidable balla qui fût encore sortie des rivières de Bornéo, et l’énergie de son attaque avait arrêté, au moins pour un temps, les ravages de la piraterie. À peine le rajah Brooke fut -il de retour dans sa capitale, qu’il reçut la visite des principaux chefs malais et dayaks, qui promirent solennellement de renoncer à leur coupable industrie, et de tourner vers l’agriculture et le commerce l’activité des tribus. Le rajah se montra clément ; il accorda aux nobles étrangers qui étaient accourus près de lui de nombreuses audiences, mit tout en œuvre pour les amuser pendant leur séjour, leur fit même montrer la lanterne magique ; enfin, ce qui ne leur fut pas moins agréable, il rendit la liberté aux prisonniers, qu’il renvoya dans leurs familles chargés de présents et de pièces de calicot à la marque anglaise. Excellente occasion pour répandre dans les districts de Bornéo quelques échantillons de cotonnades !
Si les chefs malais avaient pu être sincèrement convertis, quelle impression ne devait point produire sur eux la vue de l’établissement de Sarawak tel que l’avait créé et développé sir James Brooke en y introduisant une administration à peu près régulière ! Le capitaine Keppel et la plupart des officiers de la marine anglaise qui ont visité Bornéo s’accordent à reconnaître que le rajah européen a opéré dans cet ancien nid de voleurs et de pirates un véritable prodige. En 1842, la population de Sarawak atteignait à peine huit mille âmes ; elle s’élevait dès 1849 à quarante-cinq mille. La ville occupe une vaste étendue de terrain sur les deux bords de la rivière ; elle est protégée par un fort. Elle contient déjà plusieurs édifices, — une église protestante et une mosquée, un palais de justice, une école publique, un hôpital, de bazars où sont étalées les marchandises apportées de l’entrepôt de Singapore, des chantiers de construction pour les navires. De belles routes la traversent en tous sens et rayonnent dans la campagne, où sont situées les villas des résidents européens. Que l’on se figure en un mot une métamorphose complète, une apparence d’ordre et de bien-être là où naguère végétaient de misérables tribus. Et tout cela est l’ouvrage d’un seul homme ! Est-il besoin d’ajouter que M. Brooke s’est réservé sur ses nouveaux sujets une autorité absolue ? Il règne et gouverne sans partage ; les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire demeurent réunis entre ses mains, et les habitants de Sarawak ne connaissent pas d’autre constitution que la volonté respectueusement obéie de leur rajah exotique. — Tout à l’heure M. Brooke, l’implacable ennemi des pirates, menait en guerre sa flotte de pros dont il est naturellement le grand-amiral ; le voici maintenant sur son siège de magistrat, expédiant la justice, sans avocats et sans code. L’audience est publique ; Malais, Dayaks, Chinois, y assistent en foule, les uns alignés sur des bancs de bois, les autres accroupis par terre à la façon orientale. Une sorte de jury composé d’Européens et d’indigènes, présidé, bien entendu, par le rajah qui préside tout et à tout, vous représente le tribunal devant lequel comparaissent tour à tour les parties civiles, les prévenus, les témoins appelés par l’huissier audiencier le fidèle Subu, un vieil ami de M. Brooke. Le capitaine Keppel est admis à prendre place au milieu des juges. Cet honneur accordée un étranger de distinction, à un officier de la marine de sa majesté britannique, ne peut manque de produire un excellent effet sur les indigènes. Les débats suivent leur cours ; un procès criminel succède à une affaire civile, et la procédure est des plus simples, ou plutôt il n’y a point de procédure et partant point de frais. Quand la cause est entendue, le rajah délibère quelques instants avec son jury, puis il fait à haute voix le résumé qui contient souvent une ingénieuse leçon de morale à l’adresse de l’auditoire, et il prononce enfin l’arrêt, qui est immédiatement transcrit sur le registre de la cour. Bien rarement les affaires sont remises à huitaine ; le juge est toujours prêt à juger. Si la loi malaise n’est pas applicable, il prend la loi anglaise ; si la loi anglaise fait également défaut, il crée une jurisprudence séance tenante et la consacre dans les considérants d’un jugement sans appel. Qu’importe après tout avec de pareils justiciables la source du droit ? Il suffit que les bons se rassurent et que les méchants tremblent ; le rajah Brooke ne veut rien de plus. Est-ce à dire qu’il soit bien rigoureux dans ses arrêts, et qu’il tienne ses sujets sous une verge de fer ? Nullement. Le juge n’ignore pas qu’il a affaire à une population au sein de laquelle le meurtre n’a été longtemps considéré que comme une peccadille, et qu’il est impossible de la ramener brusquement à des mœurs plus douces. À chaque audience, il trouve l’occasion de rappeler à ses sujets qu’il leur est interdit de se faire justice par la force, et que la raison du kris n’est pas la meilleure. Une tribu de Dayaks envahit le territoire d’une tribu voisine et venge une vieille insulte par le massacre de dix-huit personnes : les meurtriers sont cités devant le tribunal de Sarawak, qui leur adresse les plus sévères remontrances, les menace de toute la rigueur des lois, mais en définitive ne les condamne qu’à l’amende. De même, dans les procès qui impliquent des questions de mariage et de divorce, le tribunal est obligé de se montrer fort tolérant, sous peine de heurter les irrésistibles préjugés du pays. Aussi le plus souvent les peines se traduisent en réparations pécuniaires : les prisons demeurent vides, et le bourreau se croise les bras.
Assurément ce n’est point là l’image d’une société parfaite : il faut comparer le district de Sarawak avec les districts encore soumis aux chefs indigènes, pour apprécier les résultats obtenus par M. Brooke ; mais qu’arrivera-t-il lorsque l’intrépide rajah n’y sera plus ? car s’il existe au monde un souverain qui ait le droit de dire : L’état, c’est moi ! à coup sûr, ce souverain est M. Brooke. Après lui, quelle main assez habile et assez ferme saura tenir en bride les populations malaises et intimider la piraterie ? Cet édifice, élevé au prix de tant d’efforts, ne parait-il pas bien fragile ? II ne repose que sur la vie, sur la présence d’un homme, et d’un jour à l’autre il peut être jeté bas par un heureux coup de main. Il y a quelques mois à peine, les pirates ont attaqué les doux forts de Sakarran et de Linga, qui ont été construits sur la côte après la campagne de 1849 ; ils ont tué les commandans anglais que M. Brooke y avait placés, et ils se préparaient à ravager de nouveau les districts apicoles. Il ne faut donc pas s’imaginer que la paix soit faite avec les Sakanans et les Serebas ; on doit au contraire s’attendre à de longues luttes, et surveiller de plus près les tribus de Bornéo.
Dans l’espace compris entre la pointe nord-est de cette grande île et l’extrémité sud-ouest de Mindanao s’étend l’archipel Soulou, dont les habitans ont figuré avec éclat dans les fastes de la piraterie. Pendant de longues années, ces forbans ont tenu victorieusement la mer qui baigne les Célèbes, les Moluques et les Philippines. Tandis que leurs pros allaient jusque dans la baie de Manille, sous le canon des forts espagnols, enlever des villages entiers, ils recevaient sur le marché de leur capitale le produit des rapines exercées dans les autres parages de la Malaisie par les Sakarrans, les Serebas et les Illanos. En diverses rencontres, ils avaient vu fuir devant eux les faluas (chaloupes canonnières) chargées de protéger les côtes de Luçon, et ils bravaient impunément les menaces du capitaine-général, qui réclamait, au nom de la couronne d’Espagne, la propriété ou tout au moins le protectorat de leur archipel. — En 1577, six ans après la fondation de Manille, une escadre des Philippines parut devant Soulou, qui fut obligé de capituler ; mais dès que le pavillon espagnol se fut éloigné de la rade, la population reprit ses habitudes de piraterie. À la suite de plusieurs expéditions, les Espagnols se décidèrent, en 1638, à occuper Soulou ; ils l’évacuèrent en 1644, et pendant près d’un siècle ils n’y firent plus d’apparition. Ce fut seulement vers le milieu du XVIIIe siècle que leur attention fut de nouveau attirée sur l’archipel dans une pensée de propagande catholique. Le sultan Aly-Muddin venait de monter sur le trône. Comme il avait passé une partie de sa jeunesse à Samboangan, dans un collège de jésuites, le roi d’Espagne pensa que le moment était opportun pour introduire le catholicisme à Soulou, et il écrivit au sultan une lettre en faveur de la loi chrétienne. Aly-Muddin consentit à recevoir quelques jésuites. Peu après, on le vit débarquer à Manille dans l’état le plus misérable. Il annonça qu’il avait été chassé par son frère et qu’il venait demander asile à ses alliés. Il fut accueilli avec enthousiasme, comblé d’honneurs et de présens ; on fit mieux : le capitaine-général arma une escadre qui devait le reconduire en triomphe et le rétablir sur le trône. Malheureusement on découvrit en route que le pieux Aly-Muddin s’entendait parfaitement avec son frère. Il avait imaginé de se rendre à Manille pour y étudier de plus près les ressources et les forces des Espagnols, qu’il avait le projet d’attaquer plus tard au centre même de leurs possessions. Le sultan qui avait osé se jouer si effrontément de la crédulité du roi des Espagnes fut ramené à Manille et jeté dans un cachot, d’où il ne sortit qu’en 1763, lorsque les Anglais se furent emparés des Philippines. Il obtint alors d’être transporté à Soulou, moyennant la cession de l’île de Balambagan, où la Grande-Bretagne établit une garnison, et son frère lui remit fidèlement son autorité. Ce dernier trait de probité malaise n’est pas le moins curieux de toute cette histoire. Le nom et les aventures du sultan Aly-Muddin sont demeurés populaires dans l’archipel. Il est inutile d’ajouter que la propagande tentée par les jésuites fut complètement stérile, et qu’il n’y eut jamais d’autres chrétiens à Soulou que les esclaves vendus par les pirates.
Ces brigandages, trop longtemps subis, devaient avoir un terme. De 1845 à 1850, les îles Soulon ont été successivement visitées par les escadres de la France, des Pays-Bas, de l’Angleterre et de l’Espagne, c’est la France, qui, provoquée, par l’assassinat d’un officier et de deux matelots appartenant à l’équipage de la corvette la Sabine, a en l’honneur d’inaugurer contre ces sauvages le système d’une énergique répression ; les Espagnols ont achevé l’œuvre. En 1850, une escadre, commandée par le capitaine-général des Philippines, don Antonio de Urbistondo, a bombardé Soulou.
On sait que, dans cette partie de l’Asie où les puissances coloniales ont conquis d’immenses et riches territoires, la France ne possède pas même un îlot. Il semble qu’elle ait volontairement déserté ces régions lointaines, dont l’avenir est cependant plein de grandeur. Nous voyons l’activité européenne envahir l’extrême Orient : l’Angleterre recule chaque jour les limites de son empire indien ; c’est à l’habile exploitation de Java qu’il faut demander le secret de la prospérité hollandaise ; l’Espagne trouvera dans les Philippines une source inépuisable de richesses, lorsque la paix et l’ordre auront ranimé au sein de la métropole les grandes entreprises ; le Portugal enfin, si déchu en Europe, conserve encore, dans les mers asiatiques quelques épaves de son ancienne fortune. Pourquoi ne pas comprendre dans ce dénombrement des nations qui se sont partagé les archipels un peuple dont on a longtemps ignoré ou méconnu le génie colonisateur, et qui pourtant est parvenu sans bruit à s’établir sur tous les points, — le peuple chinois ? Les émigrations du Céleste Empire versent sans relâche, des flots de colons sur le sol de l’Asie ; là même où les Européens pénètrent à peine, elles s’aventurent et se fixent ; elles ne redoutent pas le voisinage des pirates de Bornéo ; elles vivent et trafiquent au milieu des pirates de Soulou. — et tandis que tous ces peuples, Anglais, Espagnols, Hollandais, Portugais, Chinois, luttent d’intelligence et d’adresse pour occuper la plus large place sur les marchés de l’Asie, la France reste à l’écart. Elle n’est intervenue dans la Malaisie que pour y châtier une misérable tribu de sauvages, et c’est ainsi que, par un singulier hasard, elle a porté le premier coup aux forbans de Soulou.
Cet incident, qui attribue à la France un rôle fort imprévu dans l’histoire de la piraterie malaise, se rattache aux opérations de l’escadre envoyée dans les mers de Chine pour appuyer l’ambassade de M. de Lagrené (1843-46). Désireux d’assurer un abri à nos navires en cas de guerre et de fonder en Asie un établissement analogue à celui qui avait été créé aux îles Marquises, le gouvernement de juillet avait conçu la pensée d’acquérir l’île de Bassilan qui dépend du groupe de Soulou et qui fait face à l’établissement espagnol de Samboangan, sur l’île de Mindanao. La corvette la Sabine fut donc expédiée à Bassilan pour étudier la côte, et s’y livrer à des travaux hydrographiques. Les Malais ne parurent point s’inquiéter de la présence d’un navire de guerre dont le pavillon leur était à peu près inconnu ; quelques pirogues s’approchèrent de la corvette, et les relations, de part et d’autre, étaient assez amicales. Du reste, afin d’éviter toute occasion de querelle, le commandant avait interdit les communications avec la terre, et les canots étaient exclusivement consacrés à l’accomplissement de la mission confiée aux ingénieurs. Un jour cependant, l’un des officiers, M. de Maynard, obtint la permission d’explorer l’embouchure d’une petite rivière qui se jetait dans la rade à très courte distance, du mouillage. Il prit le you-you (c’est ainsi que l’on nomme la plus frêle embarcation du bord), emmena un patron, deux mousses et un jeune Hollandais qui servait d’interprète, et il partit après avoir reçu la recommandation expresse de ne point remonter la rivière et de ne pas perdre la corvette de vue. Malheureusement, entraîné par un sentiment de curiosité qui n’était que trop naturel et par le désir de tirer quelque parti de son exploration, M. de Maynard s’engagea dans la rivière, et la vue d’une bande de Malais qui manifestaient les dispositions les plus bienveillantes le détermina à pousser plus loin. Le chef de la bande demanda même à prendre place dans le you-you avec deux de ses hommes : il y fut admis sans défiance et s’assit à côté de l’officier qu’il invita à poursuivre sa route vers le village, où il assura que les Français seraient bien accueillis. Le sabre de M. de Maynard et un fusil de chasse qui se trouvait dans le canot excitèrent l’admiration et bientôt la convoitise du Malais, qui demanda très humblement d’abord, puis avec un certain air d’autorité, qu’on lui donnât le fusil. M. de Maynard refusa net. La situation devenait très critique, et l’interprète conseilla de retourner vers la corvette ; mais il était trop tard : le Malais exaspéré se précipita sur le malheureux officier et lui plongea son kris dans le cœur. En même temps, ses deux compagnons tuaient le patron. Les mousses et l’interprète se jetèrent à l’eau et essayèrent de gagner la rive. Saisis par les Malais qui accouraient au signal des leurs, ils furent emmenés prisonniers au village.
Cependant l’inquiétude était vive à bord de la Sabine ; le canot que l’on avait vu entrer dans la rivière ne reparaissait pas ! En vain cherchait-on à expliquer ce retard : on ne pouvait se défendre de sinistres pressentimens. Lorsque des Malais appartenant à une autre tribu de l’île apportèrent la nouvelle de l’infâme guet-apens, il y eut dans tout l’équipage une explosion d’indignation et de douleur… Il fallait d’abord délivrer les prisonniers. Le gouverneur de Samboangan fut employé comme intermédiaire, et moyennant le paiement d’un millier de piastres les Malais rendirent les deux mousses et l’interprète ; ou pouvait alors venger les victimes. La corvette la Victorieuse ayant rallié la Sabine, les deux navires firent voile pour Soulou, afin de demander raison au sultan du crime commis par les habitans de Bassilan, qui étaient considérés comme ses tributaires. Le sultan déclina toute responsabilité ; il déclara que les gens de Bassilan s’étaient constamment montrés rebelles à son autorité, et il les livra sans hésitation à la juste colère des Français. Les corvettes revinrent donc au mouillage de Bassilan, et leurs canots, remontant avec peine la rivière où avait été consommé le meurtre, attaquèrent une palissade très solidement construite derrière laquelle l’ennemi s’était embusqué. L’engagement fut assez vif : les canots ne se retirèrent qu’à la descente de la marée, après avoir tué ou blessé une vingtaine de Malais. De notre côté, nous eûmes deux matelots tués et plusieurs blessés ; mais l’affaire ne pouvait en demeurer là : le commandant de la Sabine, M. Guérin, expédia la Victorieuse à Manille pour rendre compte au chef de l’escadre, M. le contre-amiral Cécille, des événemens qui venaient de se passer.
La Cléopâtre et l’Archimède arrivaient à peine à Manille. Ils avaient à bord M. de Lagrené et la plupart des membres de la mission de Chine, qui devait visiter les colonies hollandaises de la Malaisie. Dès que les nouvelles de Bassilan furent connues, l’amiral et le ministre de France résolurent de se rendre immédiatement dans l’archipel Soulou et de rejoindre la Sabine pour aviser aux mesures que commandait l’honneur de notre pavillon, ils quittèrent Manille le 8 janvier 1845, et après une traversée de quatre jours ils mouillèrent sur les côtes de Bassilan, où la Sabine les attendait.
La situation s’était gravement compliquée. M. Guérin avait cru devoir déclarer le blocus de l’île, bien que le gouverneur de Samboangan fit valoir les droits de la couronne d’Espagne sur Bassilan et invoquât une espèce de soumission consentie par les principaux chefs de cette île au mois de février 1844. Les prétentions du gouverneur étaient appuyées par le brigadier Bocalan, commandant de la frégate espagnole l’Esperanza, qui se trouvait en croisière sur les côtes de Mindanao : prétentions singulières, car il était notoire que jamais l’Espagne n’avait été obéie à Bassilan, et d’ailleurs comment pouvait-elle concilier un droit quelconque de suzeraineté avec les démarches précédemment faites par le gouverneur de Samboangan pour obtenir à prix d’argent et par une négociation officieuse la délivrance des prisonniers de la Sabine ? Les réclamations des officiers espagnols n’étaient donc fondées ni en fait ni en droit ; aussi, lorsqu’une falua voulut tenter de forcer le blocus, le commandant Guérin n’hésita pas à lui envoyer des boulets. Ce fut au milieu de ces embarras, de ces susceptibilités fort envenimées de part et d’autre, que l’amiral Cécille et M. de Lagrené parurent à Bassilan ; mais en attendant que la question de propriété relative à ce coin de terre fût résolue en Europe par les explications échangées entre les deux gouvernemens, les malentendus regrettables qui s’étaient produits sur les lieux mêmes ne pouvaient en aucune manière paralyser la liberté d’action de notre escadre, dès qu’il s’agissait de venger nos compatriotes et d’infliger une correction exemplaire à un ramassis de forbans.
Les navires français avaient jeté l’ancre à petite distance de terre, dans une baie abritée contre les vents. Le rivage était en quelque sorte tendu d’un vert rideau de palétuviers, et les branches des arbres, inclinées vers la mer, semblaient reposer sur l’eau. On n’apercevait aucune trace d’habitation ou de culture, tout était désert ou sauvage. Au fond de la baie, entre Bassilan et l’îlot de Malamawi, s’ouvrait un chenal de trois milles de long, que l’Archimède parcourut dès le premier jour de notre arrivée. J’étais embarqué sur le steamer, et je me souviens du spectacle vraiment admirable qui s’offrit à nos yeux. Qu’on se figure un canal parfaitement droit, encaissé entre deux forêts vierges et reflétant dans une eau calme et limpide la fraîche verdure de ses bords : des essaims d’oiseaux au riche plumage voltigeaient d’une rive à l’autre. L’Archimède, poussé rapidement par la vapeur, troublait seul, au bruit de ses roues, cette charmante solitude. Ce n’était pas seulement un délicieux tableau, c’était un port merveilleux, et déjà nos imaginations impatientes défrichaient les forêts, fondaient une ville, construisaient des forts et comptaient dans ce magnifique bassin des milliers de navires ! Beaux rêves, qui devaient, comme tant d’autres, s’évanouir ! Aujourd’hui encore, le port de Malamawi n’est sillonné que par les rares pirogues des indigènes de Bassilan.
Notre premier séjour en vue des cotes de l’île se prolongea près de trois semaines : nous ne pouvions aller à terre que sur l’îlot désert de Malamawi, où les chasseurs se mirent d’abord en campagne, on tua un sanglier et quelques singes qui figurèrent sur les tables des états-majors ; on fit aussi rencontre d’un caïman, et cette découverte refroidit le zèle des plus intrépides. C’était d’ailleurs une assez médiocre distraction, que de se promener, le fusil à la main, au milieu d’épaisses broussailles et sur un sol marécageux où le pied enfonçait à chaque pas. Il fallait à tout moment se héler pour ne point se perdre ; le maître-canonnier de la Cléopâtre s’égara dans les palétuviers ; six hommes, envoyés à sa recherche, s’égarèrent à leur tour ; on ne les retrouva que le lendemain ; ils avaient passé la nuit, non pas même à la belle étoile, mais à l’ombre peu hospitalière de la forêt. On s’imagine volontiers, sur la foi des poètes, que les forêts vierges sont peuplées de grands arbres qui projettent librement leurs immenses rameaux et qui se dressent, majestueux et solennels, comme les géans de la création ! Cette description, consacrée par les classiques, est assurément très hasardée. Dans les forêts inexplorées des tropiques, la végétation ne produit guère qu’un fouillis d’arbres rabougris, de racines, de lianes, dont l’ensemble, couvert d’un manteau de verdure, peut de loin charmer la vue ; mais n’allez pas contempler ces merveilles de trop près, et ne vous avisez point d’expérimenter les agrémens de ces bois vierges ! Quant à nous, après quelques jours de tentatives infructueuses pour nous orienter dans ce dédale, nous avions pris le sage parti de ne plus quitter le rivage, où la pêche des coquillages remplaça l’exercice de la chasse. Notre relâche malaise aurait donc été des plus tristes, si nous n’avions eu pour nous distraire les visites de quelques chefs indigènes qui venaient conférer avec l’ambassadeur et l’amiral sur la destinée de leur île.
Le territoire de Bassilan est partagé entre plusieurs tribus, dont les chefs se font souvent la guerre. C’était sur la tribu du chef Youssouk que nous avions à tirer vengeance de l’assassinat de M. de Maynard, et nous entretenions des intelligences avec Baran, Panglimat Tiran et Arac, chefs d’une autre tribu. Ces trois sauvages se rendirent plusieurs fois à bord de l’Archimède et de la Cléopâtre. Baran portail des souliers, une robe de colon et un sabre qui lui avaient été donnés par la Sabine ; mais cet accoutrement trop compliqué paraissait le gêner singulièrement, les Malais de sa suite ne portaient presque rien. De part et d’autre, les relations étaient fort amicales, et si l’on avait eu la pensée de s’établir immédiatement dans l’île, la tribu s’y serait sans doute prêtée de très bonne grâce. En tous cas, avant d’entreprendre une nouvelle expédition contre Youssouk, on jugea convenable de s’entendre avec le sultan de Soulou. Le 4 février, la Cléopâtre, la Victorieuse et l’Archimède quittèrent les côtes de Bassilan, et le lendemain les trois navires étaient mouillés devant la capitale de l’archipel.
L’arrivée de trois navires de guerre produisit un grand effet dans la ville. La plage, était couverte de monde, et nous pouvions distinguer dans la foule les symptômes d’une vive agitation. Les maisons ou plutôt les cases de Soulou s’avancent jusque dans la mer et sont bâties sur pilotis ; au second plan, on aperçoit un fort garni de quelques pièces de canon ; autour de la ville s’étend une vaste plaine qui s’élève en amphithéâtre et qui parait bien cultivée. Ce tableau était donc beaucoup plus gai, plus animé que celui des palétuviers de Bassilan, et nous avions la perspective d’une relâche moins maussade ; nous devions cependant être internés à bord, car il n’eût pas été prudent de s’aventurer au milieu d’une population qui semblait fort excitée, et dont les antécédens n’inspiraient pas la moindre confiance. Les habitans de Soulou ne savaient pas d’ailleurs si nous venions en amis ou en ennemis, et ils se tenaient sur leurs gardes. Nous vîmes défiler sur la plage une bande de Malais armés de kris et de longues lances, les uns à cheval, les autres sur des buffles, et se dirigeant vers la ville qu’ils croyaient sans doute menacée. En même temps, les nombreuses pirogues qui se trouvaient disséminées le long de la côte rentraient en toute hâte au port. Lorsque le premier émoi fut passé, quelques bateaux se détachèrent du rivage et s’approchèrent de l’escadre ; peu à peu, chaque navire fut entouré par une flottille de pirogues remplies de provisions, poulets, fruits, légumes, que nous apportaient, des Chinois et des Malais. Dès que les gamelles eurent fait leur choix, vint le tour des marchands de kris, de coquillages, de perroquets, etc. Les Chinois demandaient généralement à être payés en piastres ; mais les Malais acceptaient des bouteilles vides, des miroirs cassés, des couteaux, des mouchoirs, des boutons, en sorte que l’équipage pouvait se livrer à peu de frais aux spéculations de la place. Le marché fut en pleine activité pendant la durée de notre séjour. Les échanges étaient souvent des plus grotesques et donnaient lieu aux scènes les plus divertissantes. Il fallait voir les matelots marchandant avec les Bédouins ! Ils saisirent l’occasion de vider leurs sacs, et Dieu sait ce que contient, après une longue campagne, le sac d’un matelot.
Dans les pirogues qui stationnaient le long du bord, nous avions remarqué plusieurs Tagals (indigènes de Luçon). La plupart avaient été enlevés par les pirates de Bornéo qui les avaient vendus sur le marché de Soulou : leurs maîtres leur défendaient de s’entretenir avec l’équipage. Une nuit, la sentinelle de l’Archimède vit apparaître tout à coup sur le pont un homme qui avait accosté le navire à la nage, et qui se précipita à genoux en faisant mille signes de croix. C’était un Tagal : il venait de s’échapper de terre, et il suppliait qu’on lui accordât asile et protection. Il annonça qu’il y avait à Soulou un grand nombre de prisonniers chrétiens. Les Malais avaient eu soin d’envoyer la plupart de leurs esclaves dans l’intérieur de l’île, dès que l’escadre avait été signalée ; mais plusieurs captifs réussirent à s’évader, et l’amiral ordonna qu’on les reçut à bord. Pendant quatre ou cinq nuits, il nous arriva ainsi des réfugiés. Les Malais, n’osant réclamer leurs esclaves, doublèrent leurs sentinelles, établirent une ligne de pirogues qui croisaient autour de l’escadre, allumèrent des feux sur le rivage et exercèrent la plus active surveillance. Parfois, nous entendions des coups de fusil, dirigés sans doute contre les malheureux qui venaient à nous. On eut du moins la consolation de sauver une douzaine de Tagals qui furent plus tard reconduits à Manille.
Cependant le ministre de France s’était mis en relation avec le sultan, et celui-ci avait choisi pour principal intermédiaire un Anglais, nommé Wyndham, qui habitait Soulou depuis plusieurs années. — Les Anglais sont partout ! Sur quelque rive que l’on aborde, on est sûr de rencontrer un fils d’Albion se livrant au négoce et préparant les voies à l’invasion des produits britanniques. Même au milieu des tribus les plus sauvages, il se sent protégé par son titre de sujet anglais ; il sait qu’à la moindre insulte, un navire de guerre sera là pour le défendre ou le venger. — M. Wyndham exerçait sur le sultan une grande influence ; ce fut lui qui amena à bord les chefs malais, ce fut lui encore qui servit d’interprète dans les conférences relatives à la cession de Bassilan. Comment s’étonner des progrès de la politique anglaise dans les mers d’Asie, lorsque partout le cabinet de Saint-James se trouve ainsi représenté par des agens non officiels, par conséquent irresponsables, qu’il peut, suivant les circonstances, soutenir ou désavouer ? C’est la diplomatie la plus commode et la moins coûteuse ; parfois il en est sorti des hommes éminens qui par d’heureux coups d’audace ont merveilleusement servi leur pays sans le compromettre : témoin ce rajah Brooke que nous avons vu tout à l’heure trônant à Sarawak. L’Anglais de Soulou, M. Wyndham, n’arrivera jamais sans doute à une si haute fortune ; mais il remplit dans cet archipel, encore peu fréquenté par les européens, le rôle utile d’éclaireur, et il ne manque pas de faire connaître au gouverneur de Singapore ou aux commandans des navire ; de guerre qui croisent dans ces parages les moindres incidens dont il est chaque jour témoin. Au moment même où l’escadre française était mouillée devant Soulou, une frégate anglaise, la Samarang, venait jeter l’ancre auprès d’elle, et M. Wyndham s’empressa naturellement d’instruire le capitaine sir Edward Belcher des négociations pendantes au sujet de Bassilan. Du reste, il eût été bien difficile d’assurer le secret de ces négociations, car les entrevues de l’ambassadeur et de l’amiral avec le sultan avaient lieu dans une grande salle où siégeaient les datons (principaux chefs de l’île) et en présence du peuple qui était admis en armes au sein du conseil. Les discussions furent très animées. À chaque discours, la foule manifestait librement son opinion par des applaudissemens ou par des injures ; souvent on voyait briller les kris et frémir les lances à la voix d’un orateur populaire qui repoussait avec éloquence la proposition de l’étranger. Le forum était là avec ses tempêtes et ses calmes. Un moment, la délibération fut sur le point de tourner au tragique. Un banc surchargé de monde se cassa, et voilà une dizaine de Malais par terre. Le peuple du dehors, qui entend le tumulte sans en connaître la cause, se figure qu’une lutte s’est engagée, et il veut se précipiter dans la salle. Vainement les datons, qui ont à défendre non-seulement leur propre dignité outragée, mais encore le caractère et peut-être même la vie de leurs hôtes, tentent-ils d’apaiser la colère de la foule. Comment se faire entendre à travers ces clameurs auxquelles se mêle le cliquetis fort significatif et peu rassurant des armes tirées hors du fourreau ? Nous-mêmes, demeurés à bord des navires, nous ne savions que penser de l’agitation extrême qui s’était répandue dans la ville, et nous observions avec la plus vive anxiété le mouvement inaccoutumé qui poussait dans la direction du palais la population du rivage. L’ignorance complète où nous étions de l’incident qui venait de se produire augmentait notre inquiétude, et nous nous rappelions avec effroi la trahison de Bassilan. Cette fois, c’étaient les deux chefs de l’expédition qui se trouvaient exposés aux fureurs d’une tribu de pirates ! Heureusement tout finit par se calmer ; le sultan parvint, non sans peine, à contenir ses sujets, et la délibération reprit son cours. Mais quelle émotion pour un banc cassé ! Quant à la demande qui était en discussion, elle rencontra de graves obstacles ; je crois cependant que si le gouvernement français avait persisté dans son désir d’acquérir Bassilan, il lui eût été facile d’obtenir plein succès, à force de piastres, argument irrésistible aux yeux des Malais.
Après ces pourparlers, aucune affaire ne nous retenait à Soulou, et le 22 février l’escadre remit à la voile pour Bassilan. La Cléopâtre, la Victorieuse, la Sabine et l’Archimède se trouvèrent de nouveau réunis au mouillage de Maloço, en vue du territoire appartenant à la tribu du chef Youssouk. Les équipages, qui appréciaient médiocrement les lenteurs de la diplomatie, étaient impatiens du venger sur cette bande d’assassins le meurtre de leurs camarades. Les mesures prises à bord de chaque navire par ordre de l’amiral annonçaient une expédition prochaine. Enfin le 27 février, au point du jour, toutes les embarcations furent armées en guerre : une partie, sous le commandement du capitaine de vaisseau de Candé, se dirigea vers l’embouchure de la rivière de Maloço, où l’on savait que les Malais avaient établi une forte palissade, tandis que les autres canots allaient déposer sur la plage une compagnie de débarquement qui devait pénétrer à travers bois dans l’intérieur de l’île, et prendre à revers la position de l’ennemi. Ces mesures paraissaient bien combinées : malheureusement la forêt était trop épaisse pour que la compagnie de débarquement, embarrassée par l’artillerie de campagne, pût s’y frayer un passage, et tout le poids de la lutte porta sur le détachement qui s’était engagé dans la rivière, arrivée devant la palissade, les canots furent accueillis par une décharge de mitraille qui tua deux hommes. Ils ripostèrent avec leurs caronades ; mais les boulets frappaient vainement les énormes troncs d’arbres derrière lesquels les Malais s’étaient mis à l’abri, et la lutte menaçait de se prolonger, lorsque le commandant de Candé eut l’idée de débarquer avec une partie de ses hommes, et de tourner la palissade par terre. Cette manœuvre réussit. Les Malais, attaqués à l’improviste, prirent immédiatement la fuite, laissant entre nos mains leurs armes, un canon et quatre espingoles, qui plus tard furent portés à Paris comme trophées de cette petite expédition. Le lendemain, les équipages retournèrent sur le lieu du combat. Les Malais avaient tout abandonné ; leur village, situé à peu de distance de ; la palissade, sur les deux bords de la rivière, était désert. Les matelots se dispersèrent par bandes dans la plaine ; le feu fut mis à toutes les cases et aux greniers de riz ; on abattit les cocotiers et les bananiers ; on fit la chasse aux buffles, aux poules, etc. En quelques heures, le village de Youssouk était réduit en cendres, et la population complètement ruinée. Sans doute une nation civilisée ne doit point se glorifier de tels exploits : quand on envisage froidement cette œuvre de dévastation, où l’homme vient détruire comme à plaisir les fécondes richesses du sol, quand on songe aux misères que laisse après elle l’aveugle razzia, on se sent disposé à condamner le vainqueur et à lui contester le droit de pousser ainsi à l’extrême la raison du plus fort. Cependant, il faut bien le dire, il n’y a point d’autre moyen de châtier ces peuplades incorrigibles qui sont perpétuellement en guerre contre la propriété d’autrui. De pareilles exécutions sont indispensables pour contenir ces tribus de bandits et de pirates ; ce sont les seuls argumens qu’elles comprennent, les seules vengeances qu’elles redoutent ; et la civilisation est condamnée à employer contre elles leurs propres armes. Les Malais de Bassilan et de Soulou ne se convertiront pas plus que les Serebas et les Sakarrans de Bornéo, et l’escadre Française, par la razzia de Maloço, a rendu à la navigation de ces mers un service signalé, en même temps qu’elle a accompli un acte de légitime vengeance. Le 2 mars, nous nous éloignions des côtes de Bassilan pour reprendre dans l’archipel de la Malaisie le cours de notre pacifique mission.
S’il faut en croire le capitaine Keppel, les habitans de Soulou auraient renoncé à la piraterie. Le 27 décembre 1848, le Maeander, ayant à bord sir James Brooke, jeta l’ancre devant Soulou, et les Anglais apprirent que, peu de temps avant leur arrivée, deux navires de guerre hollandais avaient lancé quelques boulets sur la ville et brûlé plusieurs cases, entre autres celle de M. Wyndham. Sauf cet incident, il ne s’était passé dans ces parages, depuis le départ de l’escadre française, aucun fait digne d’attention. Le sultan reçut en audience, solennelle M. Brooke et les officiers du Maeander : Le capitaine Keppel nous le représente entouré de son conseil de datons et de son peuple en armes, tel que l’avaient vu précédemment M. de Lagrené et l’amiral Cécille. L’entrevue fut des plus cordiales. « Après les politesses d’usage, dit M. Keppel, la conversation fut engagée par sir James Brooke ; qui, en sa qualité de commissaire de sa majesté britannique, soumit au sultan certaines propositions relatives au commerce. Sa majesté se montra fort disposée à y accéder. Elle rappela à sir James que la famille royale de Soulou était l’obligée des Anglais, puisque l’un de ses ancêtres avait été en 1763 tiré des prisons espagnoles de Manille et rétabli sur son trône par Alexandre Dalrymple. Ce retour vers le passé était d’autant plus généreux de la part de sa majesté, que son royal ancêtre n’avait point à cette époque laissé sans récompense le service qui venait de lui être rendu, car il avait cédé au gouvernement anglais une belle île voisine de Soulou (cession dont on ne parait pas s’être prévalu), ainsi que la pointe nord de Bornéo et la pointe sud de Patawan avec les îles intermédiaires. Nous prîmes congé de sa majesté. Il ne fut point conclu de traité avec le sultan : mais sir James avait préparé les voies pour l’ouverture du commerce et pour le développement de nos relations avec les indigènes ; » Cette courte citation ne saurait passer inaperçue. On y voit poindre les prétentions des Anglais sur différentes régions fort importantes de l’archipel, prétentions qui d’un jour à l’autre deviendront plus explicites, et pourraient bien se traduire par une prise de possession. C’est ainsi que la Grande-Bretagne se crée partout des droits qu’elle tient soigneusement en réserve et qu’elle fait valoir en temps opportun ; M. Wyndham, ce paisible négociant de Soulou, qui n’oublie jamais, je le dis à son honneur, les intérêts de son pays, n’avait-il pas, de son côté, conseillé à ses amis les Malais de placer sur le pavillon de leurs pros la croix de Saint-George ; pour être reconnus et ménagés par les croiseurs anglais ? Le procédé était fort simple : cependant les Malais ne se laissèrent point séduire par la croix de Saint-George, et ils gardèrent leur pavillon. Ce détail, mentionné par le capitaine Keppel, est assez caractéristique. Le Maeander resta huit jours dans la baie de Soulou. Sir James Brooke n’avait échangé avec le sultan que des paroles et des politesses, et il n’était pas homme à se contenter de si peu. L’habile rajah de Sarawak ne se met point en campagne, sans avoir dans sa poche un traité de commerce qu’il présente intrépidement, comme une traite échue, à l’acceptation des majestés indigènes. Au mois d’avril 1849, il reparut à Soulou avec l’inévitable traité, et cette fois il obtint la signature du sultan, devenu par ce fait l’allié et l’ami des Anglais. Aussi le capitaine Keppel se hâte-t-il de déclarer que, sous l’influence de sir James Brooke, cet ancien chef de pirates s’est entièrement converti, et il blâme très amèrement les Espagnols d’avoir cherché querelle à Soulou au moment même où les Européens, c’est-à-dire les Anglais, allaient profiter des avantages que leur offrait l’ouverture d’un nouveau marché.
De toutes les nations européennes qui possèdent des colonies dans ces parages reculés de la Malaisie, l’Espagne est sans contredit la plus intéressée à réprimer les audacieuses entreprises des pirates. Pendant de longues années, elle avait fermé les yeux sur les brigandages qui se commettaient jusque sur les côtes des Philippines : la marine de Manille était trop faible pour exercer dans ces mers une surveillance efficace ; mais l’expédition des français contre le village de Maloço révéla à l’Espagne les inconvénients et les dangers d’une tolérance qui accusait si manifestement sa faiblesse, et le cabinet de Madrid comprit qu’il ne pouvait laisser à d’autres pavillons la police de l’archipel sans abdiquer en quelque sorte les droits de souveraineté qu’il avait invoqués à l’occasion de la campagne de Bassilan. Son intérêt et même son honneur lui commandaient de prendre à son tour des mesures décisives contre la piraterie. Au mois de. février 1848, le général Claveria, gouverneur des Philippines, arma une flottille, partit de Manille avec quatre mille hommes, et alla attaquer une tribu de Soulou qui était établie sur l’île de Balanguigui. Les pirates s’étaient retranchés dans une forteresse en bambou, défendue par quatorze pièces de canon. Les troupes de débarquement donnèrent l’assaut le 13 février. Les Malais se battirent bravement ; quand ils virent que la résistance était désespérée, ils massacrèrent eux-mêmes les femmes, les enfans et les vieillards de la tribu, et se firent tuer jusqu’au dernier. Deux autres forts (Sipac et Sungap) furent pris pendant la même, campagne. — A son retour, le général Claveria fut accueilli avec enthousiasme ; on lui dressa des arcs de triomphe ornés d’inscriptions pompeuses, et la population tagale, qui n’a guère d’ardeur que pour les fêtes et les combats de coqs, célébra par les démonstrations les plus joyeuses cette première victoire, remportée contre les Mores. Il ne s’agissait pourtant que de la destruction de trois forts en bambou et de la défaite d’une poignée de sauvages ; mais les Tagals, élevés dans la crainte de Dieu et des Mores, ne pouvaient rien imaginer qui fût au-dessus d’un pareil exploit. Le général Claveria y gagna le titre de grand d’Espagne et de comte de Manille. — Par une singulière aventure, ses lettres de noblesse tombèrent entre les mains de pirates chinois. L’officier qui les lui apportait d’Europe par la malle de Suez, fut attaqué dans une traversée de Hong-kong à Macao. Heureusement les pirates furent pris à leur tour par un croiseur anglais et pendus à Hong-kong : on retrouva dans leur butin les dépêches de Madrid et le brevet, qui parvinrent ainsi à leur destination.
Deux ans après l’expédition de Balanguigui, le gouverneur général des Philippines, don Antonio de Urbistondo, marquis de la Solana, qui venait de succéder au général Claveria, saisit la première occasion qui s’offrit à lui pour demander raison au sultan de Soulou de divers actes de piraterie, commis au préjudice de sujets espagnols. Il voulut en même temps conclure avec le souverain de l’archipel un traité qui assurât à l’Espagne les avantages concédés à l’Angleterre sur les instances de sir James Brooke. Il se présenta donc devant Soulou, vers la fin de février 1851, avec des forces considérables. Loin d’accueillir ses propositions et de faire droit à ses demandes, les Malais insultèrent le pavillon espagnol et provoquèrent la lutte. Ils occupaient plusieurs forts armés d’une centaine de pièces de canon. Les navires ouvrirent le feu sur la ville pendant que les troupes de débarquement s’élançaient à l’attaque des forts, qui furent enlevés après une vive résistance. Le sultan et les datons se réfugièrent dans l’intérieur de l’île, où il eût été difficile de les poursuivre. Cette victoire coûta aux Espagnols trente-quatre hommes tués et quatre-vingt-quatre blessés ; mais elle fut décisive, et elle prouva aux pirates que désormais le gouvernement des Philippines ne se laisserait plus outrager impunément.
Ces corrections répétées suffiront-elles cependant pour intimider les Malais ? Cela est douteux, et les croiseurs anglais, hollandais et espagnols devront longtemps encore exercer dans l’archipel une police rigoureuse. On ne détruit pas en un jour des habitudes aussi invétérées. Essayez donc de prêcher la morale et le respect de la propriété à des tribus qui pendant des siècles ont vécu de rapine, et de pillage ! La force seule aura raison de ces forbans. C’est par la conquête, par la domination absolue, que les peuples européens couperont le mal dans sa racine et effaceront les derniers vestiges de la barbarie asiatique. On a conclu de nombreux traités avec les principaux chefs de tribus, qui, sous la menace du canon, se sont empressés de renier la piraterie et d’accueillir les plus séduisantes propositions de paix et de commerce ; mais à peine les navires de guerre sont-ils hors de vue que les Malais remontent sur leurs pros, réunissent leurs ballas et partent en course. Tôt ou tard, et le plus tôt sera le mieux, on se lassera de cette chasse continuelle à la poursuite d’ennemis presque insaisissables, et au lieu d’expédier dans les détroits d’insuffisantes et coûteuses croisières, on occupera définitivement les territoires, et on comprendra la nécessité en même temps que l’économie de la conquête. L’Angleterre est déjà entrée dans cette voie. L’établissement de Sarawak, qu’est-ce autre chose que le début de l’invasion britannique sur les côtes de Bornéo, et sir James Brooke, vainement déguisé sous son titre de rajah, ne représente-t-il pas bien plutôt un délégué de la reine Victoria qu’un souverain malais ? — Les Hollandais seront également tenus de consolider et d’étendre leur domination dans les îles de la Sonde ; ils possèdent à Batavia une forte marine à vapeur et de vaillantes troupes qui ont récemment fait leurs preuves contre les indigènes de Bali. — Les Espagnols eux-mêmes, on vient de le voir, ont résolument attaqué Soulou. — Si la France s’était emparée de Bassilan, elle aurait eu, elle aussi, un rôle à jouer dans la lutte engagée avec la piraterie.
Je ne crois pas qu’on doive regretter l’abandon des projets formés sur Bassilan. Les événemens dont j’ai rendu compte se passaient en 1845 ; à cette époque, le gouvernement avait tout intérêt à ne pas compliquer par des difficultés intempestives l’un des actes les plus hardis de sa politique extérieure, la négociation des mariages espagnols. Il ne s’agissait d’ailleurs que d’un îlot qui n’a de valeur que par son port, et en y plantant notre drapeau, nous nous serions imposé les charges d’une surveillance très dispendieuse sur les pros de Soulou. Mais ce qu’il faut déplorer amèrement, c’est de voir la France complètement en dehors des intérêts qui s’agitent dans ces régions de l’Asie. D’autres peuples, mieux avisés et plus heureux, seront assurés de tous les archipels, de toutes les îles ; nous sommes arrivés trop tard, il ne restait plus rien. Serions-nous donc éternellement condamnés à assister de loin, et sans y prendre part, à l’extension de l’influence européenne sur un si vaste théâtre ? N’existe-t-il aucun moyen de pénétrer dans l’extrême Orient et d’y fonder pour l’avenir un établissement digne de nous ? — Parmi les grandes îles qui dépendent des Philippines et de l’archipel de la Sonde, il en est sur lesquelles l’Espagne et la Hollande ne possèdent qu’une autorité nominale et dont elles ne sont pas en mesure d’exploiter les immenses richesses. Pourquoi ne tenterait-on pas d’obtenir, à prix d’argent, la cession d’un territoire appartenant à l’une ou à l’autre de ces deux puissances ? En face des agrandissements gigantesques de la domination anglaise, notre présence en Asie maintiendrait, au profit de la Hollande et de l’Espagne, l’équilibre qui menace à chaque instant d’être rompu par la Grande-Bretagne ; elle garantirait à la Hollande l’exécution du traité de 1824, à l’Espagne la propriété de Luçon : elle serait, en un mot, pour tous les peuples un gage de sécurité et de paix, en même temps qu’elle procurerait à l’œuvre commune de la colonisation asiatique un nouvel et puissant auxiliaire. — Dira-t-on que la France n’a que faire de s’engager dans une pareille aventure et de porter son ambition si loin ? On aurait pu, il y a vingt ans, tenir ce langage ; aujourd’hui, bien aveugles ceux qui n’aperçoivent pas le mouvement irrésistible qui entraîne l’Occident vers l’Orient ! Bornéo, Sumatra, Mindanao, ces grandes îles encore sauvages, sont appelées à devenir de magnifiques colonies. Encore un peu de temps, l’Europe les pénétrera de toutes parts, et la piraterie, malaise, noyée dans les flots toujours montants de la civilisation, aura disparu.
Charles Hubert Lavolée
Les Pirates Malais
La Revue des Deux Mondes
Deuxième série de la nouvelle période
Tome 3
1853
PARIS