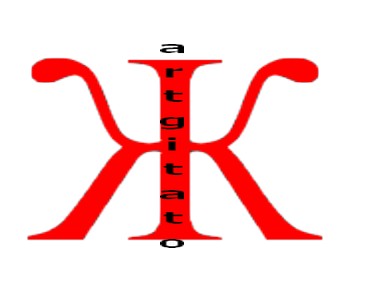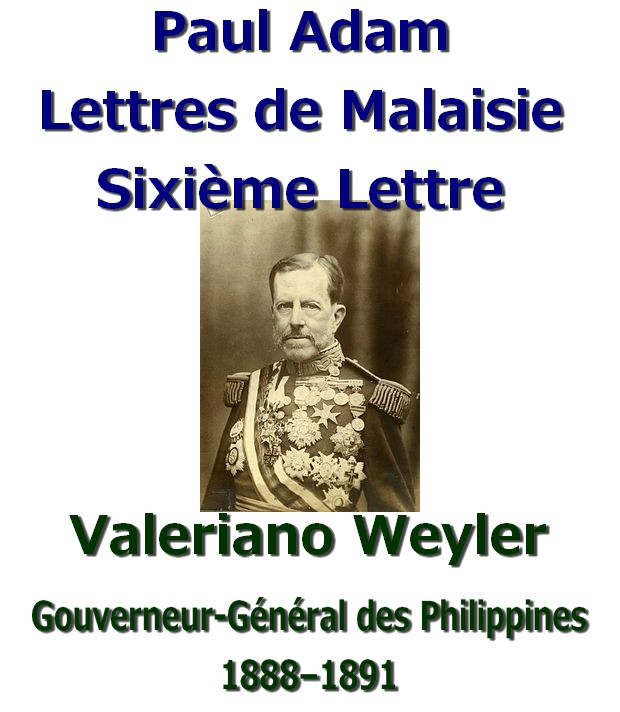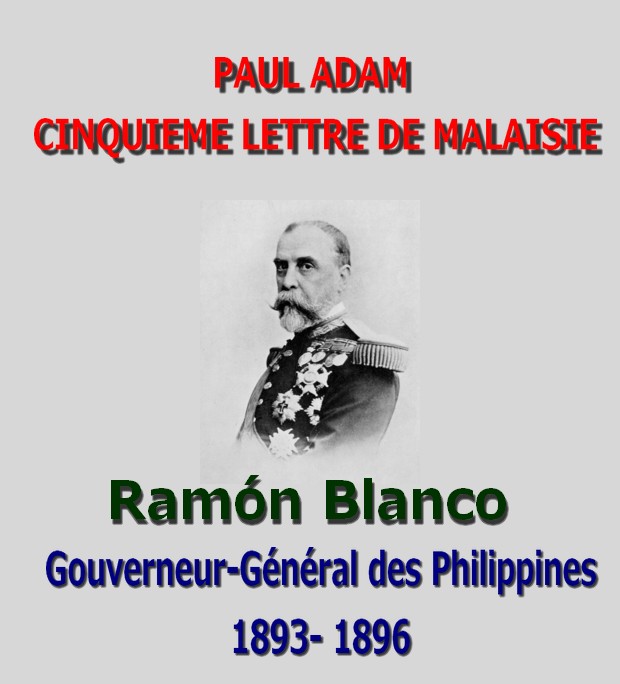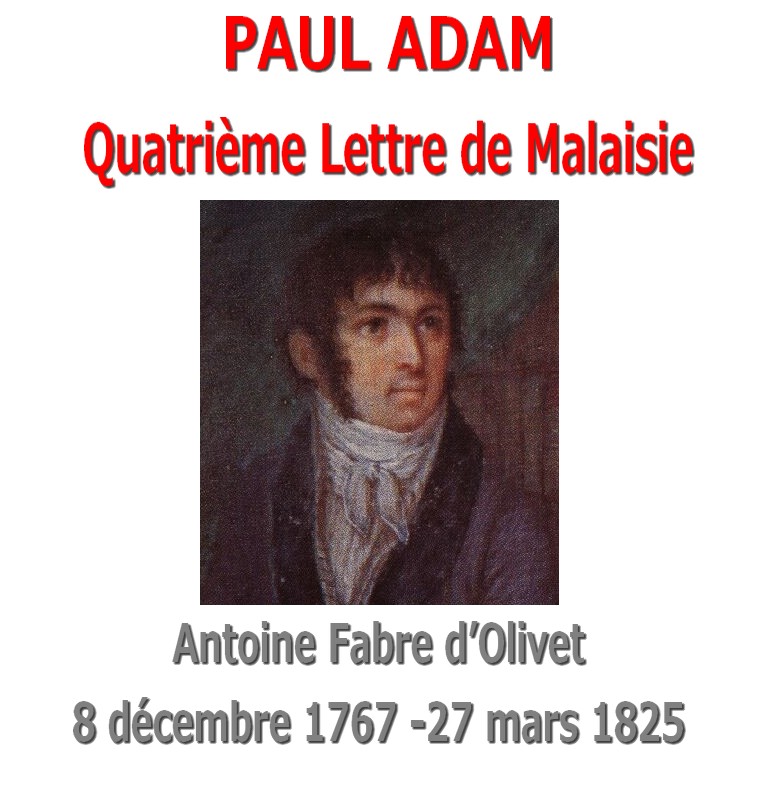MALAISIE – MALAYSIA
PAUL ADAM LETTRES DE MALAISIE
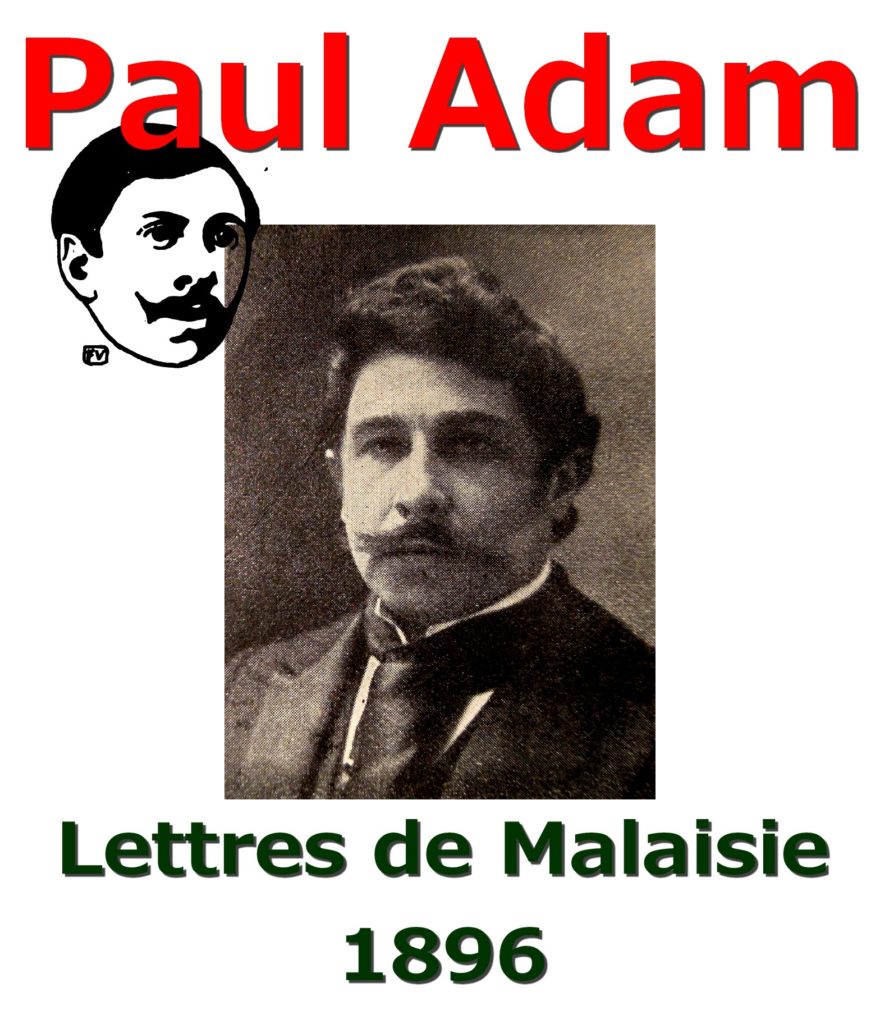
D’après une photo de Nadar et le portrait de Félix Valloton
—
PAUL ADAM
1862 – 1920
LETTRES DE MALAISIE
1896
ONZIEME LETTRE
& DERNIERE LETTRE
Texte paru dans La Revue Blanche
Paris
1898
*****
 Portrait de Paul Adam
Portrait de Paul Adam
Félix Vallotton paru
Le Livre des masques de Remy de Gourmont
1896
***
ONZIEME LETTRE DE MALAISIE
Vulcain
En bruissant avec violence, les ailes de l’aéronef nous ont enlevés hier. La ville se rétrécit. Les champs perdirent leurs couleurs. Les routes se réduisirent. La terre sembla tomber dans les abîmes lumineux du monde ; et les nuages nous enveloppèrent un temps.
On s’habitue mal au tumulte de l’air où se visse l’hélice, et que battent les ailes mécaniques. La parole humaine ne s’entend pas. Nous portons des maillots épais qui ne laissent pas de prise au vent. Il faut marcher en se tenant aux tringles et aux cordes. Au-dessus de nous la voilure qui règle la marche, s’enfle et courbe la nef sur son axe de direction. Placée à l’arrière une misaine énorme fait l’office de gouvernail, appuie sur les souffles. C’est la queue de l’oiseau artificiel nous emportant à travers le brouillard tiède. La mâture crie. Le volant tourne si vite qu’on perçoit à peine un grand halo de lueur grise à la poupe. Enfermées dans une cabine de toile, les machines mystérieuses et les accumulateurs de force palpitent de leurs bruits huilés. De lents tic-tac gouttent. Mais il demeure interdit d’approcher afin de connaître le miracle. Pythie disait : « — Nous possédons en lui la puissance de changer l’organisme des peuples. Quand s’achèvera la fabrication de nos escadres aériennes, lorsque le nombre des bâtiments nécessaires sera construit, alors nous nous élèverons sur le Vieux Monde en un vol dense, telles ces armées d’archanges titaniques aux ailes sombres qu’annoncèrent les Écritures. Notre force formidable ira du Sud au Nord. Elle planera. Elle illuminera la nuit d’astres nouveaux. Elle sillonnera le jour de ses pavillons et de ses banderoles. Son essor aigu coupera l’espace, par dessus les foules épouvantées et le tocsin des villes. Aux tirs des canons, aux feux des armées réunies par les maîtres de l’injustice répondront les chutes éclairantes de nos torpilles et les explosions formidables capables d’anéantir les Babylones. Après, nous débarquerons les charrues et les semoirs. Les limites seront nivelées, les bornes renversées ; la moisson couvrira toute la terre pour la faim de toutes les bouches. Nous cernerons la mort, la détresse et le désespoir dans leurs retranchements suprêmes…
« Or il ne faut pas que l’on découvre le mystère de notre force avant l’heure de sa bienfaisance. Supportez la règle qui prescrit de ne pas l’approfondir. Écoutez à distance la vie paisible de la machine. Savez-vous ceci ? le groupe qui inventa le miracle accepta de se sacrifier pour le sort du monde. Dix-neuf, ils sont partis vers la montagne avec le secret.
« Dans une gorge affreuse, séparés des hommes, ils vivent au milieu des forges, et hâtent le travail des Malais, des soldats. Vous allez connaître la ville de Vulcain, les incendies de ses hauts-fourneaux ? Là s’élabore la transformation prochaine de la vie au cœur des cimes… »
De ses ailes, la nef secoua l’ouate des dernières couches nuageuses, et nous apparûmes à la chaleur du soleil. Sur la mer de blancs brouillards émergeaient, immenses, lépreux, des rocs entassés dans l’horizon de soleil. Nous montâmes encore et découvrîmes, au milieu de ce chaos infini, les fumées d’usines occupant un plateau triste.
« — Voici Vulcain, annonça Pythie. Voici la cité de fer et de feu ; voici la tête ouverte de la montagne métallifère, et la plaine qui retentit de l’activité des hommes ; et voici le vol des nefs nouvelles qui évoluent dans l’air pour exercer la stratégie des commandants… »
De tous les points du ciel, des escadres planaient, montaient, descendaient par dessus le masque des nuages les dérobant aux curiosités de la terre.
Des arcatures de fer, basses contre le sol, enferment le fracas du fer. Il y a des échafaudages pour enclore les carcasses des nefs en construction. Les grues hydrauliques hissent les énormes pièces des hélices. On ajustait à grands chocs de marteau les assises des mâtures. En haut de tours à claire-voie, supportant, par quatre, une plateforme, certains minuscules êtres achevaient l’arrimage des bâtiments finis. Vaste et léger, l’aérostat ainsi maintenu étale ses ailes au large des tours. Leur ombre, à terre, protège le travail de maintes équipes.
Notre nef commença par entreprendre de vastes cercles en volant. Les voiles s’inclinaient. Depuis la pointe des mâts les focs frémissaient le long des cordes. Nous tracions dans l’air des courbes concentriques qui allèrent se réduisant jusque vers la plateforme de quatre tours. Le vent tournoyait, vibrait. Et nous finîmes, ayant rasé une fois le bord du débarcadère, par y poser doucement.
Les ascenseurs nous mirent à terre. C’est la même ville d’avenues larges, de longues façades peintes, d’arcades où s’ouvrent des salons commodes entre les serres des réfectoires et où les phonographes parlent. Des jets d’eau fusent sur les pelouses des nymphées construites autour des groupes statuaires qui perpétuent le souvenir des inventions. Les quilles des tramways glissent sur le rail des chaussées. On entend la voix des grandes orgues. L’éclosion multicolore des fleurs enivre l’air.
En habit rouge les travailleurs vont, ainsi que les travailleuses. Vers l’entrée des usines il se dresse des portiques admirables où la sculpture représente les travaux de Vulcain, ceux des kobolds et des gnomes remuant les richesses de la terre avec leurs courtes pelles. Le fracas entendu de loin augmente peu quand on approche des usines. Une savante hydraulique ménage des glissements doux. Le fer s’écrase presque sans bruit sous les pilons sourds ; c’est une mie de feu que pétrit un pouce d’acier. Des ventilateurs entretiennent une température égale. Les ingénieurs assis règlent l’effort, en appuyant sur des touches numérotées. Très peu de charges sont mises aux bras des hommes. Des pinces d’acier saisissent les masses et les barres, les élèvent, les présentent, les retirent et les jettent sans le secours humain.
Du sol montent des antennes de métal, des pinces coudées, des griffes articulées, qui œuvrent. Quelques femmes, aux claviers de force, dirigent, d’un pianotage alerte, ces mouvements que prépare dans le sous-sol un formidable et compliqué mécanisme soumis aux courants dispensés par les touches. L’énergie court le long des fils, s’élance dans le lacis des courroies rapides, lance des tentacules qui mordent le fer en fusion dans les fournaises. Point de cris d’hommes, point de clameurs de métal jeté sur le métal. Les jets d’étincelles sautent dans le soleil venu par les verrières.
Malgré la promesse faite, je ne puis m’empêcher de vouloir connaître le mystère industrieux des nefs aériennes.
Je songe au péril qui menace le monde, lorsque seront prêtes les escadres. Il m’appartient de préserver nos patries en les munissant de pareils engins de défense. Dans mon cœur tous les atavismes d’une race orgueilleuse s’émeuvent pour me crier de pourvoir à la protection de l’Europe en l’avertissant du danger, en surprenant le secret des constructions.
Et voici, j’étudie avec une intelligence sournoise, j’écoute battre les cœurs des mécaniques. Je flaire les haleines des gaz enclos dans les tubulures. J’épie la marche des rouages.
« — Oh, répète Pylhie, pourquoi te laisses-tu tenter, toi… Pense à La Seule Chose Interdite. Rappelle-toi tant de fables où la curiosité du héros cause sa défaite. Un sphinx veille ici qui dévorera ton existence si tu ne devines pas l’énigme assez habilement. Le destin du monde est un dogme trop lourd pour ne pas peser plus qu’une liberté humaine devant ceux de la Dictature qui maintiennent la balance juste. Je te sens chétif contre un tel sort. Prends garde… tu sollicites la fin de tes actions, et l’anéantissement de ta force… »
Car Pythie s’émeut pour moi.
Vraiment depuis que m’anime ce désir de connaître le mystère des cataclysmes prochains, depuis qu’elle m’assure de ma perte certaine, l’ironie voilée par ses cils blonds s’apaise : une douleur sûre plisse ses lèvres blanchies. Aucune des invites que lui miment les beaux hommes ne convainc plus sa volupté grave. Elle me suit avec tristesse dans les avenues de Vulcain, sous les arcades fraîches, au milieu des machines muettes et actives. Elle me regarde l’âme à travers les yeux. Il y a souvent du sanglot dans sa voix.
Parce que je cède au besoin de sauver l’esprit de ma race, ma compagne s’attendrit, disant : « — Voici que tous les vieux peuples d’Occident vivent en toi. La force des nationalités se dresse dans ta personne, et tu es tout ce qu’on nous apprit de l’histoire antérieure. Que de races parlent à cette heure dans tes phrases ; que d’énergies animent ton intention. Tu es ce qui fut contre ce qui sera. Dans tes gestes paraît l’élan fou des suprêmes défenses, tu es ivre de l’héroïsme dévolu à ceux qui succomberont… Cesse, cesse de chercher la Chose Interdite, tu ne la connaîtras point, sans disparaître pour ceux qui t’aiment. »
Je vais cependant. Je rôde autour des usines. J’interroge les manœuvres, les soldats, les jaunes aux yeux malicieux et las. Sans doute je pourrai savoir.
Il faudrait parvenir jusqu’aux chambres des ingénieurs qui ajustent les pièces construites en des ateliers différents. Déjà je n’ignore plus que l’accumulation de force s’obtient à l’aide d’un gaz très dense dont les molécules, sans cesse agitées par un moyen mécanique, poursuivent la multiplication de l’énergie incluse en eux. On enferme ce gaz dans des tubes faits avec un amalgame de platine et de diamant obtenu après de longues coctions au four électrique, à des chaleurs dépassant mille degrés. Mais ce gaz doit la naissance à la décomposition de métaux particuliers, rares, précieux, que l’on transporte avec soin dans des coffres fermés et sous la garde de plusieurs hommes.
J’ai voulu visiter les mines. On m’en a défendu l’accès. Des indigènes m’épient. Je les sens me suivre à pas mous dans les détours des arcades. Ils contemplent à côté de moi le chaos des monts violets, la mer illimitée des nues roses au-dessus de laquelle s’érige la ville, comme un port insulaire isolé sur l’océan. Ils sont près de notre table lorsque nous prenons, Pythie et moi, les repas du jour. Non loin du domicile assigné à notre halte, il en est qui veillent toute la nuit en jouant avec des billes et des miroirs. J’essaie d’en gagner plusieurs. Ils restent insensibles aux promesses de l’or, à l’espoir de triompher riches, dans nos patries.
Pythie blâme mon imprudence. Elle croit que les gens de la Dictature me laissent ainsi manœuvrer, afin de me convaincre tout à coup de trahison pour se saisir de moi, et m’enrôler de force dans les régiments de Mars. Ils regretteraient, selon elle, d’avoir autorisé ma visite dans leurs états. Ils redouteraient que j’apprisse au monde l’existence de leur prospérité, avant l’heure où pourront triompher les escadres aériennes.
De toutes ces craintes l’amour de Pythie, envers moi, s’augmente. Au crépuscule, nous parcourons le promontoire qui s’avance dans la mer de nuées. Les nefs reviennent au port avec de grands cris. Elles surgissent de la mer ça et là, montent au ciel rouge, s’y inscrivent en sombre avec leurs voilures enflées, le halo du volant, à l’arrière, la misaine du gouvernail et le chapelet des torpilles suspendues sous la passerelle inférieure. Les cris des sirènes les assemblent. Entre la surface pourpre des nues et le ciel écarlate, les nefs volent roides, aiguës du beaupré, vers les plateformes surmontant leurs quatre tours de fer. Les phares s’allument et tournent. Il brille dans le sombre sur l’échine bleue des montagnes de grands yeux mobiles, or, rouges, verts. La mer de nuages flotte sous les astres lentement apparus dans le ciel pers et bleu.
Alors, l’émotion du soir met les lèvres de Pythie sur mes lèvres. Tout son corps tremble contre ma poitrine… « — Tu vas mourir, dit-elle ; je sens que tu vas mourir… ; et je commence à te chérir pour ta faiblesse touchante. Tu vois. Je n’ai plus de bonté à l’égard de ceux qui ne sont pas les gaines de ton âme. Je ne regarde que le pays qui attire ta vision. Plus un parfum ne m’enchante s’il ne t’a plu ; j’admire la grandeur de ta barbarie qui résiste aux séductions de notre vie favorable et logique, pour, contre cette puissance, mesurer ton effort inutile. D’abord, j’ai méprisé ce besoin dont tu es imbu de te croire le centre du monde, d’imaginer ta liberté, ta noblesse, tes traditions, de respecter l’élan de ta race en toi. Moi, je ne comprenais que la fusion de l’individu dans le corps social, et sa contribution à l’âme universelle où il se perd. Je ne comprenais que cela, et je me donnais à tous les désirs de procréation, à la vie de tous, à l’instinct total des hommes. Je vivais l’orgueil de respirer par toutes bouches et de penser avec tous les cerveaux. Tu es venu, avec tes idées de jadis ; avec les folies de l’autre temps ; avec la jactance puérile du sauvage qui aime se dire incomparable. Tu rassemblas tout en toi. Je dispersais moi en tout. Et nous voici, ce soir, émus d’une palpitation pareille, sans que j’aie rien nié de ma foi, sans que tu aies rien nié de la tienne. Pourtant je sais que tu vas trahir mon idée. Ma volonté n’a point la force de te vaincre ; et je laisserai ton caprice détruire l’œuvre admirable…, afin de te complaire ; et je souhaite que tu trompes la vigilance des espions pour retirer aux peuples la chance ici concertée de leur affranchissement. Comme tu m’as changée, toi, toi !… toi qui me fais l’ennemie de mes espoirs, de mes croyances, de tout ce qui constituait mon être… Et je ne devine point la cause de ce changement. Tu es là ; je n’existe plus qu’en toi… Oh, tes lèvres, et la force de tes yeux !… »
Dire l’exaltation de mon triomphe — sur cet esprit vaincu par le mystère de l’amour, sur cet esprit logique et puissant, vaincu par le seul mystère de l’amour ! — Je ne saurais…
Nous consommons des soirs ainsi, au bord de la mer de nuages, alors que s’appellent les nefs aériennes dans le ciel constellé…
Telle fut la dernière lettre que je reçus de mon ami espagnol. Il n’a point reparu dans notre Europe. Sa famille demeurée sans nouvelles fit certaines démarches auprès du ministre pour savoir ce qu’il était advenu du diplomate et de sa mission. Une note récemment envoyée par le gouvernement de Manille prévoit que les pirates montant une embarcation d’insurgés philippins durent capturer l’aviso portant le fonctionnaire. Jusqu’à ce jour une enquête administrativement poursuivie n’a donné aucun résultat précis.