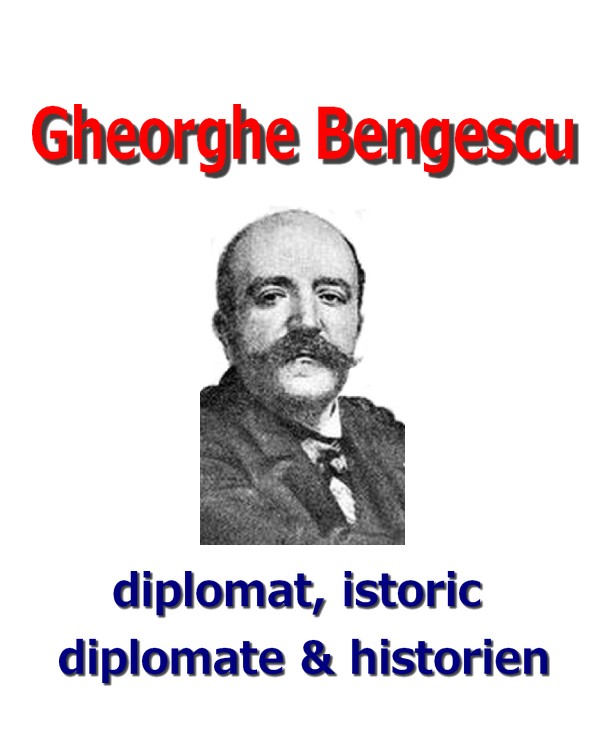******
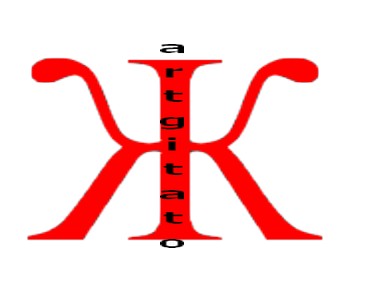
Géorgie
საქართველო
____________________________________________________________
LE PRINCE DOMENTI
SCENES DE LA VIE GEORGIENNE
1862
Par HENRI CANTEL
( – )
Revue des Deux Mondes
Tome 40

____________________________________________________________
Indolemment assise sur un fleuve entre la Mer-Noire et la Mer-Caspienne, la ville de Tiflis est le rendez-vous de l’Asie et de l’Europe. Vingt religions, vingt peuples divers s’y coudoient, et les contrastes les plus curieux s’y réunissent pour surprendre et enchanter le voyageur. Égarez-vous le jour dans ces rues que brûle un soleil de feu, et d’étranges tableaux ne tarderont pas à se disputer votre attention. Une caravane d’une centaine de chameaux s’avance lourdement, chargée des marchandises de la Perse, de la Bessarabie, de l’Inde ; leurs clochettes tintent monotones, sourdes, et involontairement on songe au morne silence des steppes. Quatre buffles attelés au col traînent avec lenteur une misérable charrette qui emporte toute une famille tatare ou géorgienne. Un galop de Cosaques, leur longue lance au poing, soulève des flots de poussière. Voici un enterrement grec qui défile, suivi de pleureuses qui déchirent l’air de leurs cris ; des pauvresses, en guenilles vous tendent une main amaigrie ; un paysan rencontre un prêtre, il lui. baise la main et reçoit en échange sa bénédiction ; un soldat russe, en face d’une église, se signe à tour de bras et fait la révérence. Où va cette pauvre Géorgienne pieds nus sur la dalle brûlante, tout enveloppée d’une grande pièce d’étoffe blanche ? A l’église, pour accomplir un vœu. Les marchands paresseux, assis devant leurs portes, regardent les passans en comptant les gros grains d’un chapelet. Sans craindre la chaleur du jour, les Arméniens, l’œil inquiet, pressent le pas en comptant leur gain de la veille et en pensant aux dupes qu’ils feront le lendemain. Mais c’est au coucher du soleil qu’il faut surtout parcourir les rues de Tiflis. Les balcons se peuplent alors de femmes, les terrasses se garnissent de jeunes filles qui dansent au son du tambourin. De toutes parts éclatent les chants et la musique ; la ville entière semble sortir du sommeil. Les jardins publics sont inondés de voitures, de cavaliers, de piétons. On se salue, on s’aborde, on cause, on se visite hors de chez soi pour ainsi dire. Les couples s’attablent devant les sorbets, les limonades, le thé, les fruits. La joie rayonne sur tous les fronts : après l’accablante chaleur de la journée, on éprouve une sensation de vrai bonheur à s’enivrer des souffles embaumés qui agitent mollement les arbres comme de grands éventails verts, et une sorte de familiarité s’établit entre des promeneurs qui n’ont ni la même patrie ni la même religion.
J’étais depuis plusieurs mois à Tiflis, et je ne pouvais me lasser du spectacle qu’offre la ville à ces belles heures du far niente. Au risque d’être classé parmi les voyageurs curieux dont parle Sterne, je me mêlais chaque soir à la foule, et bientôt je finis par avoir des amis de hasard qui soulevaient pour moi les voiles de leur vie intime, qui m’initiaient à leurs coutumes et me racontaient les histoires du pays. Je rencontrais souvent, entre autres, le prince Alexandre S… : c’était un Géorgien de très noble race, qui avait voyagé et qui avait rapporté de ses longs voyages une expérience inutile, comme il me le disait lui-même. Nous causions tous les deux de l’Asie, de l’Europe, des destinées du monde. Il souriait, et à mes rêves ambitieux il opposait les réalités de l’Orient actuel. — J’ai, ajoutait-il, visité la Russie, la Grèce, l’Allemagne ; mais je suis resté à moitié sauvage au milieu des douceurs de ma vie passée. Le luxe, si cher aux Asiatiques, m’apportait ses séductions ; mais les regrets de l’homme civilisé tombaient l’un après l’autre devant cette sauvagerie native qui reprenait sa proie. Les peuples orientaux ont beau venir boire aux sources européennes, ils sont comme peints des reflets de l’Occident : la civilisation ne les pénètre pas, et dès qu’une passion nous agite, on s’étonne de nous retrouver barbares.
— Prince, lui dis-je, depuis que vous êtes en relation avec l’Europe, vous n’avez gardé que le côté pittoresque et extérieur de la barbarie.
— Non, non, reprit-il, nous sommes des barbares, et je vais vous le prouver par l’histoire suivante.
Et le prince Alexandre me raconta en effet un épisode de la vie réelle à Tiflis qui me parut montrer dans tous leurs contrastes d’élégance et d’âpreté les mœurs géorgiennes.
Après deux jours de maladie, le vendredi 13 juillet 1853, le prince Dimitri Domenti avait rendu le dernier soupir dans son palais de Tiflis. Le médecin ignorait quel mal avait causé sa mort ; mais il avait quitté son chevet en ordonnant qu’on l’enterrât au plus vite, car la chaleur était excessive. Tout le monde était surpris d’une fin si prompte, si prématurée ; le prince n’avait que trente ans. On s’apitoyait sur lui, sur sa fille unique encore au berceau ; on plaignait le sort de la princesse Daria, qui atteignait à peine sa vingtième année. Chacun, la tristesse sur le front, allait et venait dans la maison, se racontant l’événement de la journée ; les serviteurs se parlaient à voix basse, les servantes pleuraient. Quant à la nouvelle veuve, agenouillée devant une image de la Vierge qu’éclairait une petite lampe, elle sanglotait à l’écart, déchirait les dentelles de son voile blanc, se frappait la poitrine et essuyait ses larmes avec ses longues tresses brunes. Peu à peu le désespoir s’enfuit devant une douleur plus calme, et aux phrases incohérentes et entrecoupées de cris succéda un abattement morne et silencieux. Puis, pâle, épuisée et comme lasse de son affliction même, elle se jeta la face contre terre en poussant des sanglots qui retentissaient au loin dans la maison. Malgré les caresses de Salomé, sa camériste favorite, elle refusa toute nourriture, même une tasse de thé. — Puisqu’il est mort, criait-elle, je veux mourir ! Seigneur, seigneur Dieu ! me pardonneras-tu ? Sois pour moi miséricordieux ! — Elle demanda des habits de deuil, et avec l’aide de Salomé elle se vêtit d’une robe noire bordée d’une bande blanche. Exaltée par son chagrin, elle fit ensuite le vœu d’aller pieds nus sur le tombeau de son époux le vendredi de chaque semaine pendant trois mois, de ne pas manger de viande durant le temps de son deuil, et d’habiller sa fille en rouge jusqu’à l’âge de sept ans. La servante l’écoutait silencieusement ; mais quand la veuve implora d’elle des ciseaux pour couper les quinze tresses qui la rendaient si belle, Salomé, fière elle-même des longs cheveux de sa maîtresse, s’écria que Dieu n’exigeait point tant de sacrifices. La princesse n’insista pas et se laissa tomber tout en larmes dans les bras de la fidèle camériste.
Pendant ce temps-là, Manoel, le frère de la veuve, qui était accouru en toute hâte, s’occupait des apprêts douloureux du lendemain ; il commandait le cercueil, les cierges, le char funéraire, la musique de deuil et les pleureuses. Le jour même, à la tombée de la nuit, on apporta la bière, dont les ornemens contrastaient avec l’idée grave de la mort, car sur un fond jaune et violet se croisaient des lames d’or et d’argent enroulées en capricieuses guirlandes. D’heure en heure, la princesse Daria quittait sa chambre pour venir s’agenouiller devant le mort, que veillaient un prêtre géorgien, une jeune servante et un garçon d’une douzaine d’années. Là, ses sanglots éclataient encore ; elle s’arrachait les cheveux et prononçait souvent à mi-voix ce mot : — Pardon ! — La plupart des domestiques de la maison, profitant du désordre général, s’étaient esquivés, et cherchaient des consolations dans les doukans (cabarets) du voisinage en buvant pour quelques chaours de vin de Kakhétie.
Un peu avant la nuit, on avait revêtu le prince Dimitri de ses plus beaux habits et on l’avait couché sur un lit de parade, les bras collés le long du corps. À ses côtés brillaient, à la lueur des cierges, des armes précieuses, et sur sa poitrine reposait un rameau de buis bénit. Plusieurs fois on lui avait fermé les yeux, qui se rouvraient soudain, comme à demi vivans, mais froids et sans regard. Si ses traits eussent été moins blêmes, moins immobiles, on aurait pu le croire endormi d’un sommeil magnétique, tant la mort avait respecté la calme beauté de son visage.
Vers minuit, toute la maison se livrait au repos, à l’exception de ceux qui veillaient le prince et de deux domestiques qui stationnaient dans l’antichambre. Le prêtre, qui avait copieusement soupé, sommeillait le nez sur sa poitrine ; une servante, jolie Géorgienne fraîche et blanche, déjà femme, dormait profondément aussi, allongée sur un tapis persan et la tête appuyée sur un coussin. Le petit drôle, voyant ses compagnons plongés dans le sommeil, se glissa doucement vers la servante, rampa sur ses mains et sur ses genoux, se signa trois fois et baisa la joue de la jeune fille, qui sans doute crut avoir été embrassée en songe, car elle ne s’éveilla point. Aux craquemens du plancher, le prêtre ouvrit les yeux, et, comme il avait soupé de caviar et de poisson salé, il demanda à boire. Le domestique lui apporta une lourde cruche d’argile pleine de vin que le saint homme tarit en un instant. Il marmotta une courte prière, aspergea le corps d’eau bénite, et se rendormit.
Les domestiques de l’antichambre, Basili et Iacob, las de jouer au loto, s’accroupirent l’un en face de l’autre et se mirent à causer.
— Aurais-tu cru, Basili, que le prince serait mort si vite ?
— Dame ! c’est aujourd’hui un vendredi, et le treize encore !
À ces mots, Iacob et Basili firent une demi-douzaine de signes de croix.
— Il était jeune, brave, robuste comme un platane ; cet âne de médecin l’aura tué.
— Basili, ne dis pas de mal des médecins ; cela porte malheur.
— Écoute, frère Iacob, je ne m’étonne pas que le maître soit trépassé : l’an dernier, au mois de septembre, je l’accompagnais au pèlerinage de Mtzkhèta ; nous revenions le soir à Tiflis ; tout à coup la lune se leva derrière une montagne, et le cheval du prince s’effraya et jeta son cavalier à terre. Alors je me dis en moi-même que le maître ne referait ce pèlerinage que dans le ciel.
— Ou dans l’enfer, interrompit lacob, car il ne s’est pas confessé, et il a eu une jeunesse…
— Tais-toi, murmura Basili, les murs ne sont ni aveugles ni sourds.
— Après, cela, il était bon, indulgent, généreux.
— C’est vrai ; jamais il ne nous a fait fouetter, quoique nous l’ayons mérité plus d’une fois, n’est-ce pas, Iacob ?
— Oui, oui ; mais la princesse, je ne l’aime guère, elle est orgueilleuse, parce qu’elle descend de nos anciens rois ; je hais comme la fièvre Vamiran, ce riche Arménien qui vaut moins que ses chevaux, qui oublie que son père était usurier, et qui rôde sans cesse autour des jupes de la princesse Daria.
— J’ai vu ici des choses qui…
— Parle, Basili, parle.
— Seras-tu discret ?
— Que ma langue se change en scorpion si je te trahis ! Basili approcha sa bouche de l’oreille de son compagnon.
— En es-tu sûr ? demanda lacob.
— Je l’ai vu, te dis-je ; le maître était allé à Telaw, chasser sur les terres du prince Tchavtchavadzé.
— Et il n’a rien su ?
— Est-ce que le buffle voit ses cornes ?
— Ces chiens d’Arménie ! s’écria Iacob indigné, une bonne peste ne viendra donc pas de la Perse pour les empoisonner tous ! Si nous, enfans de la belle Géorgie, nous sommes pauvres, c’est la faute de ces misérables qui ont tout acheté, tout pillé, tout volé.
— Ami Iacob, dit Basili en bâillant, j’ai soif, cours à la cuisine, apporte la grande cruche, nous boirons à la santé de l’âme du prince Dimitri.
— J’ai peur, reprit Iacob, il y a un mort, et la vieille Sophio, qui est un peu sorcière, m’a assuré que l’esprit du défunt erre dans la maison jusqu’à ce qu’on ait mis le corps en terre.
— Tu es brave comme un poulet de Mingrélie. Jouons une partie de loto, le perdant ira chercher le vin.
Tels étaient les propos qu’échangeaient dans l’antichambre de la salle mortuaire les deux plus fidèles serviteurs du prince Dimitri.
Déjà cependant le soleil empourprait les cimes neigeuses de la chaîne du Caucase. Qui n’a pas vu ces fêtes matinales de l’Asie ignore la puissance de la lumière. Ce n’est ni le soleil d’Italie, qui se lève dans un ciel d’azur, ni celui de la Grèce, qui illumine un firmament presque doré. La voûte céleste en Géorgie semble de nacre et d’opale ; au loin, grâce à la transparence de l’air, on aperçoit de cinq ou six lieues les vertes dentelures des sapins sur le haut des montagnes ; le soleil n’éclaire pas seulement le paysage, il le colore et l’enveloppe d’une vapeur impalpable qui adoucit les violences de la lumière. Les arbres reluisent de verdure, et dans le ciel plein de silence de grands aigles joyeux planent en rond, et d’un coup d’aile volent d’une montagne à l’autre.
Le frère de Daria alla réveiller les gens de la maison, qui dormaient tout habillés sur les balcons intérieurs. Après quelques cérémonies pieuses, selon le rite grec, Manoel et le prêtre déposèrent le corps de Dimitri dans la bière découverte, qu’ils entourèrent d’une vingtaine de cierges. Le prince avait l’air d’un guerrier que le sommeil a surpris le lendemain d’une bataille. Toute la journée on récita des prières devant les restes de Dimitri, jusqu’à l’arrivée du char funéraire. Une foule immense encombrait les appartemens et les abords de la maison mortuaire : c’étaient des nobles, des officiers, des marchands, des soldats, des serfs, des gens de toutes nations, car Dimitri jouissait d’une haute réputation de bravoure et de générosité. On plaça le cercueil sur le char, que traînaient six chevaux noirs recouverts de noires draperies. Le convoi se mit en marche. Quatre hommes portaient en avant le couvercle de la bière ; derrière le char plusieurs prêtres en étoles, qui brillaient aux rayons du soleil, chantaient l’hymne des trépassés. À travers les rues inégales et mal pavées, le cercueil suspendu tremblait à chaque pas des chevaux ; on eût dit que le mort était bercé pour son dernier sommeil. Après la cérémonie, qui eut lieu dans l’église de Sion, la métropole de Tiflis, le cortège se dirigea vers le cimetière de Péra. De temps en temps une musique douce, lente et plaintive, exécutée par des soldats russes, alternait avec le chant des prêtres. Devant les musiciens, en souvenir des saintes femmes de Jérusalem, des pleureuses à gages suivaient le char et jetaient dans les airs des cris aigus. Quant à la princesse et aux femmes de sa maison, on ne les voyait pas : les femmes géorgiennes n’assistent pas aux enterremens, parce que le Christ a été mis au tombeau par les apôtres et ses disciples ; le lendemain seulement, comme Marthe et Marie, elles vont prier et pleurer sur la tombe qui leur est chère.
Au cimetière, d’interminables cérémonies avaient commencé. Les prêtres géorgiens, qui sont fort avides, savaient que la famille du prince était riche et se promettaient une bonne aubaine, A côté du champ de repos s’élève une petite chapelle, garnie d’images et de reliques, où, les dernières prières achevées, on recouvre la bière avant de la descendre dans la fosse. Lorsque le prêtre eut fait l’aspersion finale et jeté une pelletée de terre sur le cercueil, la foule, comme si elle fût revenue d’une fête, sauta à travers les pierres tumulaires et se dispersa. Il était environ quatre heures du soir ; la chaleur était encore étouffante, et un immense nuage de poussière flottait au-dessus de Tiflis. Le fossoyeur, demeuré seul, s’assit auprès de la fosse béante, attendant un peu de fraîcheur pour la combler. Il laissa tomber sa tête dans sa main, fit le signe, de la croix et pleura. Ce fossoyeur, nommé Grigory, avait, quelques années auparavant, sauvé la vie au prince dans une attaque contre les montagnards lesghiens, et le prince reconnaissant lui avait donné la liberté et son humble emploi. Il habitait une maisonnette en bois contiguë au cimetière ; il gagnait quelque argent, car tous les ans la fièvre ravage Tiflis, surtout en automne. Grigory était là, immobile, les yeux fixes, songeant à son ancien maître ; de temps à autre, il regardait la fosse où gisait celui qu’il avait aimé. — Il fait jour jusqu’à huit heures, se dit-il. — Et il alluma sa pipe.
En Géorgie, la mort n’est pas entourée des mornes tristesses de l’Occident, des longs regrets, des deuils intimes. La vie orientale est tout extérieure et de surface ; les larmes sortent des yeux, non du cœur. Le matin, on enterre un parent, un ami, sans qu’un tel événement change le cours des habitudes quotidiennes ; le soir, on en cause à souper, et le lendemain l’oubli recouvre le mort d’un second linceul. Le corps remis à la terre, chacun retourne à ses affaires ou à ses plaisirs. Le plus souvent, le jour même, à la sortie du cimetière, la foule inonde les doukans : plusieurs amis se réunissent dans une salle, autour d’une vaste outre gonflée de vin, mangent du caviar frais, du poisson salé, des œufs durs, du pain noir, et boivent au son de la bizarre musique géorgienne. Ils choisissent un président nommé touloumbache, une sorte de magister bibendi, maître passé en buverie. Chaque fois que le touloumbache vide son azarpèche, vase d’or, d’argent ou de cuivre, orné d’un long manche, tous les buveurs sont obligés de l’imiter, sous peine d’une amende fixée d’avance. Des musiciens payés, accroupis à la turque le long de la muraille, chantent en s’accompagnant d’un double tambour, d’un tambourin à grelots, d’un violon à trois cordes, d’une petite guitare et d’un fifre. Au touloumbache revient l’honneur d’ouvrir la séance par quelque chant populaire tel que celui-ci :
« Je suis Bacchus, j’ai la richesse, accourez ! Buvons du vin. La vigne, je l’ai plantée pour rafraîchir les buveurs.
« Nous avons de l’or et des pierreries, nous pouvons boire toujours. Soyez sans peur : je suis assis ferme sur une outre qui ne tarira jamais. »
À peine a-t-il fini de chanter, que des cris de joie éclatent, et les convives frappent tous à la fois leurs mains l’une contre l’autre d’une façon bruyante et rhythmique. Les azarpèches et les cornes de buffle, historiées de chaînettes d’or et d’argent, circulent à la ronde ; la conversation s’anime, fouettée par le vin, semée de propos joyeux et de grosses plaisanteries, et ne s’interrompt que lorsqu’un musicien tatar entonne d’une voix aiguë et nasillarde une chanson indigène.
La scène que nous venons de décrire se reproduisit exactement dans les doukans de Tiflis à la suite des funérailles du prince Dimitri ; mais pendant que les rires et les éclats de voix des buveurs se croisaient ainsi aux sons redoublés de la musique, le cimetière était le théâtre d’une sorte de drame étrange. Rêvant à demi, son menton dans la main, le fossoyeur avait vu s’éteindre l’une après l’autre les clartés changeantes du couchant ; il écoutait le Koura gronder à travers les roches voisines, lorsque tout à coup il tressaillit, comme réveillé en sursaut d’un songe pénible : la bière du prince s’était agitée dans la fosse. Grigory, qui avait accompagné son maître dans les montagnes escarpées du Caucase, avait souvent entendu sans tressaillir, siffler à ses oreilles les balles lesghiennes, mais seul, le soir, dans ce lieu silencieux et désert, en face de ce cercueil qui remuait, il fut saisi d’une superstitieuse terreur, et se sauva à toutes jambes à travers les tertres inégaux. Haletant, blême, les genoux tremblans, il arriva à l’extrémité du cimetière.
Le pauvre homme ne s’était pas trompé : un soubresaut avait secoué le cercueil. Le prince Domenti, enseveli vivant, avait été tiré de sa léthargie profonde soit par les cahots du char funèbre, soit par l’humidité de la terre. Une légère sensation de chaleur se manifesta d’abord au cœur, qui se remit à battre, et à la gorge. Après de douloureux efforts, la respiration souleva la poitrine, et quelques larmes coulèrent. Peu à peu les idées s’éveillèrent dans le cerveau, où flottaient des images confuses ; bientôt l’infortuné respira à pleins poumons, et les yeux grands ouverts dans les ténèbres visibles de la tombe, mais ignorant encore toute l’horreur de son prochain martyre : — Où suis-je ? se demanda t-il. Quelle nuit ! quel silence ! — Puis la réalité, aidée du souvenir, se dressa devant lui, implacable et plus terrible que le trépas même, et il devina qu’il était cloué dans un cercueil, à la fois mort et vivant. Il tenta de remuer dans l’étroit cachot où il était serré de toutes parts, et sa main désespérée se crispa sur le rameau de buis bénit. Comprenant alors qu’il allait expirer là, loin des hommes et sous l’œil de Dieu, lui qui avait jeté sa jeunesse à la débauche, et qui n’avait pas reçu le suprême pardon de l’église, au lieu de se ronger les poings de rage, il sentit soudain une foi vive descendre dans son âme comme un rayon de la divine miséricorde. Cependant, raidissant ses muscles et rassemblant par instinct ses dernières forces, par un mouvement vigoureux qui agita la bière, il frappa aux portes de la vie.
C’est à ce bruit inattendu que Grigory le fossoyeur s’était enfui. Dès qu’il eut atteint la haie du cimetière, il se retourna pour s’assurer qu’aucun fantôme ne le poursuivait ; n’entrevoyant point d’ombre lugubre, il reprit un peu de courage, et après une courte prière il se sentit plus ferme sur ses deux pieds. — Par sainte Nina notre patronne, se dit-il, je ne suis ni un poltron ni un fou ! N’ai-je pas ouï conter à mon aïeule, une bonne chrétienne, que parfois les morts sortent du tombeau ? Lazare, un pauvre homme comme moi, n’a-t-il pas été, après trois soleils de séjour chez les morts, ressuscité par le Christ, qui peut encore du haut du ciel rendre miraculeusement la vie ? Non, non, à cette heure le prince est froid comme la terre ; par hasard sans doute une pierre aura glissé sur le bois du cercueil, voilà tout.
Rassuré par cette dernière réflexion, il revint lentement sur ses pas, sans trop d’audace, le cou en avant, l’œil au guet, et essayant de chasser la vision qui l’obsédait et l’attirait en même temps. Il parvint enfin au bord de l’obscure profondeur de la fosse. Çà et là le soir promenait ses larges ombres sur les mausolées, les cyprès et les croix byzantines. Le fossoyeur s’approcha, tendit l’oreille et crut entendre un bruit sourd qui diminuait de seconde en seconde. Un frisson lui courut de la tête aux pieds ; mais, fortifié par un signe de croix, il sauta dans le trou, et à l’aide de sa bêche il enleva d’un bras robuste le couvercle mal attaché de la bière, d’où s’exhala un gros soupir, pareil au dernier râle d’un mourant. — Il vient de rendre l’âme, pensa-t-il. — Le fossoyeur était arrivé à temps, car le moribond était complètement évanoui et inondé d’une sueur glacée. L’air pénétra par degrés à travers les interstices du couvercle et caressa le visage du malade. — Bon ! le cœur bat encore, dit le libérateur, qui enleva le corps et le déposa sur le gazon. Les vêtemens dégrafés, il lui frotta la poitrine, pour y ramener les tiédeurs de la vie. Les yeux se rouvrirent sans regard, les lèvres sans voix.
— Courage, prince ! cria Grigory ; c’est moi, Grigory, votre fidèle serviteur. — Puis, se parlant tout bas : — A quoi tient la mort d’un homme, même d’un prince ! Si j’eusse comblé la fosse après la cérémonie, ou si je me fusse assis dix pas plus loin, le noble seigneur aurait déjà rendu ses comptes à Dieu.
Pour comprendre la suite de ce récit, il est indispensable de se reporter quelque peu en arrière.
Né d’une grande famille de l’Iméreth, le prince Dimitri Domenti, jeune, beau et riche, emporté par le goût des voyages, visita la Turquie, la Russie et l’Allemagne ; puis, de retour à Tiflis, il prit un grade dans l’armée du Caucase. Son esprit était vif, son cœur loyal ; l’agitation d’une existence nomade et aventureuse l’avait arraché à l’indolence naturelle aux gens de sa race ; il était instruit et parlait plusieurs langues, comme presque tous les Orientaux.
Tiflis, grâce à son admirable soleil, à ses paysages pittoresques et à ses souvenirs, peut être un séjour agréable pour les étrangers et les touristes, qui prennent la fleur du panier ; mais à la longue c’est une ville intolérable par la monotonie des hommes et des choses, par la plate uniformité de la vie. Cette immobilité de l’Asie, qui semble craindre de déranger un des plis de sa robe, abêtit le corps, anéantit la pensés. Quant au prince, doué d’une âme ardente, d’une imagination toujours en éveil, pour échapper aux ennuis de l’oisiveté, il avait donné tête baissée dans tous les plaisirs chers à la jeunesse désœuvrée, — les excès de la table, les amours les plus folles, et surtout cette dévorante passion que les Russes ont importée en Géorgie, le jeu. De jour en jour, ou plutôt de nuit en nuit, son patrimoine s’engloutissait dans ce gouffre ; mais, apercevant sa ruine à l’horizon et trop fier pour supporter la pauvreté, il résolut de relever sa fortune par une riche alliance. Il épousa la princesse Daria Matchvavassé, issue de la tige royale des Bagratides, qui lui apporta en dot des biens immenses. De plus, Daria, âgée de quinze ans à peine, était la plus belle fleur du Caucase, une vardi (une rose), comme on l’appelait. Par malheur pour son âme tendre, les parens en Géorgie se passent du consentement de leurs filles. Dans tout l’Orient même, sans excepter les peuples chrétiens, la valeur sociale et conjugale de la femme est à peu près nulle ; aussi les mères se croient-elles bénies du ciel lorsqu’elles mettent au monde des enfans mâles. Le mari est tout-puissant, il règne et il gouverne ; l’épouse obéit passivement et n’oserait jamais discuter la volonté ou les caprices du maître, dont elle est la première servante. Elle s’occupe uniquement du soin de la maison, où elle vit à moitié cloîtrée, ne sortant guère que pour se rendre au bain ou à l’église, presque entièrement voilée, à la mode persane, d’une longue pièce blanche de coton, de laine ou de soie, dont elle s’enveloppe de la tête aux pieds avec beaucoup de grâce et de coquetterie.
Avant d’être unie au prince Domenti, la belle Daria s’était « blessée d’amour, » selon une charmante expression du pays, pour un jeune Arménien, nommé Vamiran, qui avait été élevé en France ; aussi versa-t-elle des larmes amères lorsque dans la cathédrale de Sion l’archevêque lui donna la bénédiction nuptiale. Quoique fidèle à son mari, la nouvelle épousée n’avait pu reprendre son cœur à son amant ; elle souffrit en silence, sans se plaindre, mais elle ne se résigna pas : la résignation est le courage des âmes affligées, et la jeune princesse était faible comme un enfant. La calomnie avait fait siffler ses vipères autour de son nom honoré ; quelques fâcheuses rumeurs vinrent même à l’oreille du prince, qui sut contenir ses fureurs jalouses. Dès ce moment toutefois il détesta Daria et courut de nouveau aux plaisirs qui avaient dévoré sa jeunesse. La princesse, délaissée, ennuyée de sa solitude, passait la plupart de ses journées à pleurer où à raconter ses chagrins à Salomé, sa sœur de lait, qui pleurait avec elle, ou à jouer avec sa petite fille. Salomé, jolie et coquette, adorait les bijoux, les étoffes de soie, et, séduite par les nombreux cadeaux de Vamiran, elle attisait l’amour de sa maîtresse au lieu de l’éteindre. Par son entremise, des lettres furent échangées entre les deux amans ; mais un jour Dimitri surprit dans la chambre de sa femme une ballade géorgienne, oubliée sur un divan. Un horrible ressentiment, mêlé d’un soupçon plus horrible encore, s’éleva soudain dans sa pensée. — Ils s’écrivent ! ils s’aiment ! murmura-t-il d’une voix étouffée.
Il ne connaissait pas l’écriture de son rival, mais il ne tarda pas à éclaircir le mystère. Il courut vers le chef du bureau de poste russe, et glissant cinquante roubles dans sa main déjà ouverte : — Voici, lui dit-il, un papier. Lorsque tu auras une lettre d’une écriture semblable, tu m’apporteras le papier et la lettre ; cela te vaudra encore cinquante roubles.
Ce fut ainsi qu’il apprit les relations secrètes de Daria et de Vamiran car il ne recevait pas le jeune Arménien chez lui. En général, les Géorgiens détestent cordialement les Arméniens, au point qu’il est très rare de voir ces deux peuples s’allier par le mariage. Du reste, ces derniers sont haïs dans tout l’Orient, depuis la Turquie jusqu’à l’Inde, pour leur fausseté, leur avidité et leur bassesse. Un Géorgien vous dira : « Il faut sept Juifs pour tromper un Arménien. » Interrogez un Persan, il répondra : « Un Cosaque nous volera nos habits ; mais les Arméniens, s’ils le pouvaient, vendraient notre peau. »
Dimitri, jaloux et irrité, se rendit dans la chambre où, sur d’épais coussins, sa femme se reposait mollement de l’écrasante chaleur de juin ; s’approchant d’elle, il la saisit par le bras. — Connais-tu cette écriture ? lui dit-il d’une voix tremblante.
— Non, répondit Daria troublée
Alors il rompit le cachet de la lettre de Vamiran. — Et celle-ci, la reconnais-tu ? — Et il lui montrait du doigt le nom de Vamiran, qui flamboya aux yeux de Daria comme une épée. Elle pâlit et s’évanouit. Le prince s’éloigna en lui arrachant les dentelles de son voile, Ce ne fut pas l’unique supplice de la pauvre femme : à tous les repas, Dimitri fit dès ce jour venir un musicien tatar qui, sans songer à mal, chantait la ballade amoureuse envoyée à la princesse par son amant. Les domestiques qui servaient à table, entendant sans cesse la même chanson, ne savaient que penser et se disaient entre eux : « Le seigneur est devenu fou. » Chaque son de la guitare, chaque vers de la ballade tombait lourdement sur le cœur de la victime. Le bruit se répandit dans Tiflis que le prince Domenti avait perdu la tête ; on chercha les causes de cette manie soudaine ; les dévots parlèrent de sorts, de maléfices, de punition du ciel ; les plus indulgens le prétendirent amoureux, et, les commentaires n’ayant pas manqué, la réputation de plusieurs grandes dames de la ville se trouva fort endommagée. Comme cette sorte de ballade devint à la mode, comme elle peut d’ailleurs donner une idée de la poésie amoureuse en Géorgie, Il n’est pas inutile de la citer :
« Ame nouvellement née au paradis, âme créée pour mon bonheur, de toi, immortelle, j’attends la vie !
« De toi, printemps en fleur, lune de deux semaines, — de toi, mon ange gardien, de toi j’attends la vie !
« Rayonne par ton visage et réjouis par ton sourire. Je ne veux pas posséder le monde, je veux ton regard. De toi j’attends la vie !
« Rose des montagnes rafraîchie par la rosée, favorite choisie de la nature, trésor doux et mystérieux, de toi j’attends la vie! »
Un mois environ après cette scène conjugale, le prince était allé à cheval à Kodjor, où il avait une maison de campagne qu’il voulait donner pour prison à sa femme. À peine rentré chez lui, il se plaignit de la fièvre ; il se coucha, fut malade deux jours et ne se releva pas. Dans son délire, il répétait sans cesse les mêmes mots, le refrain de la ballade : « De toi j’attends la vie ! »
On connaît maintenant l’histoire de l’homme qu’un étrange hasard venait d’enlever à la tombe. Le fossoyeur cependant tremblait d’avoir commis un sacrilège, parce que, selon une tradition superstitieuse, tout ce que le prêtre a béni et mis en terre doit y rester. Quoi qu’il en soit, le prince Domenti, grâce à l’activité et à l’énergie des soins de son serviteur, commençait à articuler quelques syllabes incohérentes. La première phrase qui s’échappa de ses lèvres fut celle qu’il avait prononcée la dernière à son lit de mort : « De toi j’attends la vie ! » comme si l’âme se fût pour quelques heures seulement absentée du corps.
Grigory ne savait trop que faire de son ressuscité ; il ne pouvait le laisser là, durant la nuit, au clair des étoiles. Quelles précautions prendre ? Par bonheur, le prince, jeune et robuste, recouvra assez promptement l’usage de ses sens et de la parole, et il ne tarda pas à reconnaître son ancien serf.
— Grigor, c’est toi ?
— Oui, seigneur, oui, votre Grigor.
— Pourquoi m’ont-ils mis là ? Où suis-je ?
— Vous le saurez plus tard, quand vous serez guéri.
— Je suis donc malade ?
— Non, un peu de fièvre ; rien, presque rien.
— Mais c’est le cimetière ! s’écria Dimitri avec effroi en promenant ses regards autour de lui ; voici les croix qui se détachent en noir sur le ciel… Ah ! oui, je me rappelle, des cierges, de la musique, des chants d’église ! Ce sont eux, vois-tu, qui m’ont jeté dans ce trou comme un chien ; ce sont eux, les parjures ! Oh ! si je vis !
— Vous vivrez.
— La vie, toi, tu me l’as sauvée deux fois. Va ! je te ferai riche. Eux, ce sont des misérables, des assassins, des Tcherkesses.
Naturellement Grigory ne comprenait rien à ces paroles ; il écoutait néanmoins son ancien maître sans l’interrompre, épiant le moment propice de lui demander ce qu’il y avait à faire. — Où faut-il vous porter ?
Dimitri ne répondit pas ; il leva les yeux vers le ciel, où déjà s’allumaient les étoiles, absorbé dans une idée contre laquelle il semblait lutter. Au bout de trois ou quatre minutes de silence, le fossoyeur renouvela sa question : — Où faut-il vous porter ? Dans votre maison ?
— Oh, non ! s’écria le prince. Écoute, Grigor, emmène-moi dans ton logis ; que tout le monde ignore ce qui s’est passé, sauf toi et ta femme !
— Bien.
— Maintenant aide-moi à marcher.
— Impossible. Je vais vous emporter sur mes épaules ;
— C’est vrai, je me sens faible. Encore un mot : dès que tu m’auras caché dans ta demeure, tu iras reclouer le cercueil, et tu le couvriras de terre, comme si j’étais réellement mort.
Grigory souleva doucement le prince, le chargea sur ses larges épaules et le porta dans sa maisonnette en bois, qui fort heureusement était isolée et éloignée de soixante pas à peine. Au moment où ils allaient franchir le seuil, Dimitri fut pris soudain d’un tremblement nerveux : il venait d’entendre à peu de distance chanter par les buveurs des doukans la ballade géorgienne qui lui rappelait tant de malheurs !
Ils entrèrent. Maniska, la femme de Grigory, à la vue de son ancien bienfaiteur, qu’elle reconnut malgré son extrême pâleur, et qu’elle croyait enterré, fut épouvantée et poussa un cri. — Silence ! dit Grigory en lui appuyant la main sur la bouche. Tout à l’heure tu sauras ce qui est arrivé. — Il déposa son fardeau sur des tapis grossiers et déchirés : — Tiens ! il s’est évanoui de nouveau. Par sainte Nina ! femme, on l’avait enseveli vivant, et sans moi c’était bien fini ; mais ce n’est pas le moment de jouer de la langue, agissons ! Toi, arrange vite et de ton mieux un lit avec des couvertures et des coussins, et tâche que personne n’entre ici. Moi, je cours chercher du bon vin et du pain blanc pour le restaurer un peu.
Un singulier médecin que Grigory ! Il fut bientôt de retour. Le prince, qui avait repris connaissance, tremblait de tous ses membres. Un morceau de pain imbibé de vin versa quelque force aux veines du malade, qui, chaudement enveloppé, se coucha dans l’espèce de lit improvisé par Maniska et s’endormit. Grigory soupa en hâte de pain noir, d’oignons et de fromage de chèvre, et sortit pour exécuter les ordres de son maître ; il recloua la bière et combla la fosse. Avant de toucher à la terre sacrée, le digne homme s’était assis, et presque à son insu il s’était rappelé la scène de la veille. Les Géorgiens sont superstitieux et doux, où plutôt ils ont les grâces de la superstition, et leur esprit mobile s’élance vers des régions étranges sur les ailes d’une imagination toujours prompte à s’éveiller.
Le fossoyeur était misérable, et sa maison de bois, qui consistait en deux chambres étroites, n’était certes pas d’un brillant aspect. Au milieu de la salle d’entrée, sur un long bâton fiché en terre, brûlait une maigre chandelle. Aux parois pendaient au hasard un koudi ou bonnet en poil d’agneau, une ceinture de cuir, un fusil à canon évasé, deux kindjals (poignards), quelques pipes et une guitare sans cordes. Sur une petite table qui avait eu jadis quatre pieds, s’étalaient des vases d’argile au col allongé, une assiette de bois, où les deux pauvres gens mangeaient à la gamelle. Quant au verre, il n’y en avait point : ils buvaient dans le même azarpèche. Dans un coin de cette salle, attristée encore par la demi-obscurité et les rumeurs de l’orage, gisaient sur le sol la pelle et la bêche, le double gagne-pain du fossoyeur. Par compensation, un frais bouquet de roses, cette fleur si chère aux Géorgiens, s’épanouissait dans un pot ébréché : là, il y avait une femme !
Grigory, qui ne se piquait guère de coquetterie, s’était contenté, pour être prêt à l’aurore, de se remettre sur ses pieds, de se frotter les yeux, de retrousser sa moustache et de friser son koudi ; puis il avait secoué ses amples pantalons et sa tunique de laine jaune, précaution utile dans les pays chauds où pullulent des compagnons de nuit fort incommodes pour tout autre qu’un paysan géorgien. Dimitri, dont la respiration égale présageait une prompte guérison, dormait encore au moment où Grigory, la jambe alerte et le cœur en liesse, s’éloigna de son logis en recommandant la prudence à Maniska. Il se dirigea vers le marché pour rapporter au prince du caviar frais, des œufs, du mouton, du pain blanc et du vin digne d’un si noble hôte. Le pauvre diable avait de petites économies, que sa soif quotidienne avait bien diminuées ; mais par bonheur il lui restait environ deux cents abaz. D’ailleurs, avant l’épuisement de ce maigre trésor, qui sait ? quelques bonnes aubaines viendraient peut-être réparer les vides de son sac de cuir… A son retour, il trouva sur le seuil sa femme qui faisait le guet. — Le maître est réveillé, dit-elle, il veut te parler.
Grigory entra. Le prince, fort pâle, les nerfs agités, accoudé sur un coussin, paraissait plongé dans de sombres réflexions. — Ah ! te voilà, Grigor ; viens auprès de moi et écoute-moi bien.
— Comment vous portez-vous ce matin ?
— Mieux, beaucoup mieux.
— Avez-vous faim et soif ?
— Non ; ouvre tes deux oreilles, jamais tes lèvres.
— Par saint George, protecteur du Karthli, ma bouche sera plus fermée que la grotte du farouche Amiran, le filleul de Dieu!
— As-tu de l’argent ?
— Deux cents abaz ; cette année est assez bonne, la fièvre va, et j’ai creusé…
— Bien, rends-toi au bazar où tu m’achèteras, comme pour toi même, puisque tu es de ma taille, des habits de paysan mingrélien, des sandales de porc, un bachlik, un bourka, car sous mes vêtemens de soie brodés d’or je serais reconnu, et je ne veux pas l’être.
— Seigneur, que désirez-vous faire ?
— Point de questions, Grigor ! sache attendre et souviens-toi du proverbe persan : « Avec du temps et de la patience, la feuille du mûrier devient satin. » Ton frère demeure dans une sakli (maison de paysan) isolée sur la route de Gori ?
— Oui.
— Peut-il me cacher ?
— Oui.
— Je le récompenserai plus tard… bientôt. Quant à toi, je t’achèterai une belle boutique au bazar ou sur la Perspective-Golovine, à ton choix.
— Oh ! seigneur !
— Ne m’interromps pas. Je resterai ici une semaine, juste le temps de me rétablir, car quarante verstes à cheval par de mauvais chemins seraient une trop rude fatigue pour mes forces épuisées. Ce n’est pas tout : tu me rendras fidèlement compte jour par jour de ce qui se passera en ville, même dans la maison de la princesse, je te le permets ; tu écouteras l’un et l’autre, tu questionneras avec adresse, tu recueilleras les moindres bruits et les propos les plus frivoles. M’as-tu compris ?
— Oui, maître.
— L’heure venue, je te donnerai d’autres instructions. Maintenant que ta maison soit inaccessible à tous, car je suis mort et enterré.
Sa bourse en poche, le fossoyeur, l’air grave et méditatif, traversait les interminables rues de Tiflis afin d’acheter le déguisement du prince. Il passait vite devant les doukans, où il avait coutume de se rafraîchir sans soif ; aussi, chemin faisant, entendait-il bourdonner à ses oreilles les railleries des amis qui le rencontraient.
— Tiens ! Grigor a la fièvre, il méprise le vin. — Il va sans doute à la messe. — Il est aujourd’hui gai comme la citadelle Narakléa.
— Non, il a un rat ou une grenouille dans la cervelle ; . — Est-il heureux, ce Grigor ! il vit de la mort, lui ; il fait griller du tzvadi (mouton rôti) deux fois la semaine, sans compter les jours de fête, tandis que nous, nous sommes réduits à éplucher nos oignons et à nous blanchir les dents avec du fromage, le tout arrosé d’eau.
Indifférent à ces persiflages, Grigory marchait sans détourner la tête et sans répondre. Une heure après, il revint chez lui avec le nouvel accoutrement du prince. Vers midi, la même journée, assis sur un tertre à dix pas de sa porte, Grigory fumait à l’ombre d’un haut cyprès, ayant l’air de surveiller ses domaines, je veux dire le cimetière, lorsqu’il vit au loin, du côté de la ville, s’approcher une femme enveloppée dans les plis blancs d’une tchadra bordée d’un filet noir. Avant de la reconnaître, quoiqu’il eût un œil d’oiseau de proie, il devina la veuve de la veille, et un léger sourire plissa ses lèvres. Cette forme blanche, c’était la princesse Domenti, qui, selon l’usage, venait prier et gémir sur la tombe du défunt. Grigory, par respect, ôta sa pipe de sa bouche, s’avança vers elle, le bonnet à la main, pour lui indiquer le lieu où sa douleur devait s’exhaler, et se retira. Dimitri lui ayant ordonné de lui rendre compte du moindre événement, il courut avertir son maître, qui se traîna vers le seuil et regarda par la porte entrebâillée celle qu’il avait aimée et qui l’avait trompé.
La princesse était accompagnée de sa fidèle Salomé, qui portait sur ses bras une petite fille vêtue d’une robe rouge, et dont les cheveux étaient divisés en sept nattes. La servante déposa à terre, auprès de sa mère, l’enfant, qui se mit à jouer avec les cailloux recouvrant la tombe paternelle. Daria s’agenouilla, pria, pleura, se frappa la poitrine, où battait un cœur dont les palpitations n’étaient pas d’accord avec la violence de son désespoir. À peu de chose près, Salomé imitait sa maîtresse, et l’enfant jetât de temps en temps sur les deux femmes un regard étonné. Daria portait avec une grâce singulière ses habits de deuil : sa ceinture flottante, son diadème étoile de perles, son voile de dentelle rejeté en arrière, ses longues tresses brunes, tout la faisait ressembler à l’ange de la douleur. Quiconque l’eût vue ainsi éplorée eût compris la réputation de beauté des Géorgiennes, et la princesse passait pour la plus belle femme de Tiflis.
Dimitri, qui la voyait moins avec ses yeux qu’avec les ardeurs d’un cher souvenir, murmura d’une voix étouffée : — Pourquoi me trahir, ou pourquoi me regretter ? Si elle me pleure du fond de l’âme, ne faut-il pas pardonner ? — La princesse, après s’être acquittée de tous ses devoirs de veuve, se retira ; le prince rentra dans son asile, incertain, inquiet, accablé de la plus profonde douleur. Revenue chez elle, Daria, reçut les nombreuses visites de condoléances de ses amis et de ses proches. Chaque fois que l’on vantait une des qualités de son époux, elle renchérissait et éclatait en sanglots ; puis la conversation roulait sur des sujets futiles où il n’était nullement question du mort. Nouvelle visite, nouvelle explosion de chagrin ! Cette comédie funèbre dura jusqu’au coucher du soleil. Le soir, les serviteurs du prince échangèrent comme d’habitude leurs réflexions. Iacob, couché sur le balcon du palais, à côté de Basili, lui dit à l’oreille : — La princesse a tant versé de larmes aujourd’hui, qu’elle a pleuré pour toute sa vie.
— La douleur, reprit Basili, c’est comme un méchant remède, il vaut mieux l’avaler au plus vite.
— Lorsqu’elle est vraie, la douleur entre dans le cœur comme la hache dans l’arbre.
— Crois-tu que la princesse aime l’Arménien ?
— Frère, répondit le sage Iacob, ne nous mêlons pas des affaires d’autrui, sinon on nous enverra place d’Érivan, tu sais où, n’est-ce pas ? et tu sais aussi qu’on en revient quelquefois, mais sans peau sur le dos.
— Personne ne nous entend, nous sommes seuls.
— Seuls ! hum ! ici méfie-toi de tout le monde, même des rats qui nous empêchent de dormir. Et là-dessus, Basili, bonne nuit !
Pendant une douzaine de jours, Daria vint assidûment renouveler au cimetière ses prières et ses lamentations, jusqu’au moment où l’on recouvrit le tombeau d’un lourd mausolée de granit sculpté par un ouvrier allemand. Le prince, qu’informait Grigory, ne manquait jamais l’occasion de repaître ses yeux des désespoirs vrais ou faux de sa femme, et, ne sachant où arrêter sa pensée, il prononçait tour à tour les mots de vengeance et de pardon. En voyageant, il était devenu, sauf le costume, à moitié européen, et pour lui l’amour, même dans le mariage, était un poème un peu romanesque. Pour les femmes géorgiennes, qui meurent, comme les plantes, où elles sont nées, l’amour est presque toujours une passion à fleur d’âme malgré les hyperboles de leur langage poétique et imagé. Aussi n’est-il pas difficile de comprendre que le regret de Daria devait s’adoucir vite, tandis que la jalousie de Dimitri s’accroîtrait de jour en jour…
Si l’on doutait de ces brusques retours à la vie sauvage qui forment dans la société géorgienne de si bizarres contrastes avec les plus délicats raffinemens de la civilisation, la fin de l’histoire du prince Domenti convaincrait les plus incrédules. Complètement guéri, caché sous le costume d’un paysan de Mingrélie, le prince choisit une nuit nuageuse et sortit à cheval de Tiflis, suivi de son ancien domestique. Ils arrivèrent avant l’aube à la sakli ou chaumière de Datho, frère de Grigory, qui attendait les voyageurs.
— Prince, dit le paysan, qui s’était respectueusement élancé au-devant de la bride du cheval de Dimitri…
— Écoute, Datho, ici je ne suis prince pour personne ; je suis un pauvre Mingrélien, tu m’appelleras Naskida, tu me traiteras comme ton égal. Pour être prince encore avant de recevoir ton hospitalité, puisque tu m’appartiens, dès aujourd’hui je te donne les terres que tu cultives à mon profit et ta liberté, en attendant mieux. Il est inutile que tu connaisses le motif de mon séjour ici. Naskida mangera donc de ta cuisine et boira de ton vin.
Datho, ivre de joie, baisa la main de son seigneur ; Grigory, après s’être reposé et restauré, se prépara à retourner vers ses tombes ; mais avant son départ Dimitri recommanda et même ordonna à son domestique de surveiller les événemens et d’accourir chez son frère pour l’en informer.
Si les villages de Géorgie sont misérables, une chaumière isolée est plus misérable encore. La sakli géorgienne est basse, aux deux tiers enfouie dans la terre et assez semblable à une tanière, contrairement aux chaumières de Kakhétie, qui sont élevées d’un étage. La toiture est plate, le jour on s’y assied, la nuit on s’y couche, de sorte que le Géorgien demeure dans sa maison, à côté de sa maison et sur sa maison. À l’intérieur, la sakli ne renferme ni chaises, ni table, ni banc : quelques menus ustensiles s’étalent ça et là ; au centre étincelle le foyer, l’ami de la chaumière. Telle était à peu près la demeure dont le prince Domenti était devenu l’hôte. Il y entra bravement, salua la femme de Datho, qui, spirituel comme presque tous les Géorgiens, débuta dans son rôle de la façon suivante : — Femme, voici Naskida, un de mes vieux camarades d’enfance, un homme bizarre, brave comme une chachka (sabre recourbé), chasseur comme un vautour, et paresseux comme un Mingrélien qu’il est.
Dimitri avait eu soin d’apporter des balles, de la poudre et le fusil de Grigory. Quand on a tué une vingtaine de Lesghiens, on n’a peur ni des lièvres ni des chevreuils. Il s’installa d’emblée dans la cabane enfumée, déjeuna de bon appétit, fit une courte sieste, et sortit son fusil sur l’épaule. Datho l’accompagna pour lui indiquer les collines giboyeuses. Lorsqu’ils furent seuls, le paysan, encore peu habitué à traiter familièrement son maître, se tenait sur la réserve et gardait le silence. — De ce côté-ci, prince, lui dit-il en désignant une ravine.
— Datho, même quand nous serons éloignés de toute créature humaine, je te défends de m’appeler prince ; j’entends que tu me nommes Naskida, parce qu’une oreille de hasard peut être ouverte derrière un arbre ou dans un buisson.
Le prince espérait, grâce à son adresse, enrichir un peu la table trop frugale de son hôte. D’ailleurs, par son ordre, Grigory, à son prochain voyage à la sakli, devait apporter du poisson salé. Avec la souplesse des Orientaux, lui, riche et habitué au luxe, même aux excès du luxe, il se plia d’un seul coup à la pitoyable vie de paysan ; il poussait la bienveillance jusqu’à jouer au loto avec Datho et sa femme, qui était charmée des façons du beau Mingrélien. Un souci travaillait souvent la cervelle du paysan : pour quelles raisons un haut seigneur se donnait-il la fantaisie de vivre si misérablement dans ses propres terres ? Puis comment se faisait-il qu’il passât pour mort ? Las de ne pas trouver l’énigme, il cherchait encore ; mais, pour apaiser sa curiosité, il songeait que lui-même, le pauvre serf, il était libre et propriétaire, et il cessait de se creuser la cervelle.
Parfois un nuage obscurcissait le front du prince, qui restait une journée entière sans desserrer les dents, morne, couché à l’ombre de la sakli. Deux semaines déjà s’étaient écoulées depuis son séjour dans la cabane, et il n’avait pas revu Grigory, qui arriva enfin, couvert de sueur et de poussière. Il donna familièrement le bonjour à son frère et ôta son bonnet devant le prince. — Remets ton koudi, Grigor, dit celui-ci, et pas tant de façons ! Que se passe-t-il ?
— Vendredi dernier, la princesse n’est pas venue sur votre tombe ; elle a envoyé pour la remplacer dans ses dévotions la vieille Sophio, votre nourrice, qui avait l’air bien désolé, et qui avait apporté une couronne. Pleurait-elle, la bonne âme ! Aussi les mauvaises langues ont osé dire qu’elle irait en paradis à la place de la princesse.
— Pauvre Sophio ! murmura Dimitri ; est-ce tout, Grigor ?
— Tout… Non, j’ai apporté du poisson salé, de la poudre et du plomb.
— Quand repars-tu ?
— A l’heure où le soleil tombera derrière les montagnes, car la fatigue a aiguillonné ma faim. Ne faut-il pas que le cheval se repose ?
— C’est juste. Aie soin de veiller, ouvre l’œil et l’oreille ; j’y tiens, Grigor, plus qu’à ma vie.
Grigory pénétra dans la sakli.
— Elle m’oublie promptement ! se dit à lui-même Dimitri ; j’aurais pardonné, mais si elle aime ce Vamiran, oh ! alors il y aura du sang entre nous !
À quelques jours de là, une troupe de tziganes, ces bohémiens de l’Asie qui errent de l’Inde à la Crimée, déploya ses deux tentes près de la sakli. Dans l’une, des hommes et des enfans, hâves, déguenillés, vêtus de trous pour ainsi dire, allumaient le feu avec des branches sèches, suspendaient à des trépieds de bois la marmite où devait cuire le riz bouilli, seule nourriture de ces vagabonds, qui vivent de rapines. Parmi eux se trouvait un Tatar de Tiflis, que ses instincts nomades avaient enchaîné à leur destinée. L’autre tente, rayée de couleurs fanées par le soleil ou les pluies, était occupée par des femmes en haillons, presque nues, sauf l’une d’elles, grande, belle et jeune encore, bizarrement accoutrée, couverte d’anneaux, de fausses pierreries, d’amulettes, qui se tenait au centre et paraissait être la souveraine de la horde.
Datho, pour égayer ses loisirs, filait de la laine devant sa porte ; sa femme accourut et voulut savoir sa bonne aventure. Une vieille bohémienne, tannée, laide à épouvanter Satan lui-même, contenta son envie moyennant un chaour. Dimitri sortit en ce moment de la cabane, et, pendant qu’il s’approchait, le Tatar, qui le reconnut sous son déguisement, dit à voix basse à la grande bohémienne : — Domenti-Bek ! — Puis il ajouta d’autres mots en tatar, langue que le prince parlait aussi. — Et Naskida, demanda la femme de Datho, ne désire-t-il pas connaître l’avenir ? Elle m’a prédit, à moi, que je serais riche.
Déjà la sorcière avait saisi le bras du faux Mingrélien, qui, peu crédule, se laissa faire en souriant. La mécréante fixait sur sa main des yeux attentifs et ardens, elle semblait en étudier les lignes les plus mystérieuses et regardait son visage comme pour percer les voiles de son âme ; puis soudain, se dressant dans une pose de prophétesse, elle lui parla ainsi : — Je vois ! je vois ! Ta main est blanche, elle a porté le fusil, non la hache, et tu mourras deux fois. — Dimitri tressaillit. — Ta tête, continua-t-elle, est coiffé du bachlik de Mingrélie et non du koudi du Karthli ; du sang coulera. Tiflis, la ville chaude, n’est pas loin, et ces lignes courbes annoncent que tu as une femme belle comme un épi de maïs. Lorsque le corbeau quitte la corneille, son nid, balancé au vent des hivers, est envahi par un autre corbeau qui pique son plumage avec son bec noir.
— Mais, s’écria le prince, qui sentit la pointe de l’allégorie lui entrer dans le cœur et arracha sa main des griffes de la tzigane, d’où sais-tu ?…
Elle leva son doigt vers le ciel et répondit d’une voix gutturale : — Allah ! Allah ! Domenti-Bek !
À son véritable nom, Dimitri frissonna d’épouvante. Par prudence, il reprit son calme et lui demanda où elle allait. — A Koutaïs, en Iméreth, répondit-elle.
— Oui, cria Dimitri irrité, je suis le prince Domenti, et si jamais mon nom sort de votre bouche, je vous la coudrai avec une aiguille rougie au feu, et je ferai pendre ensuite toute votre nichée d’enfer.
Les tziganes, n’ayant nul goût pour la corde, n’attendirent pas le lendemain pour s’esquiver. Ils reployèrent leurs tentes et allèrent peut-être se faire pendre ailleurs. Les trois habitans de la sakli tournèrent le dos aux enfans du diable, Datho regardant le bout de ses sandales, sa femme à demi joyeuse de devenir riche un jour et à demi effrayée du haut rang de son hôte, Dimitri sombre et songeant à la prédiction de la bohémienne.
Au grand étonnement de ses amis, Grigory était devenu sobre, vertu rare chez un Géorgien ; il ne fêtait plus les doukans, il avait renoncé à sa sieste, il rôdait même de temps en temps autour de la cathédrale de Sion, et il était rêveur, presque taciturne. On le rencontrait sur la Perspective-Golovine ou dans les rues voisines, le nez au vent, jouant avec un gros chapelet d’ivoire dont ses doigts comptaient machinalement les grains. — Que peut avoir Grigory ? demandait l’un.
— Il s’est réconcilié avec l’eau du Koura, répondait un autre.
— Cela m’étonne, disait un petit marchand ; il m’achète une effroyable quantité de poisson salé, et l’eau ne désaltère pas.
— N’a-t-il pas plutôt l’esprit dérangé ?
— Peut-être a-t-il vu des fantômes dans le cimetière.
— Non, sa grand’mère vient chaque nuit le menacer des flammes de l’enfer.
Ces bonnes gens le prenaient en pitié. Lui, il laissait jaser, il agissait, écoutait, furetait, espionnait enfin. Comme il l’avait promis à sa femme, il avait cassé sa cruche, mais si adroitement qu’elle contenait encore assez de vin pour l’enivrer un peu à huis clos le dimanche. Il n’aimait pas le son des cloches, qui lui rappelaient ses fatigues de la semaine. Au demeurant, il était dévoué corps et âme aux intérêts du prince. Muni de provisions et de nouvelles, il se rendait souvent à la sakli de Datho.
Sous les cieux d’Orient comme sous les brouillards du Nord, le temps adoucit les blessures intimes, quand il ne les guérit pas, et par tout pays l’oubli pousse plus rapidement dans l’âme que l’herbe sur les tombeaux. Daria, attirée avant son mariage par un autre amour, s’aperçut à son miroir que les pleurs ternissaient l’éclat de sa beauté, et de semaine en semaine elle en fut moins prodigue. — Vos larmes ne lui rendront pas la vie, lui disait l’insinuante Salomé, et il faut respecter la volonté de Dieu. — La princesse, qui était dévote, obéit, et au bout de trois mois à peine le défunt était tout à fait oublié.
Vamiran, doué de la subtilité arménienne, avait compris qu’il était prudent de ne point se heurter aux premières douleurs d’une veuve, et il évita avec soin de lui écrire, de la voir ou de la rencontrer. Lorsqu’il pensa que le chagrin avait perdu sa force, il reparut de nouveau dans la vie de la princesse, dont le cœur se trouva entr’ouvert pour lui. Il s’y glissa sans bruit, comme une couleuvre à travers les fissures d’un rocher. Aux lettres succédèrent de rares visites ; puis un jour, Salomé s’étant absentée, il arriva que la main de Daria, à moitié vaincue, tomba par hasard dans la main de Vamiran. Le lendemain, Salomé reçut de lui une riche turquoise. À Tiflis, où l’oisiveté est le fond de l’existence, les nobles et les gens du peuple ne se mêlent que des affaires d’autrui. On commenta les assiduités de Vamiran. les Arméniens murmuraient, les Géorgiens s’indignaient de voir un Arménien cueillir la plus belle rose de leur jardin. — Oser lever seulement les yeux sur une princesse de sang royal, disaient ces derniers, lui dont le père vendait des clous !
— Oui, répondait quelqu’un, mais il les a changés en or.
— Un lâche, interrompait-on, un renégat qui a pris en France des mœurs inconnues et un costume étranger ! Ah ! son père n’était pas si fier : il portait, comme nous, le koudi, la ceinture de cuir, la tunique en poil de chameau, les manches longues, et toute sa défroque ne valait pas un touman (40 francs). Lui, on le verra bientôt jeter dans la rivière la religion de ses aïeux !
Les semaines, les mois s’écoulaient, lents et monotones, pour le prince Domenti, qui se morfondait dans sa tanière. Il passait presque tout son temps à gravir les montagnes ; mais quand les pluies d’automne détrempèrent la terre, quand l’hiver couvrit de neige la nudité de la campagne, il dut se résigner, devant le foyer fumeux de la sakli, a dévorer l’ennui de sa solitude. Les jours de gelée, il chassait le loup et le renard. La saison rude redouble la misère du paysan géorgien ; s’il est paresseux, du moins il oppose aux rigueurs de la pauvreté une force d’inertie qui révèle la douceur de son caractère. Datho et sa femme, on se l’imagine, n’étaient pas pour Dimitri de bien joyeux compagnons, car, malgré ses ordres de le traiter comme leur égal, ils n’avaient garde d’oublier le haut rang du Mingrélien. En face d’eux, Dimitri vivait silencieux, le cœur rempli de sinistres pensées, retournant le fer dans sa plaie, et attendant l’occasion de se venger. Comment ? Il l’ignorait encore ; mais souvent la jalousie est patiente, elle sait guetter sa proie. Les images du passé, les souvenirs de son bonheur, les insultes faites à son amour, à sa dignité de gentilhomme, tout cela voltigeait autour de lui durant les longues heures de l’hiver. Entendait-il sur la route, qui était voisine, le bruit d’un arba (charrette) ou le pas d’un cheval, d’un bond il franchissait le seuil de la cabane pour voir si ce n’était point Grigory. Par une pluie battante de mars, ce dernier survint un matin, mouillé jusqu’aux os. Dimitri fronça le sourcil et courut au-devant de lui. Il apprit que Vamiran visitait presque tous les jours la princesse, et devait abjurer prochainement le culte arménien. — C’est bien, dit-il d’une voix étranglée. Viens te réchauffer.
Cinq mois cependant s’étaient passés. Daria avait quitté ses habits de deuil. La médisance et la calomnie avaient épuisé leurs malices contre elle ; on s’accoutuma à la voir reparaître dans les opulens salons de Tiflis, dont son nom lui ouvrait toutes les portes, lorsque soudain la rumeur publique s’éveilla de nouveau, surtout dans les hauts rangs de la société. La princesse Domenti devait prochainement épouser l’Arménien Vamiran. Quel scandale ! Une veuve se remariant ! Une princesse géorgienne épousant un Arménien, même converti ! Rassemblés sur la place d’Érivan, les Armemens oubliaient leurs affaires pour envoyer sous mille formes leur malédiction au parjure Vamiran, et les Géorgiens se lamentaient de voir les idées européennes se greffer sur le vieil arbre indigène. Le prince Domenti sut par Grigory l’époque précise fixée pour la célébration du mariage, et il lui dit en souriant : — Grigory, ce jour-là, il me faut dès le matin un cheval. Je reviendrai seul à ta maison, où tu m’attendras. Là, je couperai ma longue barbe, et je me revêtirai des habits que je portais dans mon cercueil. Il est temps de redevenir prince.
— Bien, répondit le serviteur, s’imaginant que son maître allait enfin mettre un terme à ses fatigues et à ses craintes.
Vers le milieu du mois d’août, à six heures du soir, la noblesse de Géorgie se pressait dans les somptueux appartemens de la princesse Daria. Les bougies de cire parfumée rayonnaient sur les rubis et les diamans ; de nombreux domestiques offraient des fruits de Perse, des confitures de Turquie, des pâtisseries, des vins de Kakhétie, et des liqueurs à profusion. Des musiciens rangés autour du salon principal animaient la joie des conviés par des chants de circonstance, les uns tatars, les autres géorgiens, en l’honneur de la nouvelle épousée, dont on célébrait les vertus et la beauté. Les dames, parées de leurs plus riches vêtemens, assises sur des divans, ressemblaient, par les éclatantes couleurs de leurs costumes, à un jardin tout en fleurs. Daria était vêtue d’une robe de soie blanche, avec une ceinture et une gorgerette roses ; ses pieds se perdaient dans de petits souliers de satin ; son voile de dentelle, retombant sur ses épaules, faisait ressortir quinze lourdes tresses brunes qui traînaient sur des tapis d’Ispahan. Le diadème qui couronnait son front était brodé de diamans. Au centre de ce diadème brillait une améthyste d’une valeur inappréciable, qui avait orné l’écrin de la race des Bagratides : elle avait été, disait-on, trouvée sur le mont Ararat, et contenait une goutte d’eau qui tremblait, et qui passait pour être la première larme d’Aïsha (Eve). Entraînée par la musique, une jeune fille s’élança au milieu de la salle et dansa la danse géorgienne, tournant nonchalamment sur le tapis, comme si elle eût glissé, et arrondissant ses bras autour de sa tête. Les mouvemens étaient d’abord tendres, langoureux ; les yeux de la danseuse se baissaient avec une pudeur charmante, puis elle les relevait, noirs, d’ardeur, s’animait, courait, tourbillonnait, s’arrêtait soudain, comme pour défier un amant invisible, et bondissait encore d’un pied ailé, le corps voluptueusement ployé en arrière, et ralentissait de nouveau la mesure. Sur sa bouche passaient tour à tour un sourire amoureux et une moue de dédain. Son voile, sa ceinture, flottaient gracieusement. Les hommes accompagnaient la musique en frappant des mains. La danse cessa, et au son de la dahira (tambourin à grelots) et du tchongouri (guitare à trois cordes) un chanteur tatar entonna un hymne de fiançailles qui représente la joie de la fiancée et le désespoir de la vierge qui n’aura point d’époux. Cet hymne rappelle une cérémonie touchante nommée vitchak. La veille de l’Epiphanie ou du premier jour de l’année, une jeune fille s’en va, de minuit à trois heures du matin, silencieuse et cachée dans sa tchadra, puiser de l’eau à chacune des sources du voisinage, pour laver ses cheveux et la tête de ses amis réunis à cette fête nocturne. Elle rentre, et pendant qu’un Tatar chante, dès le lever du soleil elle effeuille une à une les fleurs d’un bouquet. Cette coutume se retrouve encore dans les villages et quelquefois chez les gens riches.
Le Tatar chanta :
« J’ai une pomme ornée ; mon frère me l’a demandée, je la lui ai refusée : elle m’a été donnée par mon bien-aimé.
« Le ruisseau court à petites vagues ; sur le ruisseau nagent deux pommes. Voilà mon bien-aimé qui revient ; je le vois agiter sa main et son koudi.
« A côté de notre maison fleurit un potager ; dans ce potager croît une herbe qu’il faut couper pour le beau garçon : A belle fille beau garçon !
« J’ai cuit du pain de froment, il m’a semblé d’orge… Et tu es loin d’ici, mon bien-aimé ; mais, ton voyage fini, les paroles couleront de ta bouche, douces comme du miel.
« En chantant la rose, j’ai cueilli des fleurs ; je rassemblerai ces fleurs et les mettrai dans un sac, et ce sac, je le coudrai tout alentour. J’irai rôder d’une cabane à l’autre, et je trouverai un plus beau garçon que toi.
« J’ai grimpé sur une montagne escarpée pour laver les vêtemens de noce. Le savon était doré ; dans les yeux j’avais des larmes amères… O parens, ne vous affligez pas : quand je suis née, c’était déjà le destin !
« Je suis allée sous la pierre pesante, et je n’ai pris qu’un seul vêtement… Ah ! dites à mes parens que la part lourde m’était échue. »
Il était environ sept heures du soir. Déjà les cloches de la cathédrale sonnaient à grandes volées et annonçaient l’arrivée prochaine du prêtre qui allait bénir les deux époux sous le toit de la fiancée, selon l’usage du pays, avant la pompeuse cérémonie dans l’église, à la lueur des flambeaux et des cierges. À ce moment même, Dimitri, pâle comme un mort, ému, mais calme en apparence, se dirigeait mystérieusement vers sa maison par des sentiers détournés. Il escalada la muraille de la cour, et Mourzik, son vieux chien, vint lui lécher les mains. En se cachant la figure, il se fraya un passage à travers le peuple des domestiques, qui ne le reconnurent pas ou le prirent pour un invité. Il entra d’un pas ferme dans la salle en même temps que le prêtre, et, serrant la poignée de son kindjal, il se posa droit devant sa femme, sans ôter son koudi, et s’écria d’une voix mâle : — C’est moi, Dimitri Domenti ! — La princesse, terrifiée par l’apparition du fantôme conjugal, tomba à la renverse et s’évanouit. La foule, saisie d’étonnement et d’épouvante, se précipita en tumulte vers les portes. La princesse se mourait. Dimitri, la haine dans les yeux, se retourna vers l’Arménien et lui dit froidement : — Vamiran, la noce est finie !…
Un moment de silence avait succédé à l’étrange récit du prince Alexandre. — Eh bien ! me demanda-t-il un peu inquiet, que pensez-vous de mon histoire ? Ne sommes-nous pas des barbares ? Etes-vous convaincu maintenant ? Ce prince Dimitri Domenti a connu tous les raffinemens de la civilisation européenne, sa curiosité l’a porté dans divers pays, et cependant cet homme, au sortir de la tombe, n’a pas su pardonner ; la passion qui l’agitait a étouffé en lui les sentimens généreux de l’homme civilisé. Nous, Géorgiens, quoique chrétiens, nous ressemblons un peu à certain pacha mahométan, aimable et doux à Paris, féroce à Trébizonde. L’air du pays nous rend la caractère que nous paraissions avoir perdu. Cette histoire n’est pas, je vous le jure, un conte fait à plaisir ; à Tiflis, l’on s’en souvient encore, et l’on en parle le soir, à la veillée, mais en l’ornant un peu. Je la tiens de la bouche du prince Dimtri lui-même.
— Qu’est devenu Grigory ?
— Son ancien maître a récompensé son dévouement. Grigory a quitté la pelle et la bêche. Tenez, cet homme rond et enluminé qui se pavane devant sa porte, c’est lui, c’est Grigory. Cette belle boutique où se mêlent les fruits, les fleurs et les légumes, lui a été donnée par son ancien maître. Datho cultive en paix son petit champ. Vamiran, qui est resté Arménien dans l’âme, spécule et s’enrichit encore.
— Et le prince Domenti ?
— Il voyage.
**********
____________________________________________________________
LE PRINCE DOMENTI
SCENES DE LA VIE GEORGIENNE
1862
Par HENRI CANTEL
( – )
Revue des Deux Mondes
Tome 40

____________________________________________________________