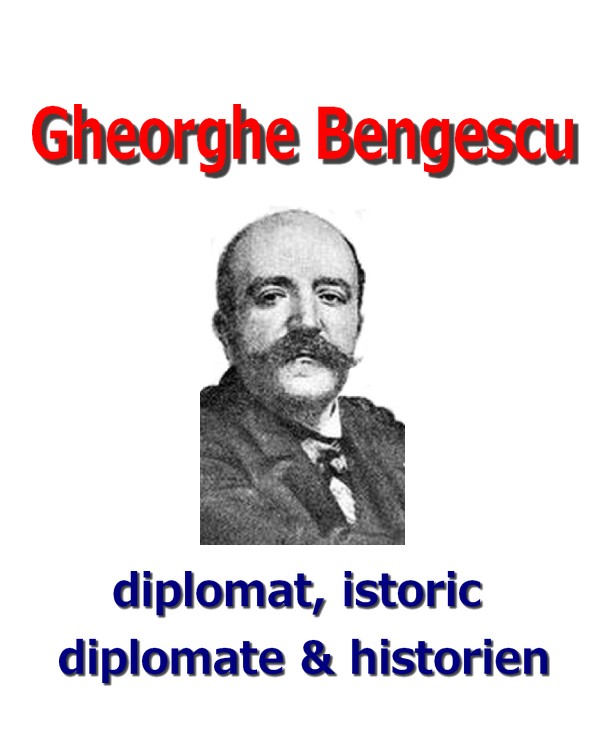BLESTEMUL VASILE ALECSANDRI
BASILE ALECSANDRI, POETE ET PATRIOTE
Un poète diplomate roumain du XIXe siècle – Basile Alecsandri
Georges Bengesco
Revue des Deux Mondes
Tome 60
1910
**
 Vasile Alecsandri par Constantin Daniel Stahi
Vasile Alecsandri par Constantin Daniel Stahi
Portretul lui Vasile Alecsandri
***
România – textul în limba română
Vasile Alecsandri

LITTERATURE ROUMAINE
POESIE ROUMAINE
Literatura Română
Romanian Poetry
Vasile Alecsandri
1821 Bacău – 1890 Mircești
Goerges Bengesco
Gheorghe Bengescu
1848 Craiova – 1921 Paris
VASILE ALECSANDRI, POETE ET PATRIOTE
par GEORGES BENGESCO
Un poète diplomate roumain du XIXe siècle
Basile Alecsandri
(Vasile Alecsandri)
Près de vingt ans se sont écoulés depuis la mort de Basile Alecsandri, et la Roumanie, dont il a été le poète peut-être le plus illustre, et certainement le plus populaire, le regrette aujourd’hui encore d’autant plus sincèrement que nul de ceux qui sont venus après lui n’a réussi à éclipser sa gloire. La renommée d’Alecsandri avait dépassé, de son vivant même, les bornes de sa patrie. Connu et apprécié en Allemagne par les remarquables traductions que Carmen Sylva a faites de quelques-uns de ses plus beaux poèmes ; en Angleterre où, dès 1856, l’honorable Henry Stanley (depuis lord Stanley d’Alderley) avait publié, dans une édition de luxe devenue fort rare et fort recherchée des amateurs, une Anthologie des poètes roumains, Alecsandri a eu surtout des amis et des admirateurs en France, où il avait été élevé, où il avait passé une partie de sa vie, rempli, à diverses reprises, des missions politiques importantes, et où, au moment de sa mort, il représentait encore, en qualité de ministre plénipotentiaire, le roi Charles Ier et son gouvernement.
Il nous a paru d’autant plus intéressant de faire revivre, dans ces pages, cette belle figure de poète et de diplomate que retracer, même brièvement, la vie d’Alecsandri et essayer de montrer quels ont été les traits essentiels et les qualités distinctives de son génie, c’est évoquer, en même temps, une grande partie de l’histoire roumaine pendant la seconde moitié du XIXe siècle, car il est peu d’événements de cette histoire auxquels son nom n’ait été mêlé, et dont il n’eût pu dire lui-même, avec assurance, et non sans quelque fierté :
-
- Et quorum pars mayna fui.
Basile Alecsandri est né à Bacau, en 1821, au plus fort du mouvement insurrectionnel provoqué par le soulèvement d’Alexandre Ypsilanti en faveur des Grecs. Peu de mois auparavant, le chef de l’Hétairie avait en effet franchi le Pruth à la tête de ses partisans. Son entrée en Moldavie avait été le signal de graves complications : massacres à Galatz, fuite précipitée du prince Michel Soutzo, envoi par la Porte d’un corps d’armée turque en Valachie. Au milieu de l’affolement général, les boyards roumains, tremblant pour leurs biens et pour leur vie, s’étaient empressés, comme toujours en pareille circonstance, de chercher un refuge dans les contrées avoisinantes, en Bukovine, en Bessarabie ; d’autres avaient gagné le fond des forêts de la haute Moldavie. Les parents d’Alecsandri s’étaient retirés à Bacau, non loin des montagnes ; c’est là que le poète vint au monde, se trouvant ainsi exposé, dès sa plus tendre enfance, à toutes les surprises de cette vie errante que, depuis les premières invasions des Tartares, avaient été contraintes de mener tant de générations de Roumains.
La famille d’Alecsandri était très vraisemblablement originaire d’Italie. Alors que les républiques de Venise et de Gênes se disputaient la prépondérance en Orient, un grand nombre d’Italiens avaient abandonné leur pays pour aller s’établir à Constantinople, où les Génois étaient maîtres, par la mer Caspienne, de presque tout le commerce avec les Indes, et où les Vénitiens possédaient d’importants comptoirs financiers. Plusieurs de ces Italiens étaient passés de Turquie en Valachie et en Moldavie, — la plupart à la suite des princes phanariotes ; — ils s’y étaient fixés, y avaient épousé des femmes indigènes et fait souche de bons Roumains. Tels furent les Couza, les Cozadini, les Negri, les Rolla. Alecsandri, dont la mère aussi était d’origine italienne, manifesta toujours une vive sympathie pour le pays auquel avaient appartenu ses ancêtres, et Venise, qu’il regardait comme le berceau de sa famille, — plusieurs des ambassadeurs vénitiens à Constantinople s’appelaient Alecsandri, et naguère encore un palais portant ce nom s’élevait dans la vieille cité des doges, — l’attira de tout temps. Il semble d’ailleurs qu’il ait eu en lui quelque chose du tempérament et du tour d’esprit italiens : une grande finesse, un sens politique aiguisé, un cœur prompt à l’enthousiasme, enfin un léger penchant au farniente et un peu de « cette paresse orientale dans l’habitude de la vie, » dont parle Mme de Staël, lorsqu’elle analyse le caractère des Italiens.
Placé de bonne heure dans un pensionnat de Iassi, que dirigeait M. Victor Cuenin, un Français qui, après la campagne de 1812, était venu s’établir en Moldavie, Alecsandri y eut, entre autres condisciples, Michel Cogalniceano, l’un des hommes d’Etat et des historiens les plus remarquables qu’ait produits la Roumanie, ainsi que l’acteur Millo, qui, appartenant à une excellente famille de vieux boyards moldaves, avait été poussé vers le théâtre par une vocation irrésistible et devait interpréter un jour sur la scène roumaine, avec un succès considérable, les principaux personnages comiques du théâtre d’Alecsandri.
L’enfant s’y perfectionna dans l’étude de la langue française, et, tout en apprenant les règles de la grammaire et les éléments de la syntaxe, s’y prit de passion pour Daniel de Foë et son Robinson Crusoé, dont il avait entendu raconter par un camarade de classe les aventures extraordinaires. Dès lors s’éveilla en lui le goût des voyages lointains ; l’île de Robinson occupait constamment sa pensée, et cette vision hanta toujours si fort son esprit que l’un de ses plus sincères regrets, jusque dans les dernières années de sa vie, fut de n’avoir pu visiter l’Amérique, où l’avait entraîné et si souvent promené son imagination d’enfant et de jeune homme.
En 1834, Alecsandri quitta la pension de M. Cuenin, et partit pour Paris en compagnie de plusieurs autres jeunes Moldaves, parmi lesquels se trouvait Alexandre Couza, celui-là même qui devait, vingt-cinq ans plus tard, réaliser l’union des Principautés en montant sur le double trône de Moldavie et de Valachie. L’exode de la jeunesse roumaine en France date des premières années du XIXe siècle, et les circonstances dans lesquelles il commença à se produire intéressent trop l’histoire des rapports intellectuels entre les deux pays pour qu’elles ne nous arrêtent pas un instant.
On sait que, pendant tout le XVIIIe siècle, les Principautés de Valachie et de Moldavie furent gouvernées par des princes, — ou hospodars, — que la puissance suzeraine choisissait parmi les Grecs du Phanar, et Ton a constaté plus d’une fois que l’un des principaux effets de la domination phanariote en Roumanie avait été une vive impulsion des esprits vers la civilisation française. Ces princes, — presque tous anciens interprètes ou drogmans de la Porte, — étaient tenus de bien posséder le français, dont la connaissance leur était devenue indispensable depuis que, dans les relations diplomatiques, son usage avait remplacé celui du latin, et, une fois investis de l’hospodarat, ils attachaient à leur personne des secrétaires et des rédacteurs français, ou d’origine française, qui les accompagnaient au siège de leur gouvernement. Il était aussi de tradition que l’ambassade de France à Constantinople désignât l’un de ses membres pour remplir auprès des hospodars les fonctions quasi officielles de secrétaire en titre, avec la mission de communiquer directement à l’ambassade les principales nouvelles d’Europe, parvenues à Iassi et à Bucarest, par la voie du Nord ou de l’Occident. C’étaient comme autant de foyers de culture intellectuelle française qui se formaient ainsi autour du prince et de sa Cour, et qui projetaient leurs rayons sur toute la haute société roumaine. Aussi les boyards, auxquels, en l’absence d’une littérature nationale à peine naissante à cette époque, on n’enseignait guère que le grec, délaissèrent-ils rapidement l’étude de cette langue pour s’initier et faire initier leurs enfants à la connaissance du français.
La présence en Roumanie, au moment de la Révolution française, d’un certain nombre d’émigrés, qui y étaient venus gagner leur vie soit comme secrétaires des princes phanariotes, soit comme précepteurs des jeunes boyards indigènes (l’un de ces émigrés, qui se disait marquis de Beaupoil de Sainte-Aulaire, devint même ministre des Affaires étrangères du prince Ypsilanti), — la création d’un corps consulaire étranger en Valachie et en Moldavie, — enfin le contact de plus en plus intime des Roumains avec les Russes depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la révolution roumaine de 1848, sont autant d’autres causes qui ont contribué à la diffusion très rapide des idées et de l’influence françaises en Roumanie. Le français devint la langue courante de la société polie ; l’Encyclopédie et les œuvres de Voltaire trouvèrent de nombreux lecteurs dans les deux Principautés ; on se mit à traduire en roumain presque tous les auteurs classiques français ; enfin, dès 1802, un nombre de plus en plus considérable de jeunes gens de nationalité roumaine prirent le chemin de Paris pour y faire leur éducation. Lorsque Alecsandri y arriva en 1834, il retrouva quantité de ses compatriotes qui suivaient déjà les cours des écoles et des facultés publiques. Son père le destinait à la médecine, et, dans son désir de se conformer aux volontés paternelles, le jeune homme, après s’être fait recevoir bachelier ès lettres, fréquenta pendant quelques mois le laboratoire de Gaultier de Claubry, répétiteur de chimie à l’Ecole polytechnique, et éditeur du Cours de chimie de Gay-Lussac. Mais il avait déjà trop d’imagination, et dans l’imagination trop de fantaisie, pour se plier volontiers aux théories abstraites des sciences. La nomenclature chimique l’intéressait beaucoup moins que les Études de la nature, de Bernardin de Saint-Pierre, et que l’Atala de Chateaubriand, dont la lecture le passionnait. Il se plaisait souvent à dire, lorsqu’il parlait de sa jeunesse, que ces deux ouvrages, ainsi que les Confessions de J.-J. Rousseau et le Jocelyn de Lamartine, paru deux ans après son arrivée en France, avaient eu sur le développement de son talent poétique une influence prépondérante et décisive. Déjà, tout enfant, il avait été vivement impressionné par la beauté mélancolique, et comme recueillie, de la campagne roumaine. Esprit rêveur et contemplatif, âme tendre et délicate, il avait profondément ressenti l’attrait mystérieux qu’exerce sur le Roumain la vue des hautes montagnes, des plaines fertiles, des forêts ombreuses qui font l’ornement et la richesse de son pays. La lecture de Chateaubriand et de Rousseau, ces grands poètes en prose, acheva d’enflammer son imagination et de le détourner de l’étude des sciences. Trop sensible d’ailleurs pour manier le scalpel, il obtint facilement de son père, qui était venu le voir à Paris, l’autorisation d’abandonner la médecine. Le droit, vers lequel il s’était tourné, ne parvint pas à le fixer davantage ; il était impatient d’essayer le luth qu’il sentait vibrer sous ses doigts ; il lui tardait de courir le monde, de voir de nouveaux pays, et de contempler, sous d’autres cieux, les aspects infinis et variés de la nature, qui seule avait le don de lui plaire, parce que seule elle parlait à son cœur en même temps qu’à son imagination. L’Italie surtout le tentait. Aussi, en 1839, après cinq années de séjour en France, prenait-il, pour rentrer dans son pays, la route de la terre, idéale entre toutes, qu’il entrevoyait depuis si longtemps dans ses rêves. Il visita successivement Florence, Rome, Bologne, Gènes, Venise et Trieste ; nulle part il n’éprouva une impression plus vive qu’à Venise,
La pauvre vieille du Lido,
Nageant dans une goutte d’eau
Pleine de larmes !
Il lui semblait y avoir retrouvé comme une seconde patrie ; il devait y retourner en 1846, et y goûter des heures d’ivresse, dont le souvenir lui inspirera quelques-uns de ses plus beaux vers.
En 1840, Alecsandri, à peine âgé de dix-neuf ans, revient en Moldavie, et, comme premier essai littéraire, donne à une revue publiée par son camarade d’enfance, Cogalniceano, une nouvelle en prose : La Bouquetière de Florence, où il retrace, d’une plume dont il est déjà maître, un touchant épisode de son voyage en Italie.
Pour bien se rendre compte du rôle important joué dès lors par Alecsandri dans la littérature et dans la succession des événements politiques de sa patrie, il est nécessaire de connaître l’état dans lequel se trouvaient, au moment de ses débuts, le pays qui l’avait vu naître, la langue dans laquelle il a écrit ses premiers vers, la société au milieu de laquelle s’est développé son génie poétique. Les difficultés qu’il eut à vaincre pour imposer au public son talent si personnel, pour ouvrir la voie à des idées nouvelles, à une nouvelle forme d’art, et, d’autre part, les luttes qu’il dut soutenir pour réaliser ses aspirations de patriote, n’en seront que mieux comprises, et l’on n’en appréciera que davantage, en même temps que l’originalité et la valeur de son œuvre, l’élévation et le désintéressement de son caractère.
Lorsqu’en 1844 parurent, dans une revue littéraire moldave, les premières poésies d’Alecsandri, il y avait un peu plus de vingt ans que les Roumains, délivrés du joug phanariote, qui leur avait été si pesant et si funeste, avaient retrouvé, sous des hospodars indigènes, une ombre d’indépendance et comme un semblant de vie nationale. Mais leur pays avait été soumis, même après la chute des Phanariotes, à trop d’épreuves : guerres, invasions, pillages, occupations étrangères successives, fléaux et calamités de toute sorte, pour qu’il n’en demeurât pas encore tout saignant et tout meurtri ; et d’ailleurs, les princes indigènes, soumis au double contrôle de la puissance suzeraine et de la puissance protectrice, — la Russie, — n’avaient pas l’autorité nécessaire pour gouverner avec énergie ; de leur côté, les boyards, partagés entre le désir de se montrer bons patriotes et la crainte de déplaire aux représentants, tout-puissants à Bucarest comme à Iassi, des gouvernements étrangers, vivaient dans une atmosphère d’intrigues plus faite pour servir leurs ambitions personnelles que les intérêts de leur pays ; la bourgeoisie n’existait encore qu’à l’état de clientèle servile des boyards ; on ne pouvait rien attendre de la classe des commerçants et des marchands qui, presque tous étrangers, n’avaient quelque influence que grâce à l’appui des consuls dont ils relevaient ; quant au peuple, écrasé d’impôts, réduit presque au servage, croupissant dans l’ignorance et dans la misère, exploitée la fois par les propriétaires, les fermiers et le fisc, il ne comptait pas.
Le tableau est moins sombre, si l’on envisage le mouvement intellectuel et littéraire qui avait commencé à se dessiner dans les Principautés, sous les premiers princes indigènes. Déjà, au temps des Phanariotes, et malgré leurs efforts persévérants et systématiques pour tout gréciser en Roumanie, quelques hauts prélats, des professeurs, des poètes, animés d’un ardent patriotisme, avaient fait de louables tentatives pour remettre en honneur la langue roumaine, qu’on n’enseignait plus que dans les écoles des villages. C’est ainsi que, sous l’active impulsion des métropolitains Grégoire et Daniel, de Valachie, Jacob et Benjamin, de Moldavie, les traductions en roumain des livres religieux, — écrits jusqu’alors en slavon et en grec, — s’étaient multipliées dès le XVIIIe siècle ; en 1804, un séminaire national avait été fondé à Socola ; plus tard, des écoles roumaines, où les élèves recevaient les premiers éléments de la grammaire, de l’histoire, des mathématiques, et même du latin, bien qu’elles fussent plutôt des écoles pratiques d’arpentage, furent créées par Georges Assaki, à Iassi, en 1813, et en 1816, par Georges Lazar, à Bucarest. Ce dernier était un Roumain de Transylvanie, où la culture nationale, mieux préservée des atteintes de l’influence grecque, avait pris un certain développement depuis que des prêtres, d’origine roumaine, convertis au catholicisme, étaient allés étudier, dans les séminaires de Rome et de Vienne, la théologie, les sciences, les langues anciennes et modernes. Les plus connus d’entre eux sont Samuel Micou (ou Klein), Petru Maïor et Shincaï. Ce furent, à vrai dire, les premiers historiens, les premiers érudits qu’ait comptés la science roumaine.
A la même génération appartiennent des chroniqueurs tels que Denis l’Ecclésiaste et Zilote dit le Roumain ; des poètes, comme les Vacaresco, les Beldiman, les Conaki, les Carlova, qui entreprirent de faire renaître la langue et la littérature roumaines. C’est aussi vers la même époque, — et principalement de 1820 à 1840, — qu’un grand nombre de chefs-d’œuvre de la littérature française furent traduits en roumain, depuis l’Oreste et le Zadig, de Voltaire, jusqu’aux Méditations de Lamartine.
Mais quelque méritoires que fussent ces efforts, et malgré le zèle et le talent déployés par les écrivains nationaux aussi bien dans leurs œuvres originales que dans leurs traductions du français, leur style manquait trop souvent de naturel et de simplicité ; leur langue ne coulait pas de source ; elle trahissait l’étude, l’apprêt, l’effort, une certaine gêne provenant sans doute de ce que la plupart d’entre eux s’étaient habitués à penser et à écrire dans un idiome étranger.
Un autre reproche qu’on peut adresser aux littérateurs roumains de cette époque, c’est qu’ils sont presque tous dépourvus d’imagination et d’originalité ; à part quelques pages empreintes d’une émotion sincère, et où passe un large souffle d’indignation, lorsqu’il s’agit de déplorer les malheurs de la patrie et d’en flétrir les auteurs, ce ne sont, la plupart du temps, que chansons érotiques ou bachiques, réminiscences d’Anacréon et des poètes grecs de son école, fades exhumations de tout le clinquant de l’antiquité, alternant avec de longs développements épiques et didactiques, dans le genre de ceux qu’on rencontre si fréquemment en France chez les poètes du premier Empire.
Le grand mérite d’Alecsandri est d’avoir rompu avec ces traditions littéraires surannées, et de n’avoir demandé conseil, selon le précepte de Victor Hugo, qu’ « à la nature, à la vérité et à l’inspiration. »
La nature en effet est son principal modèle ; il en a le sentiment profond ; il l’aime, s’y complaît, s’en délecte ; il la traduit avec l’élan d’un génie primesautier et affranchi de toute contrainte, avec le charme d’une langue exempte de toute gêne, et où l’on sent vibrer pour la première fois comme l’écho même de l’idiome national.
Dès son enfance, Alecsandri s’était passionné pour les contes populaires roumains, pour cette poésie jaillie de l’âme même du peuple et toute pleine d’idées naïves, d’inventions merveilleuses, de récits extraordinaires et fantastiques. Les fées, les sorcières, les vampires, les loups garous, les chevaux ensorcelés volant au milieu des nues ; les serpents aux écailles d’or dont les nids sont remplis de pierres précieuses ; les cerfs entre les ramures desquels on voit des berceaux de fées ; les oiseaux merveilleux à voix humaine ; les aigles géants qui habitent les entrailles de la terre, tout ce monde enchanté et féerique qui peuple les ballades et les légendes roumaines avait exercé de bonne heure sur son esprit une véritable fascination.
De très bonne heure aussi, il avait été séduit par l’originalité et la grâce poétique des chants populaires de son pays, qu’il avait entendus à la veillée, sous le toit paternel, aux fêtes des villages voisins, ou bien encore dans les campagnes lorsqu’il y promenait ses longues rêveries d’adolescent. Il avait observé que presque tous ces chants célébraient les hauts faits et les aventures héroïques de personnages fameux dans l’histoire ou dans la légende, et il comprit qu’il y aurait là des éléments précieux pour la reconstitution du passé de la Roumanie, passé qui, en l’absence de textes non encore exhumés de la poussière des archives, n’avait pu être jusqu’alors que très imparfaitement connu ; aussi entreprit-il de recueillir cette véritable histoire nationale rimée de la bouche des vieillards, des pâtres, des musiciens ambulants appelés tziganes. Il se transporta au milieu d’eux, vécut de leur vie, écouta et transcrivit leurs récits et leurs chansons, et apprit ainsi à bien connaître cette race roumaine, si curieuse, si intéressante à étudier, parce qu’elle a su conserver intacts, depuis près de vingt siècles, le type, le costume, et même quelques-uns des usages de ces farouches guerriers daces, représentés sur les bas-reliefs de la colonne Trajane, qui opposèrent à la conquête romaine une résistance acharnée. Il s’aperçut que ce peuple, si persécuté par le sort et si opprimé par les hommes, avait l’imagination vive, l’intelligence prompte ; qu’il aimait la nature dans toutes ses créations, les arbres, les fleurs, les oiseaux ; qu’il cachait sous une apparente rudesse un grand fonds de sensibilité, et il se dit que le poète qui saurait toucher son cœur simple et naïf serait sûr d’en être bien compris.
Il lui fut aussi donné d’entendre parler la vraie langue roumaine, celle que n’avait point altérée la promiscuité avec l’étranger, celle qui était demeurée pure au milieu des invasions et des mélanges infinis de races, et qui, bannie du palais du prince, de la demeure des boyards, de l’église, de l’école, avait trouvé un refuge sous le toit de chaume du paysan : c’est là qu’Alecsandri ira la chercher pour la faire refleurir dans sa fraîche et verte nouveauté.
De ce contact prolongé avec le peuple, de cette source d’inspiration qui n’avait plus rien d’artificiel, sont sorties les premières poésies publiées en 1844, par Alecsandri, dans une revue littéraire de Moldavie. Elles furent réunies huit ans plus tard en volume, et parurent à Paris, et en roumain, sous ce titre : Doïne si Lacrimioare (Doïnas et Fleurs de muguet). Ce sont en effet de véritables fleurs poétiques, cueillies dans la campagne roumaine, et tout embaumées du parfum du sol natal.
Les Doïnas tiennent à la fois des chansons des trouvères, et des « lieders » des Allemands ; le sentiment qui y domine est celui du dor, mot roumain qui n’a pas son équivalent précis en français, et qui exprime à la fois le désir, le regret, l’espoir, la douleur, tout ce qui remplit le cœur de joie ou de mélancolie : « La doïna, dit Alecsandri lui-même, est pour celui qui la comprend comme la plainte même de la patrie soupirant après la gloire des temps passés… » Dans plusieurs de ses Doïnas (l’Autel du monastère de Putma ; — l’Heure fatale ; — le Tartare ; — Chanson guerrière), le poète évoque en effet le souvenir d’un passé glorieux pour les Roumains ; dans d’autres (Marioara Florioara ; — Cinel-Cinel), il peint, en des vers d’une fraîcheur et d’une grâce incomparables, et avec des couleurs dont l’éclat est aussi vif que le sentiment qui les lui a inspirés, le ciel, les plaines, les montagnes, les sources, les fleurs de son pays, et il entremêle à ces descriptions soit quelque tableau, pris sur le vif, de mœurs populaires, soit quelque récit, tantôt joyeux, tantôt émouvant, dans lequel revivent les habitudes, les usages, les croyances naïves et superstitieuses du peuple roumain.
Les soi-disant délicats, les raffinés, qui persistaient à ne considérer comme poètes vraiment dignes de ce nom que les imitateurs serviles des pseudo-beautés de la mythologie classique, et qui ne concevaient pas qu’on pût écrire en vers sans chanter la flèche d’Eros ou le trident de Neptune, crièrent au scandale et essayèrent de déprécier et de ridiculiser ce jeune homme de vingt-trois ans, qui, au lieu de « s’attacher aveuglément aux opinions de ses anciens, » osait ainsi rompre en visière à l’idée qu’on se faisait alors de l’art et du style poétiques. Mais les connaisseurs ne s’y trompèrent pas, et saluèrent avec joie l’éclosion d’un talent si plein de promesses. Une jeune femme surtout se distingua par la conviction et la chaleur des encouragements qu’elle prodigua à Basile Alecsandri. Elle était de grande naissance, belle, ornée de tous les agréments de l’esprit : Alecsandri conçut pour elle une de ces passions, mêlées de culte et d’idolâtrie, dont les grands poètes seuls ont le privilège de dire magnifiquement au monde toute la douceur et toute l’ivresse. Hélène Negri, — son nom n’est plus aujourd’hui un mystère pour personne en Roumanie, — fut l’Elvire, la Béatrice du poète des Doïnas, et ce touchant roman d’amour, ébauché en Moldavie au commencement de l’année 1845, continué en Italie et principalement à Venise, en 1846, et tragiquement interrompu par la mort, sur les rives du Bosphore, au printemps de 1847, a fait jaillir de l’âme, tour à tour heureuse et cruellement déchirée, d’Alecsandri, quelques-uns des plus beaux vers de la langue roumaine : 8 mars 1845 ; — Une nuit à la campagne ; — Chant de bonheur ; — Venise ; — Adieu ; — Dédicace (l’Étoile).
Nous avons vu Alecsandri occupé à recueillir de la bouche des pâtres et des chanteurs nomades les poésies populaires de la Roumanie. Il attachait d’autant plus de prix à réunir et à publier cette collection qu’il considérait son entreprise comme un véritable service rendu à sa patrie.
Ce que Fauriel et Marcellus ont fait pour les chants populaires de la Grèce moderne, Leroux de Lincy pour les chants historiques français, Walter Scott pour les légendes et les ballades de l’Angleterre, Nigra et Caselli pour les chants populaires du Piémont, Alecsandri l’a fait, de la façon la plus méritoire, pour les chants populaires de la Roumanie, dans lesquels se reflètent, en traits précis et lumineux, la physionomie et le caractère du peuple roumain, et où l’on retrouve toute la richesse de son imagination, et aussi toute la fierté et toute la mélancolie de son cœur. « Le Roumain est né poète, — dit Alecsandri dans l’Introduction placée en tête de son recueil. — Doté par la nature d’une imagination brillante et d’une âme sensible, il répand dans de douces mélodies (car il ne sait encore ni lire ni écrire) les aspirations secrètes de son âme. Qu’il ressente du chagrin, qu’il s’abandonne à la joie, qu’il s’extasie devant quelque belle action, il chante sa joie ou sa douleur, ses héros, son histoire, et c’est ainsi que son cœur est une source intarissable de poésie… »
On a reproché quelquefois à Alecsandri d’avoir plus ou moins altéré ces chants populaires, et de ne les avoir pas donnés tels qu’il les avait recueillis de la bouche même du peuple, dans leur forme imparfaite, dans leur style primitif, avec leur prosodie fautive et irrégulière. Le poète s’est toujours défendu d’avoir usé de supercherie dans la mise au jour des poésies nationales roumaines, tout en reconnaissant loyalement, et dès la première heure, qu’il y avait introduit quelques remaniements, afin d’en réparer le désordre et d’en coordonner l’harmonie. On lit en effet sur le frontispice des deux premières parties des Ballades, — tel était le titre de l’édition originale, publiée à Iassi, en 1853 : — Ballades recueillies et revues par B. Alecsandri. Et plus tard, dans une lettre inédite de l’année 1855, adressée à A. Ubicini, et qui fait partie des riches collections de l’Académie roumaine, l’auteur s’expliquera avec plus de détails sur la manière dont il a procédé à ce travail de reconstitution :
« Après avoir parcouru les montagnes et les plaines, me mêlant aux paysans dans les foires, entrant avec eux dans les cabarets, grimpant sur les sommets pour trouver des bergers troubadours, fréquentant les monastères, écoutant partout les récits des contes populaires, et sténographiant tout ce qui arrivait à mon oreille, je possédais un gros fatras de vers altérés par la bouche des chanteurs, de légendes tronquées, de pièces confondues dans un désordre sans pareil ; mais les pierres précieuses étaient là, sous ma main ; il ne s’agissait plus que de les polir, de les remettre à leur place primitive, de les enchâsser enfin, pour reconstituer les anciens joyaux poétiques de nos ancêtres… »
A les examiner de près, les Chants populaires roumains peuvent se diviser en quatre groupes distincts.
Les Ballades ; les Doïnas ou chants d’amour ; les Horas, ou chants et airs de danse ; enfin les Colinde, qui ont un caractère plutôt religieux, et qui, chantées à la veille des grandes fêtes, offrent quelque ressemblance avec les Noëls des littératures occidentales.
Un trait commun à ces quatre genres de poésies populaires, c’est qu’elles ne se récitent pas, mais qu’elles s’accompagnent de chant ou de danse, très souvent de chant et de danse à la fois. Tantôt lente, tantôt plus vive, mais toujours plaintive et mélancolique, la musique de ces chants, dans son rythme cadencé, a pour les oreilles roumaines un charme étrange et une douceur particulière. On sent, à l’écouter, que ce peuple a souffert, qu’il a été opprimé et que même ses joies fugitives ont toujours été mêlées d’amertume et de tristesse. La poésie populaire roumaine est d’ailleurs restée fidèle aux lois primordiales de la poésie lyrique : c’est-à-dire un ensemble harmonieux de chants, accompagnés par des instruments, et entremêlés de danses. De même, chez les Romains, la chorea, — la hora des Roumains, — était une danse en chœur, dans laquelle ceux qui l’exécutaient se prenaient par la main, formaient un cercle et dansaient au son de leurs propres voix.
La plupart des Ballades recueillies par Alecsandri célèbrent des événements historiques, des légendes nationales, des exploits de princes, de guerriers, et même de brigands fameux, car le brigandage, dans ces temps lointains, n’était pas considéré comme un déshonneur ; on le tolérait, on l’encourageait presque, surtout lorsque les brigands (qu’on appelait alors des haiduques) tenaient la campagne contre le boyard avide et rapace qui pressurait le peuple, ou contre l’étranger qui dévastait le sol de la patrie. Dans d’autres ballades, on voit se manifester l’amour que le Roumain porte à la nature : aux forêts, dans lesquelles il fait paître ses troupeaux ; au soleil, qui féconde de ses rayons la terre qu’il laboure ; à l’étoile qui, la nuit, guide sa marche solitaire à travers les vastes plaines où il chemine ; aux fleurs, dont il aime à orner sa cabane et qui lui servent à lui-même de parure ; enfin, aux bêtes, qui sont les compagnes de sa vie nomade et pastorale. L’une des plus célèbres parmi ces ballades, Mioritza (la petite brebis), avait fait une profonde impression sur Michelet, qui la regardait « comme une chose sainte et touchante à fendre le cœur. — Rien de plus naïf, dit-il, et rien de plus grand… »
Les Doïnas ont un caractère de nationalité et comme un goût de terroir plus prononcés que les Ballades. Ce sont en général des chants d’amour, dont presque tous commencent par une invocation à un arbre ou à une plante : « feuille verte de chêne, » ou « d’érable, » ou « de marjolaine, » selon le sujet ou le ton de la doïna. « Il en est, — dit un écrivain français très compétent en matière de littérature étrangère, Xavier Marmier, — qui sont comme de gracieux médaillons dont les riantes couleurs reposent les regards au milieu d’une longue série de tableaux de batailles. Il en est qui sont comme de tendres chansons écloses dans un jeune cœur par un heureux jour de printemps…»
Quant aux koras ou airs de danse, ce nom s’applique aussi bien à la musique accompagnant la danse qu’aux vers récités ou improvisés par les danseurs ; il y a en Roumanie presque autant d’airs de horas qu’il y a de villages. Chaque bourgade, chaque hameau, chaque troupe de laoutars, a les siens. « Le peuple roumain exprime tout par la danse, écrit Carmen Sylva dans son article Bucarest, des Capitales du monde ; les hommes dansent entre eux, les femmes dansent entre elles. Les soldats, dans les casernes, trouvent toujours un violon, une flûte, ou une cornemuse pour leur jouer une danse quelconque… »
C’est aux accents d’une hora, chantée et dansée d’un bout à l’autre de la Roumanie, que s’est faite, eu 1859, l’union des Principautés. Ce chant national avait pour auteur Alecsandri, qui a composé également plusieurs autres horas, les unes d’allure riante et gracieuse, pour le village, les autres, pleines de fougue et d’entrain, pour le camp.
Poète en qui semble s’être incarnée l’âme même de la nation à laquelle il appartenait, éditeur des chants populaires de sa patrie, Alecsandri a en outre le mérite d’avoir été l’un des créateurs du théâtre roumain.
Comme la plupart des institutions artistiques de la Roumanie, le théâtre est d’origine relativement récente. Il s’est développé parallèlement pour ainsi dire dans les deux Principautés, chacune des deux capitales, — Bucarest et Iassi, — ayant eu, dès le début, une scène et une organisation théâtrale distinctes. Wilkinson, ancien consul général d’Angleterre en Valachie, et auteur d’un Voyage dans la Valachie et la Moldavie, dit qu’en 1819, une troupe d’acteurs allemands était venue à Bucarest, et qu’après quelques représentations, on les avait engagés à établir dans cette ville un théâtre régulier. « Ils jouaient, ajoute-t-il, des opéras allemands et des comédies traduites en valaque… » Il est exact que, vers la fin de 1818, une troupe d’acteurs viennois, sous la direction d’un imprésario nommé Gherghy, fut appelée à Bucarest pour y jouer la comédie, le drame et l’opéra ; mais ils n’interprétèrent pas les « comédies traduites en valaque » dont parle Wilkinson. Dès 1817, il s’était formé à Bucarest une troupe d’amateurs, qui, avec la protection et le concours de la princesse Ralou, fille du prince régnant Caradja, avait organisé, dans une des salles du palais princier, des représentations dramatiques. Plus tard, une salle spéciale, dite « salle du Club, » fut construite dans la capitale, et la troupe de Gherghy y fit ses débuts, mais ses représentations alternaient avec celles qu’y donnèrent des artistes amateurs roumains, dont le répertoire se composa d’abord de l’Hécube, d’Euripide, et de l’Avare, de Molière.
D’autres sociétés particulières tentèrent, avec des fortunes diverses, de répandre le goût de l’art dramatique en Valachie ; mais elles eurent à lutter contre toute sorte de difficultés d’ordre matériel, politique et financier, et elles n’attiraient d’ailleurs qu’un public très spécial et très restreint. Le théâtre valaque ne devait prendre réellement son essor que sous les auspices de la Société philharmonique, fondée en 1834 par Héliade et Campineano, et dont l’un des premiers actes fut la création d’un théâtre national à Bucarest.
En Moldavie, un Conservatoire national avait été institué en 1837, et parmi les premiers directeurs de cet établissement, on voit figurer le père d’Alecsandri. Bientôt, une nouvelle direction, composée d’Alecsandri lui-même, de Cogalniceano et de Negruzzi, transforma cette école en théâtre, et c’est ainsi qu’Alecsandri fut amené à traduire, pour la scène moldave, quelques pièces, la plupart françaises, auxquelles le public fit bon accueil. Encouragé par ces premiers succès, il se décida bientôt à écrire des œuvres originales, qu’il composa, — c’est lui-même qui nous l’apprend, — avec la préoccupation constante de fustiger les ridicules et de flageller les vices de ses compatriotes. Alecsandri avait, en matière d’art dramatique, des idées contestables peut-être, mais très personnelles et très arrêtées. Il était un partisan convaincu de la célèbre maxime du poète latin moderne Santeul : Castigat ridendo mores, et il pensait que dans un pays qui sortait à peine d’une longue léthargie, qui avait vécu pendant plus d’un siècle dans une atmosphère morale destructive de tout ressort et de toute énergie, où il n’y avait encore ni opinion, ni libertés publiques, où la presse était bâillonnée, où le moindre écart de langage et de plume entraînait l’emprisonnement ou l’exil, le meilleur moyen d’assainir les mœurs et de retremper les caractères était de transformer le théâtre en tribune, et de livrer à la risée publique les travers et les vices d’une société qui s’effondrait de toutes parts. La tâche était d’autant plus malaisée qu’il s’agissait, à un point de vue plus spécial, de réformer la langue théâtrale, lourde, prétentieuse, désagréable à l’oreille ; il fallait aussi faire l’éducation des acteurs, — encore très inexpérimentés, — et celle du public, presque aussi novice que les comédiens. Alecsandri y parvint à force de volonté, de patriotisme et de talent.
L’ensemble de son œuvre dramatique comprend près de cinquante pièces : comédies, drames, vaudevilles, féeries, saynètes, à-propos, dont beaucoup sont tombées dans l’oubli, et dont celles mêmes qui sont restées au théâtre n’offrent plus guère d’intérêt aujourd’hui, parce que les mœurs qui y sont peintes se sont modifiées, et que les défauts qu’elles ridiculisaient ont disparu en grande partie de la société roumaine. Alecsandri n’a jamais été d’ailleurs un dramaturge de profession, et il a ignoré le plus souvent l’art de développer une fable, de conduire une intrigue, de préparer un dénouement, d’intéresser le spectateur par l’opposition des caractères et de l’émouvoir par le choc des passions. Doué d’une extrême facilité, il écrivait son théâtre d’inspiration, comme il rimait ses poésies, et c’est pour cela que ses principales œuvres dramatiques, agréables de forme, mais mal construites et mal charpentées, manquent ordinairement d’action et de mouvement. Ces défauts sont surtout sensibles dans les trois ouvrages qu’il considérait comme ses meilleures productions dramatiques ! un drame national en vers, Despot-Voda (le voïévode Despota), et deux pièces, également en vers, dont il avait emprunté le sujet à l’antiquité classique : la Fontaine de Bandusie (qu’il a intitulée, par euphémisme, sans doute, la Fontaine de Blandusie), et Ovide.
Il avait été séduit par la figure, assurément curieuse et peu banale, d’un aventurier grec, Jacques-Basile-Héraclide Despota, originaire de Samos, ou de l’île de Crète, qui, après avoir guerroyé dans les Flandres et pris part, dans les rangs de l’armée impériale, aux sièges de Thérouanne et de Hesdin, — dont il a laissé une relation en latin, — était parvenu, à force d’intrigue et d’ambition, à s’emparer, en 1561, du trône de Moldavie. C’est ce personnage, doué de qualités d’esprit incontestables, instruit, éloquent, exerçant une véritable séduction sur tous ceux qui rapprochaient, qu’Alecsandri a eu l’idée de mettre à la scène, et dont il a voulu, ainsi que l’explique la Préface de sa pièce, conter la légende dans une « suite de tableaux historiques formant un drame, et comme une épopée, où revivraient les mœurs, les luttes, les croyances et les tendances politiques du XVIe siècle… » Certes, il pouvait y avoir là matière à un beau drame historique, et ce plan avait de quoi tenter le patriotisme d’Alecsandri ; mais le drame historique n’était pas son fait, et la nature même de son talent, aimable, facile, gracieux, et plus à son aise dans la comédie, eût dû le mettre en garde contre les périls d’une tentative qui ne réussit qu’à moitié. Son Despot-Voda, écrit dans une belle langue poétique, et qui se lit avec intérêt, languit à la scène, parce qu’il est trop dépourvu d’action, et qu’il a tous les défauts de ce genre mixte, où l’auteur, mettant en scène des personnages historiques qu’il fait discourir entre eux, sans se soucier de soutenir le dialogue par la trame d’une intrigue plus ou moins habilement conduite, n’est, à vrai dire, ni poète dramatique, ni historien.
Alecsandri devait être plus heureux avec ses deux autres pièces en vers : la Fontaine de Blandusie et Ovide, bien qu’elles aient prêté à des critiques du même genre, et qu’il n’eût guère été préparé, par ses études antérieures, à traiter de pareils sujets. Son Horace et son Ovide, personnages de convention, peu conformes à la vérité et même à la tradition historiques, eussent fait certainement sourire un Victor Le Clerc ou un Gaston Boissier. Il y a, dans les deux pièces, un grand étalage d’érudition d’emprunt, mais la véritable connaissance de l’antiquité y fait trop souvent défaut. On y trouve, en revanche, de l’imagination, de la poésie et de la grâce dans l’expression de certains sentiments qui sont de tous les temps et de tous les pays, enfin une langue toujours élégante et châtiée. Ce qui nuit surtout à ces pièces, ce qui en gâte les meilleurs endroits, c’est la préoccupation visible de l’auteur de chercher dans le passé des allusions constantes au temps présent, ainsi qu’à l’origine latine du peuple roumain. C’est ainsi qu’il a mêlé à l’action même de la Fontaine de Blandusie, — la chose s’explique mieux pour Ovide, dont le dernier acte se passe à Thomis, la Constanza actuelle, où avait été exilé et où mourut l’auteur des Métamorphoses, — des esclaves et des personnages daces, qu’on sent bien n’avoir été mis là que pour donner au poète l’occasion d’exalter ces ancêtres des Roumains et de célébrer les vertus de leurs descendants. Il y a dans l’abus de ce procédé dramatique quelque chose de déplaisant, qui choque les moins prévenus, et la succession de ces tirades redondantes fait involontairement songer à ces couplets patriotiques, chantés sur les scènes populaires, et qui soulèvent à coup sûr les applaudissements. Là où Alecsandri est vraiment original, parce qu’il marche sur un terrain sûr et dans lequel il a su s’ouvrir une voie personnelle, parce qu’il parle de choses qu’il connaît à fond et nous montre des personnages qui lui sont familiers, c’est dans une suite de comédies et de saynètes, d’une observation très juste, d’une ironie aussi fine que mordante, et où il met en scène, avec ce sens du comique qu’il possédait à un si haut degré, — car ce poète charmant et délicat avait, lorsqu’il voulait faire rire, un peu de la fantaisie de Labiche et d’Henry Monnier, — quelques-uns des types de la société moldave d’il y a soixante ans : la matrone de province qui, pour se conformer aux lois du bon ton, entreprend, avec toute une smalah d’enfants et de domestiques, des voyages à l’étranger, arrive jusqu’à Paris et y est victime d’une série de mésaventures plaisantes dont le récit ou la mise en scène ont fait, comme le Chapeau de paille d’Italie et la Cagnotte, la joie de plusieurs générations ; — le vieux « laoutar, » drapé dans une robe aux larges plis, le chef recouvert du fez oriental, l’indispensable « laoutar » sans lequel il n’y avait pas jadis de vraie fête, qui chantait aux baptêmes, aux fiançailles, aux noces, aux banquets des boyards, et que les progrès de la civilisation devaient bientôt reléguer au rang îles vieilles épaves et des vieux souvenirs ; — le petit fonctionnaire, victime des changements, des caprices et des rancunes politiques de l’administration ; — le colporteur juif et le fermier grec, grands exploiteurs de la crédulité et de la bourse du paysan. C’est surtout aux dépens de cette dernière classe d’individus, étrangers à tout sentiment national, véritables ennemis du peuple roumain, et qu’Alecsandri avait coutume d’appeler des sangsues. (il a même intitulé l’une de ses comédies les plus applaudies : Les sangsues des villages), que s’est exercée avec succès sa verve satirique, merveilleusement mise en relief par son principal interprète, l’excellent comédien Millo.
Si le théâtre d’Alecsandri n’est pas exempt de quelques faiblesses, surtout en ce qui concerne la conception et la conduite de ses drames, il n’en va pas de même de celles de ses poésies qui lui ont été inspirées par l’ardent amour qu’il avait voué à sa patrie. L’auteur des Doïnas fut en effet un grand patriote, et son patriotisme sincère, profond, désintéressé, n’est pas son moindre titre à l’admiration et à la reconnaissance de ses compatriotes. Alecsandri a toujours eu foi dans l’avenir de son pays, et cela non seulement du jour où le ciel politique de la Roumanie, devenu plus serein, permit à ses concitoyens d’entrevoir la fin de leurs maux séculaires, mais dans les temps les plus sombres, aux heures les plus tristes de l’histoire nationale, et alors que les meilleurs et les plus vaillants semblaient avoir perdu tout espoir en de meilleures destinées. Il aimait à répéter un vieil adage de son pays : Le Roumain ne périt pas (Romanul nu piere), et c’est, fort de cette conviction, qu’il a composé une longue suite de chants patriotiques, commençant, en 1843, avec l’Autel du monastère de Putna, et se succédant presque sans interruption jusqu’à l’Ode sur la consécration de la cathédrale d’Argesh, qui est de 1886. Dans cet intervalle de quarante-trois années ont jailli tour à tour de sa lyre enthousiaste et toujours harmonieuse : l’Adieu à la Moldavie ; — le Réveil de la Roumanie ; — la Sentinelle roumaine ; — le Retour au pays ; — l’An 1855 ; — l’Étoile de la pairie ; — la Moldavie en 1857 ; — la Hora de l’union ; — l’Hymne à Etienne le Grand ; — le Chant de la race latine ; — Nos guerriers, pour ne citer que quelques-unes d’entre celles de ses poésies inspirées par le sentiment patriotique. Béranger disait : « Le peuple, c’est ma muse. » Aussi bien que lui, mieux que lui peut-être, car il fut assurément un plus grand lyrique, Alecsandri eût été en droit de dire : « Ma muse, c’est ma patrie. »
Mais le poète des Doïnas ne s’est pas borné à célébrer ainsi, en dilettante et en virtuose, tous les événements importants de l’histoire roumaine. Persuadé de bonne heure que la foi qui n’agit point n’est pas une foi sincère, il est entré hardiment, lui, l’homme pacifique et doux par excellence, dans l’âpre mêlée des partis, et il a lutté avec énergie pour le triomphe des idées dont il s’était fait, dès sa première jeunesse, le défenseur convaincu.
De 1840 à 1848, il est, aux côtés de Cogalniceauo et d’Ion Ghica, — le futur prince de Samos, — à la tête du mouvement dirigé par la jeunesse libérale de Moldavie contre le gouvernement autoritaire du prince Michel Stourdza. Il fonde, avec ses amis, plusieurs revues littéraires, dont le but est de réveiller, chez ses compatriotes, le sentiment de l’unité et de la nationalité roumaines et de contrebalancer l’influence prépondérante de la Russie, qui avait intérêt à maintenir les Principautés dans l’état de dépendance matérielle et de vasselage moral où les avaient placées les Règlements organiques, élaborés sous la haute direction du comte Kisseleff. Il s’attache à battre en brèche, par la plume et par la parole, sur la scène comme dans la presse, l’édifice vermoulu des vieilles institutions politiques moldaves, et à inspirer de toutes les façons la haine de la tyrannie intérieure et de l’oppression étrangère.
Tant d’efforts ne devaient pas rester superflus. Les esprits commençaient à s’exalter. Ils s’enflammèrent tout à fait lorsque le vent de liberté qui soufflait sur l’Europe eut gagné la Moldo-Valachie, où toute une génération de patriotes, résolus à tirer leur pays de la triste situation dans laquelle il se débattait, n’attendaient qu’un moment favorable pour réaliser leurs projets. Dès lors, il était impossible que la Révolution française de 1848 n’eût pas son contrecoup sur les rives du Danube. En Moldavie, une tentative infructueuse de soulèvement contre le prince Stourdza eut lieu au mois de mars 1848 ; quelques mois plus tard, éclatait le mouvement révolutionnaire valaque qui devait avoir pour conséquence l’abdication du prince Georges Bibesco. Le gouvernement provisoire et la lieutenance princière institués à Bucarest, à la suite de ces événements, ne furent pas de longue durée ; dès le 1er mai 1849, le traité de Balta-Liman replaçait la Moldo-Valachie sous le régime de l’occupation étrangère. Dans l’intervalle, les principaux chefs de la révolution valaque avaient été proscrits, et un grand nombre d’entre eux s’étaient réfugiés à Paris, où, pendant plusieurs années, et aussi longtemps que devait durer leur exil, ils ne cessèrent de faire une propagande active pour intéresser la presse et les hommes d’Etat français au sort de leur pays. C’est le moment où les Balcesco, les Bratiano, les Gotesco, les Héliade, les Ion Ghica, secondés par quelques philoroumains convaincus, tels que Bataillard, Ubicini, Colson, Vaillant, Elias Regnault, et encouragés par des hommes tels que Lamartine, Michelet, Quinet, Royer-Collard, Philarète Chasles, font entendre à la France des appels répétés, chaleureux, éloquens, en faveur de la cause roumaine. Dans la Revue même où paraissent ces lignes, et où M. Thouvenel avait publié, en 1840, d’intéressants Souvenirs de voyage en Valachie, M. Hippolyte Desprez exposait, avec une connaissance approfondie des événement et des hommes qui s’y trouvèrent mêlés, l’histoire du mouvement révolutionnaire moldo-valaque. Grâce à toutes ces sympathies, les idées chères aux patriotes roumains gagnèrent rapidement du terrain. Alecsandri, qui, après avoir été impliqué dans l’échauffourée de Iassi, avait dû, comme beaucoup de ses compatriotes, chercher un asile à l’étranger, profita du séjour prolongé qu’il fit à Paris, au lendemain de la Révolution roumaine de 1848, pour créer à sa patrie des appuis solides et des amitiés fidèles. Ses Doïnas, publiées, comme on l’a vu, à Paris même, en 1853, ses Chants populaires, traduits en 1855, contribuèrent à mieux faire connaître aux Français un peuple qui n’était pas indigne de fixer leur attention. De leur côté, les Roumains, surtout depuis le début de la guerre de Grimée, avaient tourné anxieusement leurs regards vers la France, sentant que d’elle seule pouvait venir le salut. Aussi fut-ce chez eux un véritable cri de soulagement et d’espérance lorsqu’en 1855, le baron de Bourqueney posa devant la Conférence de Vienne, au nom du gouvernement impérial, la question de l’union des Principautés sous un prince étranger, choisi, avec droit d’hérédité, dans une des familles souveraines de l’Europe. C’est de ce jour que date la sincère reconnaissance de la Roumanie pour la France ; car c’est grâce à sa généreuse initiative et à son appui désintéressé que les Principautés ont pu avoir, en 1859, l’union, et, en 1866, le prince étranger.
Les services rendus par Alecsandri à la cause roumaine, les relations influentes qu’il s’était créées à l’étranger, ses qualités de finesse et de tact jointes à la distinction et à l’affabilité de ses manières, enfin l’étroite amitié qui l’unissait depuis l’enfance au prince Couza le désignèrent tout naturellement au choix du nouvel élu de la nation roumaine lorsque celui-ci dut notifier aux Puissances signataires du traité de Paris sa double élection aux trônes de Moldavie et de Valachie.
La mission confiée à Alecsandri, pour flatteuse qu’elle pût paraître, n’en était pas moins délicate. La Convention de Paris, sans repousser catégoriquement le principe de l’union, y avait apporté de sérieuses restrictions, en stipulant que chacune des deux Principautés devait avoir son prince, son ministère, son parlement distincts. La résistance formelle de la Porte, soutenue par l’Autriche et par l’Angleterre, avait triomphé sur ce point capital des bonnes dispositions du gouvernement de Napoléon III, et le comte Walewski, plénipotentiaire de France, après avoir essayé de défendre, au sein de la Conférence, plutôt pour la forme, le projet de l’union, s’était vu contraint de faire appel à l’esprit de conciliation de ses collègues pour l’adoption d’une solution bâtarde, qui, en jouant sur les mois, — on reconnaissait à la Roumanie le titre officiel de Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie, — ne tendait à rien moins qu’à empêcher l’union de s’effectuer en réalité. Les Roumains avaient déjoué, par la double élection du prince Couza, les trop subtiles combinaisons de la diplomatie européenne, et il s’agissait, en mettant les Puissances en présence du fait accompli, d’obtenir leur adhésion à un acte manifestement contraire à la Convention de Paris. Tel était en réalité l’objet de la mission qu’AIecsandri fut chargé de remplir, au commencement de l’année 1859, auprès des Cours de France, d’Angleterre et de Sardaigne.
Il se rendit d’abord à Paris, où le comte Walewski ne lui cacha point que l’élection d’Alexandre-Jean Ier ayant été faite contrairement aux dispositions expresses de la Convention, ne serait reconnue ni par la Turquie, ni par l’Autriche, ni par l’Angleterre, les trois Etats les plus particulièrement intéressés au maintien du statu quo. En ce qui concernait la France, le comte Walewski rappela à Alecsandri qu’elle s’était toujours montrée favorable aux revendications des Roumains, et il ajouta que tout dépendait en fin de compte des volontés de l’Empereur. On a reproché à Napoléon III d’avoir songé à céder les Principautés à l’Autriche, pour faire sortir celle-ci d’Italie. Il est possible qu’à un moment donné cette combinaison se soit présentée à l’esprit du souverain, mais il n’en est pas moins vrai que les Roumains eurent de tout temps en lui un protecteur puissant, et la façon empressée, cordiale même dont il accueillit Alecsandri, auquel il accorda trois audiences successives, montre jusqu’à quel point il s’intéressait à leur sort. Dans un fragment de l’Histoire de ses missions à l’étranger, publié en 1878 dans une revue littéraire roumaine, le poète diplomate a fait le récit détaillé de ses trois premières entrevues avec l’Empereur, et nous croyons intéressant d’en reproduire ici quelques particularités. Dès l’abord, Napoléon III exprima très nettement à Alecsandri la grande satisfaction que lui avait causée l’avènement du prince Couza. Désireux de prouver, autrement que par de bonnes paroles, sa bienveillance envers les Roumains, l’Empereur offrit de leur faire envoyer dix mille fusils et deux batteries d’artillerie, et de leur faciliter l’émission, à Paris, d’un emprunt de douze millions, destinés à la création d’une armée nationale ainsi qu’aux premiers besoins d’un pays qui doit s’organiser. Sur un seul point, Napoléon III se montra plus réservé : il déconseilla au prince Couza de proclamer l’union définitive de la Moldo-Valachie. La Convention de Paris était un acte international, revêtu de la signature des sept Puissances, et, comme tel, il devait être respecté. Les Roumains avaient tout intérêt à ne pas précipiter les événements, afin de pouvoir obtenir plus facilement d’une seconde Conférence la consécration du nouvel ordre de choses.
A Londres, l’accueil fait à Alecsandri par le ministre des Affaires étrangères, lord Malmesbury, fut beaucoup plus froid que celui qu’il avait rencontré à Paris. Aux yeux de l’Angleterre, l’union portait directement atteinte à l’intégrité de l’Empire ottoman, et était considérée comme un véritable acte de rébellion envers la Puissance suzeraine. Lord Malmesbury, qui n’avait consenti à recevoir Alecsandri qu’à titre de simple particulier, de même qu’il ne voulait voir dans le colonel Couza qu’un simple officier supérieur de l’armée moldave, ne se fit pas faute d’attirer l’attention de son interlocuteur sur les dangers auxquels s’étaient exposées les Principautés en violant la Convention de Paris. Alecsandri, que le duc de Malakoff, ambassadeur de France à Londres, avait prévenu de l’extrême irritation provoquée chez les hommes d’Etat anglais par la double élection du prince Couza, ne perdit pas contenance et plaida très habilement la cause qu’il avait été chargé de défendre. Il s’efforça de démontrera lord Malmesbury que les Roumains ne nourrissaient aucun sentiment hostile à l’égard de la Sublime-Porte ; qu’ils avaient toujours considéré l’intégrité de leur pays comme liée à celle de l’Empire ottoman, enfin que l’unique désir des Principautés, ainsi que de leur nouveau souverain, était de prouver, par leur attitude, le respect qu’ils professaient pour la volonté des Puissances. Ces déclarations eurent pour effet, sinon de modifier de tout point les idées du chef du Foreign Office, du moins de le rendre plus traitable. Après s’être recueilli un instant, il répondit à Alecsandri que l’Angleterre, pays de liberté, ne pouvait pas empêcher les autres pays de se développer librement ; qu’il n’entrait pas dans les vues du gouvernement anglais de combattre les aspirations du peuple roumain, et que si réellement le choix du prince Couza n’avait été fait qu’en vue de la prospérité intérieure des Principautés, ce choix ne rencontrerait plus, au sein d’une prochaine Conférence, l’opposition irréductible de l’Angleterre. C’était plus que n’avait espéré et que ne pouvait souhaiter l’habile négociateur, qui, une fois de plus, avait bien mérité de sa patrie.
A peine est-il besoin d’ajouter que sa mission à Turin fut couronnée d’un plein succès, et que Victor-Emmanuel, ainsi que le comte de Cavour, le reçurent avec une gracieuseté toute particulière. On était à la veille de la campagne d’Italie ; l’idée d’un prochain mouvement national et unitaire avait gagné tous les esprits, et la récente union des Principautés ne pouvait que rencontrer l’approbation unanime d’un peuple et d’un gouvernement qui aspiraient eux-mêmes à suivre le plus tôt possible l’exemple donné par les Roumains. « Je vous féliciterais volontiers de l’acte patriotique que vous venez d’accomplir chez vous, — avait dit le comte de Cavour à l’envoyé du prince Couza, — si je ne savais que toute félicitation est superflue lorsqu’un peuple fait noblement son devoir. Les Roumains, ces frères des Italiens, ont donné un admirable exemple d’union, que nous sommes prêts à imiter… »
Le succès de la triple mission d’Alecsandri avait justifié amplement la confiance de son souverain. Il aurait pu, dès lors, jouer en Roumanie un rôle politique de plus en plus important ; mais il n’était pas ambitieux ; il l’avait prouvé en refusant, en 1859, la candidature au trône de Moldavie, et en faisant reporter sur son camarade d’enfance, le colonel Couza, les voix dont il était assuré. Il préféra reprendre paisiblement le cours interrompu de ses travaux poétiques et borna toute son ambition à enrichir de nouveaux chefs-d’œuvre la littérature de son pays. Il était d’ailleurs trop indépendant de caractère et il aimait trop sa liberté pour briguer les charges et les honneurs publics. Après avoir longtemps voyagé en Europe et en Afrique, parcouru dans tous les sens la France, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne ; le Maroc, visité, en 1855, le camp français sous les murs de Sébastopol, et, en 1859, les champs de bataille de Magenta et de Solférino (il comptait de nombreux amis parmi les officiers supérieurs de l’armée française et avait conçu, à leur contact, une vive admiration pour la gloire militaire de la France), Alecsandri s’était fixé en Roumanie, dans sa propriété de Mircesti, sur les bords du Sireth. Il ne s’éloignait plus guère de chez lui que lorsqu’il devait se rendre à Bucarest, tantôt pour y faire représenter quelque nouvelle pièce, tantôt pour prendre part aux séances de l’Académie roumaine ou bien aux délibérations du Sénat, dont il fut, pendant une législature, l’un des vice-présidents : de temps à autre, on le voyait revenir à Paris, où il avait conservé des relations avec quelques personnages de l’intimité de l’Empereur et du prince Napoléon, et où résidait une partie de sa famille. C’est au cours de l’un de ces voyages, qu’il fit paraître en français et sous le pseudonyme de V. Mircesco, sa Grammaire de la langue roumaine. Il a écrit, également en français, une petite comédie en un acte et en vers, les Bonnets de la Comtesse, qui fut représentée, il y a quelque vingt ans, aux Matinées littéraires de la Gaîté.
Confiné dans sa retraite de Mircesti, — où il travaillait plus librement et avec plus de plaisir que partout ailleurs, — Alecsandri y a composé les dernières œuvres poétiques sorties de sa plume, et qui comptent certainement parmi ses plus belles : les Pastels, écrits de 1862 à 1871 ; les Légendes et enfin Nos guerriers, titre sous lequel il a réuni une suite de chants patriotiques, inspirés par la guerre de l’indépendance de 1877-1878.
De l’aveu des juges les plus compétents, les Pastels constituent l’œuvre maîtresse d’Alecsandri : « Ces poésies, dit un éminent critique roumain, M. T. Maïoresco, la plupart lyriques, généralement descriptives, quelques-unes ayant un caractère idyllique, sont dictées par un sentiment si puissant et si pur de la nature, et sont écrites dans une langue si merveilleuse qu’elles sont devenues le plus bel ornement de la poésie et de la littérature roumaines. » Et en effet, rarement poète roumain a décrit, avec autant de sincérité et de charme, et dans d’aussi beaux vers, les divers aspects de la campagne au renouvellement des saisons ; les occupations, les joies, les fêtes du village ; les travaux féconds et paisibles des laboureurs : les semailles, la moisson, la fenaison, le tout rendu avec un tel amour des choses agrestes, de la vie pastorale et de la poésie des champs, que l’on croirait plusieurs de ces petits poèmes détachés de quelque page inconnue de Théocrite ou de Virgile.
Comme les Pastels, les Légendes peuvent être rangées parmi les œuvres les plus achevées qu’ait produites le génie d’Alecsandri. C’est sous cette forme de la « légende » que, dans les vingt dernières années de sa vie, le poète livrera de préférence ses inspirations au public. Il ne faut pas perdre de vue qu’en 1859 avait paru la première série de la Légende des siècles, de Victor Hugo. La façon magistrale dont l’auteur d’Hernani avait entrepris « d’exprimer l’humanité dans une espèce d’œuvre cyclique, de la peindre successivement et simultanément sous tous ses aspects : histoire, fable, philosophie, religion, science…, » frappa vivement l’esprit d’Alecsandri, excita son émulation et éveilla en lui le désir de faire, dans des proportions beaucoup plus modestes, et en se bornant à l’histoire de son pays, ce que Hugo avait tenté de faire pour l’histoire de l’humanité. Certes, le poète roumain n’a ni la puissance de conception, ni la largeur des idées philosophiques et sociales, ni l’ampleur de la forme et de la phrase poétiques de Hugo ; en outre, il manie une langue à peine née d’hier, qu’il a en grande partie façonnée et assouplie lui-même, et qui, ayant toujours été parlée plutôt qu’écrite, n’a pas atteint le degré de perfection où quatre siècles de culture raffinée et plusieurs générations d’écrivains de génie avaient amené la langue employée, — et d’ailleurs presque complètement renouvelée, — par Victor Hugo. Il y a néanmoins chez Alecsandri un effort des plus louables pour s’élever, dans ses Légendes, jusqu’à la hauteur du grand poète français. Quelques-unes d’entre elles lui ont été inspirées, ainsi que nous venons de le dire, par des événements ou des personnages de l’histoire nationale roumaine. A cette série appartiennent la Forêt rouge (Dumbrava rosie), qui est plutôt un poème épique, — l’auteur l’a intitulé poème historique, — dans lequel il retrace un épisode sanglant des luttes mémorables d’Etienne le Grand, prince de Moldavie, contre les Polonais et les Lithuaniens ; — la princesse Anna ; — le Rêve de Pierre Raresh ; — Vlad l’empaleur et le chêne. Les contes populaires lui ont fourni le sujet d’autres légendes, telles que Dan, paladin des montagnes ; — la Massue de Briar ; — Grui-Sânger. Viennent ensuite les légendes orientales : Hodja-Mourad ; la Garde du sérail ; — le sultan Mourad et Bécri Moustafa ; enfin, et ce ne sont pas les moins belles, celles que l’auteur a tirées de sa propre imagination : la Légende de l’alouette ; — la Légende de l’Hirondelle ; — Vers la Sibérie. A quelque source qu’il puise son inspiration, Alecsandri a dans presque toutes ses légendes, de belles envolées lyriques, qui en font, — comme l’appelait son émule Eminesco, — « le roi de la poésie roumaine ; » depuis les Doïnas, le cadre de ses idées s’est élargi ; sa pensée a acquis toute sa maturité et toute sa vigueur ; il s’est fait un style et une langue qui sont à lui, qu’il a eu le mérite d’inventer, et qui portent l’empreinte de son génie ; enfin, à mesure que les événements politiques sont venus fortifier ses espérances, et, plus tard, combler ses vœux de Roumain, l’expression du sentiment patriotique, toujours dominant chez lui, a pris sous sa plume une allure plus fière, plus virile, et il est peu de légendes où il n’éclate en vers admirablement frappés. Sainte-Beuve a fait observer, en parlant de Virgile, que le côté vraiment original de son œuvre « était l’inspiration romaine profonde et l’à-propos national.» Cette remarque pourrait s’appliquer, avec la même justesse, à Alecsandri ; aussi a-t-on dit de lui qu’il avait été et qu’il resterait le poète national roumain par excellence, comme fut Virgile chez les Romains. On s’en convaincra mieux encore, en lisant son volume d’odes guerrières, composées en 1877, alors que le prince Charles de Roumanie, appelé au secours de l’armée russe en péril, avait franchi le Danube à la tête de ses troupes impatientes de recevoir le baptême du feu. Alecsandri connaissait de trop ancienne date son pays ; il savait trop bien de quoi seraient capables, à l’heure du danger, ces laboureurs, dont il avait retracé naguère, dans les Pastels, les mœurs pacifiques pour n’avoir pas eu confiance, dès le début de la campagne, dans la bravoure de la jeune armée qui devait reconquérir l’indépendance de la Roumanie. C’est en l’honneur de ces soldats victorieux qu’il a laissé échapper de sa lyre des accents empreints d’une mâle énergie et des vers aussi vigoureusement trempés que l’acier des canons qu’ils avaient pris à l’ennemi. Alecsandri aura eu ce rare privilège de couronner ainsi par un chef-d’œuvre, supérieur à tant d’autres productions de valeur, sa longue et noble carrière poétique. Il a su merveilleusement combiner l’ardeur de sa foi patriotique avec l’élan enthousiaste de toute une nation, et c’est pour cela surtout qu’associant son nom au nom de ceux qui « sont morts pieusement pour la patrie, »
-
- La voix d’un peuple entier le berce en son tombeau.
Son patriotisme avait d’ailleurs de quoi être satisfait. Il lui avait été donné de voir s’accomplir tout ce qu’il avait rêvé pour sa chère Roumanie : l’union, le prince étranger, l’indépendance, la royauté et, avec son imagination de poète, à qui tous les espoirs sont permis, il entrevoyait quelquefois l’aurore d’une ère encore plus belle, encore plus radieuse : celle où les Roumains de tous les pays seraient rassemblés sous une même loi et sous une seule domination.
En 1878, la Société pour l’étude des langues romanes, fondée en 1869 à Montpellier, ayant proposé comme sujet de son prix triennal : le Chant du Latin ou de la race latine, Alecsandri, sollicité de prendre part au concours, y envoya une cantate de trente-deux vers, à laquelle le jury, présidé par Mistral, décerna le premier prix. On voulut, en Roumanie, donner à ce petit événement littéraire, qui avait passé inaperçu en France, les proportions d’un triomphe, et on alla jusqu’à imprimer que « désormais Montpellier et Grivitza, » — on sait que la prise de la redoute de Grivitza par l’armée roumaine constitue l’un des faits les plus glorieux de la guerre de l’indépendance, — « demeureraient deux noms inséparables dans l’histoire roumaine. » Il y avait là une exagération manifeste ; elle s’explique, si l’on songe que l’amour-propre national, très flatté de la victoire d’Alecsandri, et ne se rendant pas bien compte des conditions relativement faciles dans lesquelles elle avait été remportée, s’était surtout plu à y voir la consécration par la France de la plus grande gloire littéraire de la Roumanie. Le temps et la réflexion ont remis les choses au point, et aujourd’hui, le Chant de la race latine, qui est loin de valoir la plupart des beaux poèmes écrits par Alecsandri en l’honneur de son pays, n’occupe plus, dans son œuvre, que la place secondaire à laquelle il a droit.
Le succès obtenu par l’auteur du Chant de la race latine aux fêtes du Félibrige ne fut peut-être pas tout à fait étranger à la résolution que prit le gouvernement royal de lui confier, en 1885, la Légation de Paris. Nul ne pouvait plus dignement que lui représenter en France le pays où règne Carmen Sylva. Il savait qu’il retrouverait dans le poste qu’il avait occupé jadis, comme agent diplomatique du prince Couza, un accueil sympathique et des amitiés dévouées. Mais l’idée de sacrifier sa liberté, dont il était devenu, avec l’âge, de plus en plus jaloux, à une fonction publique, quelque élevée qu’elle pût être ; l’idée surtout de quitter son beau domaine de Mircesti où il vivait heureux, entouré de l’affection de ses deux petites-filles qu’il adorait, et goûtant, vers le soir de sa vie, la douceur d’un repos bien gagné, lui faisaient envisager avec appréhension une nouvelle absence de son pays. Déjà, en 1878, il avait, pour des scrupules du même ordre, décliné l’offre que lui avait faite son vieil ami Cogalniceano, alors ministre des Affaires étrangères, de l’envoyer en mission extraordinaire à Rome. L’insistance du roi Charles, et celle de son premier ministre, M. Bratiano, devaient, en 1885, venir plus aisément à bout de ses hésitations. Malheureusement, le début de son ambassade en France fut marqué par un conflit diplomatique qui l’affecta outre mesure. Il s’agit du différend survenu, dans les premiers mois de l’année 1885, entre la France et la Roumanie, à propos de leurs relations commerciales. Bien que ce malentendu eût été assez rapidement aplani, grâce au désir de conciliation dont se montrèrent animés les deux gouvernements, il n’en laissa pas moins dans l’esprit d’Alecsandri une impression pénible, qui assombrit la joie que lui avait fait éprouver son retour à Paris. Le temps était passé où les idées personnelles de Napoléon III avaient créé en France un courant sympathique au peuple roumain ; le gouvernement qui avait succédé à l’Empire, rompant avec la politique traditionnelle de la France à l’égard de la Roumanie, lui avait témoigné, en plusieurs occasions, une hostilité à peine déguisée, et la tâche des représentants du roi Charles à Paris était d’autant plus délicate qu’il s’agissait de lutter contre certaines préventions de l’opinion publique, qui, mal renseignée sur ce qui se passait aux bords du Danube, attribuait au gouvernement de Bucarest, dans ses relations avec la France, des sentiments de malveillance, assurément fort éloignés de sa pensée. Ce fut le mérite d’Alecsandri de s’être attaché à démontrer l’inanité de ces préventions et d’avoir réussi à les dissiper en partie. Il s’y employa, pendant l’entière durée de sa mission, avec toute la conviction de son patriotisme, demeuré vivace et ardent, en dépit des années. Sa bonne grâce, sa cordialité, sa franchise, ses sympathies immuables pour la France, contribuèrent beaucoup à faire renaître entre les deux gouvernements la confiance et l’amitié qui président aujourd’hui à leurs rapports.
Très absorbé par ses devoirs professionnels, le poète n’eut guère le temps de s’occuper en France de littérature ni de poésie. D’ailleurs, sa muse, qui lui souriait avec tant de complaisance sous le ciel idéalement beau de son pays, et qui lui inspirait des idées si gracieuses et des vers si harmonieux, semblait ne plus vouloir répondre à ses appels, depuis qu’il avait dû modifier son genre de vie et ses habitudes de travail. Il s’était accoutumé à composer ses poèmes dans le recueillement de la campagne, les yeux fixés sur le merveilleux spectacle que lui offrait de toutes parts la nature. L’agitation bruyante de Paris, le manque d’air, de lumière, d’horizon, les obligations officielles et mondaines que lui imposait l’accomplissement de sa charge, — obligations qui étaient souvent pour lui de véritables corvées, — le détournèrent de plus en plus de toute occupation littéraire. Aussi attendait-il avec impatience le retour des beaux jours pour aller passer quelques mois en Roumanie et y prolonger son séjour jusqu’à l’arrière-saison.
L’un des grands attraits de ces voyages annuels d’Alecsandri, dans son pays, était sa villégiature au château royal de Sinaïa, où le retenait, pendant plusieurs semaines, à titre d’hôte privilégié, l’affection pleine de déférence du roi Charles et de la reine Elisabeth. Voltaire écrivait un jour à Thiériot que « le rôle d’un poète à la Cour traînait toujours avec lui un peu de ridicule. » Alecsandri fut la preuve du contraire. Bien qu’ami personnel du prince Couza, il n’en avait pas moins, comme tous les bons Roumains, salué avec joie l’avènement au trône du prince Charles de Hohenzollern. Il s’était tenu d’abord, — autant par discrétion que par égard pour le souverain déchu, — sur une certaine réserve vis-à-vis de la nouvelle Cour, tout en apportant, dans ses relations avec Charles Ier, la plus respectueuse courtoisie. C’est ainsi qu’en 1870, il avait dédié au prince régnant l’un de ses Pastels, et que, trois ans après, lors de la mort de la jeune princesse Marie, l’unique enfant des souverains, il avait déploré sa perte prématurée dans l’une de ses plus touchantes poésies. Ses relations littéraires avec Carmen Sylva datent du jour où la reine, — alors princesse Elisabeth de Roumanie, — cruellement affligée par la perte de sa fille, voulut, pour endormir sa douleur, demander des consolations au travail, et entreprit de traduire en allemand quelques-uns des poèmes d’Alecsandri. Ainsi que nous avons eu l’occasion de le rappeler ailleurs, le poète, une fois admis dans l’intimité de la souveraine, devint rapidement son confident littéraire et son conseiller le plus sûr et le plus écouté. De son côté Carmen Sylva professait pour le génie d’Alecsandri une sincère admiration, et elle avait coutume de dire, en plaisantant : « Alecsandri et moi, nous irons bras dessus bras dessous à la postérité. » On conçoit, dès lors, avec quel plaisir l’auteur des Pastels se rendait, chaque été, au château royal de Sinaïa, pour y passer une partie de son congé. Il y avait sa chambre, était le commensal des souverains, prenait part aux excursions et aux promenades de la famille royale et consacrait à de longs entretiens avec Carmen Sylva tous les momens de liberté que lui laissait le roi, qui, lui aussi, aimait beaucoup Alecsandri, et goûtait infiniment le charme de sa conversation. La reine Elisabeth a gardé de son cher et grand poète un souvenir qu’aujourd’hui encore elle ne peut évoquer sans émotion. Sa douceur, sa bonté, sa gaîté (car la gaîté était chez lui un don naturel qu’il avait su conserver jusque dans les dernières années de sa vie), l’avaient conquise dès l’abord. Elle seule pourrait dire, — et elle le dira certainement dans cette autobiographie qu’elle nous promet depuis si longtemps et qu’elle a déjà intitulée : Un coin de mes pénates, — les propos tour à tour graves et enjoués qu’elle échangeait avec Alecsandri lorsque, de la vaste terrasse du château royal, ils contemplaient, à l’heure du crépuscule, les pins séculaires qui se dressaient devant eux sur les sommets des Karpathes, ou que, marchant le long de quelque sentier agreste qui côtoyait le Pélesh, ils devisaient de littérature et d’art sous l’épais ombrage de la forêt. Aussi le poète éprouva-t-il un véritable chagrin le jour où, se sentant déjà atteint par le mal qui devait l’emporter une année plus tard, il ne put, dans le courant de l’été de 1889, rendre sa visite accoutumée aux souverains. Il était parti malade de Paris, il y revint en automne et y traîna durant tout l’hiver une vie défaillante. Il se savait condamné, et voyait approcher sa fin avec la sérénité que donnent aux âmes élevées une conscience pure et le sentiment du devoir accompli. Dès lors, il n’eut plus qu’un désir, celui de rentrer en Roumanie pour y mourir. Il se mit péniblement en route au mois de juin 1890, et il rendit le dernier soupir, le 3 septembre, dans sa maison de Mircesti, sur cette terre roumaine, qu’il avait tant aimée et qui, selon la poétique expression d’un homme d’Etat roumain, « compte moins de fleurs que les fleurs impérissables de son génie. »
L’Académie roumaine a pris, il y a quelques années, l’initiative d’une souscription nationale en vue d’ériger une statue à Alecsandri. On est à la veille de l’inaugurer à Bucarest. Nous voudrions que sur le socle de ce monument, juste tribut de l’admiration et de l’amour que lui garde son pays, on inscrivît ces simples mots, qui résument sa belle et noble existence :
GEORGES BENGESCO
Georges Bengesco
Revue des Deux Mondes
Tome 60
1910