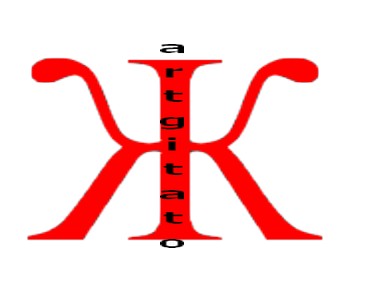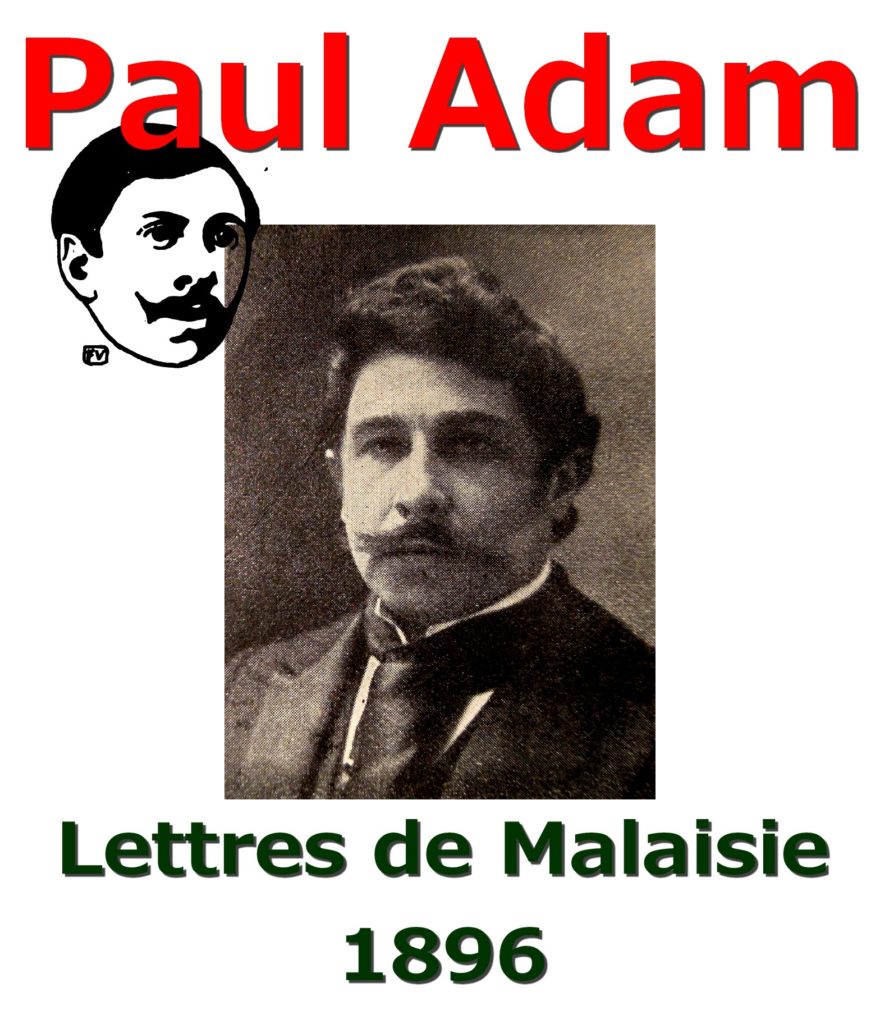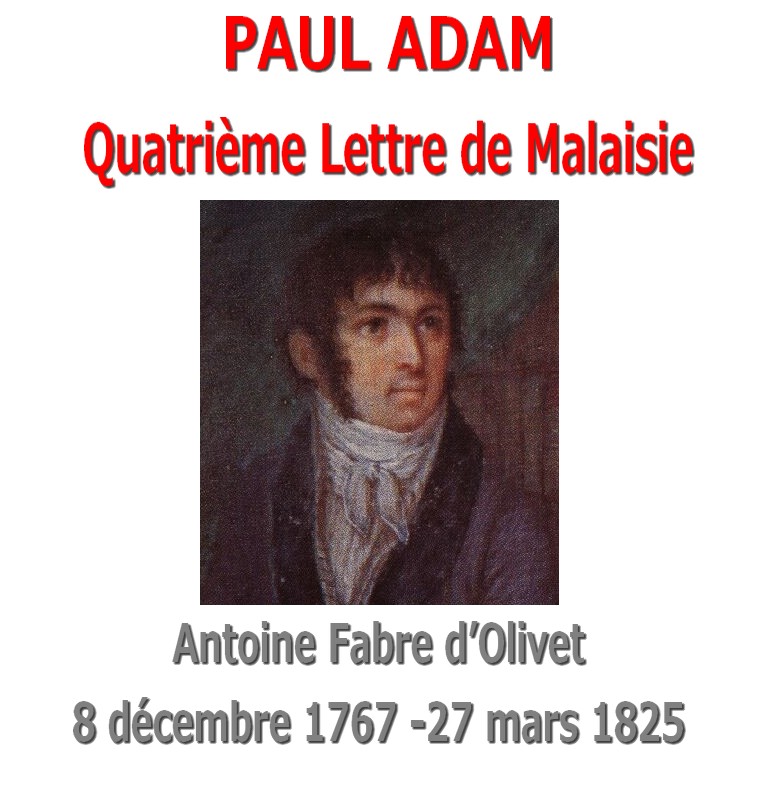LITTERATURE LATINE
GASTON BOISSIER
1823-1908

JUVENAL & SON TEMPS
par
Gaston BOISSIER
(revue des deux mondes 1870)
JUVENAL EST UN PROBLEME POUR NOUS
L’opposition que les Césars rencontrèrent à Rome, nous l’avons montré, n’était pas républicaine. Les mécontents acceptaient l’empire, ils ne contestaient pas aux empereurs leur autorité absolue ; ils leur demandaient seulement de l’exercer avec plus de douceur et d’humanité, de consulter davantage le sénat, d’écouter l’opinion et de s’accommoder d’une certaine liberté de parler et d’écrire. Ces désirs étaient modérés, et il ne fut pas difficile aux Antonins de les satisfaire. Depuis l’avènement de Nerva jusqu’à la mort de Marc-Aurèle, pendant près d’un siècle, Rome a joui de ce gouvernement tempéré qu’elle souhaitait, et cette époque est restée comme une sorte d’âge d’or dans ses souvenirs. C’est pourtant à l’aurore de ces beaux jours, au moment où Rome devait être le plus sensible à ce bonheur qui lui était inconnu, qu’une voix discordante et emportée s’élève, qui accuse son temps avec une violence inouïe, et qui voudrait nous faire croire que jamais l’humanité n’a été si criminelle ni si misérable. Juvénal est un problème pour nous. Quand on songe qu’il vivait sous Trajan et sous Hadrien, que le siècle qu’il a si maltraité est celui dont les historiens nous font de si grands éloges, on ne sait comment expliquer son amertume, on ne peut rien comprendre à sa colère. Pourquoi s’est-il mis ainsi en contradiction avec tous ses contemporains ? Comment se décider entre eux et lui ? Qui donc trompe la postérité, qui nous a menti, de l’histoire, qui dit tant de bien de cette époque, ou du poète qui en a laissé des tableaux si repoussants ?
RENDRE AU POETE SA VRAIE FIGURE
Il est surprenant que ce problème n’ait pas tenté plus de critiques. Celui qui jusqu’ici l’a le plus franchement abordé chez nous, c’est M. Nisard dans ses Études sur les poètes latins de la décadence. Le chapitre qu’il a consacré à Juvénal est l’un des meilleurs de son livre ; il est écrit de verve et plein d’observations nouvelles et piquantes. Seulement les conclusions en sont trop rigoureuses : M. Nisard ne voit en Juvénal qu’un moraliste sans conscience et sans conviction, un indifférent qui s’emporte à froid, un coupable peut-être qui, craignant d’être grondé, prend les devants et crie plus fort que tout le monde. Il n’a pas non plus rendu assez justice au talent de l’auteur qu’il étudiait. La rigueur de ses principes littéraires, sa préférence exclusive pour la perfection classique, l’empêchent quelquefois de sentir pleinement la grandeur des littératures de décadence. Il a trop pris l’habitude des développements réguliers et des horizons calmes pour se laisser jamais séduire à ces beautés mêlées et heurtées qui inquiètent le goût, mais qui impriment à l’âme de si vives secousses. Il n’en reste pas moins à M. Nisard le mérite d’avoir cherché à nous donner un Juvénal véritable et de nous avoir délivrés de celui que le pédantisme de la tradition imposait depuis des siècles à l’admiration servile des écoliers. C’est sur ses traces qu’il faut marcher pour rendre au poète sa vraie figure.
CONNAÎTRE SON CARACTERE ET LA VALEUR DE SON JUGEMENT
Il est bien fâcheux que M. Widal, qui vient de publier un volume sur Juvénal, n’ait pas cru devoir suivre M. Nisard dans la voie qu’il avait ouverte. M. Widal s’était préparé à ce travail par des études sérieuses : il connaissait bien son auteur, il avait lu les ouvrages qui ont paru récemment sur ce sujet en Allemagne, et son livre s’ouvre par une critique judicieuse des opinions d’Otto Ribbeck, qui a entrepris de nier l’authenticité des dernières satires parce qu’elles lui semblent trop différentes des autres. Malheureusement, une fois l’introduction achevée, M. Widal entre dans un système de critique qui ne pouvait le mener à rien de curieux ni de nouveau. Il reprend successivement chaque satire, il en explique le sujet, il en traduit les morceaux les plus importants, et s’interrompt à chaque fois pour en faire ressortir la beauté. Ce procédé littéraire a beaucoup vieilli. C’est celui dont M. Tissot se servait, il y a quelque cinquante ans, au Collège de France, pour faire admirer Virgile à ses auditeurs ; je n’en connais pas qui soit plus propre à nous le faire détester. Il y a toujours quelque chose de déplaisant dans ces commentaires hyperboliques, et ce système d’admiration à outrance finit par impatienter les plus résignés. Il est assurément regrettable que M. Widal n’ait pas pensé qu’il y avait mieux à faire pour Juvénal que de l’analyser sans fin et de le louer sans mesure. Aujourd’hui on attend de celui qui veut parler du satirique latin autre chose que des observations littéraires. Certes l’écrivain et le poète sont intéressants à étudier, mais il importe bien plus de connaître ce que valent l’homme et le moraliste. Son talent n’a pas de contradicteurs, tandis qu’on hésite sur son caractère et qu’on discute la valeur de ses jugements. La première question qu’on se pose quand on le lit, c’est de savoir quelle confiance on peut lui accorder, et s’il est digne de tenir en échec toutes les affirmations de l’histoire. C’est à cette question que je vais essayer de répondre.
UN HOMME QUI NOUS PARLE PEU DE LUI-MÊME : PRUDENCE ou MODESTIE ?
Toutes les fois qu’un homme s’arroge le droit de faire le procès à son temps, il convient de le traiter comme on fait d’un témoin en justice ; pour savoir ce que vaut sa parole, il faut chercher ce qu’a été sa vie. L’autorité de ses reproches est-elle appuyée sur une conduite austère ? N’était-il pas disposé par sa naissance ou sa fortune à juger sévèrement ses contemporains, et, sous prétexte de défendre la cause de la morale et de la vertu, ne vengeait-il pas des injures privées ? La plupart de ces questions restent sans réponse pour Juvénal. Sa biographie nous est très mal connue. L’événement le plus considérable de sa vie, l’exil auquel il fut condamné pour avoir été trop hardi dans ses satires, nous a été raconté avec des circonstances très différentes, et l’on ne sait pas même avec certitude le nom de l’empereur sous lequel il fut exilé. Si, pour suppléer au silence de ses biographes, on s’adresse à l’auteur lui-même, on n’est guère plus satisfait : il nous parle de lui le moins qu’il peut. C’était pourtant une habitude chez les satiriques latins de se mettre volontiers en scène ; la vie de Lucilius, nous dit Horace, était peinte dans ses écrits comme dans un tableau ; Horace aussi nous entretient souvent de la sienne, et il est facile avec ses vers de refaire toute son histoire. Juvénal est plus modeste ou plus prudent et il se livre rarement au public. Quel qu’ait été le motif de cette réserve, elle n’a pas été inutile à sa gloire. Il est rare que la personnalité d’un satirique, quand elle se fait trop voir, n’enlève pas quelque poids à ses leçons ; la vie la plus pure a toujours ses faiblesses et ses fautes, dont la malveillance s’empare et qu’elle est heureuse d’exagérer, car celui qui est sévère aux autres pousse naturellement les autres à l’être pour lui. Tout le monde se demande alors comment il a eu si peu d’indulgence pour ses contemporains quand il en avait besoin pour lui-même, et où il a pris le droit, n’étant pas irréprochable, de les traiter sans pitié.
UNE MAIN QUI SORT DES TENEBRES ET QUI FRAPPE UNE SOCIETE COUPABLE
VENGER LA MORALE ET LA VERTU OUTRAGEES
Juvénal, en se cachant, a su échapper à tous ces reproches. Comme on connaît très mal sa vie, rien n’empêche ses admirateurs de lui en imaginer une qui soit tout à fait en rapport avec les sentiments qu’il exprime, de se le figurer, non pas tel qu’il était, mais comme il devait être. C’est ainsi que l’obscurité l’a grandi. Cette main qui sort des ténèbres pour frapper une société coupable a pris quelque chose d’étrange et d’effrayant. Ce n’est plus un satirique ordinaire, un homme dont l’autorité est limitée par les faiblesses de sa vie, c’est la satire elle-même qui venge la morale et la vertu outragées.
FAIRE SORTIR JUVENAL DE L’OMBRE
Il faut pourtant le faire sortir de ces ombres et jeter, s’il est possible, un rayon de lumière sur cette figure qui nous fuit. Quelque soin qu’il ait eu de parler le moins possible de lui, ses ouvrages laissent échapper de temps en temps des confidences discrètes qu’il importe de recueillir ; elles nous font d’abord entrevoir quelles étaient sa situation et sa fortune. Nous savons par ses biographes qu’il était le fils ou l’enfant adoptif (alumnus) d’un riche affranchi d’Aquinum. Il devait donc avoir, à son entrée dans la vie, une certaine aisance, et à la manière dont il parle dans ses dernières satires, qui sont de sa vieillesse, on voit bien qu’il ne l’avait pas compromise. Au retour d’un de ses amis qu’il avait cru perdu, il raconte qu’il a immolé deux brebis à Minerve et à Junon et un veau à Jupiter. « Si j’étais plus riche, ajoute-t-il, si ma fortune répondait à mon affection, je ferais traîner à l’autel une victime plus grasse qu’Hispulla, un bœuf nourri dans les pâturages de Clitumnes ». C’est quelque chose pourtant que de sacrifier des veaux et des brebis ; tout le monde n’en pouvait pas faire autant, et Martial aurait bien été forcé de chercher un autre moyen de témoigner aux dieux sa reconnaissance. Ailleurs Juvénal décrit un dîner qu’il compte donner à ses amis. Il a grand soin d’annoncer que le repas ne sera point somptueux, et il profite de l’occasion pour railler les dépenses insensées des grands seigneurs de son temps. Son menu cependant n’est pas trop frugal. « Le marché ne fera point les frais du dîner ; on m’enverra des environs de Tibur un chevreau gras qui n’a point encore brouté l’herbe, puis des asperges, puis, avec de beaux œufs encore chauds dans leur foin, les mères qui les ont pondus, enfin des raisins conservés pendant une saison et tels encore qu’ils étaient sur leur vigne, des poires de Signia et de Syrie, et dans les mêmes corbeilles des pommes au frais parfum, aussi belles que celles du Picénum. » Ce n’est pas tout à fait, comme on voit, un dîner de Spartiate, et Horace recevait ses amis à moins de frais. Ajoutons que le service répond au menu. Sans doute on ne trouve pas chez Juvénal de ces maîtres d’hôtel comme on en rencontre chez Trimalchion, véritables virtuoses qui découpent en mesure et avec des gestes de pantomimes.
JUVENAL N’A PAS BESOIN DE MENDIER POUR VIVRE
Il a pourtant plusieurs esclaves. « Mes deux serviteurs ont même costume, cheveux courts et sans frisures, peignés exprès pour ce grand jour ; l’un est le fils de mon pâtre, l’autre est le fils de mon bouvier ; il soupire après sa mère, qu’il n’a pas vue depuis longtemps. Il te versera du vin récolté sur les coteaux d’où lui-même il est venu à Rome, et au pied desquels il jouait naguère : le vin et l’échanson sont du même cru ». Ainsi Juvénal possède un bouvier et un pâtre, il fait venir un chevreau de Tibur, sans doute de quelque propriété qui lui appartient, et il récolte sa provision de vin chez lui. Il n’eut donc pas besoin de mendier pour vivre, comme la plupart de ses confrères en littérature ; il n’était pas réduit au triste sort de Rubrénus Lappa, qui mettait sa pièce d’Atrée en gage quand il voulait se payer un manteau, ou de Stace, qui serait mort de faim, si l’histrion Paris ne lui avait acheté son Agavé. Toutefois il ne se trouvait pas riche, et se mettait volontiers parmi ces gens de peu (mediocres), pour qui le monde est si sévère ; mais n’a-t-il pas fait remarquer que personne n’est satisfait de son sort ? Dans un passage curieux où il s’élève contre ceux qui sont insatiables, il essaie de fixer la limite où l’on doit raisonnablement s’arrêter dans la recherche de la fortune. Cette limite est pour lui le revenu de trois chevaliers réunis, c’est-à-dire 12,000 livres de rente. C’était mettre assez haut son idéal ; un revenu de 12,000 francs était considérable dans une société où les fortunes moyennes n’existaient pas, et qui se composait de millionnaires et de mendiants ; on pouvait ne pas l’atteindre sans être pauvre pour cela. Il est donc permis de penser que si Juvénal n’était pas aussi riche qu’il l’aurait voulu, s’il ne possédait pas tout à fait les 12,000 francs de rente qui lui semblaient nécessaires pour bien vivre, il n’en était pas moins à son aise, et qu’il ne faut pas le ranger parmi ceux dont il a dit avec tant de tristesse : « Il est bien difficile à l’homme de mérite de se faire un nom quand la misère est à son foyer ».
PENDANT LA MOITIE DE SA VIE, IL DECLAMA
Ce qui achève de le prouver, c’est que lorsqu’il vint d’Aquinum à Rome, il ne se mit pas en peine de choisir un métier qui pût le nourrir. Il suivit uniquement ses préférences, et se décida pour cette éloquence d’apparat et d’école qu’on appelait la déclamation. Voilà un goût bien étrange chez un esprit qui nous semble de loin si sérieux ! Pendant la moitié de sa vie il déclama, c’est-à-dire qu’à certains jours il convoquait par des lettres et des affiches tous les beaux esprits de Rome à se réunir dans une salle qu’il avait louée pour l’entendre plaider des causes imaginaires et trouver des arguments nouveaux sur des sujets mille fois traités. Son biographe nous dit qu’il déclamait pour son agrément (animi causa) ; mais il est difficile d’admettre qu’en se livrant à ce travail futile il n’ait cherché que le plaisir de donner des conseils à Sylla ou de défendre des gens qui n’avaient jamais été mis en cause. Il voulait évidemment se faire connaître ; il espérait arriver à la réputation et faire parler de lui dans Rome. Y est-il parvenu ? a-t-il acquis dans ces exercices d’école un nom qui répondît à son talent ? Cela paraît douteux. Martial l’appelle quelque part l’éloquent Juvénal ; c’est peut-être un de ces compliments d’ami auxquels il ne faut pas trop donner d’importance.
MOI AUSSI J’AI TENDU LA MAIN A LA FERULE !
Ce qui est sûr, c’est que son nom ne se trouve pas une seule fois cité dans la correspondance de Pline, qui contient tout le mouvement littéraire de ce siècle. Dans la suite, quand Juvénal eut quitté son premier métier, il n’en parla jamais sans amertume. « Moi aussi, disait-il, j’ai tendu la main à la férule ; tout comme un autre, j’ai tâché de persuader à Sylla de rentrer dans la vie privée et de dormir sur les deux oreilles ». Se serait-il servi de ces termes railleurs, si cette époque lui avait rappelé des souvenirs de triomphes ? On a remarqué aussi qu’en général il est mal disposé pour ceux qui suivaient la même carrière que lui et qui y avaient mieux réussi. Il ne manque pas une occasion de se moquer de Quintilien ; il plaisante en passant Isée, ce déclamateur grec qui fit courir Rome entière, et auquel Pline a consacré une de ses lettres. Cette mauvaise humeur manifeste, ces mots amers qui lui échappent sans cesse contre les déclamateurs et la déclamation, semblent trahir une espérance trompée. Il débuta dans la vie par un mécompte, et dut être d’abord mal disposé contre cette société qui refusait de le mettre au rang dont il se sentait digne.
JUVENAL DANS LES ANTICHAMBRES DU POUVOIR ?
Elle avait pourtant du goût pour les gens de mérite. Les orateurs qui s’étaient fait un nom dans le barreau ou dans les écoles étaient bien accueillis de tout le monde. Cet Isée, dont je viens de parler, vivait familièrement avec les plus grands personnages, et les lettres de Pline nous apprennent que de simples philosophes épousaient souvent des femmes de naissance très distinguée. Juvénal ne connut pas ces bonnes fortunes ; rien n’indique qu’il ait pénétré dans l’intimité des grands seigneurs ; probablement il ne dépassa jamais leurs antichambres. Il faut voir aussi comme il envie le sort de ce Virgile, un petit propriétaire de Mantoue, ou de cet Horace, le fils d’un esclave, qui tous deux arrivèrent à être les protégés de l’empereur et presque les confidents du premier ministre ! Gardons-nous de croire, sur la foi de sa réputation, que Juvénal ait méprisé ces faveurs ; n’allons pas nous le figurer comme un de ces mécontents superbes qui vivent dans une fière solitude, et que le patriciat laisse dans leur isolement volontaire parce qu’ils refusent de se courber devant lui.
JUVENAL ADEPTE DE LA SPORTULE, CETTE ETRANGE INSTITUTION
Une indiscrétion piquante de son ami Martial détruirait ces illusions. — Tout le monde connaît cette étrange institution de la sportule, dont vivait une bonne partie du peuple de Rome. Tous les matins, avant le jour, les pauvres clients des grandes maisons quittaient leurs quartiers lointains pour venir à la porte des gens riches et y attendre leur réveil. Ils voulaient tous arriver les premiers et paraître empressés à remplir leur devoir. On les voyait rangés contre le mur, transis de froid en hiver, étouffant en été sous le poids de la toge, occupés à défendre leur place contre les chiens et les esclaves, jusqu’au moment où la porte s’ouvrait et où ils étaient successivement introduits dans l’atrium ; ils passaient alors en s’inclinant devant le maître, qui leur répondait par un salut dédaigneux, puis recevaient du trésorier, après un examen minutieux, les 10 sesterces (2 fr.) qui les faisaient vivre. Ce qu’on sait, c’est que Juvénal était de ces clients du matin qui assiégeaient les maisons des riches. On a conservé une pièce de vers très agréable où Martial, de retour enfin dans sa chère Espagne, décrit le repos et le bonheur dont il jouit, et vante à son ami ces longs sommeils par lesquels il se rattrape de trente ans de veilles. « À ce moment peut-être, lui dit-il, tu te promènes sans repos, mon cher Juvénal, dans la bruyante Suburra ou sur la colline de Diane. Couvert de cette lourde toge qui fait suer, tu te présentes chez les grands seigneurs et tu te fatigues à gravir les rampes du grand et du petit Coelius ». Ce n’est pas que Juvénal eût besoin de tendre la main comme les autres, et sa fortune lui permettait de se passer de l’aumône des 10 sesterces ; mais il voulait sans doute se faire des protecteurs puissants, il tenait peut-être à se mêler de quelque manière à ce monde somptueux qui n’avait pas d’autre accès pour lui, et ce désir lui faisait braver l’ennui de ces visites matinales. Il a donc supporté toutes ces humiliations qu’il a si souvent dépeintes. Il s’est levé au milieu de la nuit, il s’est habillé en toute hâte de peur d’être devancé par des clients plus zélés, il est parti à moitié vêtu, « il a grimpé au pas de course la montée glaciale des Esquilies, alors que l’air frémissait fouetté par la grêle, et que son pauvre manteau ruisselait sous les giboulées du printemps ». Il a subi les insultes de ces esclaves impertinents dont les grandes maisons étaient pleines ; il s’est présenté humblement devant ce riche qui, encore assoupi par les plaisirs de la veille, s’est contenté de fixer sur lui un regard insolent, sans même daigner ouvrir la bouche, ut te respiciat clauso Veiento labello ! C’est sans doute alors que, malade et mécontent, maudissant Rome et ses ennuis, il prenait la résolution d’échapper à tous ces devoirs humiliants, et il allait se refaire, comme il dit à son cher Aquinum.
JUVENAL PREMIER MAGISTRAT & PRÊTRE DU DIEU VESPASIEN A AQUINUM
La petite ville ne négligeait rien pour le bien accueillir et pour le garder ; ce déclamateur obscur de Rome se retrouvait là un grand personnage dont ses compatriotes étaient fiers. Une inscription nous apprend qu’on l’avait revêtu de la première magistrature du pays, et que même, ce qui est assez singulier pour un sceptique comme lui, il avait accepté d’être le prêtre du dieu Vespasien. Il pouvait donc y vivre heureux et honoré ; mais, il est probable qu’il n’y restait guère. Dans cette satire célèbre où il décrit avec tant de verve les inconvénients des grandes villes, il a oublié de nous dire le plus grand de tous : celui qui les a une fois connues ne peut jamais plus se passer d’elles ; même quand elles ne le contentent pas, elles le dégoûtent de tout le reste. Cette boue et ce bruit, ce mouvement fébrile, cette agitation désordonnée, ce tracas, ces ennuis, ces misères dont on se plaint amèrement quand on est forcé de les subir, forment en réalité un charme étrange et puissant auquel on ne peut plus se soustraire. Quelque tristesse qu’on éprouve à y rester, quelque résolution qu’on prenne de s’éloigner d’elles, il faut toujours qu’on revienne y vivre et y mourir. — C’est ainsi que ce grand ennemi de Rome qui ne rêvait pas d’autre bonheur que d’aller vieillir dans un trou de lézard, « amoureux de sa bêche et soignant bien son petit clos », se fatiguait bientôt du calme d’Aquinum, et qu’il revenait au plus vite dans cette ville qu’il détestait, s’exposer de nouveau à tous ces mépris qui attendaient les pauvres gens à la porte des grands seigneurs.
L’IMPERTINENCE D’UNE ARISTOCRATIE IMPUISSANTE ET VANITEUSE
L’aristocratie romaine n’a donc pas fait un bon accueil à Juvénal ; il n’a pas pris chez elle la situation qu’avait Horace à la cour d’Auguste, parmi ces grands personnages qui le traitaient en ami, qui venaient dîner sans façon chez lui le jour de sa fête, qui le consultaient sur des questions de littérature et de morale, et se tenaient honorés d’une ode ou d’une épître qui leur était adressée par le poète. Il n’y a pas de traces de familiarités de ce genre dans les satires de Juvénal, et cela ne nous surprend guère. Plus la noblesse romaine avait perdu de sa puissance, plus elle s’attachait à ces distinctions futiles qui la rendaient insupportable ; elle se vengeait des outrages dont les Césars l’accablaient en les infligeant à son tour aux plébéiens ; il ne lui restait plus guère qu’un droit, celui d’être insolente avec ses inférieurs, et elle se plaisait à en abuser. Il n’y a rien qui nous blesse plus que ces mépris, surtout lorsqu’ils viennent de personnes qui en réalité n’ont pas plus de pouvoir que nous. Quand l’orgueil est appuyé sur une autorité réelle, il semble avoir sa raison, et on le supporte plus aisément ; mais on ne peut pas se résigner à l’impertinence d’une aristocratie lorsqu’elle est à la fois impuissante et vaniteuse.
UN HOMME QUI A SOUFFERT DES DISTINCTIONS SOCIALES
Juvénal a parlé avec beaucoup d’aigreur de celle de Rome. Sa huitième satire semble n’être d’abord que le développement d’une thèse morale à la façon de Sénèque ; mais on sent bientôt que d’anciennes blessures se réveillent, et un accent personnel et passionné remplace ces généralités philosophiques. Ce moraliste n’est pas un sage qui discourt à loisir et froidement sur les conditions humaines, c’est un homme qui a souffert de ces distinctions sociales et qui ne l’a pas oublié. Il a supporté les dédains de ce Damasippe, un cocher de grande famille qui vit dans ses écuries, « qui délie la botte de foin et verse l’orge à ses chevaux », de ce Lentulus, de ce Gracchus, qui se sont faits histrions ou gladiateurs ; il a entendu ce jeune fat, fier d’avoir sa maison pleine de portraits d’ancêtres, dire aux pauvres gens : « Vous autres, vous êtes des misérables, des gueux, la lie de notre populace ; nul de vous ne saurait dire de quel pays sort son père. Moi, je descends de Cécrops. — Grand bien te fasse, lui répond-il, et puisses-tu longtemps savourer la gloire d’être descendu de si haut ! Pourtant c’est dans cette populace que tu trouveras d’ordinaire le Romain dont la parole protège devant la justice le noble ignorant ; c’est de cette canaille que sort le jurisconsulte qui sait résoudre les énigmes de la loi ; c’est de là que partent nos jeunes et vaillants soldats pour aller sur l’Euphrate et chez les Bataves rejoindre les aigles qui veillent sur les nations domptées. Toi, tu es le descendant de Cécrops, voilà tout. Tu me fais l’effet d’un Hermès dans sa gaine ; ton seul avantage, c’est qu’un Hermès est de marbre, toi, tu es une statue qui vit ». Que de rancunes accumulées laissent entrevoir ces paroles, et comme on y sent la colère que le poète a dû ressentir des mépris de ce grand monde, où son talent sentait devoir lui donner une place, et qui ne voulut pas s’ouvrir pour lui !
JUVENAL SE RETIRE DANS LA MAUVAISE COMPAGNIE Repoussé par la bonne compagnie, Juvénal se retira dans la mauvaise. Il a pris soin de nous faire connaître lui-même quelques-unes des personnes qu’il fréquentait, société en vérité fort étrange pour un homme qui faisait profession de prêcher la vertu. Je ne dis rien de Martial, quoiqu’il fût loin d’être exemplaire ; son amitié, s’il était seul, ne témoignerait pas trop contre Juvénal. C’était un poète si spirituel, il avait tant d’agrément dans l’esprit, tant de verve et de grâce, qu’on pouvait bien oublier les légèretés de sa conduite et de sa morale pour le charme de son talent. Je veux parler surtout de ceux à qui Juvénal adresse ses satires ; ils n’ont pas l’air d’être des personnages imaginaires, et il les traite comme des amis avec lesquels il passait sa vie. Le plus honnête de tous est encore ce pauvre Umbritius, un poète crotté sans doute, qui, las de mourir de faim à Rome, se décide un jour à se retirer à Cumes, et dont tout le mobilier tient dans une petite charrette ; mais que dire des autres ? L’un d’eux est un coureur d’aventures galantes, débauché célèbre (mœchorum notissimus), que le retour imprévu d’un mari a forcé souvent à se cacher dans un coffre ; l’autre est un parasite éhonté à qui l’espoir d’un dîner fait braver toute sorte d’outrages, qui se résigne aux injures des valets, aux railleries des affranchis, aux impertinences du maître, pour attraper quelque bon morceau et manger un peu mieux qu’il ne fait dans sa mansarde ; un autre enfin trafique de lui-même et s’attribue de la meilleure grâce du monde le plus ignoble de tous les métiers.
LES PLAISANTERIES GROSSIERES ET LES PROPOS EFFRONTES
Voilà pourtant les gens à qui Juvénal adresse ses morales et dont il n’hésite pas à se dire l’ami ! Il n’a pas cherché à nous faire un mystère de ces liaisons, tant elles lui paraissent naturelles. M. Nisard fait remarquer que chacune des petites pièces que lui adresse Martial contient une obscénité ; c’était sans doute le ton ordinaire de l’entretien dans cette société, et c’est en la fréquentant que Juvénal a pris l’habitude des plaisanteries grossières et des propos effrontés. Un jour qu’il adresse une invitation à dîner à l’un de ses meilleurs amis, il lui demande d’oublier tous les tracas du ménage : « Ne songe plus, lui dit-il, aux ennuis que te donne ta femme lorsqu’elle rentre le soir au logis, la coiffure dérangée, le teint enflammé, l’oreille rouge, les vêtements froissés d’une façon suspecte ». Voilà des railleries singulières, et il faut avouer que ce n’était pas un monde délicat et distingué que celui où l’on pouvait se permettre de plaisanter ainsi son ami sans craindre de le fâcher.
LA SATIRE DES PETITES GENS
C’est pourtant là ce qui fait l’originalité la plus piquante de la satire de Juvénal ; elle nous introduit dans une société où nous ne pénétrerions pas sans elle. C’est la satire des petites gens. Nous sommes avec lui chez les poètes à jeun, chez les professeurs sans élèves, chez les avocats sans causes, chez les négociants ruinés, chez tous ceux qui vivent de privations ou d’aventures, qui frappent le matin à la porte des riches et qui s’endorment quelquefois le soir dans la taverne de Syrophoenix, « à côté des matelots, des filous, des esclaves fugitifs, des fabricants de cercueils et des prêtres mendiants de Cybèle ». Juvénal parle pour eux ; il s’est fait leur interprète et leur défenseur, il connaît toutes leurs misères, il est admirable de force et de vérité quand il les décrit. Il a fréquenté ces poètes « qui font des vers sublimes dans de pauvres galetas », ces rhéteurs, ces grammairiens auxquels on dispute leur maigre salaire, ces avocats qui comptent pour dîner sur le succès de leur plaidoirie, et « dont la faconde ronfle comme un soufflet de forge, tandis que le mensonge écume sur leurs lèvres ».
LE RETOUR DES CIGALES
Il a vécu parmi ces pauvres clients qui se présentent chez leurs patrons « avec une tunique sale et déchirée, une toge crottée, des souliers béants ou grossièrement rapiécés » ; il les a entendus dire à ceux qui leur reprochent de tendre la main et d’accepter l’aumône du riche : « Que voulez-vous donc, quand viendra décembre, que je réponde à ces épaules nues qui me demandent un vêtement, à ces pieds qui réclament des chaussures ? Puis-je leur dire : Patience, attendez le retour des cigales ? » C’est là, je le répète, une grande partie de l’originalité de Juvénal. Personne encore, dans les lettres latines, n’avait daigné prendre la parole pour ce petit monde besogneux ; sans lui, les plaintes de ces misérables ne seraient pas venues jusqu’à nous.
LE POINT DE VUE DES PAUVRES GENS
Les historiens ne songent à s’apitoyer que sur les malheurs des grands personnages ; il faut être sénateur ou chevalier pour avoir des droits à leurs larmes ; la pitié de Juvénal descend beaucoup plus bas. Quand il dépeint les malheurs de la société, c’est presque toujours au point de vue des pauvres gens qu’il se place. Il adopte tous leurs préjugés et reproduit leurs plaintes ; il juge le monde comme eux et ne s’appesantit que sur les maux dont ils souffrent. Dans cette première satire, où il étale avec tant de complaisance tous les vices de son temps, il en veut aux riches, moins peut-être de dévorer leur fortune que de la dévorer tout seuls. Débauchés, avares et solitaires, ils n’appellent plus de compagnons pour les aider à se ruiner plus vite. « Eh quoi ! s’écrie Juvénal, il n’y aura donc plus de parasites, nullus jam parasitus erit ! » N’entendez-vous pas ce cri qui sort du cœur des Naevolus, des Umbritius, des Trébius ? Ce n’est certes pas la morale qui peut être fâchée qu’on supprime ce métier honteux ; mais que deviendront ceux qui faisaient profession d’en vivre ? Juvénal s’est mis à leur place, et il a parlé en leur nom.
JUVENAL DEFENSEUR DE L’INDEPENDANCE NATIONALE ?
Un des passages les plus curieux en ce genre et où le poète a le plus subi l’influence de son entourage, c’est celui où il attaque si vigoureusement les Grecs. On est tenté d’abord d’y voir l’expression du plus ardent patriotisme. « Citoyens, dit-il d’un ton solennel, je ne puis supporter que Rome soit devenue une ville grecque ! » Ne semble-t-il pas qu’on entend la voix de Caton le censeur ? Aussi que de critiques s’y sont trompés ! Ils ont pris ces emportements au sérieux et se représentent Juvénal comme un des derniers défenseurs de l’indépendance nationale. C’est une erreur profonde. Le motif qui le fait gronder est moins élevé qu’on ne pense, et il n’y a au fond de cette colère qu’une rivalité de parasites. Le vieux client romain, qui s’est habitué à vivre de la générosité des riches, ne peut pas supporter l’idée qu’un étranger va prendre sa place. « Ainsi, dit-il, il signerait avant moi, il aurait à table la place d’honneur, ce drôle jeté ici par le vent qui nous apporte les figues et les pruneaux ! Ce n’est donc plus rien que d’avoir dans son enfance respiré l’air du mont Aventin et de s’être nourri des fruits de la Sabine ! » Quelle étrange bouffée d’orgueil national ! Ne dirait-on pas, à l’entendre, que le droit de flatter le maître et de vivre à ses dépens est un privilège qu’on acquiert par la naissance ou le domicile, comme celui de voter les lois et d’élire les consuls ! En réalité, ce ne sont pas les moyens employés par les Grecs qui lui répugnent ; il essaierait volontiers de s’en servir, s’il pensait le faire avec succès. « Je pourrais bien flatter comme eux, dit-il ; mais eux, ils savent se faire croire ! » Comment lutter de complaisance et de servilité avec cette race habile et souple ? « Le Grec naît comédien ; vous riez, il va rire plus fort que vous. Son patron laisse-t-il échapper une larme, le voilà tout en pleurs, sans être plus triste du reste. En hiver, demandez-vous un peu de feu, il endosse son manteau fourré. — Il fait bien chaud, dites-vous, la sueur lui coule du front ». Voilà ce que le Romain ne sait pas faire.
LES GRECS ONT TROP DAVANTAGES !
Malgré ses efforts, il est toujours épais et maladroit : c’est un vice de nature. Ses reparties manquent de finesse, il mange gloutonnement, il a, jusque dans ses plus honteuses complaisances, des brusqueries et des rudesses qui ne peuvent pas se souffrir ; il ne sait pas mettre autant de grâce et d’invention dans sa bassesse. Aussi, quand le patron a une fois goûté du Grec, qui flatte si bien ses penchants et qui sert si adroitement ses plaisirs, il ne peut plus revenir au lourd client romain. « La lutte est inégale entre nous, dit tristement Juvénal, ils ont trop d’avantages ! » Encore s’ils laissaient le pauvre client s’asseoir sans bruit au bout de la table et de temps en temps égayer l’assistance de quelques bons mots « qui sentent le terroir » ; mais non, ils veulent la maison tout entière. « Un Romain n’a plus de place là où règnent un Protogène quelconque, un Diphile ou un Erimarque. Ils détestent le partage, le patron tout entier leur appartient. Qu’ils disent seulement un mot, toute ma servilité passée ne compte plus : il me faut déguerpir ». C’est ainsi que ce malheureux, chassé de la maison du riche, l’imagination toute pleine des mets espérés ou entrevus, s’en revient tristement manger chez lui son misérable ordinaire, — domum revortit ad moenam miser. Voilà les raisons véritables qu’il a d’en vouloir aux Grecs, et Juvénal, qui l’a souvent entendu gémir après son maigre dîner, nous a fidèlement transmis ses plaintes.
PARMI LES DEBAUCHES ET LES PARASITES
Ces détails étaient utiles à réunir. Ils nous font connaître la situation véritable de Juvénal, et, quand on la connaît, on s’explique plus facilement le caractère de ses œuvres. Il en résulte qu’avant de devenir un grand poète, il n’était regardé que comme un de ces parleurs médiocres « qui ébranlaient de leur éloquence les salles de marbre de Fronton », que le grand monde ne l’avait pas accueilli, quoiqu’il eût fait, à ce qu’il semble, quelque effort pour y pénétrer, qu’il fréquentait une assez mauvaise compagnie et vivait volontiers parmi des débauchés et des parasites, bien qu’il fût au-dessus d’eux par sa fortune et par une certaine élévation naturelle de caractère, qu’en un mot, pour me servir d’expressions modernes, c’était un mécontent et un déclassé. Ces dispositions, il faut l’avouer, n’étaient pas tout à fait celles qui pouvaient faire de lui un poète équitable et un satirique impartial.
LA RAGE QUI ME SECHE, QUI ME BRÛLE LE FOIE
Juvénal n’a jamais dit d’une manière précise pourquoi il abandonna la prose et d’où lui vint un jour la pensée d’écrire en vers. Il attribue vaguement cette vocation subite à l’indignation que lui cause la vue des ridicules et des crimes dont il est témoin. « Quand je vois la fortune de tous nos patriciens effacée par l’opulence de ce drôle qui jadis, au temps de ma jeunesse, a fait crier ma barbe sous son rasoir, quand un faquin sorti de la canaille d’Égypte ramène fièrement sur son épaule la pourpre tyrienne, il est difficile de ne pas écrire des satires… Puis-je dire la rage qui me sèche, qui me brûle le foie, lorsqu’un misérable qui a dépouillé son pupille encombre la voie publique de la horde de ses cliens ?… Comment à cette vue ne pas être tenté de s’arrêter là, en plein carrefour, de prendre ses tablettes et d’y marquer ces monstruosités qui passent ? » Sa colère est assurément très légitime, mais comment se fait-il qu’elle lui soit venue si tard ? Il avait près de quarante ans quand il s’avisa de composer les premières satires que nous ayons de lui. Aucune d’elles, au moins sous la forme où nous les possédons, n’est antérieure au règne de Trajan. Faut-il croire qu’il n’y avait pas de débauchés ou de voleurs du temps de Domitien, ou qu’à ce moment Juvénal n’avait pas encore songé à s’irriter de leur présence ? Pour qu’il soit devenu si violent à l’âge où d’ordinaire les grands emportements se calment, pour qu’il ait à quarante ans, quand les habitudes de l’esprit sont définitives, quitté tout d’un coup la prose pour les vers, il faut supposer qu’une circonstance particulière alluma sa verve et lui révéla son talent.
TIBERE ET NERON, DES MODELES POUR DOMITIEN
Ce fut sans doute la révolution soudaine qui délivra l’empire de Domitien. Peu de princes ont été plus détestés que celui-là, quoiqu’au premier abord il ne nous semble pas plus détestable que les autres ; mais ce qui peut expliquer cette sorte de préférence de haine, c’est que de Tibère à Néron Rome n’avait pour ainsi dire pas respiré ; la tyrannie y avait été continuelle, elle ne surprenait plus, et l’on en avait pris l’habitude. L’avènement des Flaviens changea ces dispositions. On crut que le mauvais sort de l’empire était conjuré, on attendit l’avenir avec confiance ; on s’accoutuma de nouveau au bien-être, à la sécurité, à tous ces agréments de la vie dont il est si naturel de jouir qu’il ne semble plus possible, quand on les possède, qu’on puisse en être jamais privé. Du temps de Vespasien et de Titus, personne ne songeait plus qu’on pût revoir un jour Tibère ou Néron ; on les revit pourtant tous les deux ensemble avec Domitien, qui semblait les avoir pris pour modèle et qui mettait sa gloire à leur ressembler. Cette tyrannie parut plus lourde parce qu’elle était moins attendue ; on détesta Domitien et pour les crimes qu’il avait commis et pour les espérances qu’il avait trompées. Cette haine furieuse explique l’ivresse de joie qui saisit le monde à la nouvelle de sa mort ; on peut s’en faire une idée en lisant les lettres de Pline. « C’étaient, dit-il, de tous les côtés des cris confus et tumultueux ». Tous ceux qui avaient perdu quelque ami ou quelques parents cherchaient à les venger. Les délateurs tremblaient ; ils allaient le soir trouver les gens qu’ils savaient irrités contre eux et s’humiliaient pour les désarmer ; mais on ne leur accordait guère le pardon qu’ils sollicitaient. Toute cette jeunesse qui était entrée dans la vie politique à la mort de Vespasien, pleine de confiance en elle-même et d’espoir dans l’avenir, que quinze ans de despotisme avaient condamnée à l’inaction et au silence, était heureuse d’agir et de parler ; elle voulait frapper des coups d’éclat en attaquant les grands coupables. Dans ce réveil de la liberté, l’histoire se ranimait comme l’éloquence. Fannius composait l’éloge des victimes de Néron ; Capiton réunissait ses amis pour leur lire la vie des hommes illustres que Domitien avait fait périr. N’était-il pas naturel que la poésie ressentît aussi l’effet de cette réaction violente ? Dans ses premières satires, Juvénal parle de la mort de Domitien comme d’un événement récent ; elles furent écrites immédiatement après la révolution qui délivra l’empire, pendant ces premiers moments d’agitation et de bruit par lesquels on se dédommageait de quinze ans de silence. C’est donc, on peut le supposer, la haine de ce prince qui lui inspira ses premières poésies. Peut-être avait-il des raisons particulières de le haïr ; beaucoup ont soupçonné que c’est sous Domitien et par son ordre qu’il fut exilé. On comprend alors que l’émotion publique ait excité jusqu’à la fureur ce cœur violent qui avait une injure personnelle à venger, et que la prose, quelque emportée qu’elle fût, ne lui ait pas suffi pour exprimer cette colère qui débordait. À la même époque et sous la même impression, Tacite débutait dans l’histoire en écrivant la vie d’Agricola. La destinée de ces deux grands écrivains avait été semblable ; tous deux avaient passé la plus grande partie de leur vie dans des occupations qui devaient être inutiles à leur gloire, tous deux avaient été remis dans leur voie naturelle par le même ébranlement politique, tous deux abordaient à peu près au même âge le genre littéraire dans lequel ils devaient s’illustrer, où ils étaient maîtres du premier coup.
AVANT TOUT, UNE SATIRE POLITIQUE
Sortie d’une révolution, il était naturel que la satire de Juvénal fût avant tout une satire politique ; elle s’occupe en effet volontiers des événements contemporains ou antérieurs, et dit librement son opinion sur les faits et sur les hommes. Cependant, si l’on se demande, après avoir lu les vers de Juvénal, à quel parti il appartient et quelle forme de gouvernement il préfère, la réponse n’est pas facile. C’est bientôt fait de dire avec M. Victor Hugo qu’il est « la vieille âme libre des républiques mortes » ; l’embarras commence quand on veut le prouver. Il n’y a pas un seul passage chez lui qui permette d’affirmer avec certitude que c’était un républicain. On a recours pour l’établir aux raisons les plus futiles. Quand par exemple il se plaint d’un patron qui fait servir à ses convives du vinaigre ou de la piquette, tandis qu’on lui verse du vin d’Albe et de Sétia, « du vin comme en buvaient Helvidius et Thraséa, couronnés de fleurs, pour célébrer la fête des deux Brutus », — « les beaux vers, s’écrie aussitôt Lemaire, et comme on y voit qu’il aimait la liberté et qu’il détestait la tyrannie ! » — « C’était un Romain de la vieille roche », ajoute à son tour M. Widal. C’était simplement un railleur qui n’était pas fâché de nous dire en passant que ces républicains terribles buvaient parfois d’excellent vin, et il faut en vérité beaucoup de complaisance pour voir dans cette boutade une profession de foi. Je n’attache pas beaucoup plus d’importance aux éloges qu’il donne partout au passé. C’était l’usage alors ; tous les moralistes sont pleins de ces regrets de l’ancien temps, et les empereurs eux-mêmes, quand ils voulaient faire dans leurs édits quelque réprimande vertueuse à leurs sujets, ne manquaient pas de citer avec attendrissement les exemples des Fabricius et des Cincinnatus.
LE REGRET DES VERTUS ANTIQUES
C’est dans le même sens que Juvénal parle de la vieille république ; il en rappelle volontiers les vertus, il admire chez elle l’honnêteté des mœurs, la pauvreté des ameublements, la frugalité des repas. Au luxe de son temps, à tous ces raffinements de bien-être et d’élégance sans lesquels on ne peut plus vivre, il est heureux d’opposer le tableau d’une famille antique, ces enfants demi-nus qui se roulent dans la poussière, ce mari fatigué des travaux du jour qui se gorge de glands dans un coin, et auprès de lui sa femme, souvent plus sauvage que lui, qui abreuve ses fils à sa mamelle. « Cette dame-là, vous ne lui ressemblez guère, ô Cynthia ! non plus que vous, ô Lesbie, vous qui pour pleurer un moineau avez compromis le doux éclat de vos yeux ! » C’est donc plutôt en moraliste qu’en politique que Juvénal parle du passé, et il a l’air de regretter bien plus les vertus antiques que l’ancien gouvernement. Il n’a parlé du gouvernement républicain qu’une fois et avec une singulière légèreté : « Depuis que nous ne vendons plus notre voix à personne », dit-il ; cela signifie : depuis que nous avons cessé d’être libres et d’élire nos magistrats. Cette phrase railleuse n’indique pas, il faut l’avouer, un regret bien profond de la république.
ABAISSER LES AUTRES POUR PARAÎTRE PLUS GRAND
Il est vrai que, si Juvénal ne laisse pas trop voir ses préférences, en revanche il ne dissimule point ses haines. On sait de quelle manière cruelle il a traité tous les princes qui ont gouverné Rome depuis Auguste. N’est-ce pas un indice assuré de ses opinions politiques, et n’est-on pas en droit d’en conclure qu’un homme qui dit tant de mal des empereurs est un ennemi décidé de l’empire ? Cette illusion paraît d’abord très naturelle ; il semble que des princes qui régnaient sur le même pays et au nom du même principe devaient se croire liés les uns aux autres, et que c’était une façon indirecte d’attaquer leur gouvernement que d’insulter leurs prédécesseurs. Napoléon entendait de cette manière la solidarité des rois ; il prenait pour lui les compliments qu’on adressait à Charlemagne, et se tenait pour outragé quand on se permettait de dire du mal de Louis XIV ; mais les Césars n’avaient pas les mêmes scrupules. Comme chacun d’eux avait été l’ennemi de celui qui régnait avant lui et qu’il s’en était souvent débarrassé pour prendre plus vite sa place, il n’avait aucun intérêt à défendre sa mémoire, et c’était même lui rendre service et lui faire plaisir que de l’attaquer. Depuis Auguste, qui souffrait que le flatteur Ovide le mît bien au-dessus de César, ce fut une tradition chez tous ces princes de permettre qu’on abaissât les autres pour paraître plus grands. Ils se chargeaient quelquefois eux-mêmes de ce soin, et l’on vient de retrouver à Trente un édit de l’empereur Claude où il parle très légèrement de son oncle Tibère et de son neveu Caligula. Cet exemple nous prouve que la mémoire des Césars n’était pas regardée comme sacrée, et qu’on pouvait maltraiter l’empereur mort sans déplaire à l’empereur vivant. Les sévérités de Juvénal, quand elles s’adressaient au passé, n’étaient donc pas des crimes ou même des témérités, et beaucoup se les étaient permises, qu’on ne pouvait pas soupçonner d’être des républicains.
UN EXCELLENT PLAT DE CHAMPIGNONS APRES LEQUEL IL NE MANGEA PLUS RIEN
Il a osé attaquer le chef de la dynastie impériale ; mais avant lui Sénèque ne l’avait pas ménagé davantage : ne disait-il pas, dans un ouvrage dédié à Néron, que la clémence d’Auguste n’était qu’une cruauté fatiguée ? Il ne s’est pas fait scrupule de se moquer de l’apothéose de Claude ; il plaisante sur la façon dont Agrippine « le précipita dans le ciel en lui faisant manger cet excellent plat de champignons après lequel il ne mangea plus rien » ; mais qui parlait sans rire de ce dieu étrange ? Sénèque est bien moins respectueux encore dans cette spirituelle satire qu’il composa quelques jours après la mort du prince, et au moment même où un décret du sénat lui ouvrait le ciel. Il est probable que ce charmant ouvrage fut bien accueilli au Palatin, et qu’Agrippine et Néron, qui détestaient Claude, cherchaient en le lisant à se délasser de ces airs de veuve inconsolable et de fils désolé qu’ils étaient obligés de prendre pour recevoir les compliments du sénat et des provinces. Je ne dis rien de la manière dont Juvénal traite partout Domitien ; quelque sévère qu’il soit pour ce prince, il ne l’est pas autant que Pline. Le Panégyrique était pourtant un discours officiel, et si Pline, qui parlait en présence de Trajan, n’a pas cru qu’il fût nécessaire de modérer ses violences, c’est qu’elles étaient sans signification et sans danger, et qu’en disant des empereurs après leur mort ce que tout le monde en pensait pendant leur vie, on ne s’exposait pas à passer pour un ennemi du gouvernement impérial.
DE L’OBSCURITE VOLONTAIRE
Juvénal est allé plus loin ; ce n’est pas seulement pour le passé qu’il est sévère, on voit bien que le présent lui-même ne le contente pas, et l’empereur vivant n’échappe pas tout à fait à ces outrages qu’il prodigue aux empereurs morts. Pour en être sûr, cherchons d’abord, quand il attaque la société romaine, de quelle société il veut parler. Est-ce à celle de son temps que s’applique sa sévérité, ou remonte-t-il plus haut et n’a-t-il l’intention d’atteindre que l’époque de Néron et de Domitien ? La réponse est douteuse, Juvénal a laissé sur ce point quelque obscurité, et cette obscurité me semble très volontaire. Il prévoyait sans doute le bruit qu’allaient faire ses satires, il en redoutait pour lui les conséquences ; aussi essaya-t-il, au milieu de ses hardiesses, de prendre ses précautions et de se garder une excuse. Si ses contemporains se fâchaient d’être ainsi maltraités, si le prince surtout, qu’on rend si aisément responsable de tous les vices de son temps, trouvait les tableaux trop chargés, il voulait pouvoir lui répondre qu’il s’agissait d’une autre époque, et qu’il parlait d’une société qui n’existait plus.
DES REPROCHES A L’HUMANITE TOUTE ENTIERE
Dans sa première satire, qui fut évidemment composée pour servir de préface au recueil de ses œuvres, il veut nous persuader que ses reproches s’adressent non pas à un siècle en particulier, mais à l’humanité tout entière. « Tout ce qui se pratique dans le monde depuis que Deucalion jeta les cailloux derrière lui, toutes les passions qui agitent l’homme, l’espérance et la crainte, la colère et la volupté, la joie et l’inquiétude, voilà la matière dont se compose mon petit livre ». Nous sommes bien avertis, il va remonter au déluge. On dirait pourtant qu’il n’espère pas nous le faire croire, car il reconnaît de bonne grâce, à la fin de la même satire, qu’il n’ira pas prendre ses sujets si loin. Il ne s’agit plus alors de Deucalion, il nous annonce seulement qu’il n’attaquera que les morts. « Je veux essayer, dit-il, ce qu’il est permis de dire de ceux dont la cendre repose le long de la voie Flaminienne ou de la voie Latine ». Il a mal tenu sa parole, et il lui est arrivé plus d’une fois de maltraiter des gens qui n’étaient pas encore couchés dans leurs tombeaux de marbre le long des voies romaines ; seulement il est curieux de voir, quand il ose le faire, les précautions qu’il prend pour nous dérouter. Il présente, dans sa XIIIe satire, une énumération effrayante des crimes qui se commettent tous les jours à Rome, assassinats, parjures, incendies, sacrilèges, empoisonnements, parricides. Nous ne doutons pas en le lisant qu’il ne soit question de son époque, on ne décrit avec autant de verve que les spectacles qu’on a sous les yeux ; mais tout à coup il ajoute : « Tout ce que je viens de dire n’est que la moindre partie des crimes qu’on défère tous les jours à Gallicus ». Or ce Gallicus, nous le connaissons ; c’était un préfet de Rome sous Domitien. Nous pensions que Juvénal parlait de son temps, cette petite phrase vient à propos nous détromper. Les contemporains de Trajan et d’Hadrien ne pourront pas se plaindre, ce n’est pas d’eux qu’il s’agit : le poète nous a brusquement jetés un quart de siècle en arrière.
PARLER A SES CONTEMPORAINS ET MECONTENT DE SON EPOQUE
L’artifice est encore plus visible dans la satire contre la noblesse. Au milieu d’un développement, il s’interrompt sans motif pour nous dire : « À qui donc en ai-je à ce moment ? C’est avec toi que je veux parler, Bubellius Plautus ». Les commentateurs sont assez surpris de cette brusque apostrophe, et, comme c’est leur usage, ils l’admirent beaucoup faute de pouvoir l’expliquer. Elle me rappelle tout à fait ce mot du bonhomme Chrysale dans les Femmes savantes : « C’est à vous que je parle, ma sœur ». La situation est la même : Chrysale, décidé à faire un éclat, mais toujours tremblant devant sa femme, voudrait bien lui persuader qu’il ne s’adresse qu’à Bélise. Juvénal, qui se souvient tout d’un coup que les grands seigneurs sont puissants et qu’il peut être dangereux de le prendre de trop haut avec eux, a soin de se choisir un interlocuteur commode et dont il n’ait rien à redouter. Comme Plautus est mort depuis cinquante ans, il n’y a pas à craindre qu’il se fâche, et voilà pourquoi il le prend si résolument à partie. En réalité, c’est à ses contemporains qu’il veut parler, c’est de son époque qu’il est mécontent. Les allusions au temps présent abondent dans ses vers, et il y est sans cesse question de personnages vivants.
LE VICE EST A SON COMBLE
Les vices qu’il attaque sont ceux qu’il voit ou croit voir autour de lui. Quand il se demande si jamais aucun siècle fut plus fertile en crimes, quand il dit : « La postérité n’ajoutera rien à nos dépravations ; je défie nos descendants de trouver du nouveau, le vice est à son comble, et il ne peut que baisser », il n’y a pas à en douter, c’est de son siècle qu’il se plaint, c’est la société au milieu de laquelle il vit qui lui semble si corrompue, et s’il n’a dit nulle part son opinion sur les empereurs qui règnent alors, c’est qu’il n’ose pas le faire ; mais on voit bien à la façon dont il blâme leur temps et dont il parle de leurs actes, aux demi-mots qu’il laisse échapper et aux réticences qu’il s’impose, qu’il ne les met pas beaucoup au-dessus de leurs prédécesseurs.
LA LIBERTE OU L’APPARENCE DE LIBERTE
Parmi ces empereurs se trouve Trajan ; il est clair que Trajan lui-même n’a pas désarmé la colère de Juvénal, et que le poète n’a pris aucune part à ces acclamations qui saluaient, selon l’expression de Tacite, l’aurore de ce siècle fortuné. Certes on comprendrait que, tout en rendant justice aux vertus de ce prince honnête, Juvénal eût fait quelques réserves. Il pouvait n’être pas de l’avis de Tacite qui proclamait que l’alliance était faite entre le principat et la liberté. En réalité, le régime impérial n’était pas changé dans son principe ; le pouvoir restait tout entier dans les mains d’un homme, et s’il consentait à en partager quelques attributions avec le sénat et les consuls, c’était une générosité volontaire, et qu’il était libre de révoquer. Le fleuve coulait toujours dans le même sens, seulement, nous dit Pline, les magistrats avaient la permission d’y faire quelques saignées à leur profit (quidam ad nos quoque velut rivi ex illo benignissimo fonte decurrunt). Ces petits filets de pouvoir suffisaient à Pline, qui se contentait de peu : n’a-t-il pas eu la naïveté de nous dire qu’il réclamait du prince non la liberté elle-même, mais seulement une apparence de liberté ? On n’en voudrait pas à Juvénal d’être plus exigeant. Il lui était permis de trouver que, même sous Trajan, la sécurité et la liberté des citoyens n’avaient pas assez de garanties. Le gouvernement restait le même, l’empereur seul était changé ; la félicité publique ne s’appuyait que sur la vie du prince : ce n’était pas assez, et une nation est en droit de chercher pour son bonheur des assurances plus solides. Voilà les réserves que pouvait légitimement faire Juvénal quand il parlait de Trajan ; mais il est allé plus loin, il ne s’est pas contenté de tempérer ses éloges par des restrictions, il a impitoyablement refusé de donner aucun éloge.
NERON AU-DESSUS DE TRAJAN ?
C’est là que commence l’injustice. Il affecte de ne mettre aucune différence entre ce gouvernement imparfait sans doute, mais honnête et glorieux, et celui d’un Tibère ou d’un Néron. Il semble même parfois qu’il mette l’époque de Néron et de Tibère bien au-dessus de celle de Trajan. N’a-t-il pas prétendu que jamais les provinces n’ont été plus mal gouvernées que de son temps, parce qu’elles en étaient venues à regretter même Verrès, qu’elles étaient pauvres et ruinées, et que, comme on ne leur avait rien laissé que leurs armes, elles ne tarderaient pas à se révolter contre Rome ? Ce sont des exagérations dont l’histoire fait justice. Il suffit pour y répondre de lire la correspondance que Pline entretint avec Trajan pendant qu’il gouvernait la Bithynie. On y voit les soins infinis et minutieux que prenait le prince pour assurer le bonheur et la sécurité de ses états. Il s’occupe de tout, aucun détail ne lui échappe. Jamais honnêteté plus active et plus scrupuleuse ne veilla au repos des provinces ; jamais regard plus attentif ne fut jeté du Palatin sur le monde. Comment admettre que le proconsul qui se sentait toujours sous cet œil vigilant fût aussi libre de malverser qu’à l’époque de la république, où il était jugé par des complices et surveillé par des amis décidés à ne rien voir chez les autres pour ne pas les encourager à regarder chez eux ? Cette correspondance nous fait connaître et aimer ce vaillant soldat, qui portait dans les affaires politiques un esprit si ferme et si résolu, tant de justice et de bon sens, tant d’énergie et d’humanité, qui écrivait à Pline, un jour que celui-ci lui demandait s’il fallait punir un jeune homme coupable d’avoir outragé sa statue : « C’est mon dessein de ne pas renouveler les procès de majesté ; je ne veux pas avoir recours à la terreur pour obtenir le respect ». Que nous sommes loin de l’époque où Domitien condamnait une femme à mort parce qu’elle s’était permis de changer de vêtements devant son image !
LA TURBA REMI
Ces différences entre les temps et les hommes sont visibles ; comment se fait-il qu’elles n’aient pas frappé Juvénal ? comment ne nous laisse-t-il nulle part deviner que le régime sous lequel il vivait valait mieux que celui qui l’avait précédé ? En le supposant sincère, et je ne vois pas de raison d’en douter, d’où sont venues ses préventions ? Sont-elles l’effet d’un système politique arrêté, exclusif, qui, en s’imposant à son esprit, le rend pour tout le reste incapable de justice et d’impartialité, et, s’il en est ainsi, quel peut être ce système ? Serait-ce par exemple un gouvernement où le peuple aurait plus de part ? On est tenté de le croire quand on se souvient des beaux vers que j’ai cités, dans lesquels, pour abaisser la noblesse, il relève les plébéiens, et montre qu’ils sont vraiment la force et l’honneur de l’état ; mais faut-il chercher dans ce passage autre chose qu’un admirable élan de colère et la vengeance légitime d’un orgueil blessé ? Juvénal demande-t-il en réalité pour ces pauvres gens que les grands seigneurs dédaignent une situation plus avantageuse dans l’empire ? A-t-il prévu ou désiré un nouvel état social où l’on tiendrait plus de compte de tous ces déshérités de la naissance et de la fortune, et où les plébéiens reprendraient leurs droits politiques ? Cela paraît difficile à croire quand on le voit partout ailleurs traiter la plèbe de son temps avec le mépris que malheureusement elle méritait. C’est la tourbe des enfans de Rémus, turba Remi ; elle est toujours pour le plus fort, elle salue la fortune et déteste les proscrits. Elle forme le cortège ordinaire du vainqueur, et s’empresse d’aller donner quelques coups de pied à l’ennemi de César quand il est à terre. Elle a perdu le goût du pouvoir, elle ne se soucie plus de la liberté ; pourvu qu’on la nourrisse et qu’on l’amuse, le reste lui est indifférent, elle ne demande à celui qui la gouverne que des spectacles et du pain. Après un jugement aussi sévère, il n’est pas possible de croire que Juvénal voulût réclamer des droits nouveaux pour un peuple aussi dégradé.
DES PREJUGES LES PLUS ETROITS DE LA NOBLESSE À défaut du peuple, est-ce vers la petite bourgeoisie, vers ce monde actif et affairé de marchands et d’industriels de toute sorte, qu’il tourne les yeux ? S’est-il fait le défenseur de ces commerçants affranchis ou fils d’affranchis, répandus alors dans toutes les villes de l’empire, dont ils faisaient la fortune ? Les a-t-il vengés des mépris des grands seigneurs, et a-t-il demandé pour eux plus de part dans les affaires de leur pays ? C’est ici peut-être la plus grande et la plus curieuse inconséquence de Juvénal ; ce violent ennemi de la noblesse se trouve en avoir conservé les préjugés les plus étroits. On comprend que dans une société aristocratique la première vertu soit l’immobilité. Ceux qui occupent les bonnes places trouvent naturellement qu’il convient que tout le monde reste où il est, et ils n’épargnent ni les railleries ni les insultes à ces fortunes subites qui dérangent l’ordre établi et leur créent des rivaux. Par une étrange aberration, la philosophie antique s’était faite, avec une complaisance qui nous surprend, la complice de l’aristocratie et de ses opinions. Sous prétexte qu’il faut être modéré dans ses désirs et se contenter de peu, elle avait fini par décourager l’industrie et l’activité qui s’appliquent aux choses de la vie, et par faire comme un devoir à tout le monde de rester dans sa condition.
CEUX QUI ONT ETABLI LEUR DOMICILE SUR UN VAISSEAU
C’est ce que répètent tous les anciens sages, aussi bien ceux qui vivaient dans un tonneau, comme Diogène, que ceux qui, comme Sénèque, habitaient des palais. Horace avait prêché de son temps ces vieilles maximes ; Juvénal aussi les accepte sans hésiter. Il s’emporte à tout propos contre ceux qui se donnent du mal pour faire fortune, et, ce qui est plus surprenant, c’est que de toutes les manières de s’enrichir il en veut principalement à celle qui nous semble le plus légitime. Jamais la richesse ne nous paraît mieux acquise que quand on l’a gagnée dans des voyages lointains, au prix de son repos, au péril de ses jours. Juvénal au contraire, comme Horace, ne peut comprendre ces gens « qui ont établi leur domicile sur un vaisseau, qui se font secouer sans cesse par le vent du nord et du midi, pour rapporter de bien loin quelque marchandise puante », et les pires de tous les fous lui semblent être « ceux qui ne mettent que quelques planches entre la mort et eux ». Il n’a guère plus d’estime pour les commerces moins hasardeux ; il faut voir comme le poète affamé qu’il fait parler dans sa IIIe satire se donne des airs de grand seigneur pour se moquer de ces gens « qui prennent l’entreprise des ports et des boues de Rome, et même afferment les pompes funèbres ou les vidanges ! » Cette haine du commerce et de l’industrie était un héritage que l’ancienne aristocratie avait laissé aux temps nouveaux. Les préjugés survivent souvent aux sociétés qui leur ont donné naissance, et ils ne sont jamais plus tenaces que lorsqu’ils n’ont plus de raisons d’être. Ils se perpétuent, on ne sait pourquoi, au milieu d’un monde qui repose sur des principes différents, et s’imposent à des gens qui devraient leur échapper par leurs opinions et par leur naissance.
LES FINANCIERS AUX ÂMES SALES PETRIES DE BOUE ET D’ORDURE
Ne voyons-nous pas chez nous La Bruyère, qui avait vieilli dans une situation subalterne, moitié ami, moitié valet, chez ces Condé si durs à leurs serviteurs, ne le voyons-nous pas accepter toutes les antipathies, toutes les rancunes de cette aristocratie qui par moments lui semblait si sotte et si désagréable ? Il juge comme elle les financiers, « ces âmes sales, pétries de boue et d’ordure, éprises du gain et de l’intérêt » ; les spéculations heureuses lui semblent toujours des friponneries. Il rougit de bonté à la vue de ces mariages disproportionnés qui font entrer les filles des traitants dans les plus illustres familles de France, et toutes ces révolutions naturelles de la fortune, qui va des dissipateurs aux intelligents, lui semblent autant de sacrilèges. « Si certains morts revenaient au monde, dit-il, et s’ils voyaient leurs grands noms portés, et leurs terres les mieux situées avec leurs châteaux et leurs maisons antiques possédés par des gens dont les pères étaient peut-être leurs métayers, quelle opinion pourraient-ils avoir de notre siècle ? » Leur opinion nous importe peu ; nous pensons aujourd’hui que la richesse appartient de droit aux plus industrieux, qu’il est naturel qu’elle passe de ceux qui n’ont pas su la conserver à ceux qui savent la conquérir, que les terres et les domaines doivent aller aux gens qui, en faisant leur fortune, font celle des autres et de l’état, et nous trouvons fort étrange que le plébéien La Bruyère en soit indigné. De même, nous ne pouvons pas comprendre comment Juvénal, un fils d’affranchi, se montre si sévère pour ceux qui essaient de s’enrichir. Si de pauvres gens comme Umbritius ou Trébius refusent de hasarder leur vie dans des entreprises lointaines ou de faire à Rome quelque commerce lucratif, quelle ressource leur reste-t-il pour vivre ? Ils n’en ont plus qu’une, il faut qu’ils aillent le matin chez les riches solliciter la sportule, ou qu’ils se présentent l’après-midi au portique de Minucius pour recevoir le blé et l’huile que l’empereur accorde aux 200,000 pauvres de Rome ; en un mot, il faut qu’ils demandent l’aumône aux particuliers ou à l’état.
VIVRE DE LA GENEROSITE DES AUTRES
Juvénal accepte de bon cœur cette extrémité. À tous ces bas métiers qui déshonorent, il préfère ouvertement la charité publique ou privée ; il approuve tout à fait ces mendiants superbes, comme Umbritius, qui se croiraient humiliés, s’ils affermaient les boues ou les vidanges, et qui aiment bien mieux tendre la main. Une société lui semble très bien ordonnée quand une bonne partie des citoyens vit de la générosité des autres, et la principale raison qu’il a de regretter le passé, c’est que les riches étaient alors beaucoup plus généreux. L’heureux temps où l’on donnait sans compter, où la sportule coulait à flots, où les clients étaient toujours bien accueillis le matin et souvent reçus le soir à la table du maître ! Quels grands hommes que les Cotta, les Pison, les Messala ! « Ils mettaient la gloire de donner bien au-dessus de celle qui leur venait de leur naissance et de leurs triomphes ! » Ce n’est pas de ses beaux ouvrages qu’il faut féliciter Sénèque ; on doit l’admirer surtout « parce qu’il envoyait souvent des cadeaux à ses clients pauvres ». Fidèle à ses principes, Juvénal n’entrevoit aucun autre avenir pour les gens de lettres que d’être protégés par les grands seigneurs. Comme en général « la muse adorée donne plus de génie que de vêtements », il faut bien trouver quelqu’un qui vous nourrisse et vous couvre. Malheureusement il n’y a plus de Mécènes. « Où sont les Proculéius, les Fabius ? Cotta et Lentulus n’ont pas de successeurs ».
PRENDRE UN LION PLUTÔT QU’UN POETE
Les lettres ne peuvent plus rien espérer des gens riches. Quelques-uns d’entre eux se sont avisés de se faire poètes, et quand on leur dédie un bel ouvrage, au lieu de répondre comme il convient en argent comptant, ils s’empressent de payer en vers. Les autres se ruinent en fantaisies coûteuses ; ils construisent des villas et des portiques, ils dépensent leur fortune avec des femmes à la mode ou entretiennent chez eux des lions apprivoisés, « comme si, après tout, un lion ne coûtait pas plus à nourrir qu’un poète ». Que faire et à qui s’adresser ? Juvénal n’hésite pas ; si les riches ferment leur bourse, il tendra résolument la main à l’empereur. « L’empereur, dit-il, tel est l’unique espoir des lettres aujourd’hui, et leur seule raison d’être ».
CESAR VOUS REGARDE ET VOUS AIME
Du reste cette démarche ne paraît pas lui coûter, et l’on ne peut pas dire qu’il s’y résigne de mauvaise grâce. Au contraire, quand il excite les jeunes poètes à profiter de la protection impériale, il a comme un air de triomphe. « Courage, leur dit-il, César vous regarde et vous aime ; sa bonté souveraine ne cherche qu’une occasion de s’exercer ». Voilà pourtant celui qui paraît être quelquefois un implacable ennemi de l’empire, celui qu’on nous dépeint « comme la vieille âme libre des républiques mortes ! » En réalité, il se soucie aussi peu de l’empire que de la république. Ces clients misérables, ces littérateurs affamés dont il s’est fait l’interprète, ne portaient pas leur vue si haut. Comme ils ne trouvaient pas de sort plus souhaitable que de vivre ; des libéralités d’autrui, la société la plus parfaite leur semblait celle où ces libéralités seraient le plus abondantes. C’était leur idéal, et Juvénal le plus souvent ne paraît pas en avoir d’autre. Ce n’est donc pas au nom d’une opinion politique qu’il s’est montré quelquefois si dur pour les Césars. Sa colère était non pas l’effet d’un système raisonné, mais d’un tempérament chagrin. Il était, comme je l’ai fait voir, de ces gens aigris par la vie, que le sort a placés dans des situations irrégulières, qui, trompés dans leurs espérances, blessés dans leur orgueil, ont perdu l’équité.
UN CARACTERE PLUTÔT QU’UNE OPINION
N’en faisons pas le défenseur convaincu d’une grande cause populaire, l’adversaire systématique et décidé d’un gouvernement odieux ; il représentait un caractère plutôt qu’une opinion, il avait plus de passions que de principes, et aucun parti sérieux ne peut se prévaloir de son nom.
LA PRIMAUTE DE LA MORALE SUR LA POLITIQUE
Le moraliste est encore plus important dans Juvénal que le politique, et nous ne pouvons pas nous séparer de lui sans apprécier le jugement qu’il porte sur les mœurs de son temps. Ce jugement, comme on sait, est très sévère, et il l’exprime avec tant de passion, il entre dans des détails si effrayants, il donne des exemples si nombreux de l’immoralité de ses contemporains, qu’il a entraîné l’opinion. Tout le monde est de son avis, et les critiques même qui, comme M. Nisard, lui accordent ordinairement peu d’autorité, n’hésitent pas à reconnaître sur sa foi que ce siècle est un des plus corrompus de l’histoire.
EST-CE UNE LEGITIME COLERE ?
C’est au point qu’on court le risque de surprendre et de scandaliser les honnêtes gens, si l’on ne partage pas tout à fait leur indignation. Il est bon pourtant, avant de s’indigner, de savoir si la colère est légitime, et il faut encore ici se demander quelle confiance mérite le témoignage de Juvénal. Cette question est plus sérieuse qu’il ne le semble au premier abord. Ce n’est pas une curiosité futile et le vain désir de penser autrement que tout le monde, qui nous poussent à la poser. Dans cette société que décrit Juvénal, et à des profondeurs où son œil ne semble pas avoir pénétré, le christianisme naissait. N’importe-t-il pas de savoir dans quel milieu il a grandi et sur quel fond il a germé ? Pour apprécier le changement qu’il a fait subir au monde, ne faut-il pas établir d’abord en quel état il l’a trouvé ? Tout devient grave dès qu’on touche aux origines de cette révolution d’où la société moderne est sortie, et personne ne sera surpris, puisque le témoignage de Juvénal prend cette importance, qu’on ne l’accepte pas sans discussion.
COMMENT SE PRONONCER SUR UNE SOCIETE QUI N’EXISTE PLUS
Rien n’est plus malaisé que de se prononcer sur une société qui n’existe plus ; il suffit de voir, pour en être convaincu, combien nous éprouvons de difficulté à nous mettre d’accord sur celle au milieu de laquelle nous vivons. Chacun juge son temps à sa manière, d’après son âge, ses relations ou son humeur. Nous sommes naturellement portés à l’estimer quand il nous estime, et nous lui devenons sévères sans le vouloir s’il ne fait pas de nous le cas que nous croyons mériter. Écartons, si l’on veut, toutes ces chances d’erreur ; supposons un homme comme il n’y en a pas, sans parti-pris et sans passion, résolu à chercher la vérité et à la dire ; comment fera-t-il pour la trouver ? Il affirme que son siècle est vertueux ou corrompu ; qu’en peut-il savoir ? à quelle profondeur ont pénétré ses recherches ? sur quel espace se sont-elles étendues ? Et d’abord qu’appelle-t-il son siècle ? Par ce mot, on entend d’ordinaire la réunion de quelques personnes qui sont en possession d’attirer les yeux de la foule, qui posent devant elle et qui l’amusent par les spectacles qu’elles lui donnent. Ce que Mme de Sévigné appelait « toute la France », c’était tout au plus un millier de grands seigneurs. Au-delà de ce monde restreint, rien n’existait plus pour elle, et c’est sur lui seul qu’elle jugeait son temps. « Toute la France » était galante pendant le règne de La Vallière et de Montespan, « toute la France » devint dévote quand le vieux roi se fut réduit aux sévères amours de Mme de Maintenon. Nous apprécions nos contemporains comme Mme de Sévigné traitait les siens, et nos jugements ne sont pas mieux motivés. Quand on veut connaître les mœurs du temps, on se contente d’observer ces quelques personnes qui font la mode et l’opinion ; c’est uniquement d’eux que s’occupent le roman et le théâtre, et les bonnes gens qui vont écouter avec tant de plaisir les comédies en renom ne se doutent guère que la postérité les jugera d’après les pièces qu’ils applaudissent, qu’on établira doctement dans quelques siècles qu’il n’y avait chez nous ni financier honnête, ni femme vertueuse, ni ménages unis, parce qu’il a plu à nos auteurs dramatiques de ne représenter jamais que des escroqueries et des adultères. C’est justice, après tout ; nos appréciations du passé ne sont pas plus légitimes, et l’on nous jugera tout à fait comme nous jugeons les autres.
UNE SOCIETE PLUS SEVERE CAR PLUS SCRUPULEUSE
Le roman et le théâtre ne sont pas seuls à nous présenter ainsi des peintures de fantaisie ; les moralistes, auxquels on se fie si volontiers me semblent encore plus suspects d’exagérer. Quand on veut faire la morale à son temps, il convient d’être rigoureux, et, pour être sûr que les coups portent, il n’est pas mauvais de frapper fort. Ne risquons-nous pas d’être injustes si nous prenons tous ces reproches à la lettre ? Ce n’est pas toujours dans les siècles les plus mauvais que les moralistes sont le plus nombreux et paraissent le plus mécontents ; il arrive souvent qu’une société s’accuse avec plus de sévérité quand elle est plus scrupuleuse, et que le sentiment moral est plus exigeant chez elle.
LE DERNIER DEGRE DE LA CORRUPTION EST DE NE PAS EN AVOIR CONSCIENCE
C’est quelque chose que de se gronder, même quand on ne se corrige pas, et le dernier degré de la corruption est de n’en pas avoir conscience. Il peut donc se faire que des époques qui se maltraitent beaucoup elles-mêmes, et dont nous avons une mauvaise opinion parce que nous nous fions à leurs aveux, soient en réalité bien plus honnêtes que celles qui ne voient pas leurs fautes ou qui n’en disent rien. J’ajoute que les moralistes ont l’habitude d’apprécier leur temps plutôt d’après le mal que d’après le bien qui s’y trouve. Le bien passe ordinairement inaperçu : on ne songe pas à s’étonner d’un honnête homme ou d’un bon ménage qu’on rencontre ; il n’y a rien là qui éveille la curiosité. Au contraire un procès immoral, un crime éclatant, attirent les regards précisément parce qu’ils sont plus rares. Un seul scandale dont on parle longtemps n’a pas de peine à détruire l’effet de cent familles honnêtes et prosaïques dont on n’a jamais rien dit.
QUAND LE MAL EST L’EXCEPTION, IL PARAÎT LA REGLE
C’est ainsi que, même quand le mal est l’exception, il paraît la règle. Cette illusion, dont la plupart des moralistes sont victimes, a souvent trompé Juvénal. La manière dont il procède dans les tableaux qu’il trace de son époque est toujours la même : il n’invente pas les types qu’il met sous nos yeux ; ses caractères sont des portraits ; il part d’une anecdote réelle, d’un fait précis et particulier, et les généralise. Hippia vient de quitter son mari Veiento, un sénateur, un consulaire ; elle abandonne son pays et ses enfants pour suivre jusqu’en Égypte un gladiateur qu’elle aime : n’est-ce pas la preuve que toutes les femmes de Rome ont la passion des gens de théâtre ? « L’épouse que tu prends, c’est le joueur de lyre Echion, c’est Glaphyrus ou Ambrosius le joueur de flûte qui la rendra mère ». Une femme du meilleur monde, Pontia, égarée par un amour insensé, tue ses deux fils pour enrichir son amant.
UN POISON QUI SE CACHE DANS UN METS EXQUIS
L’affaire fait grand bruit, comme on pense, et pendant plusieurs semaines on ne parle pas d’autre chose à Rome. Juvénal en conclut que tous les enfants sont en danger d’être tués par leur mère. « Veillez sur vos jours, leur dit-il ; faites attention à ce que vous mangez : un poison peut se cacher dans ce mets exquis que vous présentent des mains maternelles. Faites goûter tous les morceaux qu’on vous apporte, et que votre vieux serviteur fasse l’essai de vos coupes ». N’est-ce pas ainsi que raisonnent encore aujourd’hui d’honnêtes gens qui vivent loin du monde, et n’ont de rapport avec lui que par les scandales éclatants qui transpirent de temps à autre et occupent les curieux ? Ils ne connaissent que les fautes ou les crimes, c’est-à-dire que l’extraordinaire et l’exception, et ils se figurent de bonne foi que tout ressemble à ce qu’ils connaissent.
UN AVOCAT QUI CHANGE D’OPINION QUIVANT LA CAUSE QU’IL PLAIDE
Nous avons par bonheur deux manières de corriger ces exagérations de Juvénal ; l’une consiste à le mettre aux prises avec lui-même, l’autre à le comparer à ses contemporains. Il lui est arrivé, comme à tous ceux qui écrivent plus par tempérament que par raison, et qui se laissent trop emporter à leurs premiers mouvements, de se contredire quelquefois. Je n’en veux citer qu’un exemple. Un des plus graves reproches qu’il adresse aux femmes dans sa VIe satire, c’est d’envahir les occupations des hommes ; il leur en veut beaucoup « d’être fortes sur la procédure, de rédiger des mémoires, et d’en remontrer au besoin au jurisconsulte Celsus ». Ailleurs il parle d’une façon toute contraire. Il a introduit dans sa IIe satire une femme qui défend résolument son sexe contre les hommes. « Est-ce que nous avons la rage des procès, leur dit-elle ? est-ce que nous sommes ferrées sur la chicane ? est-ce que nous venons faire vacarme dans vos tribunaux ? » Où donc est la vérité ? Ces contradictions formelles nous apprennent à ne pas nous fier sans réserve aux allégations de Juvénal ; ce n’est pas tout à fait, comme on l’a dit, un témoin qui dépose, c’est un avocat, et il change d’opinion suivant la cause qu’il plaide. Les démentis qu’il reçoit des autres sont plus graves encore que ceux qu’il se donne quelquefois à lui-même. Tacite ne passe pas pour un moraliste complaisant ; on l’a même quelquefois accusé de mettre trop d’amertume dans sa façon d’apprécier les événements et les hommes.
UNE NOUVELLE ARISTOCRATIE AVEC DES HABITUDES D’ORDRE & D’ECONOMIE
Il a pourtant loué plusieurs fois son époque : « Tout ne fut pas mieux autrefois, dit-il ; notre siècle a produit aussi des vertus et des talents dignes d’être un jour proposés pour modèles ». Il y a surtout une qualité qu’il accorde à ses contemporains : il les félicite d’être devenus plus raisonnables dans leurs dépenses et plus modérés dans leurs goûts ; il trouve que le luxe a diminué, et il a soin de nous donner la cause et la date de cet heureux changement. Depuis que la vieille aristocratie, qui aimait la magnificence, a disparu sous les coups des Césars, une noblesse nouvelle est venue à Rome des provinces, et elle y a porté ces habitudes d’ordre et d’économie qu’elle pratiquait ailleurs. Vespasien, qui en faisait partie, a mis la vie simple et bourgeoise à la mode. Cette réforme, que Tacite signale avec tant de précision, Juvénal semble ne l’avoir pas aperçue. Du reste il n’en pouvait pas être satisfait, et l’économie chez les riches lui semblait sans doute beaucoup plus près d’un vice que d’une vertu. Pline est encore plus contraire à Juvénal que Tacite, et son témoignage me paraît mériter d’autant plus de confiance qu’il n’a pas la prétention d’être un témoin. Il ne parle nulle part en moraliste de profession ; c’est par hasard et d’une façon indirecte, en reproduisant les lettres qu’il avait écrites à ses amis, qu’il nous fournit les documents les plus curieux et les plus certains pour juger la société de son temps. Cette société est pourtant la même que Juvénal a voulu nous peindre ; on ne s’en douterait guère en la parcourant à la suite de Pline.
A ROME, PAS PLUS DE GENS HONNETES QUE DE PORTES A THEBES
Il s’y trouve sans doute encore de malhonnêtes gens, quelques vieux délateurs désolés de ne pouvoir plus nuire, des gouverneurs de province qui pillaient leurs administrés ; mais en même temps que d’agréables portraits, que de nobles figures, que de gens du monde aimables et distingués, bons à leurs serviteurs, dévoués à leurs amis, fidèles à leurs opinions ! Juvénal déclare dans une boutade qu’il ne reste pas plus de gens honnêtes à Rome qu’il n’y a de portes à Thèbes, ou même de bouches au Nil. Évidemment il ne s’est pas donné la peine de bien chercher. Dans ce monde charmant que Pline nous fait connaître, et qui n’est pas la société romaine tout entière, il serait facile d’en trouver bien davantage.
PLINE ET JUVENAL, DEUX VISIONS OPPOSEES
On pourrait en faire une liste nombreuse en tête de laquelle on placerait les rares survivants des générations précédentes, ce Spurinna, sage vieillard qui, retiré des affaires dans une retraite grave et studieuse, voulait, comme nos grands hommes du XVIIe siècle, mettre quelque intervalle entre la vie et la mort ; ce Verginius Rufus, qui avait refusé l’empire après Néron, et que sa modestie exposa à plus de dangers que ne lui en aurait créé son ambition. Il faudrait y mettre aussi toute cette jeunesse honnête et active dont Pline s’était fait le patron, qui plaidait devant les tribunaux, qui servait sous Trajan dans les légions du Danube, et qui trouvait le temps de composer des vers grecs ou latins entre deux campagnes ; on ne devrait pas non plus oublier les femmes, et l’on y verrait figurer avec honneur, à côté de la lignée héroïque des filles et des petites filles de Thraséa, cette jeune Calpurnia, qui rendait Pline si heureux en admirant ses plaidoyers et en chantant ses vers sur la lyre. Nous voilà aussi éloignés que possible des sombres tableaux de Juvénal, et il nous est bien difficile de comprendre comment deux contemporains peuvent nous donner du même temps une opinion si différente.
LES DEFAUTS DE L’HUMANITE, NON D’UNE EPOQUE
Est-ce à dire que Juvénal nous trompe et que les reproches qu’il fait à son siècle ne soient pas vrais ? Ils me semblent trop vrais au contraire, quand je les retrouve chez les moralistes de tous les temps. Les défauts dont il se plaint avec tant d’amertume sont bien plus vieux que Domitien ou que Trajan ; ce sont les défauts non d’une époque, mais de l’humanité. Lucilius trouve déjà, cinq siècles avant Hadrien, qu’autour de lui on ne tient plus qu’à la fortune ; il dit presque dans les mêmes termes qu’Horace et que Juvénal qu’on mesure l’estime à la richesse, et que plus on a d’écus, plus on possède de crédit. Il ne ménage pas davantage les femmes ; il les blâme d’être prodigues et coquettes, de tromper et de ruiner leurs maris.
DES HUÎTRES A MILLE SESTERCES
Il les appelle sans plus de façons des fléaux et des pestes (aerumnae atque molestiae), et bien longtemps avant Juvénal il déclare qu’il vaut mieux se pendre que se marier. Il attaque avec autant de vivacité que ses successeurs les voleurs, les avares, les coureurs de testaments, les débauchés, les gourmands surtout, car déjà il y avait des gens « qui ne vivaient que pour manger et qui payaient des huîtres 1,000 sesterces, ce qui pour le temps vaut bien les 6,000 sesterces que Crispinus donnait pour un barbillon ; il trouve enfin que le vice est à son comble, « qu’on n’a plus souci de l’honneur, que personne ne respecte les lois, la religion ni les dieux. »
ON S’EST PLAINT AUTREFOIS, AUJOURD’HUI, ON SE PLAINDRA DEMAIN
C’était pourtant l’époque dont Juvénal ne parlait jamais qu’avec l’admiration la plus vive et qui lui semblait un âge d’or ! Les contemporains, comme on voit, n’étaient pas de cette opinion ; ils ne s’imaginaient pas vivre dans un siècle si fortuné, et se croyaient, eux aussi, dans l’âge de fer. Quand on est atteint d’un mal cruel, on est toujours tenté de croire qu’on en souffre plus que personne, ou même que personne n’en a jamais souffert avant nous ; c’est une illusion de malade. La santé physique et morale de l’humanité est soumise aux mêmes crises depuis le commencement du monde, et lorsqu’on voit que tous les siècles ont entendu les mêmes gémissements, il est naturel d’en conclure que tous à peu de chose près ont connu les mêmes maux. « On s’est plaint autrefois, dit Sénèque, on se plaint aujourd’hui, on se plaindra toujours de la dépravation des mœurs publiques, du triomphe du crime et de la méchanceté croissante du genre humain. En réalité, le vice reste et restera toujours au même point à quelques déplacements près au-delà ou en-deçà de ses limites ordinaires. Il ressemble aux flots de l’océan que le flux pousse en dehors des rivages et que le reflux fait rentrer dans leur lit ». Voilà ce qu’il faut répondre à ces moralistes grondeurs comme Juvénal, qui croient toujours que leur époque est la plus mauvaise de toutes.
VERS QUEL IDEAL DE VERTU ?
Nous avons heureusement une autre manière, et à mon avis beaucoup plus sûre, d’apprécier ce qu’on peut appeler le tempérament moral d’une époque : c’est de passer résolument de la pratique à la théorie, de chercher non pas de quelle façon on vivait alors, ce qu’il est toujours très difficile de savoir, mais comment on croyait qu’il fallait vivre, quel idéal de vertu on se proposait d’atteindre, ce qu’on pensait des rapports des hommes entre eux et de leurs devoirs envers leurs subordonnés ou leurs supérieurs, quelles qualités l’opinion publique exigeait d’un honnête homme et à quel prix elle accordait ce nom. Considéré de ce côté, le siècle des Antonins se relève. Ceux même qui sont le plus disposés à croire aux médisances de Juvénal seront bien forcés de reconnaître que jamais les sages n’avaient encore enseigné une doctrine plus haute et plus pure, et qu’aucune autre société dans ses théories morales ne s’était autant approchée de la perfection. Aucune contestation n’est ici possible, et si l’on voulait élever quelques doutes, Juvénal lui-même se chargerait de les réfuter. Sans le savoir, il nous a donné des armes pour le combattre, et quand il pense nuire à son temps, il nous permet de lui rendre justice.
CYNIQUE MAIS PHILOSOPHE RIGOUREUX ET MORALISTE DELICAT
Ce cynique effronté se trouve être par moments le philosophe le plus rigoureux, le moraliste le plus délicat. Par exemple, il condamne sévèrement ceux qui sont cruels pour leurs esclaves, qui leur refusent une tunique quand il fait froid, qui les font enfermer ou battre pour la moindre faute, « et pour qui le bruit des coups de fouet est une musique plus douce que le chant des sirènes ». Horace aussi défend de les maltraiter, mais c’est uniquement pour lui un devoir de société, une obligation qu’il impose aux gens du monde au nom du savoir-vivre ; s’ils veulent paraître bien élevés, il ne leur convient pas plus de s’emporter contre leurs serviteurs que de verser à leurs convives une eau malpropre dans des verres sales. Pour Juvénal, c’est un devoir d’humanité ; il veut que dans l’esclave on respecte l’homme, « car leur âme et la nôtre, dit-il sont formées des mêmes principes ».
UN PROFOND RESPECT DE L’ENFANCE
Personne aussi ne s’est fait dans l’antiquité une idée plus élevée de la famille que Juvénal, personne ne s’est occupé avec plus de tendresse du respect qu’on doit à l’enfance, des bons exemples qu’il faut mettre sous ses yeux et des spectacles qu’il convient de lui épargner. « Éloigne du seuil où ton enfant s’élève tout ce qui peut blesser son oreille ou ses yeux. Loin d’ici les femmes galantes ! loin d’ici les chansons nocturnes des parasites ! on ne saurait trop respecter l’enfance. Prêt à commettre quelque honteuse action, songe à l’innocence de ton fils, et qu’au moment de faillir la pensée de ton enfant vienne te préserver… » Même envers les gens qui nous sont étrangers, Juvénal trouve que nous avons des devoirs à remplir ; il ne veut pas qu’on réponde par le mal au mal qu’ils nous font, et il condamne la vengeance aussi rigoureusement que le ferait un chrétien. Les sots la regardent comme le bien le plus doux de la vie ; Juvénal l’appelle le plaisir d’une âme faible, infirmi est animi exiguique voluptas.
L’HOMME EST NE POUR LA PITIE
LES LARMES, LE PLUS BEAU TITRE DE L’HUMANITE
En laissant le coupable à ses remords, en l’abandonnant à ce bourreau qu’il porte nuit et jour dans son âme, on n’est que trop vengé. Térence et Virgile avaient déjà célébré cette sympathie universelle qui, sans intérêt personnel, en dehors des liens du sang et de l’amitié, porte les hommes, parce qu’ils sont hommes, à souffrir des maux de leurs semblables et à se croire atteints dans leurs malheurs ; mais ce n’était chez eux qu’une réflexion touchante, Juvénal y insiste et la développe dans des vers admirables. « L’homme est né pour la pitié, la nature elle-même le proclame. Elle lui a donné les larmes, c’est le plus beau titre de l’humanité. Oui, la nature le veut, il faut que l’homme pleure quand il voit paraître devant les juges son ami éperdu et les vêtements en désordre. Oui, la nature gémit en nous quand nous rencontrons le convoi d’une jeune fille, quand nous voyons mettre dans la terre un petit enfant. Où est-il l’homme vraiment honnête qui croit que le malheur de ses semblables ne te touche pas ? C’est là ce qui nous distingue des bêtes. Aux premiers jours du monde, Dieu, notre créateur, accorda aux animaux la vie seulement, aux hommes il donna une âme pour qu’une mutuelle affection les portât à s’entraider ».
LES ENSEIGNEMENTS DE LA VIE
Ces grandes idées venaient à Juvénal de la philosophie. C’est elle qui avait proclamé par la bouche de Chrysippe que la vengeance est coupable, qui avait dit avec Sénèque que l’esclave est un homme, qui répétait tous les jours avec les stoïciens que tous les hommes sont frères. Juvénal n’était pas un philosophe de profession, il n’avait pas appris la sagesse dans les écoles, et il se range modestement parmi ceux qui n’ont eu que les enseignements de la vie ; mais personne alors, quels que fussent ses origines et son passé, n’échappait à la philosophie, comme aujourd’hui personne ne peut se soustraire au christianisme, même en le combattant. Elle avait d’abord rencontré des résistances opiniâtres, Sénèque dit que son nom était odieux, les rhéteurs et les hommes d’état l’avaient mal accueillie ; malgré cette opposition, elle finit par s’imposer à tout le monde. Les satires de Juvénal nous montrent qu’à ce moment elle était sortie des écrits et des écoles des maîtres, qu’elle s’insinuait partout, qu’elle s’emparait de tous les esprits, qu’elle formait cette opinion commune dans laquelle les générations sont obligées de vivre, et qu’elles respirent comme l’air.
Il resterait à savoir si ces belles leçons qu’elle donnait n’ont jamais été appliquées. Ceux qui se fient à Juvénal et qui acceptent ses jugements sont tentés de ne pas le croire ; mais est-il possible que des principes accueillis de tout le monde et répandus dans toute une société n’aient pas eu quelque effet pratique, et ne devaient-ils pas finir un jour par passer des livres dans la vie ? Nous pouvons l’affirmer au moins des plus importants, et nous avons la preuve qu’ils ne sont pas restés à l’état de préceptes et de théories. Juvénal, nous l’avons vu, recommande aux maîtres de se montrer doux pour leurs esclaves ; les lettres de Pline nous font voir qu’un honnête homme ne se permettait plus de les maltraiter. Ils faisaient partie de la famille ; on les soignait avec dévouement lorsqu’ils étaient malades, on les pleurait quand on les avait perdus ; on se faisait un devoir de respecter leurs testaments et d’accomplir leurs dernières volontés.
DEVANT LE DROIT NATUREL, TOUT LE MONDE NAÎT LIBRE
Ce qui est plus important encore, c’est qu’à partir de cette époque la loi intervient pour les protéger. L’empereur Claude décide que l’esclave abandonné par son maître dans une maladie grave devient libre s’il guérit. Hadrien punit de l’exil ceux qui les traitent avec cruauté, Antonin et Marc-Aurèle sont sans cesse occupés à les défendre, et les jurisconsultes, introduisant dans la législation les principes de Sénèque, finissent par proclamer que devant le droit naturel tout le monde naît libre. J’ai cité ces beaux vers de Juvénal où l’on trouve un si tendre souci de l’enfance ; la société tout entière s’en préoccupe comme lui. Sénèque et Tacite sont pleins de réflexions justes et profondes sur l’éducation ; c’était pour tous les sages d’alors un sujet d’études, et l’on discutait déjà dans les écoles les théories de l’Émile de Rousseau. Dans un discours plein d’émotion, le philosophe Favorinus conseillait aux mères de nourrir leurs enfants. « N’est-ce pas outrager la nature, leur disait-il, n’est-ce pas être mère à moitié que de rejeter son enfant loin de soi au moment même où l’on vient de lui donner le jour ? Convient-il de nourrir de son sang dans ses entrailles je ne sais quoi qu’on ne connaît pas, et de ne plus vouloir le nourrir de son lait quand on le voit vivant et que c’est un homme ! » Ces conseils ont été entendus, et nous voyons à la même époque des femmes se faire gloire dans leurs épitaphes d’avoir allaité leurs fils elles-mêmes (quae etiam filios suos propriis uberibus educavit). Quand l’enfant a grandi, on lui cherche un précepteur, et les lettres de Pline nous montrent le soin qu’on prend de le bien choisir. Ici encore la législation trahit et partage ces préoccupations générales. Les empereurs fondent des écoles publiques, et Antonin encourage les grandes villes à créer des chaires de médecine, de rhétorique et de grammaire.
UN ELAN DE BIENFAISANCE
On se souvient enfin de ce passage admirable dans lequel Juvénal rappelle aux hommes qu’ils sont frères et leur fait un devoir de s’entraider. Ces sentiments étaient ceux de tous les honnêtes gens. Ému du sort des pauvres et des périls que leurs misères font courir à la société, Trajan imagine son grand système de charité légale, ses institutions alimentaires, et il fonde sur elles l’espoir de la régénération de l’empire. Tous les grands seigneurs qui l’entourent se croient obligés de l’imiter, et il y a dans les rangs élevés de cette aristocratie comme un élan de bienfaisance dont la trace est restée dans les lettres de Pline et dans les inscriptions du IIe siècle. Les pauvres de leur côté s’entendent et s’unissent ; l’empire se couvre de sociétés d’artisans, d’affranchis, d’esclaves, dont les caisses, alimentées par les cotisations des associations par la générosité des riches, permettent aux misérables d’espérer quelques secours quand ils sont malades et un tombeau décent après leur mort. Trajan hésite d’abord à les autoriser : c’est un prince prudent, qui craint les coalitions et les troubles politiques ; il se décide pourtant à permettre celles « qui n’ont d’autre dessein que de soulager la misère des pauvres ». Après lui, les empereurs se montrent plus faciles ; Sévère se déclare ouvertement le protecteur de ces associations, et leur garantit la possession de leurs biens. M. de Rossi a démontré que le christianisme naissant a profité de leurs privilèges, qu’il s’en est servi pour posséder en paix ses oratoires et ses tombeaux, et qu’ainsi c’est sous la protection de la charité païenne qu’il a grandi. Ces faits sont incontestables ; ils ne permettent pas de nier le progrès qui, même dans les temps les plus tristes de l’empire, s’est accompli dans les mœurs publiques.
Cette époque, quand on l’étudie dans les satires de Juvénal, avec son mélange singulier de vertus et de fautes, de grandes théories et de petites passions, de morale délicate et de basses immoralités, nous fait songer malgré nous à la société française du siècle dernier. Alors aussi il arrivait « qu’on voyait le bien et qu’on faisait le mal », et la légèreté des mœurs s’unissait souvent à la sévérité des principes. Que de frivolité et de sérieux tout ensemble ! quels contrastes dans les propos des gens du monde entre l’élévation des idées et le cynisme des expressions ! Que de faiblesses, que de scandales dans ces réunions où l’on avait toujours à la bouche le nom de la vertu ! Chez ces grands écrivains, qui faisaient la leçon à leur siècle, quel désaccord entre la conduite et les doctrines !
REPARER LES INJUSTICES DES SIECLES PRECEDENTS
Et pourtant cette société qui nous semble quelquefois si futile et si corrompue était peut-être au fond plus morale par le sentiment qu’elle avait de la justice et du droit que celle qui l’a précédée et qu’on trouve si austère ; l’on peut dire en tout cas qu’elle a mieux fait les affaires de l’humanité. Il en est de même du monde romain au IIe siècle ; malgré des fautes et des crimes que nous ne voulons pas excuser, et à travers tous ces démentis que la pratique donnait quelquefois aux théories, il s’acheminait vers un état social meilleur. On songe alors à réparer de vieilles injustices que les siècles précédents n’avaient pas aperçues, on se préoccupe d’adoucir le sort de l’esclave, de relever la situation de la femme, de venir au secours des pauvres, de mieux élever les enfants. Le courant est si fort que les plus mauvais empereurs eux-mêmes n’y peuvent pas résister. Depuis Auguste jusqu’à Constantin, la législation devient tous les jours plus juste et plus humaine. Tibère, Néron, Domitien, font des lois excellentes et qui ont pris place dans les codes des princes chrétiens. Ne faut-il pas que le progrès moral soit une nécessité inévitable quand il s’accomplit par des instruments aussi indignes ? C’est ainsi que cette société, sous la conduite de la philosophie, s’était déjà engagée dans la route où l’entraîna plus tard le christianisme. Tous les témoignages prouvent qu’avec les Antonins elle était devenue plus morale et meilleure ; Juvénal lui-même, quoiqu’il semble d’abord contredire cette opinion, nous fournit les moyens de la justifier.
GASTON BOISSIER
Gaston Boissier
JUVENAL ET SON TEMPS
Les Mœurs romaines sous l’empire
Revue des Deux Mondes
Deuxième période
Tome 87
1870
Pages 141 à 174