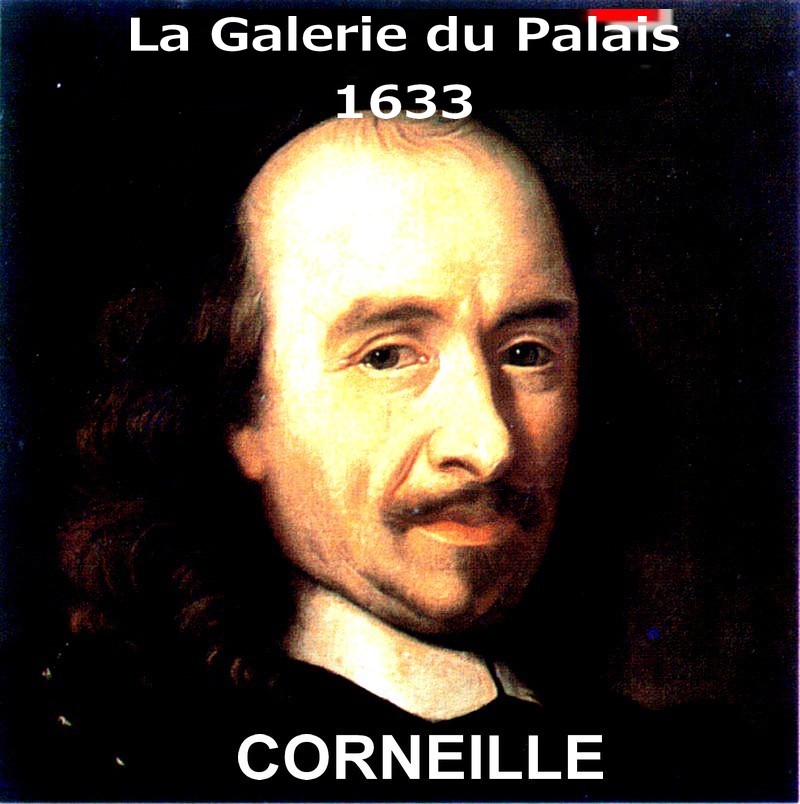Je sais bien que l’impression d’une pièce en affoiblit la réputation : la publier, c’est l’avilir ; et même il s’y rencontre un particulier désavantage pour moi, vu que ma façon d’écrire étant simple et familière, la lecture fera prendre mes naïvetés pour des bassesses. Aussi beaucoup de mes amis m’ont toujours conseillé de ne rien mettre sous la presse, et ont raison, comme je crois ; mais, par je ne sais quel malheur, c’est un conseil que reçoivent de tout le monde ceux qui écrivent, et pas un d’eux ne s’en sert. Ronsard, Malherbe et Théophile l’ont méprisé ; et si je ne les puis imiter en leurs grâces, je les veux du moins imiter en leurs fautes, si c’en est une que de faire imprimer. Je contenterai par là deux sortes de personnes, mes amis et mes envieux, donnant aux uns de quoi se divertir, aux autres de quoi censurer : et j’espère que les premiers me conserveront encore la même affection qu’ils m’ont témoignée par le passé ; que des derniers, si beaucoup font mieux, peu réussiront plus heureusement, et que le reste fera encore quelque sorte d’estime de cette pièce, soit par coutume de l’approuver, soit par honte de se dédire. En tout cas, elle est mon coup d’essai ; et d’autres que moi ont intérêt à la défendre, puisque, si elle n’est pas bonne, celles qui sont demeurées au-dessous doivent être fort mauvaises.
ARGUMENT
Éraste, amoureux de Mélite, l’a fait connoître à son ami Tircis, et devenu puis après jaloux de leur hantise, fait rendre des lettres d’amour supposées, de la part de Mélite, à Philandre, accordé de Cloris, sœur de Tircis. Philandre s’étant résolu, par l’artifice et les suasions d’Éraste, de quitter Cloris pour Mélite, montre ces lettres à Tircis. Ce pauvre amant en tombe en désespoir, et se retire chez Lisis, qui vient donner à Mélite de fausses alarmes de sa mort. Elle se pâme à cette nouvelle, et témoignant par là son affection, Lisis la désabuse, et fait revenir Tircis, qui l’épouse. Cependant Cliton ayant vu Mélite pâmée, la croit morte, et en porte la nouvelle à Éraste, aussi bien que de la mort de Tircis. Éraste, saisi de remords, entre en folie ; et remis en son bon sens par la nourrice de Mélite, dont il apprend qu’elle et Tircis sont vivants, il lui va demander pardon de sa fourbe et obtient de ces deux amants Cloris, qui ne vouloit plus de Philandre après sa légèreté.
*********************************
Mélite Corneille
********************
EXAMEN
Cette pièce fut mon coup d’essai, et elle n’a garde d’être dans les règles, puisque je ne savois pas alors qu’il y en eût. Je n’avois pour guide qu’un peu de sens commun, avec les exemples de feu Hardy, dont la veine étoit plus féconde que polie, et de quelques modernes qui commençoient à se produire, et qui n’étoient pas plus réguliers que lui. Le succès en fut surprenant : il établit une nouvelle troupe de comédiens à Paris, malgré le mérite de celle qui étoit en possession de s’y voir l’unique ; il égala tout ce qui s’étoit fait de plus beau jusqu’alors, et me fit connoître à la cour. Ce sens commun, qui étoit toute ma règle, m’avoit fait trouver l’unité d’action pour brouiller quatre amants par un seul intrique, et m’avoit donné assez d’aversion de cet horrible dérèglement qui mettoit Paris, Rome et Constantinople sur le même théâtre, pour réduire le mien dans une seule ville.
La nouveauté de ce genre de comédie, dont il n’y a point d’exemple en aucune langue, et le style naïf qui faisoit une peinture de la conversation des honnêtes gens, furent sans doute cause de ce bonheur surprenant, qui fit alors tant de bruit. On n’avoit jamais vu jusque-là que la comédie fît rire sans personnages ridicules, tels que les valets bouffons, les parasites, les capitans, les docteurs, etc. Celle-ci faisoit son effet par l’humeur enjouée de gens d’une condition au-dessus de ceux qu’on voit dans les comédies de Plaute et de Térence, qui n’étoient que des marchands. Avec tout cela, j’avoue que l’auditeur fut bien facile à donner son approbation à une pièce dont le nœud n’avoit aucune justesse. Éraste y fait contrefaire des lettres de Mélite, et les porter à Philandre. Ce Philandre est bien crédule de se persuader d’être aimé d’une personne qu’il n’a jamais entretenue, dont il ne connoît point l’écriture, et qui lui défend de l’aller voir, cependant qu’elle reçoit les visites d’un autre avec qui il doit avoir une amitié assez étroite, puisqu’il est accordé de sa sœur. Il fait plus : sur la légèreté d’une croyance si peu raisonnable, il renonce à une affection dont il étoit assuré, et qui étoit prête d’avoir son effet. Éraste n’est pas moins ridicule que lui, de s’imaginer que sa fourbe causera cette rupture, qui seroit toutefois inutile à son dessein, s’il ne savoit de certitude que Philandre, malgré le secret qu’il lui fait demander par Mélite dans ces fausses lettres, ne manquera pas à les montrer à Tircis ; que cet amant favorisé croira plutôt un caractère qu’il n’a jamais vu, que les assurances d’amour qu’il reçoit tous les jours de sa maîtresse ; et qu’il rompra avec elle sans lui parler, de peur de s’en éclaircir. Cette prétention d’Éraste ne pouvoit être supportable, à moins d’une révélation ; et Tircis, qui est l’honnête homme de la pièce, n’a pas l’esprit moins léger que les deux autres, de s’abandonner au désespoir par une même facilité de croyance, à la vue de ce caractère inconnu. Les sentiments de douleur qu’il en peut légitimement concevoir devroient du moins l’emporter à faire quelques reproches à celle dont il se croit trahi, et lui donner par là l’occasion de le désabuser. La folie d’Éraste n’est pas de meilleure trempe. Je la condamnois dès lors en mon âme ; mais comme c’étoit un ornement de théâtre qui ne manquoit jamais de plaire, et se faisoit souvent admirer, j’affectai volontiers ces grands égarements, et en tirai un effet que je tiendrois encore admirable en ce temps : c’est la manière dont Éraste fait connoître à Philandre, en le prenant pour Minos, la fourbe qu’il lui a faite, et l’erreur où il l’a jeté. Dans tout ce que j’ai fait depuis, je ne pense pas qu’il se rencontre rien de plus adroit pour un dénouement.
Tout le cinquième acte peut passer pour inutile. Tircis et Mélite se sont raccommodés avant qu’il commence, et par conséquent l’action est terminée. Il n’est plus question que de savoir qui a fait la supposition des lettres, et ils pouvoient Tavoir su de Cloris, à qui Philandre l’avoit dit pour se justifier. Il est vrai que cet acte retire Éraste de folie, qu’il le réconcilie avec les deux amants, et fait son mariage avec Cloris ; mais tout cela ne regarde plus qu’une action épisodique, qui ne doit pas amuser le théâtre quand la principale est finie ; et surtout ce mariage a si peu d’apparence, qu’il est aisé de voir qu’on ne le propose que pour satisfaire à la coutume de ce temps-là, qui étoit de marier tout ce qu’on introduisoit sur la scène. Il semble même que le personnage de Philandre, qui part avec un ressentiment ridicule, dont on ne craint pas l’effet, ne soit point achevé, et qu’il lui falloit quelque cousine de Mélite, ou quelque sœur d’Éraste, pour le réunir avec les autres. Mais dès lors je ne m’assujettissois pas tout à fait à cette mode, et je me contentai 11 de faire voir l’assiette de son esprit, sans prendre soin de le pourvoir d’une autre femme.
Quant à la durée de l’action, il est assez visible qu’elle passe l’unité de jour ; mais ce n’en est pas le seul défaut : il y a de plus une inégalité d’intervalle entre les actes, qu’il faut éviter. Il doit s’être passé huit ou quinze jours entre le premier et le second, et autant entre le second et le troisième ; mais du troisième au quatrième il n’est pas besoin de plus d’une heure, et il en faut encore moins entre les deux derniers, de peur de donner le temps de se ralentir à cette chaleur qui jette Éraste dans l’égarement d’esprit. Je ne sais même si les personnages qui paroissent deux fois dans un même acte (posé que cela soit permis, ce que j’examinerai ailleurs), je ne sais, dis-je, s’ils ont le loisir d’aller d’un quartier de la ville à l’autre, puisque ces quartiers doivent être si éloignés l’un de l’autre, que les acteurs ayent lieu de ne pas s’entreconnoître. Au premier acte, Tircis, après avoir quitté Mélite chez elle, n’a que le temps d’environ soixante vers pour aller chez lui, où il rencontre Philandre avec sa sœur, et n’en a guère davantage au second à refaire le même chemin. Je sais bien que la représentation raccourcit la durée de l’action, et qu’elle fait voir en deux heures, sans sortir de la règle, ce qui souvent a besoin d’un jour entier pour s’effectuer ; mais je voudrois que pour mettre les choses dans leur justesse, ce raccourcissement se ménageât dans les intervalles des actes, et que le temps qu’il faut perdre s’y perdît, en sorte que chaque acte n’en eût, pour la partie de l’action qu’il représente, que ce qu’il en faut pour sa représentation.
Ce coup d’essai a sans doute encore d’autres irrégularités ; mais je ne m’attache pas à les examiner si ponctuellement que je m’obstine à n’en vouloir oublier aucune. Je pense avoir marqué les plus notables ; et pour peu que le lecteur aye peu d’indulgence pour moi, j’espère qu’il ne s’offensera pas d’un peu de négligence pour le reste.
******************************
Mélite Corneille
***************
LES ACTEURS
ÉRASTE, amoureux de Mélite
TIRCIS, ami d’Éraste et son rival
PHILANDRE, amant de Cloris
MÉLITE, maîtresse d’Éraste et de Tircis
CLORIS, sœur de Tircis
LISIS, ami de Tircis
CLITON, voisin de Mélite
La Nourrice de Mélite
La scène est à Paris
****
ACTE I
SCÈNE PREMIÈRE
ÉRASTE, TIRCIS.
ÉRASTE.
Je te l’avoue, ami, mon mal est incurable ;
Je n’y sais qu’un remède, et j’en suis incapable :
Le change seroit juste, après tant de rigueur ;
Mais malgré ses dédains, Mélite a tout mon cœur ;
Elle a sur tous mes sens une entière puissance ;
Si j’ose en murmurer, ce n’est qu’en son absence,
Et je ménage en vain dans un éloignement
Un peu de liberté pour mon ressentiment :
D’un seul de ses regards l’adorable contrainte
Me rend tous mes liens, en resserre l’étreinte,
Et par un si doux charme aveugle ma raison,
Que je cherche mon mal et fuis ma guérison.
Son œil agit sur moi d’une vertu si forte,
Qu’il ranime soudain mon espérance morte,
Combat les déplaisirs de mon cœur irrité,
Et soutient mon amour contre sa cruauté ;
Mais ce flatteur espoir qu’il rejette en mon âme
N’est qu’un doux imposteur qu’autorise ma flamme,
Et qui sans m’assurer ce qu’il semble m’offrir,
Me fait plaire en ma peine, et m’obstine à souffrir.
TIRCIS.
Que je te trouve, ami, d’une humeur admirable !
Pour paroître éloquent tu te feins misérable :
Est-ce à dessein de voir avec quelles couleurs
Je saurois adoucir les traits de tes malheurs ?
Ne t’imagine pas qu’ainsi sur ta parole
D’une fausse douleur un ami te console :
Ce que chacun en dit ne m’a que trop appris
Que Mélite pour toi n’eut jamais de mépris.
ÉRASTE.
Son gracieux accueil et ma persévérance
Font naître ce faux bruit d’une vaine apparence :
Ses mépris sont cachés, et s’en font mieux sentir,
Et n’étant point connus, on n’y peut compatir.
TIRCIS.
En étant bien reçu, du reste que t’importe ?
C’est tout ce que tu veux des filles de sa sorte.
ÉRASTE.
Cet accès favorable, ouvert et libre à tous,
Ne me fait pas trouver mon martyre plus doux :
Elle souffre aisément mes soins et mon service ;
Mais loin de se résoudre à leur rendre justice,
Parler de l’hyménée à ce cœur de rocher,
C’est l’unique moyen de n’en plus approcher.
TIRCIS.
Ne dissimulons point : tu règles mieux ta flamme,
Et tu n’es pas si fou que d’en faire ta femme.
ÉRASTE.
Quoi ! tu sembles douter de mes intentions ?
TIRCIS.
Je crois malaisément que tes affections
Sur l’éclat d’un beau teint, qu’on voit si périssable,
Règlent d’une moitié le choix invariable.
Tu serois incivil de la voir chaque jour
Et ne lui pas tenir quelques propos d’amour ;
Mais d’un vain compliment ta passion bornée
Laisse aller tes desseins ailleurs pour l’hyménée.
Tu sais qu’on te souhaite aux plus riches maisons,
Que les meilleurs partis …
ÉRASTE.
Trêve de ces raisons ;
Mon amour s’en offense, et tiendroit pour supplice
De recevoir des lois d’une sale avarice ;
Il me rend insensible aux faux attraits de l’or,
Et trouve en sa personne un assez grand trésor.
TIRCIS.
Si c’est là le chemin qu’en aimant tu veux suivre,
Tu ne sais guère encor ce que c’est que de vivre.
Ces visages d’éclat sont bons à cajoler ;
C’est là qu’un apprentif doit s’instruire à parler ;
J’aime à remplir de feux ma bouche en leur présence ;
La mode nous oblige à cette complaisance ;
Tous ces discours de livre alors sont de saison :
Il faut feindre des maux, demander guérison,
Donner sur le phébus, promettre des miracles ;
Jurer qu’on brisera toute sorte d’obstacles ;
Mais du vent et cela doivent être tout un.
ÉRASTE.
Passe pour des beautés qui sont dans le commun :
C’est ainsi qu’autrefois j’amusai Crisolite ;
Mais c’est d’autre façon qu’on doit servir Mélite.
Malgré tes sentiments, il me faut accorder
Que le souverain bien n’est qu’à la posséder.
Le jour qu’elle naquit, Vénus, bien qu’immortelle,
Pensa mourir de honte en la voyant si belle ;
Les Grâces, à l’envi, descendirent des cieux,
Pour se donner l’honneur d’accompagner ses yeux ;
Et l’Amour, qui ne put entrer dans son courage,
Voulut obstinément loger sur son visage.
TIRCIS.
Tu le prends d’un haut ton, et je crois qu’au besoin
Ce discours emphatique iroit encor bien loin.
Pauvre amant, je te plains, qui ne sais pas encore
Que bien qu’une beauté mérite qu’on l’adore,
Pour en perdre le goût, on n’a qu’à l’épouser.
Un bien qui nous est dû se fait si peu priser,
Qu’une femme fût-elle entre toutes choisie,
On en voit en six mois passer la fantaisie.
Tel au bout de ce temps n’en voit plus la beauté
Qu’avec un esprit sombre, inquiet, agité ;
Au premier qui lui parle ou jette l’œil sur elle,
Mille sottes frayeurs lui brouillent la cervelle ;
Ce n’est plus lors qu’une aide à faire un favori,
Un charme pour tout autre, et non pour un mari.
ÉRASTE.
Ces caprices honteux et ces chimères vaines
Ne sauroient ébranler des cervelles bien saines,
Et quiconque a su prendre une fille d’honneur
N’a point à redouter l’appas d’un suborneur.
TIRCIS.
Peut-être dis-tu vrai ; mais ce choix difficile
Assez et trop souvent trompe le plus habile,
Et l’hymen de soi-même est un si lourd fardeau,
Qu’il faut l’appréhender à l’égal du tombeau.
S’attacher pour jamais aux côtés d’une femme !
Perdre pour des enfants le repos de son âme !
Voir leur nombre importun remplir une maison !
Ah ! qu’on aime ce joug avec peu de raison !
ÉRASTE.
Mais il y faut venir ; c’est en vain qu’on recule,
C’est en vain qu’on refuit, tôt ou tard on s’y brûle ;
Pour libertin qu’on soit, on s’y trouve attrapé :
Toi-même, qui fais tant le cheval échappé.
Nous te verrons un jour songer au mariage.
TIRCIS.
Alors ne pense pas que j’épouse un visage :
Je règle mes désirs suivant mon intérêt.
Si Doris me vouloit, toute laide qu’elle est,
Je l’estimerois plus qu’Aminte et qu’Hippolyte ;
Son revenu chez moi tiendrait lieu de mérite :
C’est comme il faut aimer. L’abondance des biens
Pour l’amour conjugal a de puissants liens :
La beauté, les attraits, l’esprit, la bonne mine,
Échauffent bien le cœur, mais non pas la cuisine ;
Et l’hymen qui succède à ces folles amours,
Après quelques douceurs, a bien de mauvais jours.
Une amitié si longue est fort mal assurée
Dessus des fondements de si peu de durée.
L’argent dans le ménage a certaine splendeur
Qui donne un teint d’éclat à la même laideur ;
Et tu ne peux trouver de si douces caresses
Dont le goût dure autant que celui des richesses.
ÉRASTE.
Auprès de ce bel œil qui tient mes sens ravis,
À peine pourrois-tu conserver ton avis.
TIRCIS.
La raison en tous lieux est également forte
ÉRASTE.
L’essai n’en coûte rien : Mélite est à sa porte ;
Allons, et tu verras dans ses aimables traits
Tant de charmants appas, tant de brillants attraits,
Que tu seras forcé toi-même à reconnoître
Que si je suis un fou, j’ai bien raison de l’être.
TIRCIS.
Allons, et tu verras que toute sa beauté
Ne saura me tourner contre la vérité.
******
ACTE I
Scène II
MÉLITE, ÉRASTE, TIRCIS.
ÉRASTE.
De deux amis, Madame, apaisez la querelle.
Un esclave d’Amour le défend d’un rebelle,
Si toutefois un cœur qui n’a jamais aimé,
Fier et vain qu’il en est, peut être ainsi nommé.
Comme dès le moment que je vous ai servie
J’ai cru qu’il étoit seul la véritable vie,
Il n’est pas merveilleux que ce peu de rapport
Entre nos deux esprits sème quelque discord.
Je me suis donc piqué contre sa médisance,
Avec tant de malheur ou tant d’insuffisance.
Que des droits si sacrés et si pleins d’équité.
N’ont pu se garantir de sa subtilité,
Et je l’amène ici, n’ayant plus que répondre,
Assuré que vos yeux le sauront mieux confondre.
MÉLITE.
Vous deviez l’assurer plutôt qu’il trouveroit
En ce mépris d’Amour qui le seconderoit.
TIRCIS.
Si le cœur ne dédit ce que la bouche exprime,
Et ne fait de l’amour une plus haute estime,
Je plains les malheureux à qui vous en donnez,
Comme à d’étranges maux par leur sort destinés.
MÉLITE.
Ce reproche sans cause avec raison m’étonne :
Je ne reçois d’amour et n’en donne à personne.
Les moyens de donner ce que je n’eus jamais ?
ÉRASTE.
Ils vous sont trop aisés, et par vous désormais
La nature pour moi montre son injustice
À pervertir son cours pour me faire un supplice.
MÉLITE.
Supplice imaginaire, et qui sent son moqueur.
ÉRASTE.
Supplice qui déchire et mon âme et mon cœur.
MÉLITE.
Il est rare qu’on porte avec si bon visage
L’âme et le cœur ensemble en si triste équipage.
ÉRASTE.
Votre charmant aspect suspendant mes douleurs,
Mon visage du vôtre emprunte les couleurs.
MÉLITE.
Faites mieux : pour finir vos maux et votre flamme,
Empruntez tout d’un temps les froideurs de mon âme.
ÉRASTE.
Vous voyant, les froideurs perdent tout leur pouvoir,
Et vous n’en conservez que faute de vous voir.
MÉLITE.
Et quoi ! tous les miroirs ont-ils de fausses glaces ?
ÉRASTE.
Penseriez-vous y voir la moindre de vos grâces ?
De si frêles sujets ne sauroient exprimer
Ce que l’amour aux cœurs peut lui seul imprimer,
Et quand vous en voudrez croire leur impuissance,
Cette légère idée et foible connoissance
Que vous aurez par eux de tant de raretés
Vous mettra hors du pair de toutes les beautés.
MÉLITE.
Voilà trop vous tenir dans une complaisance
Que vous dussiez quitter, du moins en ma présence,
Et ne démentir pas le rapport de vos yeux,
Afin d’avoir sujet de m’entreprendre mieux.
ÉRASTE.
Le rapport de mes yeux, aux dépens de mes larmes,
Ne m’a que trop appris le pouvoir de vos charmes.
TIRCIS.
Sur peine d’être ingrate, il faut de votre part
Reconnoître les dons que le ciel vous départ.
ÉRASTE.
Voyez que d’un second mon droit se fortifie.
MÉLITE.
Voyez que son secours montre qu’il s’en défie.
TIRCIS.
Je me range toujours avec la vérité.
MÉLITE.
Si vous la voulez suivre, elle est de mon côté.
TIRCIS.
Oui, sur votre visage, et non en vos paroles.
Mais cessez de chercher ces refuites frivoles,
Et prenant désormais des sentiments plus doux,
Ne soyez plus de glace à qui brûle pour vous.
MÉLITE.
Un ennemi d’Amour me tenir ce langage !
Accordez votre bouche avec votre courage ;
Pratiquez vos conseils, ou ne m’en donnez pas.
TIRCIS.
J’ai connu mon erreur auprès de vos appas :
Il vous l’avoit bien dit.
ÉRASTE.
Il vous l’avoit bien dit._Ainsi donc par l’issue
Mon âme sur ce point n’a point été déçue ?
TIRCIS.
Si tes feux en son cœur produisoient même effet,
Crois-moi que ton bonheur seroit bientôt parfait.
MÉLITE.
Pour voir si peu de chose aussitôt vous dédire
Me donne à vos dépens de beaux sujets de rire ;
Mais je pourrois bientôt, à m’entendre flatter,
Concevoir quelque orgueil qu’il vaut mieux éviter.
Excusez ma retraite.
ÉRASTE.
Excusez ma retraite._Adieu, belle inhumaine.
De qui seule dépend et ma joie et ma peine.
MÉLITE.
Plus sage à l’avenir, quittez ces vains propos,
Et laissez votre esprit et le mien en repos.
****
ACTE I
Scène III
ÉRASTE, TIRCIS.
ÉRASTE.
Maintenant suis-je un fou ? mérité- je du blâme ?
Que dis-tu de l’objet? que dis-tu de ma flamme?
TIRCIS.
Que veux-tu que j’en die ? elle a je ne sais quoi
Qui ne peut consentir que l’on demeure à soi.
Mon cœur, jusqu’à présent à l’amour invincible.
Ne se maintient qu’à force aux termes d’insensible ;
Tout autre que Tircis mourroit pour la servir.
ÉRASTE.
Confesse franchement qu’elle a su te ravir,
Mais que tu ne veux pas prendre pour cette belle
Avec le nom d’amant le titre d’infidèle.
Rien que notre amitié ne t’en peut détourner ;
Mais ta muse du moins, facile à suborner,
Avec plaisir déjà prépare quelques veilles
À de puissants efforts pour de telles merveilles.
TIRCIS.
En effet ayant vu tant et de tels appas,
Que je ne rime point, je ne le promets pas.
ÉRASTE.
Tes feux n’iront-ils point plus avant que la rime ?
TIRCIS.
Si je brûle jamais, je veux brûler sans crime.
ÉRASTE.
Mais si sans y penser tu te trouvois surpris ?
TIRCIS.
Quitte pour décharger mon creur dans mes écrits.
J’aime bien ces discours de plaintes et d’alarmes,
De soupirs, de sanglots, de tourments et de larmes :
C’est de quoi fort souvent je bâtis ma chanson ;
Mais j’en connois, sans plus, la cadence et le son.
Souffre qu’en un sonnet je m’efforce à dépeindre
Cet agréable feu que tu ne peux éteindre ;
Tu le pourras donner comme venant de toi.
ÉRASTE.
Ainsi ce cœur d’acier qui me tient sous sa loi
Verra ma passion pour le moins en peinture.
Je doute néanmoins qu’en cette portraiture
Tu ne suives plutôt tes propres sentiments.
TIRCIS.
Me prépare le ciel de nouveaux châtiments,
Si jamais un tel crime entre dans mon courage !
ÉRASTE.
Adieu, je suis content, j’ai ta parole en gage,
Et sais trop que l’honneur t’en fera souvenir.
TIRCIS, seul.
En matière d’amour rien n’oblige à tenir,
Et les meilleurs amis, lorsque son feu les presse.
Font bientôt vanité d’oublier leur promesse.
******
ACTE I
Scène IV
PHILANDRE, CLORIS.
PHILANDRE.
Je meure, mon souci, tu dois bien me haïr :
Tous mes soins depuis peu ne vont qu’à te trahir.
CLORIS.
Ne m’épouvante point : à ta mine, je pense
Que le pardon suivra de fort près cette offense,
Sitôt que j’aurai su quel est ce mauvais tour.
PHILANDRE.
Sache donc qu’il ne vient sinon de trop d’amour.
CLORIS.
J’eusse osé le gager qu’ainsi par quelque ruse
Ton crime officieux porteroit son excuse.
PHILANDRE.
Ton adorable objet, mon unique vainqueur,
Fait naître chaque jour tant de feux en mon cœur,
Que leur excès m’accable, et que pour m’en défaire
J’y cherche des défauts qui puissent me déplaire.
J’examine ton teint dont l’éclat me surprit,
Les traits de ton visage, et ceux de ton esprit ;
Mais je n’en puis trouver un seul qui ne me charme.
CLORIS.
Et moi, je suis ravie, après ce peu d’alarme.
Qu’ainsi tes sens trompés te puissent obliger
À chérir ta Cloris, et jamais ne changer.
PHILANDRE.
Ta beauté te répond de ma persévérance,
Et ma foi qui t’en donne une entière assurance.
CLORIS.
Voilà fort doucement dire que sans ta foi
Ma beauté ne pourroit te conserver à moi.
PHILANDRE.
Je traiterois trop mal une telle maîtresse
De l’aimer seulement pour tenir ma promesse :
Ma passion en est la cause, et non l’effet ;
Outre que tu n’as rien qui ne soit si parfait,
Qu’on ne peut te servir sans voir sur ton visage
De quoi rendre constant l’esprit le plus volage.
CLORIS.
Ne m’en conte point tant de ma perfection :
Tu dois être assuré de mon affection,
Et tu perds tout l’effort de ta galanterie,
Si tu crois l’augmenter par une flatterie.
Une fausse louange est un blâme secret :
Je suis belle à tes yeux ; il suffit, sois discret ;
C’est mon plus grand bonheur, et le seul où j’aspire.
PHILANDRE.
Tu sais adroitement adoucir mon martyre ;
Mais parmi les plaisirs qu’avec toi je ressens,
À peine mon esprit ose croire mes sens.
Toujours entre la crainte et l’espoir en balance
Car s’il faut que l’amour naisse de ressemblance,
Mes imperfections nous éloignant si fort,
Qu’oserois-je prétendre en ce peu de rapport ?
CLORIS.
Du moins ne prétends pas qu’à présent je te loue,
Et qu’un mépris rusé, que ton cœur désavoue,
Me mette sur la langue un babil affété,
Pour te rendre à mon tour ce que tu m’as prêté :
Au contraire, je veux que tout le monde sache
Que je connois en toi des défauts que je cache.
Quiconque avec raison peut être négligé
À qui le veut aimer est bien plus obligé.
PHILANDRE.
Quant à toi, tu te crois de beaucoup plus aimable ?
CLORIS.
Sans doute ; et qu’aurois-tu qui me fût comparable ?
PHILANDRE.
Regarde dans mes yeux, et reconnois qu’en moi
On peut voir quelque chose aussi parfait que toi.
CLORIS.
C’est sans difficulté, m’y voyant exprimée.
PHILANDRE.
Quitte ce vain orgueil dont ta vue est charmée.
Tu n’y vois que mon cœur, qui n’a plus un seul trait
Que ceux qu’il a reçus de ton charmant portrait,
Et qui tout aussitôt que tu t’es fait paroître,
Afin de te mieux voir s’est mis à la fenêtre.
CLORIS.
Le trait n’est pas mauvais ; mais puisqu’il te plaît tant.
Regarde dans mes yeux, ils t’en montrent autant,
Et nos feux tous pareils ont mêmes étincelles.
PHILANDRE.
Ainsi, chère Cloris, nos ardeurs mutuelles,
Dedans cette union prenant un même cours,
Nous préparent un heur qui durera toujours.
Cependant, en faveur de ma longue souffrance …
CLORIS.
Tais-toi, mon frère vient.
*******
ACTE I
Scène V
TIRCIS, PHILANDRE, CLORIS.
TIRCIS.
Tais-toi, mon frère vient._Si j’en crois l’apparence,
Mon arrivée ici fait quelque contre-temps.
PHILANDRE.
Que t’en semble, Tircis ?
TIRCIS.
Que t’en semble, Tircis ?_Je vous vois si contents,
Qu’à ne vous rien celer touchant ce qu’il me semble
Du divertissement que vous preniez ensemble,
De moins sorciers que moi pourroient bien deviner
Qu’un troisième ne fait que vous importuner.
CLORIS.
Dis ce que tu voudras ; nos feux n’ont point de crimes,
Et pour t’appréhender ils sont trop légitimes,
Puisqu’un hymen sacré, promis ces jours passés.
Sous ton consentement les autorise assez.
TIRCIS.
Ou je te connois mal, ou son heure tardive
Te désoblige fort de ce qu’elle n’arrive.
CLORIS.
Ta belle humeur te tient, mon frère.
TIRCIS.
Ta belle humeur te tient, mon frère._Assurément.
CLORIS.
Le sujet ?
TIRCIS.
Le sujet ?_J’en ai trop dans ton contentement.
CLORIS.
Le cœur t’en dit d’ailleurs.
TIRCIS.
Le cœur t’en dit d’ailleurs_._Il est vrai, je te jure ;
J’ai vu je ne sais quoi…
CLORIS.
J’ai vu je ne sais quoi…_Dis tout, je t’en conjure.
TIRCIS.
Ma foi, si ton Philandre avoit vu de mes yeux,
Tes affaires, ma sœur, n’en iroient guère mieux.
CLORIS.
J’ai trop de vanité pour croire que Philandre
Trouve encore après moi qui puisse le surprendre.
TIRCIS.
Tes vanités à part, repose-t’en sur moi.
Que celle que j’ai vue est bien autre que toi.
PHILANDRE.
Parle mieux de l’objet dont mon âme est ravie ;
Ce blasphème à tout autre auroit coûté la vie.
TIRCIS.
Nous tomberons d’accord sans nous mettre en pourpoint.
CLORIS.
Encor, cette beauté, ne la nomme-ton point ?
TIRCIS.
Non pas sitôt. Adieu : ma présence importune
Te laisse à la merci d’Amour et de la brune.
Continuez les jeux que vous avez quittés.
CLORIS.
Ne crois pas éviter mes importunités :
Ou tu diras le nom de cette incomparable,
Ou je vais de tes pas me rendre inséparable.
TIRCIS.
Il n’est pas fort aisé d’arracher ce secret.
Adieu : ne perds point temps.
CLORIS.
Adieu : ne perds point temps._Ô l’amoureux discret !
Eh bien ! nous allons voir si tu sauras te taire.
PHILANDRE.
(Il retient Cloris, qui suit son frère.)
C’est donc ainsi qu’on quitte un amant pour un frère !
CLORIS.
Philandre, avoir un peu de curiosité,
Ce n’est pas envers toi grande infidélité :
Souffre que je dérobe un moment à ma flamme,
Pour lire malgré lui jusqu’au fond de son âme.
Nous en rirons après ensemble, si tu veux.
PHILANDRE.
Quoi ! c’est là tout l’état que tu fais de mes feux ?
CLORIS.
Je ne t’aime pas moins pour être curieuse ?
Et ta flamme à mon cœur n’est pas moins précieuse.
Conserve-moi le tien, et sois sûr de ma foi.
PHILANDRE.
Ah, folle ! qu’en t’aimant il faut souffrir de toi !
*******
ACTE II
SCÈNE PREMIÈRE
ÉRASTE
Je l’avois bien prévu, que ce cœur infidèle
Ne se défendroit point des yeux de ma cruelle,
Qui traite mille amants avec mille mépris,
Et n’a point de faveurs que pour le dernier pris.
Sitôt qu’il l’aborda, je lus sur son visage
De sa déloyauté l’infaillible présage ;
Un inconnu frisson dans mon corps épandu
Me donna les avis de ce que j’ai perdu
Depuis, cette volage évite ma rencontre,
Ou si malgré ses soins le hasard me la montre,
Si je puis l’aborder, son discours se confond,
Son esprit en désordre à peine me répond ;
Une réflexion vers le traître qu’elle aime
Presque à tous les moments le ramène en lui-même ;
Et tout rêveur qu’il est, il n’a point de soucis
Qu’un soupir ne trahisse au seul nom de Tircis.
Lors, par le prompt effet d’un changement étrange,
Son silence rompu se déborde en louange.
Elle remarque en lui tant de perfections,
Que les moins éclairés verroient ses passions.
Sa bouche ne se plaît qu’en cette flatterie,
Et tout autre propos lui rend sa rêverie.
Cependant chaque jour au discours attachés,
Ils ne retiennent plus leurs sentiments cachés :
Ils ont des rendez-vous où l’amour les assemble ;
Encore hier sur le soir je les surpris ensemble ;
Encor tout de nouveau je la vois qui l’attend.
Que cet œil assuré marque un esprit content !
Perds tout respect, Éraste, et tout soin de lui plaire ;
Rends, sans plus différer, ta vengeance exemplaire ;
Mais il vaut mieux t’en rire, et pour dernier effort
Lui montrer en raillant combien elle a de tort.
******
ACTE II
Scène II
ÉRASTE, MÉLITE.
ÉRASTE.
Quoi ! seule et sans Tircis ! vraiment c’est un prodige,
Et ce nouvel amant déjà trop vous néglige,
Laissant ainsi couler la belle occasion
De vous conter l’excès de son affection.
MÉLITE.
Vous savez que son âme en est fort dépourvue.
ÉRASTE.
Toutefois, ce dit-on, depuis qu’il vous a vue,
Il en porte dans l’âme un si doux souvenir,
Qu’il n’a plus de plaisirs qu’à vous entretenir.
MÉLITE.
Il a lieu de s’y plaire avec quelque justice :
L’amour ainsi qu’à lui me paroît un supplice ;
Et sa froideur, qu’augmente un si lourd entretien,
Le résout d’autant mieux à n’aimer jamais rien.
ÉRASTE.
Dites : à n’aimer rien que la belle Mélite.
MÉLITE.
Pour tant de vanité j’ai trop peu de mérite.
ÉRASTE.
En faut-il tant avoir pour ce nouveau venu ?
MÉLITE.
Un peu plus que pour vous.
ÉRASTE.
Un peu plus que pour vous._De vrai, j’ai reconnu,
Vous ayant pu servir deux ans, et davantage,
Qu’il faut si peu que rien à toucher mon courage.
MÉLITE.
Encor si peu que c’est vous étant refusé,
Présumez comme ailleurs vous serez méprisé.
ÉRASTE.
Vos mépris ne sont pas de grande conséquence,
Et ne vaudront jamais la peine que j’y pense ;
Sachant qu’il vous voyoit, je m’étois bien douté
Que je ne serois plus que fort mal écouté.
MÉLITE.
Sans que mes actions de plus près j’examine,
À la meilleure humeur je fais meilleure mine,
Et s’il m’osoit tenir de semblables discours,
Nous romprions ensemble avant qu’il fût deux jours.
ÉRASTE.
Si chaque objet nouveau de même vous engage,
Il changera bientôt d’humeur et de langage.
Caressé maintenant aussitôt qu’aperçu,
Qu’auroit-il à se plaindre, étant si bien reçu ?
MÉLITE.
Éraste, voyez-vous, trêve de jalousie ;
Purgez votre cerveau de cette frénésie ;
Laissez en liberté mes inclinations.
Qui vous a fait censeur de mes affections ?
Est-ce à votre chagrin que j’en dois rendre conte ?
ÉRASTE.
Non, mais j’ai malgré moi pour vous un peu de honte
De ce qu’on dit partout du trop de privauté
Que déjà vous souffrez à sa témérité.
MÉLITE.
Ne soyez en souci que de ce qui vous touche.
ÉRASTE.
Le moyen, sans regret, de vous voir si farouche
Aux légitimes vœux de tant de gens d’honneur,
Et d’ailleurs si facile à ceux d’un suborneur ?
MÉLITE.
Ce n’est pas contre lui qu’il faut en ma présence
Lâcher les traits jaloux de votre médisance.
Adieu : souvenez-vous que ces mots insensés
L’avanceront chez moi plus que vous ne pensez.
********
ACTE II
Scène III
ÉRASTE.
C’est là donc ce qu’enfin me gardoit ton caprice ?
C’est ce que j’ai gagné par deux ans de service ?
C’est ainsi que mon feu s’étant trop abaissé
D’un outrageux mépris se voit récompensé ?
Tu m’oses préférer un traître qui te flatte ;
Mais dans ta lâcheté ne crois pas que j’éclate,
Et que par la grandeur de mes ressentiments
Je laisse aller au jour celle de mes tourments.
Un aveu si public qu’en feroit ma colère
Enfleroit trop l’orgueil de ton âme légère
Et me convaincroit trop de ce désir abjet
Qui m’a fait soupirer pour un indigne objet.
Je saurai me venger, mais avec l’apparence
De n’avoir pour tous deux que de l’indifférence.
Il fut toujours permis de tirer sa raison
D’une infidélité par une trahison.
Tiens, déloyal ami, tiens ton âme assurée
Que ton heur surprenant aura peu de durée,
Et que par une adresse égale à tes forfaits
Je mettrai le désordre où tu crois voir la paix.
L’esprit fourbe et vénal d’un voisin de Mélite
Donnera prompte issue à ce que je médite.
À servir qui l’achète il est toujours tout prêt,
Et ne voit rien d’injuste où brille l’intérêt.
Allons sans perdre temps lui payer ma vengeance,
Et la pistole en main presser sa diligence.
******
ACTE II
Scène IV
TIRCIS, CLORIS.
TIRCIS.
Ma sœur, un mot d’avis sur un méchant sonnet
Que je viens de brouiller dedans mon cabinet.
CLORIS.
C’est à quelque beauté que ta muse l’adresse ?
TIRCIS.
En faveur d’un ami je flatte sa maîtresse.
Vois si tu le connois, et si, parlant pour lui,
J’ai su m’accommoder aux passions d’autrui.
SONNET.
Après l’œil de Mélite il n’est rien d’admirable…
CLORIS.
Ah ! frère, il n’en faut plus.
TIRCIS.
Ah ! frère, il n’en faut plus._Tu n’es pas supportable
De me rompre sitôt.
CLORIS.
De me rompre sitôt._C’étoit sans y penser ;
Achève.
TIRCIS.
Achève_Tais-toi donc, je vais recommencer.
SONNET.
Après l’œil de Mélite il n’est rien d’admirable ;
Il n’est rien de solide après ma loyauté.
Mon feu, comme son teint, se rend incomparable,
Et je suis en amour ce qu’elle est en beauté.
Quoi que puisse à mes sens offrir la nouveauté,
Mon cœur à tous ses traits demeure invulnérable,
Et bien qu’elle ait au sien la même cruauté.
Ma foi pour ses rigueurs n’en est pas moins durable.
C’est donc avec raison que mon extrême ardeur
Trouve chez cette belle une extrême froideur,
Et que sans être aimé je brûle pour Mélite ;
Car de ce que les Dieux, nous envoyant au jour,
Donnèrent pour nous deux d’amour et de mérite,
Elle a tout le mérite, et moi j’ai tout l’amour.
CLORIS.
Tu l’as fait pour Éraste ?
TIRCIS.
Tu l’as fait pour Éraste ?_Oui, j’ai dépeint sa flamme,
CLORIS.
Comme tu la ressens peut-être dans ton âme ?
TIRCIS.
Tu sais mieux qui je suis, et que ma libre humeur
N’a de part en mes vers que celle de rimeur.
CLORIS.
Pauvre frère, vois-tu, ton silence t’abuse ;
De la langue ou des yeux, n’importe qui t’accuse :
Les tiens m’avoient bien dit malgré toi que ton cœur
Soupiroit sous les lois de quelque objet vainqueur ;
Mais j’ignorois encor qui tenoit ta franchise,
Et le nom de Mélite a causé ma surprise,
Sitôt qu’au premier vers ton sonnet m’a fait voir
Ce que depuis huit jours je brûlois de savoir.
TIRCIS.
Tu crois donc que j’en tiens ?
CLORIS.
Tu crois donc que j’en tiens ?_Fort avant.
TIRCIS.
Tu crois donc que j’en tiens ? Fort avant._Pour Mélite ?
CLORIS.
Pour Mélite, et de plus que ta flamme n’excite
Au cœur de cette belle aucun embrasement.
TIRCIS.
Qui t’en a tant appris ? mon sonnet ?
CLORIS.
Qui t’en a tant appris ? mon sonnet ?_Justement.
TIRCIS.
Et c’est ce qui te trompe avec tes conjectures,
Et par où ta finesse a mal pris ses mesures.
Un visage jamais ne m’auroit arrêté,
S’il falloit que l’amour fût tout de mon côté.
Ma rime seulement est un portrait fidèle
De ce qu’Éraste souffre en servant cette belle ;
Mais quand je l’entretiens de mon affection,
J’en ai toujours assez de satisfaction.
CLORIS.
Montre, si tu dis vrai, quelque peu plus de joie,
Et rends-toi moins rêveur, afin que je te croie.
TIRCIS.
Je rêve, et mon esprit ne s’en peut exempter ;
Car sitôt que je viens à me représenter
Qu’une vieille amitié de mon amour s’irrite,
Qu’Éraste s’en offense et s’oppose à Mélite,
Tantôt je suis ami, tantôt je suis rival,
Et toujours balancé d’un contre-poids égal,
J’ai honte de me voir insensible ou perfide :
Si l’amour m’enhardit, l’amitié m’intimide.
Entre ces mouvements mon esprit partagé
Ne sait duquel des deux il doit prendre congé.
CLORIS.
Voilà bien des détours pour dire, au bout du conte,
Que c’est contre ton gré que l’amour te surmonte.
Tu présumes par là me le persuader ;
Mais ce n’est pas ainsi qu’on m’en donne à garder.
À la mode du temps, quand nous servons quelque autre,
C’est seulement alors qu’il n’y va rien du nôtre.
Chacun en son affaire est son meilleur ami,
Et tout autre intérêt ne touche qu’à demi.
TIRCIS.
Que du foudre à tes yeux j’éprouve la furie,
Si rien que ce rival cause ma rêverie !
CLORIS.
C’est donc assurément son bien qui t’est suspect :
Son bien te fait rêver, et non pas son respect,
Et toute amitié bas, tu crains que sa richesse
En dépit de tes feux n’obtienne ta maîtresse.
TIRCIS.
Tu devines, ma sœur : cela me fait mourir.
CLORIS.
Ce sont vaines frayeurs dont je veux te guérir.
Depuis quand ton Éraste en tient-il pour Mélite ?
TIRCIS.
Il rend depuis deux ans hommage à son mérite.
CLORIS.
Mais dit-il les grands mots ? parle-t-il d’épouser ?
TIRCIS.
Presque à chaque moment.
CLORIS.
Presque à chaque moment._Laisse-le donc jaser.
Ce malheureux amant ne vaut pas qu’on le craigne ;
Quelque riche qu’il soit, Mélite le dédaigne :
Puisqu’on voit sans effet deux ans d’affection,
Tu ne dois plus douter de son aversion ;
Le temps ne la rendra que plus grande et plus forte.
On prend soudain au mot les hommes de sa sorte,
Et sans rien hasarder à la moindre longueur,
On leur donne la main dès qu’ils offrent le cœur.
TIRCIS.
Sa mère peut agir de puissance absolue.
CLORIS.
Crois que déjà l’affaire en seroit résolue,
Et qu’il auroit déjà de quoi se contenter,
Si sa mère étoit femme à la violenter.
TIRCIS.
Ma crainte diminue et ma douleur s’apaise ;
Mais si je t’abandonne, excuse mon trop d’aise.
Avec cette lumière et ma dextérité,
J’en veux aller savoir toute la vérité.
Adieu.
CLORIS.
Adieu._Moi, je m’en vais paisiblement attendre
Le retour désiré du paresseux Philandre.
Un moment de froideur lui fera souvenir
Qu’il faut une autre fois tarder moins à venir.
********
ACTE II
Scène V
ÉRASTE, CLITON.
ÉRASTE, lui donnant une lettre.
Va-t’en chercher Philandre, et dis-lui que Mélite
A dedans ce billet sa passion décrite ;
Dis-lui que sa pudeur ne sauroit plus cacher
Un feu qui la consume et qu’elle tient si cher.
Mais prends garde surtout à bien jouer ton rôle :
Remarque sa couleur, son maintien, sa parole ;
Vois si dans la lecture un peu d’émotion
Ne te montrera rien de son intention.
CLITON.
Cela vaut fait, Monsieur.
ÉRASTE.
Cela vaut fait, Monsieur._Mais après ce message
Sache avec tant d’adresse ébranler son courage,
Que tu viennes à bout de sa fidélité.
CLITON.
Monsieur, reposez-vous sur ma subtilité ;
Il faudra malgré lui qu’il donne dans le piége :
Ma tête sur ce point vous servira de plége ;
Mais aussi vous savez…
ÉRASTE.
Mais aussi vous savez…_Oui, va, sois diligent.
Ces âmes du commun n’ont pour but que l’argent ;
Et je n’ai que trop vu par mon expérience…
Mais tu reviens bientôt ?
CLITON.
Mais tu reviens bientôt__?_Donnez-vous patience,
Monsieur; il ne nous faut qu’un moment de loisir,
Et vous pourrez vous-même en avoir le plaisir.
ÉRASTE.
Comment ?
CLITON.
Comment ?_De ce carfour j’ai vu venir Philandre.
Cachez-vous en ce coin, et de là sachez prendre
L’occasion commode à seconder mes coups :
Par là nous le tenons. Le voici ; sauvez-vous.
*********
ACTE II
Scène VI
PHILANDRE, ÉRASTE, CLITON.
PHILANDRE.
(Éraste est caché et les écoute.)
Quelle réception me fera ma maîtresse ?
Le moyen d’excuser une telle paresse ?
CLITON.
Monsieur, tout à propos je vous rencontre ici,
Expressément chargé de vous rendre ceci.
PHILANDRE.
Qu’est-ce ?
CLITON.
Qu’est-ce ?_Vous allez voir, en lisant cette lettre,
Ce qu’un homme jamais n’oseroit se promettre ;
Ouvrez-la seulement.
PHILANDRE.
Ouvrez-la seulement._Va, tu n’es qu’un conteur.
CLITON.
Je veux mourir au cas qu’on me trouve menteur.
lettre supposée de mélite à philandre.
Malgré le devoir et la bienséance du sexe, celle-ci m’échappe en faveur de vos mérites, pour vous apprendre que c’est Mélite qui vous écrit, et qui vous aime. Si elle est assez heureuse pour recevoir de vous une réciproque affection, contentez-vous de cet entretien par lettres, jusques à ce quelle ait 144 ôté de l’esprit de sa mère quelques personnes qui n’y sont que trop bien pour son contentement.
ÉRASTE, feignant d’avoir lu la lettre par-dessus son épaule.
C’est donc la vérité que la belle Mélite
Fait du brave Philandre une louable élite,
Et qu’il obtient ainsi de sa seule vertu
Ce qu’Éraste et Tircis ont en vain débattu !
Vraiment dans un tel choix mon regret diminue ;
Outre qu’une froideur depuis peu survenue,
De tant de vœux perdus ayant su me lasser,
N’attendoit qu’un prétexte à m’en débarrasser.
PHILANDRE.
Me dis-tu que Tircis brûle pour cette belle ?
ÉRASTE.
Il en meurt.
PHILANDRE.
Il en meurt._Ce courage à l’amour si rebelle ?
ÉRASTE.
Lui-même.
PHILANDRE.
Lui-même._Si ton cœur ne tient plus qu’à demi,
Tu peux le retirer en faveur d’un ami ;
Sinon, pour mon regard ne cesse de prétendre :
Étant pris une fois, je ne suis plus à prendre.
Tout ce que je puis faire à ce beau feu naissant,
C’est de m’en revancher par un zèle impuissant ;
Et ma Cloris la prie, afin de s’en distraire,
De tourner, s’il se peut, sa flamme vers son frère.
ÉRASTE.
Auprès de sa beauté qu’est-ce que ta Cloris ?
PHILANDRE.
Un peu plus de respect pour ce que je chéris.
ÉRASTE.
Je veux qu’elle ait en soi quelque chose d’aimable ;
Mais enfin à Mélite est-elle comparable ?
PHILANDRE.
Qu’elle le soit ou non, je n’examine pas
Si des deux l’une ou l’autre a plus ou moins d’appas.
J’aime l’une ; et mon cœur pour toute autre insensible …
ÉRASTE.
Avise toutefois, le prétexte est plausible.
PHILANDRE.
J’en serois mal voulu des hommes et des Dieux.
ÉRASTE.
On pardonne aisément à qui trouve son mieux.
PHILANDRE.
Mais en quoi gît ce mieux ?
ÉRASTE.
Mais en quoi gît ce mieux ?_En esprit, en richesse.
PHILANDRE.
Ô le honteux motif à changer de maîtresse !
ÉRASTE.
En amour.
PHILANDRE.
En amour._Cloris m’aime, et si je m’y connoi,
Rien ne peut égaler celui qu’elle a pour moi.
ÉRASTE.
Tu te détromperas, si tu veux prendre garde
À ce qu’à ton sujet l’une et l’autre hasarde.
L’une en t’aimant s’expose au péril d’un mépris :
L’autre ne t’aime point que tu n’en sois épris ;
L’une t’aime engagé vers une autre moins belle :
L’autre se rend sensible à qui n’aime rien qu’elle ;
L’une au desçu des siens te montre son ardeur,
Et l’autre après leur choix quitte un peu sa froideur ;
L’une…
PHILANDRE.
L’une…_Adieu : des raisons de si peu d’importance
Ne pourroient en un siècle ébranler ma constance.
(Il dit ce vers à Cliton tout bas.)
Dans deux heures d’ici tu viendras me revoir.
CLITON.
Disposez librement de mon petit pouvoir.
ÉRASTE,
seul
Il a beau déguiser, il a goûté l’amorce ;
Cloris déjà sur lui n’a presque plus de force :
Ainsi je suis deux fois vengé du ravisseur,
Ruinant tout ensemble et le frère et la sœur.
******
ACTE II
Scène VII
TIRCIS, ÉRASTE, MÉLITE.
TIRCIS.
Éraste, arrête un peu.
ÉRASTE.
Éraste, arrête un peu._Que me veux- tu ?
TIRCIS.
Éraste, arrête un peu. Que me veux- tu ?_Te rendre
Ce sonnet que pour toi j’ai promis d’entreprendre.
MÉLITE, au travers d’une jalousie, cependant qu’Éraste
lit le sonnet.
Que font-ils là tous deux ? qu’ont-ils à démêler ?
Ce jaloux à la fin le pourra quereller :
Du moins les compliments, dont peut-être ils se jouent,
Sont des civilités qu’en l’âme ils désavouent.
TIRCIS.
J’y donne une raison de ton sort inhumain.
Allons, je le veux voir présenter de ta main
À ce charmant objet dont ton âme est blessée.
ÉRASTE, lui rendant son sonnet.
Une autre fois, Tircis ; quelque affaire pressée
Fait que je ne saurois pour l’heure m’en charger.
Tu trouveras ailleurs un meilleur messager.
TIRCIS, seul.
La belle humeur de l’homme ! Ô Dieux, quel personnage !
Quel ami j’avois fait de ce plaisant visage !
Une mine froncée, un regard de travers,
C’est le remercîment que j’aurai de mes vers.
Je manque, à mon avis, d’assurance ou d’adresse,
Pour les donner moi-même à sa jeune maîtresse,
Et prendre ainsi le temps de dire à sa beauté
L’empire que ses yeux ont sur ma liberté.
Je pense l’entrevoir par cette jalousie :
Oui, mon âme de joie en est toute saisie.
Hélas ! et le moyen de pouvoir lui parler,
Si mon premier aspect l’oblige à s’en aller ?
Que cette joie est courte, et qu’elle est cher vendue !
Toutefois tout va bien, la voilà descendue.
Ses regards pleins de feu s’entendent avec moi ;
Que dis-je ? en s’avançant elle m’appelle à soi.
******
ACTE II
Scène VIII
TIRCIS, MÉLITE.
MÉLITE.
Eh bien ! qu’avez-vous fait de votre compagnie ?
TIRCIS.
Je ne puis rien juger de ce qui l’a bannie :
À peine ai-je eu loisir de lui dire deux mots,
Qu’aussitôt le fantasque, en me tournant le dos,
S’est échappé de moi.
MÉLITE.
S’est échappé de moi._Sans doute il m’aura vue,
Et c’est de là que vient cette fuite imprévue.
TIRCIS.
Vous aimant comme il fait, qui l’eût jamais pensé ?
MÉLITE.
Vous ne savez donc rien de ce qui s’est passé ?
TIRCIS.
J’aimerois beaucoup mieux savoir ce qui se passe,
Et la part qu’a Tircis en votre bonne grâce.
MÉLITE.
Meilleure aucunement qu’Éraste ne voudroit.
Je n’ai jamais connu d’amant si maladroit ;
Il ne sauroit souffrir qu’autre que lui m’approche.
Dieux ! qu’à votre sujet il m’a fait de reproche !
Vous ne sauriez me voir sans le désobliger.
TIRCIS.
Et de tous mes soucis c’est là le plus léger.
Toute une légion de rivaux de sa sorte
Ne divertiroit pas l’amour que je vous porte,
Qui ne craindra jamais les humeurs d’un jaloux.
MÉLITE.
Aussi le croit-il bien, ou je me trompe.
TIRCIS.
Aussi le croit-il bien, ou je me trompe._Et vous ?
MÉLITE.
Bien que cette croyance à quelque erreur m’expose,
Pour lui faire dépit, j’en croirai quelque chose.
TIRCIS.
Mais afin qu’il reçût un entier déplaisir,
Il faudroit que nos cœurs n’eussent plus qu’un désir,
Et quitter ces discours de volontés sujettes,
Qui ne sont point de mise en l’état où vous êtes.
Vous-même consultez un moment vos appas,
Songez à leurs effets, et ne présumez pas
Avoir sur tous les cœurs un pouvoir si suprême,
Sans qu’il vous soit permis d’en user sur vous-même.
Un si digne sujet ne reçoit point de loi,
De règle, ni d’avis, d’un autre que de soi.
MÉLITE.
Ton mérite, plus fort que ta raison flatteuse,
Me rend, je le confesse, un peu moins scrupuleuse.
Je dois tout à ma mère, et pour tout autre amant
Je voudrois tout remettre à son commandement ;
Mais attendre pour toi l’effet de sa puissance,
Sans te rien témoigner que par obéissance,
Tircis, ce seroit trop : tes rares qualités
Dispensent mon devoir de ces formalités.
TIRCIS.
Que d’amour et de joie un tel aveu me donne !
MÉLITE.
C’est peut-être en trop dire, et me montrer trop bonne ;
Mais par là tu peux voir que mon affection
Prend confiance entière en ta discrétion.
TIRCIS.
Vous la verrez toujours, dans un respect sincère,
Attacher mon bonheur à celui de vous plaire,
N’avoir point d’autre soin, n’avoir point d’autre esprit ;
Et si vous en voulez un serment par écrit,
Ce sonnet que pour vous vient de tracer ma flamme
Vous fera voir à nu jusqu’au fond de mon âme.
MÉLITE.
.
Garde bien ton sonnet, et pense qu’aujourd’hui
Mélite veut te croire autant et plus que lui.
Je le prends toutefois comme un précieux gage
Du pouvoir que mes yeux ont pris sur ton courage.
Adieu : sois-moi fidèle en dépit du jaloux.
TIRCIS.
Ô ciel ! jamais amant eut-il un sort plus doux ?
******
ACTE III
Scène Première
PHILANDRE.
Tu l’as gagné, Mélite ; il ne m’est pas possible
D’être à tant de faveurs plus longtemps insensible.
Tes lettres où sans fard tu dépeins ton esprit,
Tes lettres où ton cœur est si bien par écrit,
Ont charmé tous mes sens par leurs douces promesses.
Leur attente vaut mieux, Cloris, que tes caresses.
Ah ! Mélite, pardon ! je t’offense à nommer
Celle qui m’empêcha si longtemps de t’aimer.
Souvenirs importuns d’une amante laissée,
Qui venez malgré moi remettre en ma pensée
Un portrait que j’en veux tellement effacer
Que le sommeil ait peine à me le retracer,
Hâtez-vous de sortir sans plus troubler ma joie,
Et retournant trouver celle qui vous envoie,
Dites-lui de ma part pour la dernière fois
Qu’elle est en liberté de faire un autre choix ;
Que ma fidélité n’entretient plus ma flamme,
Ou que s’il m’en demeure encore un peu dans l’âme,
Je souhaite en faveur de ce reste de foi
Qu’elle puisse gagner au change autant que moi.
Dites-lui que Mélite, ainsi qu’une Déesse,
Est de tous nos désirs souveraine maîtresse,
Dispose de nos cœurs, force nos volontés,
Et que par son pouvoir nos destins surmontés
Se tiennent trop heureux de prendre l’ordre d’elle ;
Enfin que tous mes vœux…
ACTE III
Scène II
TIRCIS, PHILANDRE.
TIRCIS.
Enfin que tous mes vœux…_Philandre !
PHILANDRE.
Enfin que tous mes vœux… Philandre !_Qui m’appelle ?
TIRCIS.
Tircis, dont le bonheur au plus haut point monté
Ne peut être parfait sans te l’avoir conté.
PHILANDRE.
Tu me fais trop d’honneur par cette confidence.
TIRCIS.
J’userois envers toi d’une sotte prudence.
Si je faisois dessein de te dissimuler
Ce qu’aussi bien mes yeux ne sauroient te celer.
PHILANDRE.
En effet, si l’on peut te juger au visage,
Si l’on peut par tes yeux lire dans ton courage,
Ce qu’ils montrent de joie à tel point me surprend,
Que je n’en puis trouver de sujet assez grand :
Rien n’atteint, ce me semble, aux signes qu’ils en donnent.
TIRCIS.
Que fera le sujet, si les signes t’étonnent ?
Mon bonheur est plus grand qu’on ne peut soupçonner ;
C’est quand tu l’auras su qu’il faudra t’étonner.
PHILANDRE.
Je ne le saurai pas sans marque plus expresse.
TIRCIS.
Possesseur, autant vaut…
PHILANDRE.
Possesseur, autant vaut…_De quoi ?
TIRCIS.
Possesseur, autant vaut… De quoi ?_D’une maîtresse.
Belle, honnête, jolie, et dont l’esprit charmant
De son seul entretien peut ravir un amant :
En un mot, de Mélite.
PHILANDRE.
En un mot, de Mélite._Il est vrai qu’elle est belle ;
Tu n’as pas mal choisi ; mais…
TIRCIS.
Tu n’as pas mal choisi ; mais…_Quoi, mais ?
PHILANDRE.
Tu n’as pas mal choisi ; mais… Quoi, mais ?_T’aime-t-elle ?
TIRCIS.
Cela n’est plus en doute.
PHILANDRE.
Cela n’est plus en doute._Et de cœur ?
TIRCIS.
Cela n’est plus en doute. Et de cœur ?_Et de cœur,
Je t’en réponds.
PHILANDRE.
Je t’en réponds._Souvent un visage moqueur
N’a que le beau semblant d’une mine hypocrite.
TIRCIS.
Je ne crains rien de tel du côté de Mélite.
PHILANDRE.
Écoute, j’en ai vu de toutes les façons :
J’en ai vu qui sembloient n’être que des glaçons,
Dont le feu, retenu par une adroite feinte,
S’allumoit d’autant plus qu’il souffroit de contrainte ;
J’en ai vu, mais beaucoup, qui sous le faux appas
Des preuves d’un amour qui ne les touchoit pas,
Prenoient du passe-temps d’une folle jeunesse
Qui se laisse affiner à ces traits de souplesse,
Et pratiquoient sous main d’autres affections ;
Mais j’en ai vu fort peu de qui les passions
Fussent d’intelligence avec tout le visage.
TIRCIS.
Et de ce petit nombre est celle qui m’engage :
De sa possession je me tiens aussi seur
Que tu te peux tenir de celle de ma sœur.
PHILANDRE.
Donc, si ton espérance à la lin n’est déçue.
Ces deux amours auront une pareille issue.
TIRCIS.
Si cela n’arrivoit, je me tromperois fort.
PHILANDRE.
Pour te faire plaisir j’en veux être d’accord.
Cependant apprends-moi comment elle te traite,
Et qui te fait juger son ardeur si parfaite.
TIRCIS.
Une parfaite ardeur a trop de truchements
Par qui se faire entendre aux esprits des amants :
Un coup d’œil, un soupir…
PHILANDRE.
Un coup d’œil, un soupir…_Ces faveurs ridicules
Ne servent qu’à duper des âmes trop crédules.
N’as-tu rien que cela ?
TIRCIS.
N’as-tu rien que cela ?_Sa parole et sa foi.
PHILANDRE.
Encor c’est quelque chose. Achève et conte-moi
Les petites douceurs, les aimables tendresses
Qu’elle se plaît à joindre à de telles promesses.
Quelques lettres du moins te daignent confirmer
Ce vœu qu’entre tes mains elle a fait de t’aimer ?
TIRCIS.
Recherche qui voudra ces menus badinages,
Qui n’en sont pas toujours de fort sûrs témoignages ;
Je n’ai que sa parole, et ne veux que sa foi.
PHILANDRE.
Je connois donc quelqu’un plus avancé que toi.
TIRCIS.
J’entends qui tu veux dire, et pour ne te rien feindre.
Ce rival est bien moins à redouter qu’à plaindre.
Éraste, qu’ont banni ses dédains rigoureux…
PHILANDRE.
Je parle de quelque autre un peu moins malheureux.
TIRCIS.
Je ne connois que lui qui soupire pour elle.
PHILANDRE.
Je ne te tiendrai point plus longtemps en cervelle :
Pendant qu’elle t’amuse avec ses beaux discours,
Un rival inconnu possède ses amours,
Et la dissimulée, au mépris de ta flamme,
Par lettres chaque jour lui fait don de son âme.
TIRCIS.
De telles trahisons lui sont trop en horreur.
PHILANDRE.
Je te veux par pitié tirer de cette erreur.
Tantôt, sans y penser, j’ai trouvé cette lettre ;
Tiens, vois ce que tu peux désormais t’en promettre.
lettre supposée de mélite à philandre.
Je commence à m’estimer quelque chose, puisque je vous plais ; et mon miroir m’offense tous les jours, ne me représentant pas assez belle, comme je m’imagine qu’il faut être pour mériter votre affection. Aussi je veux bien que vous sachiez que Mélite ne croit la posséder que par faveur, ou comme une récompense extraordinaire d’un excès d’amour, dont elle tâche de suppléer au défaut des grâces que le ciel lui a refusées.
PHILANDRE.
Maintenant qu’en dis-tu? n’est-ce pas t’affronter ?
TIRCIS.
Cette lettre en tes mains ne peut m’épouvanter.
PHILANDRE.
La raison ?
TIRCIS.
La raison ?_Le porteur a su combien je t’aime,
Et par galanterie il t’a pris pour moi-même,
Comme aussi ce n’est qu’un de deux parfaits amis.
PHILANDRE.
Voilà bien te flatter plus qu’il ne t’est permis,
Et pour ton intérêt aimer à te méprendre.
TIRCIS.
On t’en aura donné quelque autre pour me rendre,
Afin qu’encore un coup je sois ainsi déçu.
PHILANDRE.
Oui, j’ai quelque billet que tantôt j’ai reçu,
Et puisqu’il est pour toi…
TIRCIS.
Et puisqu’il est pour toi…_Que ta longueur me tue !
Dépêche.
PHILANDRE.
Dépêche._Le voilà que je te restitue.
autre lettre supposée de mélite à philandre.
Vous n’avez plus affaire qu’à Tircis ; je le souffre encore, afin que par sa hantise je remarque plus exactement ses défauts et les fasse mieux goûter à ma mère. Après cela Philandre et Mélite auront tout loisir de rire ensemble des belles imaginations dont le frère et la sœur ont repu leurs espérances.
PHILANDRE.
Te voilà tout rêveur, cher ami ; par ta foi,
Crois-tu que ce billet s’adresse encore à toi ?
TIRCIS.
Traître ! c’est donc ainsi que ma sœur méprisée
Sert à ton changement d’un sujet de risée ?
C’est ainsi qu’à sa foi Mélite osant manquer,
D’un parjure si noir ne fait que se moquer ?
C’est ainsi que sans honte à mes yeux tu subornes
Un amour qui pour moi devoit être sans bornes ?
Suis-moi tout de ce pas, que l’épée à la main
Un si cruel affront se répare soudain :
Il faut que pour tous deux ta tête me réponde.
PHILANDRE.
Si pour te voir trompé tu te déplais au monde,
Cherche en ce désespoir qui t’en veuille arracher ;
Quant à moi, ton trépas me coûteroit trop cher.
TIRCIS.
Quoi ! tu crains le duel ?
PHILANDRE.
Quoi ! tu crains le duel ?_Non ; mais j’en crains la suite,
Où la mort du vaincu met le vainqueur en fuite,
Et du plus beau succès le dangereux éclat
Nous fait perdre l’objet et le prix du combat.
TIRCIS.
Tant de raisonnement et si peu de courage
Sont de tes lâchetés le digne témoignage.
Viens, ou dis que ton sang n’oseroit s’exposer.
PHILANDRE.
Mon sang n’est plus à moi ; je n’en puis disposer.
Mais puisque ta douleur de mes raisons s’irrite,
J’en prendrai dès ce soir le congé de Mélite.
Adieu.
ACTE III
Scène III
TIRCIS
Adieu._Tu fuis, perfide, et ta légèreté,
T’ayant fait criminel, te met en sûreté !
Reviens, reviens défendre une place usurpée :
Celle qui te chérit vaut bien un coup d’épée.
Fais voir que l’infidèle, en se donnant à toi,
A fait choix d’un amant qui valoit mieux que moi ;
Soutiens son jugement, et sauve ainsi de blâme
Celle qui pour la tienne a négligé ma flamme.
Crois-tu qu’on la mérite à force de courir ?
Peux-tu m’abandonner ses faveurs sans mourir ?
Ô lettres, ô faveurs indignement placées,
À ma discrétion honteusement laissées !
Ô gages qu’il néglige ainsi que superflus !
Je ne sais qui de nous vous diffamez le plus ;
Je ne sais qui des trois doit rougir davantage ;
Car vous nous apprenez qu’elle est une volage,
Son amant un parjure, et moi sans jugement,
De n’avoir rien prévu de leur déguisement.
Mais il le falloit bien, que cette âme infidèle,
Changeant d’affection, prît un traître comme elle,
Et que le digne amant qu’elle a su rechercher
À sa déloyauté n’eût rien à reprocher.
Cependant j’en croyois cette fausse apparence
Dont elle repaissoit ma frivole espérance ;
J’en croyois ses regards, qui tous remplis d’amour,
Étoient de la partie en un si lâche tour.
Ô ciel ! vit-on jamais tant de supercherie,
Que tout l’extérieur ne fût que tromperie ?
Non, non, il n’en est rien : une telle beauté
Ne fut jamais sujette à la déloyauté.
Foibles et seuls témoins du malheur qui me touche,
Vous êtes trop hardis de démentir sa bouche.
Mélite me chérit, elle me l’a juré :
Son oracle reçu, je m’en tiens assuré.
Que dites-vous là contre ? êtes-vous plus croyables ?
Caractères trompeurs, vous me contez des fables,
Vous voulez me trahir ; mais vos efforts sont vains :
Sa parole a laissé son cœur entre mes mains.
À ce doux souvenir ma flamme se rallume ;
Je ne sais plus qui croire ou d’elle ou de sa plume :
L’un et l’autre en effet n’ont rien que de léger ;
Mais du plus ou du moins je n’en puis que juger.
Loin, loin, doutes flatteurs que mon feu me suggère !
Je vois trop clairement qu’elle est la plus légère ;
La foi que j’en reçus s’en est allée en l’air.
Et ces traits de sa plume osent encor parler,
Et laissent en mes mains une honteuse image,
Où son cœur peint au vif remplit le mien de rage.
Oui, j’enrage, je meurs, et tous mes sens troublés
D’un excès de douleur se trouvent accablés ;
Un si cruel tourment me gêne et me déchire,
Que je ne puis plus vivre avec un tel martyre :
Mais cachons-en la honte, et nous donnons du moins
Ce faux soulagement, en mourant sans témoins,
Que mon trépas secret empêche l’infidèle
D’avoir la vanité que je sois mort pour elle.
ACTE III
Scène IV
TIRCIS, CLORIS.
CLORIS.
Mon frère, en ma faveur retourne sur tes pas.
Dis-moi la vérité : tu ne me cherchois pas ?
Eh quoi ! tu fais semblant de ne me pas connoître ?
Dieux ! en quel état te vois-je ici paroitre !
Tu pâlis tout à coup, et tes louches regards
S’élancent incertains presque de toutes parts !
Tu manques à la fois de couleur et d’haleine !
Ton pied mal affermi ne te soutient qu’à peine !
Quel accident nouveau te trouble ainsi les sens ?
TIRCIS.
Puisque tu veux savoir le mal que je ressens,
Avant que d’assouvir l’inexorable envie
De mon sort rigoureux qui demande ma vie,
Je vais l’assassiner d’un fatal entretien,
Et te dire en deux mots mon malheur et le tien.
En nos chastes amours de tous deux on se moque :
Philandre… Ah ! la douleur m’étouffe et me suffoque.
Adieu, ma sœur, adieu ; je ne puis plus parler :
Lis, et si tu le peux, tâche à te consoler.
CLORIS.
Ne m’échappe donc pas.
TIRCIS.
Ne m’échappe donc pas._Ma sœur, je te supplie…
CLORIS.
Quoi ! que je t’abandonne à ta mélancolie ?
Voyons auparavant ce qui te fait mourir,
Et nous aviserons à te laisser courir.
TIRCIS.
Hélas ! quelle injustice !
CLORIS, après avoir lu les lettres qu’il lui a données.
Hélas ! quelle injustice !_Est-ce là tout, fantasque ?
Quoi ! si la déloyale enfin lève le masque,
Oses-tu te fâcher d’être désabusé ?
Apprends qu’il le faut être en amour plus rusé ;
Apprends que les discours des filles bien sensées
Découvrent rarement le fond de leurs pensées,
Et que les yeux aidant à ce déguisement,
Notre sexe a le don de tromper finement.
Apprends aussi de moi que ta raison s’égare,
Que Mélite n’est pas une pièce si rare,
Qu’elle soit seule ici qui vaille la servir ;
Assez d’autres objets y sauront te ravir.
Ne t’inquiète point pour une écervelée
Qui n’a d’ambition que d’être cajolée,
Et rend à plaindre ceux qui flattant ses beautés
Ont assez de malheur pour en être écoutés.
Damon lui plut jadis, Aristandre, et Géronte ;
Éraste après deux ans n’y voit pas mieux son conte ;
Elle t’a trouvé bon seulement pour huit jours ;
Philandre est aujourd’hui l’objet de ses amours,
Et peut-être déjà (tant elle aime le change !)
Quelque autre nouveauté le supplante et nous venge.
Ce n’est qu’une coquette avec tous ses attraits ;
Sa langue avec son cœur ne s’accorde jamais ;
Les infidélités font ses jeux ordinaires ;
Et ses plus doux appas sont tellement vulgaires,
Qu’en elle homme d’esprit n’admira jamais rien
Que le sujet pourquoi tu lui voulois du bien.
TIRCIS.
Penses-tu m’arrêter par ce torrent d’injures ?
Que ce soient vérités, que ce soient impostures,
Tu redoubles mes maux, au lieu de les guérir.
Adieu : rien que la mort ne peut me secourir.
ACTE III
Scène V
CLORIS.
Mon frère… Il s’est sauvé ; son désespoir l’emporte :
Me préserve le ciel d’en user de la sorte !
Un volage me quitte, et je le quitte aussi :
Je l’obligerois trop de m’en mettre en souci.
Pour perdre des amants, celles qui s’en affligent
Donnent trop d’avantage à ceux qui les négligent ;
Il n’est lors que la joie : elle nous venge mieux,
Et la fît-on à faux éclater par les yeux,
C’est montrer par bravade à leur vaine inconstance
Qu’elle est pour nous toucher de trop peu d’importance.
Que Philandre à son gré rende ses vœux contents ;
S’il attend que j’en pleure, il attendra longtemps.
Son cœur est un trésor dont j’aime qu’il dispose ;
Le larcin qu’il m’en fait me vole peu de chose,
Et l’amour qui pour lui m’éprit si follement
M’avoit fait bonne part de son aveuglement.
On enchérit pourtant sur ma faute passée :
Dans la même folie une autre embarrassée
Le rend encor parjure, et sans âme, et sans foi,
Pour se donner l’honneur de faillir après moi.
Je meure, s’il n’est vrai que la moitié du monde
Sur l’exemple d’autrui se conduit et se fonde.
À cause qu’il parut quelque temps m’enflammer,
La pauvre fille a cru qu’il valoit bien l’aimer,
Et sur cette croyance elle en a pris envie :
Lui pût-elle durer jusqu’au bout de sa vie !
Si Mélite a failli me l’ayant débauché,
Dieux, par là seulement punissez son péché !
Elle verra bientôt que sa digne conquête
N’est pas une aventure à me rompre la tête.
Un si plaisant malheur m’en console à l’instant.
Ah! si mon fou de frère en pouvoit faire autant,
Que j’en aurois de joie, et que j’en ferois gloire !
Si je puis le rejoindre et qu’il me veuille croire,
Nous leur ferons bien voir que leur change indiscret
Ne vaut pas un soupir, ne vaut pas un regret.
Je me veux toutefois en venger par malice,
Me divertir une heure à m’en faire justice :
Ces lettres fourniront assez d’occasion
D’un peu de défiance et de division.
Si je prends bien mon temps, j’aurai pleine matière
À les jouer tous deux d’une belle manière.
En voici déjà l’un qui craint de m’aborder.
ACTE III
Scène VI
PHILANDRE, CLORIS.
CLORIS.
Quoi, tu passes, Philandre, et sans me regarder ?
PHILANDRE.
Pardonne-moi, de grâce : une affaire importune
M’empêche de jouir de ma bonne fortune,
Et son empressement, qui porte ailleurs mes pas,
Me remplissoit l’esprit jusqu’à ne te voir pas.
CLORIS.
J’ai donc souvent le don d’aimer plus qu’on ne m’aime :
Je ne pense qu’à toi, j’en parlois en moi-même.
PHILANDRE.
Me veux-tu quelque chose ?
CLORIS.
Me veux-tu quelque chose ?_Il t’ennuie avec moi ;
Mais comme de tes feux j’ai pour garant ta foi,
Je ne m’alarme point. N’étoit ce qui le presse,
Ta flamme un peu plus loin eût porté la tendresse,
Et je t’aurois fait voir quelques vers de Tircis
Pour le charmant objet de ses nouveaux soucis.
Je viens de les surprendre, et j’y pourrois encore
Joindre quelques billets de l’objet qu’il adore ;
Mais tu n’as pas le temps. Toutefois, si tu veux
Perdre un domi-quart d’heure à les lire nous deux…
PHILANDRE.
Voyons donc ce que c’est, sans plus longue demeure ;
Ma curiosité pour ce demi-quart d’heure
S’osera dispenser.
CLORIS.
S’osera dispenser._Aussi tu me promets,
Quand tu les auras lus, de n’en parler jamais ;
Autrement, ne crois pas…
PHILANDRE,
reconnoissant les lettres.
Autrement, ne crois pas…_Cela s’en va sans dire :
Donne, donne-les-moi, tu ne les saurois lire :
Et nous aurions ainsi besoin de trop de temps.
CLORIS,
les resserrant.
Philandre, tu n’es pas encore où tu prétends ;
Quelques hautes faveurs que ton mérite obtienne,
Elles sont aussi bien en ma main qu’en la tienne :
Je les garderai mieux, tu peux en assurer
La belle qui pour toi daigne se parjurer.
PHILANDRE.
Un homme doit souffrir d’une fille en colère ;
Mais je sais comme il faut les ravoir de ton frère :
Tout exprès je le cherche, et son sang, ou le mien…
CLORIS.
Quoi ! Philandre est vaillant, et je n’en savois rien !
Tes coups sont dangereux quand tu ne veux pas feindre ;
Mais ils ont le bonheur de se faire peu craindre,
Et mon frère, qui sait comme il s’en faut guérir,
Quand tu l’aurois tué, pourroit n’en pas mourir.
PHILANDRE.
L’effet en fera foi, s’il en a le courage.
Adieu : j’en perds le temps à parler davantage.
Tremble.
CLORIS.
Tremble. J’en ai grand lieu, connoissant ta vertu :
Pourvu qu’il y consente, il sera bien battu.
ACTE IV
Scène Première
MÉLITE, La Nourrice.
LA NOURRICE.
Cette obstination à faire la secrète
M’accuse injustement d’être trop peu discrète.
MÉLITE.
Ton importunité n’est pas à supporter :
Ce que je ne sais point, te le puis-je conter ?
LA NOURRICE.
Les visites d’Éraste un peu moins assidues
Témoignent quelque ennui de ses peines perdues,
Et ce qu’on voit par là de refroidissement
Ne fait que trop juger son mécontentement.
Tu m’en veux cependant cacher tout le mystère ;
Mais je pourrois enfin en croire ma colère,
Et pour punition te priver des avis
Qu’a jusqu’ici ton cœur si doucement suivis.
MÉLITE.
C’est à moi de trembler après cette menace,
Et tout autre du moins trembleroit en ma place.
LA NOURRICE.
Ne raillons point : le fruit qui t’en est demeuré
(Je parle sans reproche, et tout considéré)
Vaut bien… Mais revenons à notre humeur chagrine :
Apprends-moi ce que c’est.
MÉLITE.
Apprends-moi ce que c’est._Veux-tu que je devine ?
Dégoûté d’un esprit si grossier que le mien,
Il cherche ailleurs peut-être un meilleur entretien.
LA NOURRICE.
Ce n’est pas bien ainsi qu’un amant perd l’envie
D’une chose deux ans ardemment poursuivie :
D’assurance un mépris l’oblige à se piquer ;
Mais ce n’est pas un trait qu’il faille pratiquer.
Une fille qui voit et que voit la jeunesse
Ne s’y doit gouverner qu’avec beaucoup d’adresse ;
Le dédain lui messied, ou quand elle s’en sert,
Que ce soit pour reprendre un amant qu’elle perd.
Une heure de froideur, à propos ménagée,
Peut rembraser une âme à demi dégagée,
Qu’un traitement trop doux dispense à des mépris
D’un bien dont cet orgueil fait mieux savoir le prix.
Hors ce cas, il lui faut complaire à tout le monde,
Faire qu’aux vœux de tous l’apparence réponde,
Et sans embarrasser son cœur de leurs amours,
Leur faire bonne mine, et souffrir leurs discours.
Qu’à part ils pensent tous avoir la préférence,
Et paroissent ensemble entrer en concurrence ;
Que tout l’extérieur de son visage égal
Ne rende aucun jaloux du bonheur d’un rival ;
Que ses yeux partagés leur donnent de quoi craindre,
Sans donner à pas un aucun lieu de se plaindre ;
Qu’ils vivent tous d’espoir jusqu’au choix d’un mari,
Mais qu’aucun cependant ne soit le plus chéri,
Et qu’elle cède enfin, puisqu’il faut qu’elle cède,
A qui paiera le mieux le bien qu’elle possède.
Si tu n’eusses jamais quitté cette leçon,
Ton Éraste avec toi vivroit d’autre façon.
MÉLITE.
Ce n’est pas son humeur de souffrir ce partage :
Il croit que mes regards soient son propre héritage,
Et prend ceux que je donne à tout autre qu’à lui
Pour autant de larcins faits sur le bien d’autrui.
LA NOURRICE.
J’entends à demi-mot ; achève, et m’expédie
Promptement le motif de cette maladie.
MÉLITE.
Si tu m’avois, Nourrice, entendue à demi,
Tu saurois que Tircis…
LA NOURRICE.
Tu saurois que Tircis…_Quoi ? son meilleur ami !
N’a-ce pas été lui qui te l’a fait connoître ?
MÉLITE.
Il voudroit que le jour en fût encore à naître ;
Et si d’auprès de moi je l’avois écarté,
Tu verrois tout à l’heure Éraste à mon côté.
LA NOURRICE.
J’ai regret que tu sois leur pomme de discorde ;
Mais puisque leur humeur ensemble ne s’accorde,
Éraste n’est pas homme à laisser échapper ;
Un semblable pigeon ne se peut rattraper :
Il a deux fois le bien de l’autre, et davantage.
MÉLITE.
Le bien ne touche point un généreux courage.
LA NOURRICE.
Tout le monde l’adore, et tâche d’en jouir.
MÉLITE.
Il suit un faux éclat qui ne peut m’éblouir.
LA NOURRICE.
Auprès de sa splendeur toute autre est fort petite.
MÉLITE.
Tu le places au rang qui n’est dû qu’au mérite.
LA NOURRICE.
On a trop de mérite étant riche à ce point.
MÉLITE.
Les biens en donnent-ils à ceux qui n’en ont point ?
LA NOURRICE.
Oui, ce n’est que par là qu’on est considérable.
MÉLITE.
Mais ce n’est que par là qu’on devient méprisable :
Un homme dont les biens font toutes les vertus
Ne peut être estimé que des cœurs abattus.
LA NOURRICE.
Est-il quelques défauts que les biens ne réparent ?
MÉLITE.
Mais plutôt en est-il où les biens ne préparent ?
Étant riche, on méprise assez communément
Des belles qualités le solide ornement,
Et d’un luxe honteux la richesse suivie
Souvent par l’abondance aux vices nous convie.
LA NOURRICE.
Enfin je reconnois…
MÉLITE.
Enfin je reconnois…_Qu’avec tout ce grand bien
Un jaloux sur mon cœur n’obtiendra jamais rien.
LA NOURRICE.
Et que d’un cajoleur la nouvelle conquête
T’imprime, à mon regret, ces erreurs dans la tête.
Si ta mère le sait…
MÉLITE.
Si ta mère le sait…_Laisse-moi ces soucis,
Et rentre, que je parle à la sœur de Tircis.
LA NOURRICE.
Peut-être elle t’en veut dire quelque nouvelle.
MÉLITE.
Ta curiosité te met trop en cervelle.
Rentre sans t’informer de ce qu’elle prétend ;
Un meilleur entretien avec elle m’attend.
ACTE IV
Scène II
CLORIS, MÉLITE.
CLORIS.
Je chéris tellement celles de votre sorte,
Et prends tant d’intérêt en ce qui leur importe,
Qu’aux pièces qu’on leur fait je ne puis consentir,
Ni même en rien savoir sans les en avertir.
Ainsi donc, au hasard d’être la mal venue,
Encor que je vous sois, peu s’en faut, inconnue,
Je viens vous faire voir que votre affection
N’a pas été fort juste en son élection.
MÉLITE.
Vous pourriez, sous couleur de rendre un bon office,
Mettre quelque autre en peine avec cet artifice ;
Mais pour m’en repentir j’ai fait un trop bon choix :
Je renonce à choisir une seconde fois,
Et mon affection ne s’est point arrêtée
Que chez un cavalier qui l’a trop méritée.
CLORIS.
Vous me pardonnerez, j’en ai de bons témoins,
C’est l’homme qui de tous la mérite le moins.
MÉLITE.
Si je n’avois de lui qu’une foible assurance,
Vous me feriez entrer en quelque défiance ;
Mais je m’étonne fort que vous l’osiez blâmer,
Ayant quelque intérêt vous-même à l’estimer.
CLORIS.
Je l’estimai jadis, et je l’aime et l’estime
Plus que je ne faisois auparavant son crime.
Ce n’est qu’en ma faveur qu’il ose vous trahir,
Et vous pouvez juger si je le puis haïr,
Lorsque sa trahison m’est un clair témoignage
Du pouvoir absolu que j’ai sur son courage.
MÉLITE.
Le pousser à me faire une infidélité,
C’est assez mal user de cette autorité.
CLORIS.
Me le faut-il pousser où son devoir l’oblige ?
C’est son devoir qu’il suit alors qu’il vous néglige.
MÉLITE.
Quoi ! le devoir chez vous oblige aux trahisons ?
CLORIS.
Quand il n’en auroit point de plus justes raisons,
La parole donnée, il faut que l’on la tienne.
MÉLITE.
Cela fait contre vous : il m’a donné la sienne.
CLORIS.
Oui ; mais ayant déjà reçu mon amitié,
Sur un vœu solennel d’être un jour sa moitié,
Peut-il s’en départir pour accepter la vôtre ?
MÉLITE.
De grâce, excusez-moi, je vous prends pour une autre,
Et c’étoit à Cloris que je croyois parler.
CLORIS.
Vous ne vous trompez pas.
MÉLITE.
Vous ne vous trompez pas._Donc, pour mieux me railler,
La sœur de mon amant contrefait ma rivale ?
CLORIS.
Donc, pour mieux m’éblouir, une âme déloyale
Contrefait la fidèle ? Ah ! Mélite, sachez
Que je ne sais que trop ce que vous me cachez.
Philandre m’a tout dit : vous pensez qu’il vous aime ;
Mais sortant d’avec vous, il me conte lui-même
Jusqu’aux moindres discours dont votre passion
Tâche de suborner son inclination.
MÉLITE.
Moi, suborner Philandre ! ah ! que m’osez-vous dire !
CLORIS.
La pure vérité.
MÉLITE.
La pure vérité._Vraiment, en voulant rire,
Vous passez trop avant ; brisons là, s’il vous plaît.
Je ne vois point Philandre, et ne sais quel il est.
CLORIS.
Vous en croirez du moins votre propre écriture.
Tenez, voyez, lisez.
MÉLITE.
Tenez, voyez, lisez._Ah, Dieux ! quelle imposture !
Jamais un de ces traits ne partit de ma main.
CLORIS.
Nous pourrions demeurer ici jusqu’à demain,
Que vous persisteriez dans la méconnoissance :
Je les vous laisse. Adieu.
MÉLITE.
Je les vous laisse. Adieu._Tout beau, mon innocence
Veut apprendre de vous le nom de l’imposteur,
Pour faire retomber l’affront sur son auteur.
CLORIS.
Vous pensez me duper, et perdez votre peine.
Que sert le désaveu quand la preuve est certaine ?
À quoi bon démentir? à quoi bon dénier… ?
MÉLITE.
Ne vous obstinez point à me calomnier ;
Je veux que, si jamais j’ai dit mot à Philandre…
CLORIS.
Remettons ce discours : quelqu’un vient nous surprendre ;
C’est le brave Lisis, qui semble sur le front
Porter empreints les traits d’un déplaisir profond.
ACTE IV
Scène III
LISIS, MÉLITE, CLORIS.
LISIS, à Cloris.
Préparez vos soupirs à la triste nouvelle
Du malheur où nous plonge un esprit infidèle ;
Quittez son entretien, et venez avec moi
Plaindre un frère au cercueil par son manque de foi.
MÉLITE.
Quoi ! son frère au cercueil !
LISIS.
Quoi ! son frère au cercueil !_Oui, Tircis, plein de rage
De voir que votre change indignement l’outrage.
Maudissant mille fois le détestable jour
Que votre bon accueil lui donna de l’amour,
Dedans ce désespoir a chez moi rendu l’âme,
Et mes yeux désolés…
MÉLITE.
Et mes yeux désolés…_Je n’en puis plus ; je pâme.
CLORIS.
Au secours ! au secours !
ACTE IV
Scène IV
CLITON, la Nourrice, MÉLITE,
LISIS, CLORIS.
CLITON.
Au secours ! au secours !_D’où provient cette voix ?
LA NOURRICE.
Qu’avez-vous, mes enfants ?
CLORIS.
Qu’avez-vous, mes enfants ?_Mélite que tu vois…
LA NOURRICE.
Hélas ! elle se meurt ; son teint vermeil s’efface;
Sa chaleur se dissipe ; elle n’est plus que glace.
LISIS,
à Cliton.
Va quérir un peu d’eau ; mais il faut te hâter.
CLITON,
à Lisis.
Si proches du logis, il vaut mieux l’y porter.
CLORIS.
Aidez mes foibles pas ; les forces me défaillent,
Et je vais succomber aux douleurs qui m’assaillent.
ACTE IV
Scène V
ÉRASTE.
À la fin je triomphe, et les destins amis
M’ont donné le succès que je m’étois promis.
Me voilà trop heureux, puisque par mon adresse
Mélite est sans amant, et Tircis sans maîtresse ;
Et comme si c’étoit trop peu pour me venger,
Philandre et sa Cloris courent même danger.
Mais par quelle raison leurs âmes désunies
Pour les crimes d’autrui seront-elles punies ?
Que m’ont-ils fait tous deux pour troubler leurs accords ?
Fuyez de ma pensée, inutiles remords ;
La joie y veut régner, cessez de m’en distraire.
Cloris m’offense trop d’être sœur d’un tel frère,
Et Philandre, si prompt à l’infidélité,
N’a que la peine due à sa crédulité.
Mais que me veut Cliton qui sort de chez Mélite ?
ACTE IV
Scène VI
ÉRASTE, CLITON.
CLITON.
Monsieur, tout est perdu : votre fourbe maudite,
Dont je fus à regret le damnable instrument,
A couché de douleur Tircis au monument.
ÉRASTE.
Courage ! tout va bien, le traître m’a fait place ;
Le seul qui me rendoit son courage de glace,
D’un favorable coup la mort me l’a ravi.
CLITON.
Monsieur, ce n’est pas tout, Mélite l’a suivi.
ÉRASTE.
Mélite l’a suivi ! que dis-tu, misérable ?
CLITON.
Monsieur, il est trop vrai : le moment déplorable
Qu’elle a su son trépas a terminé ses jours.
ÉRASTE.
Ah ciel ! s’il est ainsi…
CLITON.
Ah ciel ! s’il est ainsi…_Laissez là ces discours,
Et vantez-vous plutôt que par votre imposture
Ces malheureux amants trouvent la sépulture,
Et que votre artifice a mis dans le tombeau
Ce que le monde avoit de parfait et de beau.
ÉRASTE.
Tu m’oses donc flatter, infâme, et tu supprimes
Par ce reproche obscur la moitié de mes crimes ?
Est-ce ainsi qu’il te faut n’en parler qu’à demi ?
Achève tout d’un coup : dis que maîtresse, ami,
Tout ce que je chéris, tout ce qui dans mon âme
Sut jamais allumer une pudique flamme,
Tout ce que l’amitié me rendit précieux,
Par ma fourbe a perdu la lumière des cieux ;
Dis que j’ai violé les deux lois les plus saintes,
Qui nous rendent heureux par leurs douces contraintes ;
Dis que j’ai corrompu, dis que j’ai suborné,
Falsifié, trahi, séduit, assassiné :
Tu n’en diras encor que la moindre partie.
Quoi ! Tircis est donc mort, et Mélite est sans vie !
Je ne l’avois pas su, Parques, jusqu’à ce jour,
Que vous relevassiez de l’empire d’Amour ;
J’ignorois qu’aussitôt qu’il assemble deux âmes,
Il vous pût commander d’unir aussi leurs trames.
Vous en relevez donc, et montrez aujourd’hui
Que vous êtes pour nous aveugles comme lui !
Vous en relevez donc, et vos ciseaux barbares
Tranchent comme il lui plaît les destins les plus rares !
Mais je m’en prends à vous, moi qui suis l’imposteur,
Moi qui suis de leurs maux le détestable auteur.
Hélas ! et falloit-il que ma supercherie
Tournât si lâchement tant d’amour en furie ?
Inutiles regrets, repentirs superflus,
Vous ne me rendez pas Mélite qui n’est plus ;
Vos mouvements tardifs ne la font pas revivre :
Elle a suivi Tircis, et moi je la veux suivre.
Il faut que de mon sang je lui fasse raison,
Et de ma jalousie, et de ma trahison,
Et que de ma main propre une âme si fidèle
Reçoive… Mais d’où vient que tout mon corps chancelle ?
Quel murmure confus ! et qu’entends-je hurler ?
Que de pointes de feu se perdent parmi l’air !
Les Dieux à mes forfaits ont dénoncé la guerre ;
Leur foudre décoché vient de fendre la terre.
Et pour leur obéir son sein me recevant
M’engloutit, et me plonge aux enfers tout vivant.
Je vous entends, grands Dieux : c’est là-bas que leurs âmes
Aux champs Élysiens éternisent leurs flammes ;
C’est là-bas qu’à leurs pieds il faut verser mon sang :
La terre à ce dessein m’ouvre son large flanc,
Et jusqu’aux bords du Styx me fait libre passage ;
Je l’aperçois déjà, je suis sur son rivage.
Fleuve, dont le saint nom est redoutable aux Dieux,
Et dont les neuf replis ceignent ces tristes lieux,
N’entre point en courroux contre mon insolence,
Si j’ose avec mes cris violer ton silence ;
Je ne te veux qu’un mot : Tircis est-il passé ?
Mélite est-elle ici ? Mais qu’attends-je ? insensé !
Ils sont tous deux si chers à ton funeste empire,
Que tu crains de les perdre, et n’oses m’en rien dire.
Vous donc, esprits légers, qui, manque de tombeaux,
Tournoyez vagabonds à l’entour de ces eaux,
À qui Charon cent ans refuse sa nacelle,
Ne m’en pourriez-vous point donner quelque nouvelle ?
Parlez, et je promets d’employer mon crédit
À vous faciliter ce passage interdit.
CLITON.
Monsieur, que faites-vous ? Votre raison troublée
Par l’effort des douleurs dont elle est accablée
Figure à votre vue…
ÉRASTE.
Figure à votre vue…_Ah ! te voilà, Charon ;
Dépêche promptement, et d’un coup d’aviron
Passe-moi, si tu peux, jusqu’à l’autre rivage.
CLITON.
Monsieur, rentrez en vous, regardez mon visage :
Reconnoissez Cliton.
ÉRASTE.
Reconnoissez Cliton._Dépêche, vieux nocher,
Avant que ces esprits nous puissent approcher.
Ton bateau de leur poids fondroit dans les abîmes ;
Il n’en aura que trop d’Éraste et de ses crimes.
Quoi ! tu veux te sauver à l’autre bord sans moi ?
Si faut-il qu’à ton cou je passe malgré toi.
(Il se jette sur les épaules de Cliton, qui l’emporte
derrière le théâtre)
ACTE IV
Scène VII
PHILANDRE.
Présomptueux rival, dont l’absence importune
Retarde le succès de ma bonne fortune,
As-tu sitôt perdu cette ombre de valeur
Que te prêtoit tantôt l’effort de ta douleur ?
Que devient à présent cette bouillante envie
De punir ta volage aux dépens de ma vie ?
Il ne tient plus qu’à toi que tu ne sois content :
Ton ennemi l’appelle, et ton rival t’attend.
Je te cherche en tous lieux, et cependant ta fuite
Se rit impunément de ma vaine poursuite.
Crois-tu, laissant mon bien dans les mains de ta sœur,
En demeurer toujours l’injuste possesseur,
Ou que ma patience, à la fin échappée
(Puisque tu ne veux pas le débattre à l’épée),
Oubliant le respect du sexe et tout devoir,
Ne laisse point sur elle agir mon désespoir ?
ACTE IV
Scène VIII
ÉRASTE, PHILANDRE.
ÉRASTE.
Détacher Ixion pour me mettre en sa place !
Mégères, c’est à vous une indiscrète audace.
Ai-je avec même front que cet ambitieux
Attenté sur le lit du monarque des cieux ?
Vous travaillez en vain, barbares Euménides ;
Non, ce n’est pas ainsi qu’on punit les perfides.
Quoi ! me presser encor ? Sus, de pieds et de mains
Essayons d’écarter ces monstres inhumains.
À mon secours, esprits ! vengez-vous de vos peines ;
Écrasons leurs serpents ; chargeons-les de vos chaînes.
Pour ces filles d’enfer nous sommes trop puissants.
PHILANDRE.
Il semble à ce discours qu’il ait perdu le sens.
Éraste, cher ami, quelle mélancolie
Te met dans le cerveau cet excès de folie ?
ÉRASTE.
Équitable Minos, grand juge des enfers,
Voyez qu’injustement on m’apprête des fers.
Faire un tour d’amoureux, supposer une lettre,
Ce n’est pas un forfait qu’on ne puisse remettre.
Il est vrai que Tircis en est mort de douleur,
Que Mélite après lui redouble ce malheur,
Que Cloris sans amant ne sait à qui s’en prendre ;
Mais la faute n’en est qu’au crédule Philandre ;
Lui seul en est la cause, et son esprit léger,
Qui trop facilement résolut de changer ;
Car ces lettres, qu’il croit l’effet de ses mérites,
La main que vous voyez les a toutes écrites.
PHILANDRE.
Je te laisse impuni, traître : de tels remords
Te donnent des tourments pires que mille morts ;
Je t’obligerois trop de t’arracher la vie,
Et ma juste vengeance est bien mieux assouvie
Par les folles horreurs de cette illusion.
Ah ! grands Dieux, que je suis plein de confusion !
ACTE IV
Scène IX
ÉRASTE.
Tu t’enfuis donc, barbare, et me laissant en proie
À ces cruelles sœurs, tu les combles de joie ?
Non, non, retirez-vous, Tisiphone, Alecton,
Et tout ce que je vois d’officiers de Pluton :
Vous me connoissez mal ; dans le corps d’un perfide
Je porte le courage et les forces d’Alcide.
Je vais tout renverser dans ces royaumes noirs,
Et saccager moi seul ces ténébreux manoirs.
Une seconde fois le triple chien Cerbère
Vomira l’aconit en voyant la lumière ;
J’irai du fond d’enfer dégager les Titans,
Et si Pluton s’oppose à ce que je prétends,
Passant dessus le ventre à sa troupe mutine,
J’irai d’entre ses bras enlever Proserpine.
ACTE IV
Scène X
LISIS, CLORIS.
LISIS.
N’en doute plus, Cloris, ton frère n’est point mort ;
Mais ayant su de lui son déplorable sort,
Je voulois éprouver par cette triste feinte
Si celle qu’il adore, aucunement atteinte,
Deviendroit plus sensible aux traits de la pitié
Qu’aux sincères ardeurs d’une sainte amitié.
Maintenant que je vois qu’il faut qu’on nous abuse.
Afin que nous puissions découvrir cette ruse,
Et que Tircis en soit de tout point éclairci.
Sois sûre que dans peu je te le rends ici.
Ma parole sera d’un prompt effet suivie :
Tu reverras bientôt ce frère plein de vie ;
C’est assez que je passe une fois pour trompeur.
CLORIS.
Si bien qu’au lieu du mal nous n’aurons que la peur ?
Le cœur me le disoit : je sentois que mes larmes
Refusoient de couler pour de fausses alarmes,
Dont les plus dangereux et plus rudes assauts
Avoient beaucoup de peine à m’émouvoir à faux ;
Et je n’étudiai cette douleur menteuse
Qu’à cause qu’en effet j’étois un peu honteuse
Qu’une autre en témoignât plus de ressentiment.
LISIS.
Après tout, entre nous, confesse franchement
Qu’une fille en ces lieux, qui perd un frère unique,
Jusques au désespoir fort rarement se pique :
Ce beau nom d’héritière a de telles douceurs,
Qu’il devient souverain à consoler des sœurs.
CLORIS.
Adieu, railleur, adieu : son intérêt me presse
D’aller rendre d’un mot la vie à sa maîtresse ;
Autrement je saurois t’apprendre à discourir.
LISIS.
Et moi, de ces frayeurs de nouveau te guérir.
ACTE V
Scène Première
CLITON, la Nourrice.
CLITON.
Je ne t’ai rien celé : tu sais toute l’affaire.
LA NOURRICE.
Tu m’en as bien conté ; mais se pourroit-il faire
Qu’Éraste eût des remords si vifs et si pressants
Que de violenter sa raison et ses sens ?
CLITON.
Eût-il pu, sans en perdre entièrement l’usage,
Se figurer Charon des traits de mon visage,
Et de plus, me prenant pour ce vieux nautonier,
Me payer à bons coups des droits de son denier ?
LA NOURRICE.
Plaisante illusion !
CLITON.
Plaisante illusion !_Mais funeste à ma tête,
Sur qui se déchargeoit une telle tempête,
Que je tiens maintenant à miracle évident
Qu’il me soit demeuré dans la bouche une dent.
LA NOURRICE.
C’étoit mal reconnoître un si rare service.
ÉRASTE,
derrière le théâtre.
Arrêtez, arrêtez, poltrons !
CLITON.
Arrêtez, arrêtez, poltrons !_Adieu, Nourrice :
Voici ce fou qui vient, je l’entends à la voix ;
Crois que ce n’est pas moi qu’il attrape deux fois.
LA NOURRICE.
Pour moi, quand je devrois passer pour Proserpine,
Je veux voir à quel point sa fureur le domine.
CLITON.
Contente à tes périls ton curieux désir.
LA NOURRICE.
Quoi qu’il puisse arriver, j’en aurai le plaisir.
ACTE V
Scène II
ÉRASTE, la Nourrice.
ÉRASTE.
En vain je les rappelle, en vain pour se défendre
La honte et le devoir leur parlent de m’attendre ;
Ces lâches escadrons de fantômes affreux
Cherchent leur assurance aux cachots les plus creux,
Et se fiant à peine à la nuit qui les couvre,
Souhaitent sous l’enfer qu’un autre enfer s’entr’ouvre.
Ma voix met tout en fuite, et dans ce vaste effroi,
La peur saisit si bien les ombres et leur roi,
Que se précipitant à de promptes retraites,
Tous leurs soucis ne vont qu’à les rendre secrètes.
Le bouillant Phlégéthon, parmi ses flots pierreux,
Pour les favoriser ne roule plus de feux ;
Tisiphone tremblante, Alecton et Mégère,
Ont de leurs flambeaux noirs étouffé la lumière ;
Les Parques même en hâte emportent leurs fuseaux.
Et dans ce grand désordre oubliant leurs ciseaux,
Charon, les bras croisés, dans sa barque s’étonne
De ce qu’après Éraste il n’a passé personne.
Trop heureux accident, s’il avoit prévenu
Le déplorable coup du malheur avenu !
Trop heureux accident, si la terre entr’ouverte
Avant ce jour fatal eût consenti ma perte,
Et si ce que le ciel me donne ici d’accès
Eût de ma trahison devancé le succès !
Dieux, que vous savez mal gouverner votre foudre !
N’étoit-ce pas assez pour me réduire en poudre
Que le simple dessein d’un si lâche forfait ?
Injustes, deviez-vous en attendre l’effet ?
Ah Mélite ! ah Tircis ! leur cruelle justice
Aux dépens de vos jours me choisit un supplice.
Ils doutoient que l’enfer eût de quoi me punir
Sans le triste secours de ce dur souvenir.
Tout ce qu’ont les enfers de feux, de fouets, de chaînes,
Ne sont auprès de lui que de légères peines ;
On reçoit d’Alecton un plus doux traitement.
Souvenir rigoureux, trêve, trêve un moment !
Qu’au moins avant ma mort dans ces demeures sombres
Je puisse rencontrer ces bienheureuses ombres !
Use après, si tu veux, de toute ta rigueur,
Et si pour m’achever tu manques de vigueur,
(Il met la main sur son épée.)
Voici qui t’aidera : mais derechef, de grâce,
Cesse de me gêner durant ce peu d’espace.
Je vois déjà Mélite. Ah ! belle ombre, voici
L’ennemi de votre heur qui vous cherchoit ici :
C’est Éraste, c’est lui, qui n’a plus d’autre envie
Que d’épandre à vos pieds son sang avec sa vie :
Ainsi le veut le sort, et tout exprès les Dieux
L’ont abîmé vivant en ces funestes lieux.
LA NOURRICE.
Pourquoi permettez-vous que cette frénésie
Règne si puissamment sur votre fantaisie ?
L’enfer voit-il jamais une telle clarté ?
ÉRASTE.
Aussi ne la tient-il que de votre beauté ;
Ce n’est que de vos yeux que part cette lumière.
LA NOURRICE.
Ce n’est que de mes yeux ! Dessillez la paupière,
Et d’un sens plus rassis jugez de leur éclat.
ÉRASTE.
Ils ont, de vérité, je ne sais quoi de plat ;
Et plus je vous contemple, et plus sur ce visage
Je m’étonne de voir un autre air, un autre âge :
Je ne reconnois plus aucun de vos attraits.
Jadis votre nourrice avoit ainsi les traits,
Le front ainsi ridé, la couleur ainsi blême,
Le poil ainsi grison. Dieux ! c’est elle-même.
Nourrice, qui t’amène en ces lieux pleins d’effroi ?
Y viens-tu rechercher Mélite comme moi ?
LA NOURRICE.
Cliton la vit pâmer, et se brouilla de sorte
Que la voyant si pâle il la crut être morte ;
Cet étourdi trompé vous trompa comme lui.
Au reste, elle est vivante, et peut-être aujourd’hui
Tircis, de qui la mort n’étoit qu’imaginaire,
De sa fidélité recevra le salaire.
ÉRASTE.
Désormais donc en vain je les cherche ici-bas ;
En vain pour les trouver je rends tant de combats.
LA NOURRICE.
Votre douleur vous trouble, et forme des nuages
Qui séduisent vos sens par de fausses images :
Cet enfer, ces combats ne sont qu’illusions.
ÉRASTE.
Je ne m’abuse point de fausses visions :
Mes propres yeux ont vu tous ces monstres en fuite,
Et Pluton de frayeur en quitter la conduite.
LA NOURRICE.
Peut-être que chacun s’enfuyoit devant vous,
Craignant votre fureur et le poids de vos coups ;
Mais voyez si l’enfer ressemble à cette place :
Ces murs, ces bâtiments, ont-ils la même face ?
Le logis de Mélite et celui de Cliton
Ont-ils quelque rapport à celui de Pluton ?
Quoi ? n’y remarquez-vous aucune différence ?
ÉRASTE.
De vrai, ce que tu dis a beaucoup d’apparence.
Nourrice, prends pitié d’un esprit égaré
Qu’ont mes vives douleurs d’avec moi séparé :
Ma guérison dépend de parler à Mélite.
LA NOURRICE.
Différez pour le mieux un peu cette visite,
Tant que, maître absolu de votre jugement,
Vous soyez en état de faire un compliment.
Votre teint et vos yeux n’ont rien d’un homme sage ;
Donnez-vous le loisir de changer de visage :
Un moment de repos que vous prendrez chez vous…
ÉRASTE.
Ne peut, si tu n’y viens, rendre mon sort plus doux,
Et ma foible raison, de guide dépourvue.
Va de nouveau se perdre en te perdant de vue.
LA NOURRICE.
Si je vous suis utile, allons, je ne veux pas
Pour un si bon sujet vous épargner mes pas.
ACTE V
Scène III
CLORIS, PHILANDRE.
CLORIS.
Ne m’importune plus, Philandre, je t’en prie ;
Me rapaiser jamais passe ton industrie.
Ton meilleur, je t’assure, est de n’y plus penser ;
Tes protestations ne font que m’offenser :
Savante à mes dépens de leur peu de durée,
Je ne veux point en gage une foi parjurée,
Un cœur que d’autres yeux peuvent sitôt brûler,
Qu’un billet supposé peut sitôt ébranler.
PHILANDRE.
Ah ! ne remettez plus dedans votre mémoire
L’indigne souvenir d’une action si noire.
Et pour rendre à jamais nos premiers vœux contents,
Étouffez l’ennemi du pardon que j’attends.
Mon crime est sans égal ; mais enfin, ma chère âme…
CLORIS.
Laisse là désormais ces petits mots de flamme,
Et par ces faux témoins d’un feu mal allumé
Ne me reproche plus que je t’ai trop aimé.
PHILANDRE.
De grâce, redonnez à l’amitié passée
Le rang que je tenois dedans votre pensée.
Derechef, ma Cloris, par ces doux entretiens,
Par ces feux qui voloient de vos yeux dans les miens,
Par ce que votre foi me permettoit d’attendre…
CLORIS.
C’est d’où dorénavant tu ne dois plus prétendre.
Ta sottise m’instruit, et par là je vois bien
Qu’un visage commun, et fait comme le mien,
N’a point assez d’appas, ni de chaîne assez forte,
Pour tenir en devoir un homme de ta sorte.
Mélite a des attraits qui savent tout dompter ;
Mais elle ne pourroit qu’à peine t’arrêter :
Il te faut un sujet qui la passe ou l’égale.
C’est en vain que vers moi ton amour se ravale ;
Fais-lui, si tu m’en crois, agréer tes ardeurs :
Je ne veux point devoir mon bien à ses froideurs.
PHILANDRE.
Ne me déguisez rien, un autre a pris ma place ;
Une autre affection vous rend pour moi de glace.
CLORIS.
Aucun jusqu’à ce point n’est encore arrivé ;
Mais je te changerai pour le premier trouvé.
PHILANDRE.
C’en est trop, tes dédains épuisent ma souffrance.
Adieu ; je ne veux plus avoir d’autre espérance,
Sinon qu’un jour le ciel te fera ressentir
De tant de cruautés le juste repentir.
CLORIS.
Adieu : Mélite et moi nous aurons de quoi rire
De tous les beaux discours que tu me viens de dire.
Que lui veux-tu mander ?
PHILANDRE.
Que lui veux-tu mander ?_Va, dis-lui de ma part
Qu’elle, ton frère et toi, reconnoîtrez trop tard
Ce que c’est que d’aigrir un homme de ma sorte.
CLORIS.
Ne crois pas la chaleur du courroux qui t’emporte :
Tu nous ferois trembler plus d’un quart d’heure ou deux.
PHILANDRE.
Tu railles, mais bientôt nous verrons d’autres jeux :
Je sais trop comme on venge une flamme outragée.
CLORIS.
Le sais-tu mieux que moi, qui suis déjà vengée ?
Par où t’y prendras-tu ? de quel air ?
PHILANDRE.
Par où t’y prendras-tu ? de quel air ?_Il suffit :
Je sais comme on se venge.
CLORIS.
Je sais comme on se venge._Et moi comme on s’en rit.
ACTE V
Scène IV
TIRCIS, MÉLITE.
TIRCIS.
Maintenant que le sort, attendri par nos plaintes,
Comble notre espérance et dissipe nos craintes,
Que nos contentements ne sont plus traversés
Que par le souvenir de nos malheurs passés,
Ouvrons toute notre âme à ces douces tendresses
Qu’inspirent aux amants les pleines allégresses,
Et d’un commun accord chérissons nos ennuis,
Dont nous voyons sortir de si précieux fruits.
Adorables regards, fidèles interprètes
Par qui nous expliquions nos passions secrètes,
Doux truchements du cœur, qui déjà tant de fois
M’avez si bien appris ce que n’osoit la voix,
Nous n’avons plus besoin de votre confidence :
L’amour en liberté peut dire ce qu’il pense,
Et dédaigne un secours qu’en sa naissante ardeur
Lui faisoient mendier la crainte et la pudeur.
Beaux yeux, à mon transport pardonnez ce blasphème,
La bouche est impuissante où l’amour est extrême :
Quand l’espoir est permis, elle a droit de parler ;
Mais vous allez plus loin qu’elle ne peut aller.
Ne vous lassez donc point d’en usurper l’usage,
Et quoi qu’elle m’ait dit, dites-moi davantage.
Mais tu ne me dis mot, ma vie ; et quels soucis
T’obligent à te taire auprès de ton Tircis ?
MÉLITE.
Tu parles à mes yeux, et mes yeux te répondent.
TIRCIS.
Ah ! mon heur, il est vrai, si tes désirs secondent
Cet amour qui paroît et brille dans tes yeux,
Je n’ai rien désormais à demander aux Dieux.
MÉLITE.
Tu t’en peux assurer : mes yeux si pleins de flamme
Suivent l’instruction des mouvements de l’âme.
On en a vu l’effet, lorsque ta fausse mort
A fait sur tous mes sens un véritable effort ;
On en a vu l’effet, quand te sachant en vie,
De revivre avec toi j’ai pris aussi l’envie ;
On en a vu l’effet, lorsqu’à force de pleurs
Mon amour et mes soins, aidés de mes douleurs,
Ont fléchi la rigueur d’une mère obstinée,
Et gagné cet aveu qui fait notre hyménée,
Si bien qu’à ton retour ta chaste affection
Ne trouve plus d’obstacle à sa prétention.
Cependant l’aspect seul des lettres d’un faussaire
Te sut persuader tellement le contraire,
Que sans vouloir m’entendre, et sans me dire adieu,
Jaloux et furieux tu partis de ce lieu.
TIRCIS.
J’en rougis, mais apprends qu’il n’étoit pas possible
D’aimer comme j’aimois, et d’être moins sensible ;
Qu’un juste déplaisir ne sauroit écouter
La raison qui s’efforce à le violenter ;
Et qu’après des transports de telle promptitude,
Ma flamme ne te laisse aucune incertitude.
MÉLITE.
Tout cela seroit peu, n’étoit que ma bonté
T’en accorde un oubli sans l’avoir mérité,
Et que, tout criminel, tu m’es encore aimable.
TIRCIS.
Je me tiens donc heureux d’avoir été coupable,
Puisque l’on me rappelle au lieu de me bannir,
Et qu’on me récompense au lieu de me punir.
J’en aimerai l’auteur de cette perfidie,
Et si jamais je sais quelle main si hardie…
ACTE V
Scène V
CLORIS, TIRCIS, MÉLITE.
CLORIS.
Il vous fait fort bon voir, mon frère, à cajoler,
Cependant qu’une sœur ne se peut consoler,
Et que le triste ennui d’une attente incertaine
Touchant votre retour la tient encore en peine.
TIRCIS.
L’amour a fait au sang un peu de trahison ;
Mais Philandre pour moi t’en aura fait raison.
Dis-nous, auprès de lui retrouves-tu ton conte,
Et te peut-il revoir sans montrer quelque honte ?
CLORIS.
L’infidèle m’a fait tant de nouveaux serments,
Tant d’offres, tant de vœux, et tant de compliments,
Mêlés de repentir…
MÉLITE.
Mêlés de repentir…_Qu’à la fin exorable,
Vous l’avez regardé d’un œil plus favorable.
CLORIS.
Vous devinez fort mal.
TIRCIS.
Vous devinez fort mal._Quoi, tu l’as dédaigné ?
CLORIS.
Du moins, tous ses discours n’ont encor rien gagné.
MÉLITE.
Si bien qu’à n’aimer plus votre dépit s’obstine ?
CLORIS.
Non pas cela du tout, mais je suis assez fine :
Pour la première fois, il me dupe qui veut ;
Mais pour une seconde, il m’attrape qui peut.
MÉLITE.
C’est-à-dire, en un mot…
CLORIS.
C’est-à-dire, en un mot…_Que son humeur volage
Ne me tient pas deux fois en un même passage ;
En vain dessous mes lois il revient se ranger.
Il m’est avantageux de l’avoir vu changer,
Avant que de l’hymen le joug impitoyable,
M’attachant avec lui, me rendît misérable.
Qu’il cherche femme ailleurs, tandis que de ma part
J’attendrai du destin quelque meilleur hasard.
MÉLITE.
Mais le peu qu’il voulut me rendre de service
Ne lui doit pas porter un si grand préjudice.
CLORIS.
Après un tel faux bond, un change si soudain,
À volage, volage, et dédain pour dédain.
MÉLITE.
Ma sœur, ce fut pour moi qu’il osa s’en dédire.
CLORIS.
Et pour l’amour de vous je n’en ferai que rire.
MÉLITE.
Et pour l’amour de moi vous lui pardonnerez.
CLORIS.
Et pour l’amour de moi vous m’en dispenserez.
MÉLITE.
Que vous êtes mauvaise !
CLORIS.
Que vous êtes mauvaise !_Un peu plus qu’il ne semble.
MÉLITE.
Je vous veux toutefois remettre bien ensemble.
CLORIS.
Ne l’entreprenez pas; peut-être qu’après tout
Votre dextérité n’en viendroit pas à bout.
ACTE V
Scène VI
TIRCIS, la Nourrice, ÉRASTE, MÉLITE,
CLORIS.
TIRCIS.
De grâce, mon souci, laissons cette causeuse :
Qu’elle soit à son choix facile ou rigoureuse,
L’excès de mon ardeur ne sauroit consentir
Que ces frivoles soins te viennent divertir :
Tous nos pensers sont dus, en l’état où nous sommes,
À ce nœud qui me rend le plus heureux des hommes,
Et ma fidélité, qu’il va récompenser…
LA NOURRICE.
Vous donnera bientôt autre chose à penser.
Votre rival vous cherche, et la main à l’épée
Vient demander raison de sa place usurpée.
ÉRASTE, à Mélite
.
Non, non, vous ne voyez en moi qu’un criminel,
À qui l’âpre rigueur d’un remords éternel
Rend le jour odieux, et fait naître l’envie
De sortir de sa gêne en sortant de la vie.
Il vient mettre à vos pieds sa tête à l’abandon ;
La mort lui sera douce à l’égal du pardon.
Vengez donc vos malheurs ; jugez ce que mérite
La main qui sépara Tircis d’avec Mélite,
Et de qui l’imposture avec de faux écrits
A dérobé Philandre aux vœux de sa Cloris.
MÉLITE.
Eclaircis du seul point qui nous tenoit en doute,
Que serois-tu d’avis de lui répondre ?
TIRCIS.
Que serois-tu d’avis de lui répondre ?_Écoute
Quatre mots à quartier.
ÉRASTE.
Quatre mots à quartier.__Que vous avez de tort
De prolonger ma peine en différant ma mort !
De grâce, hâtez-vous d’abréger mon supplice,
Ou ma main préviendra votre lente justice.
MÉLITE.
Voyez comme le ciel a de secrets ressorts
Pour se faire obéir malgré nos vains efforts :
Votre fourbe, inventée à dessein de nous nuire,
Avance nos amours au lieu de les détruire ;
De son fâcheux succès, dont nous devions périr,
Le sort tire un remède afin de nous guérir.
Donc pour nous revancher de la faveur reçue,
Nous en aimons l’auteur à cause de l’issue,
Obligés désormais de ce que tour à tour
Nous nous sommes rendu tant de preuves d’amour,
Et de ce que l’excès de ma douleur sincère
A mis tant de pitié dans le cœur de ma mère,
Que cette occasion prise comme aux cheveux,
Tircis n’a rien trouvé de contraire à ses vœux ;
Outre qu’en fait d’amour la fraude est légitime ;
Mais puisque vous voulez la prendre pour un crime,
Regardez, acceptant le pardon, ou l’oubli,
Par où votre repos sera mieux établi.
ÉRASTE.
Tout confus et honteux de tant de courtoisie,
Je veux dorénavant chérir ma jalousie,
Et puisque c’est de là que vos félicités…
LA NOURRICE, à Éraste.
Quittez ces compliments qu’ils n’ont pas mérités :
Ils ont tous deux leur compte, et sur cette assurance
Ils tiennent le passé dans quelque indifférence,
N’osant se hasarder à des ressentiments
Qui donneroient du trouble à leurs contentements.
Mais Cloris, qui s’en tait, vous la gardera bonne,
Et seule intéressée, à ce que je soupçonne,
Saura bien se venger sur vous à l’avenir
D’un amant échappé qu’elle pensoit tenir.
ÉRASTE, à Cloris.
Si vous pouviez souffrir qu’en votre bonne grâce
Celui qui l’en tira pût occuper sa place,
Éraste, qu’un pardon purge de son forfait,
Est prêt de réparer le tort qu’il vous a fait.
Mélite répondra de ma persévérance :
Je n’ai pu la quitter qu’en perdant l’espérance ;
Encore avez-vous vu mon amour irrité
Mettre tout en usage en cette extrémité ;
Et c’est avec raison que ma flamme contrainte
De réduire ses feux dans une amitié sainte,
Mes amoureux desirs, vers elle superflus
Tournent vers la beauté qu’elle chérit le plus.
TIRCIS.
Que t’en semble, ma sœur ?
CLORIS.
Que t’en semble, ma sœur ?_Mais toi-même, mon frère ?
TIRCIS.
Tu sais bien que jamais je ne te fus contraire.
CLORIS.
Tu sais qu’en tel sujet ce fut toujours de toi
Que mon affection voulut prendre la loi.
TIRCIS.
Encor que dans tes yeux tes sentiments se lisent,
Tu veux qu’auparavant les miens les autorisent.
Parlons donc pour la forme. Oui, ma sœur, j’y consens
Bien sûr que mon avis s’accommode à ton sens.
Fassent les puissants Dieux que par cette alliance
Il ne reste entre nous aucune défiance,
Et que m’aimant en frère, et ma maîtresse en sœur,
Nos ans puissent couler avec plus de douceur !
ÉRASTE.
Heureux dans mon malheur, c’est dont je les supplie ;
Mais ma félicité ne peut être accomplie
Jusqu’à ce qu’après vous son aveu m’ait permis
D’aspirer à ce bien que vous m’avez promis.
CLORIS.
Aimez-moi seulement, et pour la récompense
On me donnera bien le loisir que j’y pense.
TIRCIS.
Oui, sous condition qu’avant la fin du jour
Vous vous rendrez sensible à ce naissant amour.
CLORIS.
Vous prodiguez en vain vos foibles artifices ;
Je n’ai reçu de lui ni devoirs ni services.
MÉLITE.
C’est bien quelque raison ; mais ceux qu’il m’a rendus,
Il ne les faut pas mettre au rang des pas perdus.
Ma sœur, acquitte-moi d’une reconnoissance
Dont un autre destin m’a mise en impuissance :
Accorde cette grâce à nos justes desirs.
TIRCIS.
Ne nous refuse pas ce comble à nos plaisirs.
ÉRASTE.
Donnez à leurs souhaits, donnez à leurs prières,
Donnez à leurs raisons ces faveurs singulières ;
Et pour faire aujourd’hui le bonheur d’un amant,
Laissez-les disposer de votre sentiment.
CLORIS.
En vain en ta faveur chacun me sollicite,
J’en croirai seulement la mère de Mélite :
Son avis m’ôtera la peur du repentir,
Et ton mérite alors m’y fera consentir.
TIRCIS.
Entrons donc ; et tandis que nous irons le prendre,
Nourrice, va t’offrir pour maîtresse à Philandre.
LA NOURRICE.
(Tous rentrent, et elle demeure seule.)
Là, là, n’en riez point : autrefois en mon temps
D’aussi beaux fils que vous étoient assez contents,
Et croyoient de leur peine avoir trop de salaire
Quand je quittois un peu mon dédain ordinaire.
À leur compte, mes yeux étoient de vrais soleils
Qui répandoient partout des rayons nompareils ;
Je n’avois rien en moi qui ne fût un miracle ;
Un seul mot de ma part leur étoit un oracle…
Mais je parle à moi seule. Amoureux, qu’est-ce-ci ?
Vous êtes bien hâtés de me laisser ainsi !
Allez, quelle que soit l’ardeur qui vous emporte,
On ne se moque point des femmes de ma sorte,
Et je ferai bien voir à vos feux empressés
Que vous n’en êtes pas encore où vous pensez.
*************
Mélite Corneille