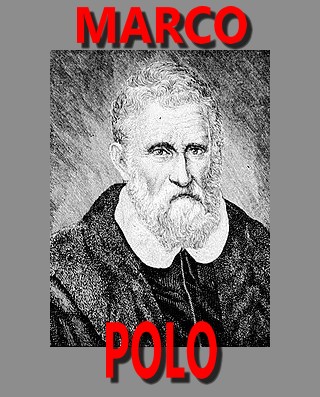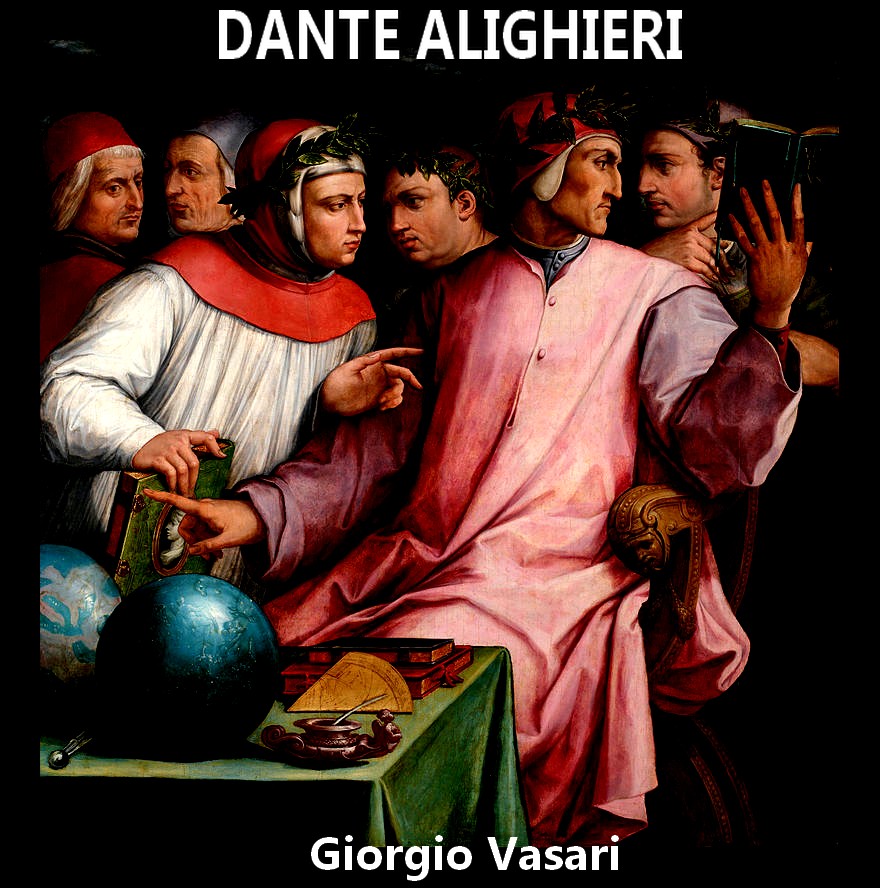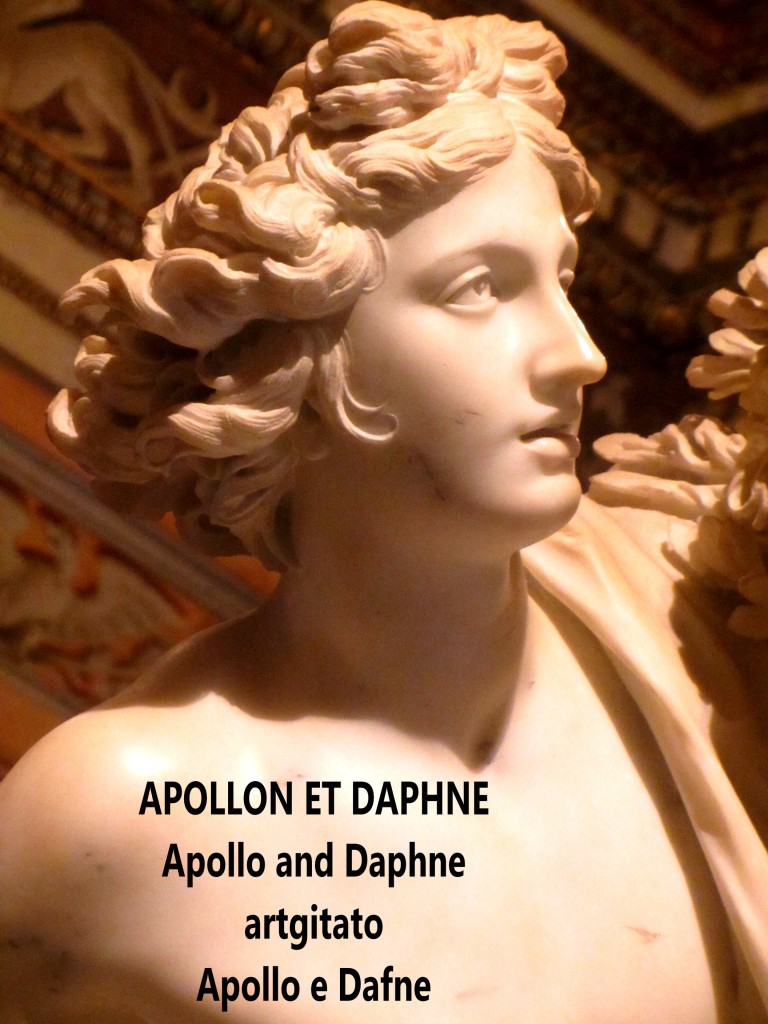Photos Jacky Lavauzelle
——-

MARCO POLO
马可波罗
Venise 1254 – Venise 1324
威尼斯 Venice
*
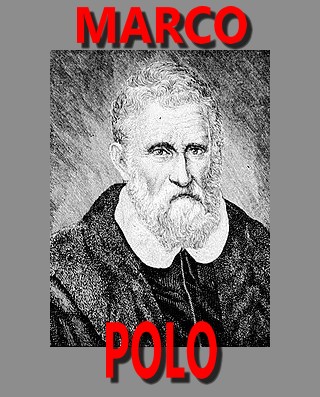

ETIENNE-JEAN DELECLUZE
Revue des Deux Mondes
1832 – tome 7
Marco Polo
Andréa Polo de Saint Felice, noble patricien de Venise, Dalmate d’origine, eut trois fils, nommés Marco, Maffio et Nicolo : ce dernier qui fut père de Marco Polo, le fameux voyageur, ainsi que Maffio son oncle, étaient marchands à Venise. Il parait même qu’ils étaient en société de commerce et que poussés par cet esprit entreprenant et aventureux qui animait alors tous les citoyens de cette république, ils combinèrent une expédition et s’embarquèrent ensemble pour Constantinople, qui alors était en relation habituelle et intime avec Venise. C’était à l’époque où l’empire grec avait été conquis par les armes da la France, réunies à celles de la république, et où l’ambassadeur de ce dernier gouvernement prenait, au moyen de son alliance avec Baudouin II [1], une très grande part à tout ce que faisait le gouvernement impérial.
Dans la plupart des manuscrits et des éditions imprimées du voyage de Marco Polo, il y a quelques différences de dates sur l’année où les deux premiers voyageurs, Marco et Maffio, arrivèrent à Constantinople. Mais la confrontation de ces livres donne lieu de croire que les voyageurs ne s’y trouvèrent pas plus tard qu’en 1254 ou 1255.
Après avoir vendu les marchandises qu’ils avaient apportées d’Italie, ils avisèrent au moyen de faire valoir leurs capitaux. Ayant entendu parler d’objets précieux à vendre parmi les Tartares occidentaux, ils résolurent d’aller au milieu de ces peuples. Ceux ci, après avoir ravagé plus leurs provinces de l’Asie et de l’Europe, s’étaient établis sur les bords du Wolga, avaient bâti des villes et y vivaient sous une espèce de gouvernement régulier.
Lorsqu’ils eurent fait des achats considérables de joyaux précieux, ils traversèrent la mer Noire, abordèrent en Crimée ; puis, continuant leur voyage par terre et par eau, ils arrivèrent enfin à la cour ou au camp de Barkah, frère ou fils de Batu, petit-fils de Tchingkis-Kan, qui faisait sa résidence tantôt à Saraï et tantôt à Bolghar, noms bien connus des géographes du moyen-âge.
Les voyageurs eurent à se louer de la bonne réception que leur fit ce prince, auquel ils offrirent tout ce qu’ils possédaient de précieux. Barkah accepta leur don, mais leur remit une somme double en valeur et y joignit encore des présens. Marco et Maffio restèrent un an environ dans ce pays.
Bientôt un différend s’éleva entre Barkah et Hulagu, son cousin, chef d’une horde voisine. Une guerre s’ensuivit, et Barkah ayant été vaincu, nos voyageurs dont le dessein était de retourner à Constantinople, sachant que toutes les routes étaient interceptées par les troupes victorieuses, furent contraints de chercher un chemin plus sûr en faisant de grands circuits. Ils arrivèrent jusqu’au haut de la mer Caspienne, traversèrent le Jaik et le Jaxartes, prenant cette dernière rivière pour l’une des quatre qui coulent dans le Paradis, et après avoir parcouru les déserts de Transoxiana, ils parvinrent à la grande cité de Bokhara.
Le hasard fit qu’au même moment où ils étaient arrêtés dans cette ville, un noble Tartare, envoyé par Hulagu à son frère Kublaï, y fit aussi une halte. Le messager, poussé par la curiosité de voir et d’entendre des Latins qu’il n’avait jamais eu l’occasion de rencontrer, fit connaissance avec les deux marchands vénitiens, prit plaisir à entendre leur langage et à profiter de leurs connaissances ; en telle sorte qu’il leur proposa de venir le rejoindre à la cour de l’empereur, ayant soin de les assurer qu’ils seraient protégés pendant leur voyage, et que le prince ne manquerait pas de leur faire une réception favorable. Nos voyageurs, fort incertains de pouvoir retourner à Constantinople, ou poussés plutôt par le goût des entreprises et l’espoir d’augmenter leurs richesses, acceptèrent la proposition. Après s’être recommandés à Dieu, ils poursuivirent leur voyage vers des contrées que, dans leur esprit, ils estimaient être les extrémités de l’Orient. Après avoir voyagé un an, ils arrivèrent à la résidence impériale.
La manière gracieuse dont ils furent reçus par le grand Kan, chef de tous les Tartares, leur donna bonne espérance. Ce prince leur adressa des questions sur toutes les parties occidentales du monde, sur l’empereur des Romains et sur tous les rois et princes de la chrétienté. Il s’informa de l’importance respective de ces souverains, de l’étendue de leurs possessions, de la manière dont la justice était administrée dans chaque état ; comment les princes faisaient la guerre, et par-dessus tout il multiplia les questions au sujet du pape, des affaires de l’église et de la doctrine et de la foi des chrétiens. Les voyageurs, dit la relation de Marco Polo, répondirent en gens sages et discrets, mesurant toutes leurs réponses d’après l’importance des matières et faisant usage du langage tartare (Moghul), ce qui augmenta singulièrement l’estime que le grand Kan avait conçue pour eux,
Ce passage fort curieux de Marco Polo où il règne une espèce de réserve diplomatique, a donné lieu de croire que l’intérêt que le grand Kan semble prendre à l’église et à la foi chrétienne, avait été exagéré par le zèle de ceux qui originairement tirèrent des copies de la relation de Marco Polo. Mais l’importance que les Tartares Moghuls mettaient à savoir quel était l’état des puissances chrétiennes de l’Occident, avec lesquelles elles faisaient alors cause commune contre les Sarrasins et les Mahométans, est assez connue pour que l’on s’explique avec quel intérêt et quelle curiosité bienveillante le prince mongol a dû écouter les renseignemens que lui donnèrent nos deux Vénitiens. Non-seulement cette alliance d’intérêt entre les Tartares et les chrétiens occidentaux existait, comme on n’en a jamais douté, mais on a acquis la certitude, depuis quelque temps, qu’il s’était établi non-seulement avec le pape, mais avec le roi de France et les successeurs de la race de Tchingkis-Kan, des relations diplomatiques dont les pièces originales en langue mongole existent dans les archives royales de France.
C’est au savant M. Abel Rémusat que l’on doit cette découverte sur laquelle il donne lui-même des détails qui serviront de commentaire à la partie de la relation de Marco Polo, où il parle du grand Kan Kublaï à la cour duquel il a été admis. « Je m’étais occupé, dit M. Abel Rémusat [2], de rechercher quelles avaient été l’origine et l’occasion des rapports que saint Louis et ses successeurs raient eus avec les princes de la race de Tchingkis-Kan. Des passages oubliés de nos vieilles chroniques, des particularités négligées par nos historiens, des monumens originaux ensevelis dans nos archives, m’avaient appris les motifs de ces négociations que Voltaire, Deguignes et plusieurs autres ont traitées de fabuleuses, parce qu’ils n’en avaient pas deviné l’objet et qu’ils n’en saisissaient pas l’enchaînement. « La terreur que l’irruption subite des Mongols avait inspirée depuis la Corée et le Japon jusqu’en Pologne et en Silésie, s’était propagée en Allemagne, en Italie et en France même. On voulut savoir quels étaient ces barbares nouveaux qui menaçaient d’envahir encore une fois l’Europe romaine, après avoir conquis et dévasté l’Asie. On hasarda de leur envoyer des ambassadeurs ; on brava leurs menaces, on dévora leurs mépris, et le résultat des courses lointaines et périlleuses entreprises par les envoyés de saint Louis et du pontife romain, fut d’ouvrir avec les généraux tartares devenus souverains de la Perse, de l’Arménie et de la Géorgie, des relations qu’on espérait faire tourner au profit du christianisme et de la cause des croisés. Tel fut l’état de ces négociations dans leur première période….
« La haine des nations musulmanes, commune aux Tartares et aux chrétiens, conduisit les uns et les autres à combiner leurs efforts. On fut d’autant plus disposé à agréer les propositions des Mongols, qu’ils passaient alors pour avoir une grande propension au christianisme. C’était presque être chrétien, dans ces siècles peu éclairés, que d’être ennemi des musulmans. Enfin les Tartares avaient été pris d’abord pour des démons incarnés, quand ils avaient attaqué les Hongrois et les Polonais ; peu s’en fallut qu’on ne les jugeât tout-à-fait convertis, quand on vit qu’ils faisaient avec acharnement la guerre aux Turcs et aux Sarrasins.
« Dans ce moment, la puissance des Francs, en Syrie, était sur son déclin ; elle ne tarda même pas à tomber sous les coups des sultans d’Egypte ; mais de nouvelles croisades pouvaient la relever en un instant. Les Mongols se mirent à en solliciter dans l’Occident. Ile joignirent leurs exhortations à celles des Géorgiens, des Arméniens, des Grecs, des croisés réfugiés en Chypre. Les premiers Tartares avaient débuté par des menaces et des injures. Les derniers en vinrent aux offres, et descendirent jusqu’aux prières. Des ambassadeurs furent envoyés par eux en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre, et il ne tint pas a eux que le feu des guerres saintes ne se rallumât de nouveau et ne s’étendît encore sur l’Europe et sur l’Asie. On peut croire qu’ils avaient aisément fait entrer les papes dans leurs vues, et qu’ils trouvaient en eux de zélés auxiliaires ; mais, circonstance aussi singulière que peu remarquée, ce n’était plus de Rome ou, d’Avignon, c’était de la cour de ces rois idolâtres que partaient d’abord ces sollicitations pour engager les rois chrétiens à venir à la délivrance du Saint-Sépulcre ; et lorsque Clément y prêcha cette grande croisade qui devait mettre la Palestine entre les mains des Francs, c’est qu’il avait vu à Poitiers des envoyés mongols, qui lui avaient appris qu’une paix générale venait d’être conclue entre tous les princes de la Tartarie, depuis la grande muraille de la Chine jusqu’aux frontières du pays des Francs. Cette circonstance permettait au roi de Perse de mettre à la disposition de Philippe-le-Bel, pour une expédition en Syrie, deux cent mille chevaux, deux cent mille charges de blé et plus de cent mille cavaliers tartares que le prince s’offrait de conduire en personne. La lettre, en langue mongole, relative à ces dispositions, est un rouleau de dix-huit pouces de haut sur neuf pieds de longueur, lequel existe encore aujourd’hui dans les archives du royaume. »
C’est pendant le cours de ces relations diplomatiques que nos Vénitiens étaient à la cour du grand Kan. On peut supposer même qu’ils avaient reçu quelques commissions particulières de l’empereur Beaudoin II, dont la politique s’accordait alors avec celle de la république de Venise, ce qui motiverait la réserve avec laquelle ils rendent compte de leur réponse, et l’intérêt que le prince tartare leur témoigna sur tout ce qui touchait aux intérêts des chrétiens occidentaux.
Quoi qu’il en soit, ce que Marco Polo rapporte des questions qui lui furent adressées par Kublaï, joint à la découverte faite par M. Rémusat des relations officielles qui ont existé entre les princes tartares et les souverains de l’Occident, prouve qu’il y avait un fondement à ces discours vagues qui couraient dans toutes les bouches en Europe aux treizième, quatorzième et quinzième siècles. Il n’était question alors que d’un grand souverain dont les vastes états occupaient l’Asie centrale ; tous les auteurs écrivaient et chacun répétait que le grand Kan, attaché à la religion chrétienne, demandait instamment qu’on lui envoyât de Rome des missionnaires qui pussent instruire les peuples idolâtres dans la religion chrétienne. Les ambassades auxquelles les croisades donnèrent lieu, firent sans doute naître ces bruits qui prirent encore plus de consistance, lorsque, vers 1298, les copies de la relation de Marco Polo commencèrent à se répandre en Europe.
Maintenant que nous avons fait connaître de quelle nature et de quelle importance étaient les relations diplomatiques qui s’étaient établies entre les Tartares et les nations de l’Occident, revenons à l’histoire des deux marchands vénitiens qui, en rentrant dans leur patrie, donnèrent l’éveil sur ce grand événement et jetèrent en Europe les premières notions positives que l’on ait eues sur les nations de l’Asie.
Le grand Kan, satisfait de la précision des réponses de Maffio et de Nicolo Polo, ainsi que de l’habileté qu’ils montraient dans les affaires, résolut de les aider à retourner en Italie, en les faisant accompagner par un de ses officiers qu’il revêtit de la qualité d’ambassadeur auprès du saint siège de Rome. Cet envoyé était chargé de supplier sa Sainteté d’envoyer des missionnaires pour répandre l’instruction religieuse parmi les peuples de la Tartarie. Cependant, sans prétendre absolument que le grand Kan fût tout-à-fait indifférent à la foi chrétienne, il est permis de croire que les dispositions hostiles des chrétiens envers les musulmans qui étaient aussi ses ennemis, ont pu engager ce prince à flatter le pape d’un espoir sur lequel il comptait peu lui-même.
Cependant les deux Vénitiens partirent pour retourner dans leur pays, et vers le commencement du voyage, l’ambassadeur tartare qui les accompagnait, tomba malade, resta en arrière et ne les rattrapa plus . Toutefois les voyageurs européens, munis d’un firman du prince qui leur assurait aide, protection et respect partout où ils passaient, parvinrent, au bout de trois ans, jusqu’aux rives de la Méditerranée. Ce fut de Giazza ou Ayas dans le royaume de la Basse-Arménie qu’ils s’embarquèrent pour Acre, alors tombée au pouvoir des chrétiens, et où ils arrivèrent au mois d’avril 1269.
En mettant pied à terre, ils apprirent la nouvelle, de la mort du pape Clément IV ; elle avait eu lieu l’année précédente. Le légat qu’ils trouvèrent à Acre leur conseilla de ne pas parler de l’ambassade dont ils étaient chargés, avant l’élection d’un nouveau pape, ce qui décida les voyageurs à profiter de cet intervalle de temps pour aller revoir leur famille à Venise.
En arrivant dans leur patrie, Nicolo Polo apprit que sa femme, qu’il avait laissée enceinte, était morte en accouchant d’un fils auquel elle avait donné le nom de Marco, en mémoire du frère aîné de son mari. Ce fils, dit la relation, était près de toucher à l’âge viril, et d’après la confrontation des dates incertaines du départ avec celle du retour, 1269, on estime que Marco Polo le célèbre voyageur, fils de Nicolo et auteur de la relation qui nous occupe, était né en 1254, et avait seize ans lorsqu’il vit son père.
Le pape Clément IV était mort à Viterbe au mois de novembre 1268, et ce ne fut qu’au mois de septembre 1271 que Grégoire X, son successeur, fut élu. Pendant trois ans, le sacré collège resta assemblé dans Viterbe et même tenu enfermé par le Podesta de la ville sans pouvoir se réunir. Enfin, par le conseil de saint Bonaventure, présent et cardinal lui-même, il se détermina à faire un compromis entre les mains de six de ses membres, lesquels élurent tout d’une voix Thealde (Théobalde), qui n’était autre que ce légat du pape que les voyageurs vénitiens avaient trouvé à Acre, et qui leur avait conseillé de ne faire connaître l’objet de leur mission qu’après l’élection du pape.
Mais les Polo n’eurent pas la patience d’attendre la décision du sacré collège. Craignant donc d’encourir la disgrâce de leur protecteur asiatique, Maffio et Nicolo prirent la résolution d’aller retrouver le légat à Acre pour s’entendre avec lui et reprendre le chemin de l’Asie. Ce fut dans cette occasion que les deux voyageurs vénitiens emmenèrent avec eux le jeune Marco Polo, fils de Nicolo. Arrivés à Acre, ils se munirent de lettres que le légat leur donna pour remettre à l’empereur de Tartarie, et ils s’embarquèrent pour Ayas. Mais à peine avaient-ils mis à la voile, qu’ils reçurent avis que le légat Théobalde de Plaisance était nommé pape. Ce nouveau pontife ayant fait revenir vers lui les trois voyageurs, substitua aux premières instructions qu’il leur avait données, des lettres papales, écrites selon l’usage que sa nouvelle dignité lui faisait un devoir de suivre. Il leur donna ensuite sa bénédiction et leur confia deux frères prêcheurs, chargés de remettre de riches présens, de la part du pape, au grand Kan des Tartares.
Ces arrangemens et le départ de la famille eurent lieu vers la fin de l’an 1271. Alors la partie septentrionale de la Syrie avait été envahie par le soudan d’Egypte, et l’alarme que causait son approche vers les frontières de la basse Arménie était telle, que les deux frères prêcheurs, commissionnés par le nouveau pape, n’osèrent pas s’y enfoncer et retournèrent prudemment à la côte.
Quant à la famille Polo, sans être arrêtée par l’idée des dangers qu’ils pouvaient courir, ils poursuivirent leur voyage vers l’intérieur de l’Asie, en suivant la direction du nord-est. D’après la relation, il paraît qu’ils n’eurent à surmonter que des difficultés dont les causes étaient naturelles, car rien n’indique qu’ils aient jamais été arrêtés hostilement dans le cours de leur long voyage.
Ils traversèrent la Haute-Arménie, une partie de la Perse, le Khorassan, et arrivèrent dans le pays de Badaksan au milieu des sources de l’Oxus, où ils s’arrêtèrent un an.
Dans ces contrées, alors, comme il arrive aujourd’hui même encore, on ne voyageait qu’avec de grandes difficultés et beaucoup de lenteur. Les conquêtes des Tartares avaient détruit beaucoup de villes, et celles qui restaient étaient souvent à de grandes distances l’une de l’autre. Outre ces inconvéniens, la route que l’on voulait suivre était coupée par des fleuves, des marais, des montagnes et des déserts. Il fallait souvent attendre qu’un assez grand nombre de voyageurs, tendant vers le même but, fussent rassemblés pour former une caravane qui pût surmonter les obstacles qu’offriraient les lieux, et se défendre en cas d’attaque. Peut-être est-ce par des causes de cette nature, jointes aux opérations commerciales que les Polo faisaient en route, que l’on peut expliquer le séjour d’un an qu’ils firent près des sources de l’Oxus. Toutefois il paraît, d’après un passage de la relation (Liv. I, chap. 25), que Marco Polo a éprouvé là une longue indisposition dont il ne s’est rétabli qu’en faisant des excursions dans les montagnes environnantes, dont il vante les salutaires bienfaits.
Ce fut là qu’ils recueillirent des renseignemens sur le royaume de Cachemire et sur d’autres provinces qui forment de ce côté les limites de l’Inde ; mais ils ne voyagèrent pas dans cette direction. Ils suivirent la route qui conduit à la vallée de Vokhan d’où ils montèrent dans les régions élevées de Pamer et de Belor et parvinrent à la ville de Khasghar qui faisait partie des vastes états du grand Kan. Après avoir dit quelques mots de Samarkand, situé à l’ouest de leur route, ils font aussi mention de Yerhen, et vont directement à Koten, ville célèbre. Enfin, après avoir traversé plus leurs villes moins importantes et peu connues aujourd’hui, ils arrivent au désert de Lop ou Kobi, dont ils donnent une description circonstanciée. (Chap. XXXV livre I, édit. Marsden). Après avoir employé trente jours à traverser ce désert, ils entrent dans le district de Tangut, coupent le pays que les Chinois nomment Si-Fan ou Tu-Fan, passent par la ville appelée Scha-Cheu, la Ville du Sable, et de là se dirigent vers l’extrémité ouest de la province de Shen-Si jusqu’à la cité de Kan-cheu.
En cet endroit, ils furent encore obligés de s’arrêter, mais Marco Polo ne donne pas précisément la cause de ce retard ; seulement, il indique que cette ville était une de celles où les voyageurs occidentaux avaient coutume de faire halte et de se reposer.
Il paraîtrait que nos voyageurs, ayant eu des désagrémens à essuyer de la part des autorités locales à Kan-cheu, trouvèrent moyen de faire savoir leur arrivée au grand Kan qui aurait alors ordonné que l’on protégeât au contraire ces voyageurs italiens.
Enfin, ils furent reçus par le grand Kan dans sa capitale nommée Tay-yuen-fu. L’accueil qu’ils reçurent de ce prince fut tout-à-fait favorable. Les voyageurs, après s’être prosternés selon l’usage en présentant leurs lettres, rendirent compte au grand Kan de leur mission et donnèrent les détails de tout ce qu’ils avaient fait en Europe. Le prince les écouta avec intérêt, les loua de leur zèle, accepta avec plaisir les présens qui lui étaient envoyés par le pape, et avec respect un vase rempli d’huile du saint sépulcre de Jésus-Christ, que l’on avait été chercher exprès à Jérusalem, ajoutant, en le recevant, que ses vertus devaient être grandes, si l’on en jugeait par l’importance et la valeur qu’y attachaient les chrétiens.
Le grand Kan remarqua le jeune Marco, notre auteur, et ayant su qu’il était le fils de Nicolo Polo, il l’honora d’un accueil particulier, le prit sous sa protection et lui donna un emploi dans sa maison. Cette position fournit à ce jeune homme les moyens de se distinguer par ses talens et de se faire respecter à la cour du prince tartare. Il adopta les manières du pays, et acquit la connaissance des quatre langues qui y étaient le plus en usage, le mongol, l’iey-ighur, le mantchou et le chinois. Bientôt il devint un favori utile pour son maître qui l’employa à des affaires importantes et délicates dans les parties les plus éloignées du siège de son empire. On voit par exemple au chapitre LXX du IIe livre (édition Marsden), que Marco Polo fut chargé, pendant trois ans, du gouvernement de la ville importante de Yan-gus, qui en comprenait vingt-sept autres dans sa juridiction.
Parmi les contrées dont la relation de Marco Polo révéla l’existence à l’Europe, et auxquelles elle donna une grande célébrité, il faut compter le royaume de Cathay, qui comprend la moitié septentrionale de la Chine, et l’île de Zipangu, que l’on a désignée depuis sous le nom de Japon.
L’île et le royaume de Zipangu ou japon fit naître à Kublaï, le grand Kan, l’idée de s’en rendre maître. Il équipa une flotte nombreuse, et par ce moyen y fit transporter une armée considérable. Mais les vents excitèrent une tempête terrible qui en submergea une partie, et dissipa le reste. Marco Polo, qui reporte cet événement à l’année 1264, était alors dans les états du grand Kan, mais ne dit pas s’il a été témoin de cette catastrophe, ou s’il en parle seulement d’après le rapport de ceux qui avaient fait partie de cette expédition.,
Quoi qu’il en soit, les trois circonstances des voyages de Marco Polo, qui firent impression en Europe lorsqu’il en publia la relation, furent les richesses immenses du grand Kan que l’on regardait comme disposé à se faire chrétien, l’existence du royaume de Cathay où l’or, les perles et toute espèce de richesses étaient en grande abondance, et enfin l’idée d’une grande île, celle de Zipangu (Japon), qui était située à l’extrémité orientale de l’Inde.
Marco Polo profita de ces différentes missions pour observer les mœurs, les usages des habitans, ainsi que les localités et les richesses des différens pays où il se trouvait. Il faisait des notes de toutes les choses remarquables, dans l’intention de satisfaire sur cet important sujet, l’extrême curiosité du grand Kan Kublaï. C’est à ces notes qu’il fît pour accomplir un devoir, que nous devons la relation de ses voyages dont il eut plus tard l’idée de donner connaissance à l’Europe. Au surplus, ce fut cette attention pour son maître qui augmenta la confiance que ce dernier avait en lui, et c’est après avoir présenté ce résultat de ses observations que Kublaï lui confia, pendant trois ans, la place de gouverneur d’un district.
Selon toute apparence, le père et l’oncle de Marco Polo conservèrent aussi la faveur du grand Kan, car peu après l’époque de leur arrivée chez ce prince, ils eurent l’occasion de lui rendre un service signalé. Le prince tartare faisait le siège d’une ville très importante de la Chine, Siang-yang-fu, qui résistait depuis trois ans à ses attaques. Nos deux Vénitiens firent connaître à Kublaï l’usage des catapultes au moyen desquels ils lancèrent tant de pierres dans la ville que les habitans se rendirent.
Il y avait dix-sept ans que nos voyageurs étaient dans ce pays, et jouissaient des plus brillans avantages à la cour du grand Kan, lorsqu’ils éprouvèrent le désir si naturel de revoir leur patrie. L’âge avancé et l’avenir tant soit peu incertain de leur protecteur leur firent faire des réflexions sérieuses sur leur propre sort : craignant que ce prince ne vînt à mourir, ce qui aurait pu faire naître des difficultés insurmontables pour leur retour en Europe, ils témoignèrent le désir de partir. Les efforts qu’ils firent pour obtenir le consentement de l’empereur furent d’abord non-seulement inutiles, mais leur attirèrent même des reproches de la part de Kublaï. Il leur fit entendre que, si la résolution de le quitter était causée par le désir et l’espérance qu’ils avaient d’augmenter leurs richesses, il était disposé à les combler de biens au-delà de tout ce qu’ils pourraient jamais souhaiter, mais que, quant à leur départ, ils ne devaient pas y penser. Au milieu des chagrins que leur causa cette espèce d’esclavage, leur bonne fortune permit qu’ils fussent tirés d’embarras par un événement tout-à-fait inattendu.
Il arriva vers ce temps, à la cour de Kublaï, des ambassadeurs qui lui étaient envoyés par un prince tartare-mongol, nommé Arghun, qui régnait en Perse : c’était le petit-fils de Houlagou, et par conséquent le petit-neveu du grand Kan. Cet Arghun, ayant perdu sa principale femme, issue du sang impérial, avait promis à cette épouse, lorsqu’elle était au lit de mort, de ne pas faire tort à sa mémoire, en formant une nouvelle alliance avec une autre femme inférieure à elle par la naissance. Pour accomplir ce vœu, et d’après les conseils de sa famille, il envoya donc une ambassade à son seigneur suzerain, pour obtenir de lui une femme de leur famille impériale. Cette demande fut aussitôt accueillie par le grand Kan, qui fit choix d’une princesse âgée de dix-sept ans parmi ses petites filles. Elle se nommait Kogatin, dit la relation, et elle était aussi aimable que belle. Les ambassadeurs, satisfaits des qualités de la jeune fiancée royale, se mirent en route, accompagnés d’une suite nombreuse, pour la conduire en Perse ; mais, après avoir voyagé quelques mois, car, ainsi qu’on l’a déjà fait observer, on ne marche pas vite dans ces contrées, la caravane n’osa plus avancer à cause des troubles qui avaient lieu dans différens états, à la suite des querelles fréquentes qui commençaient à s’élever entre les petits princes tartares. La crainte s’empara tellement des ambassadeurs chargés de conduire la jeune princesse, qu’ils prirent le parti de retourner à la capitale du grand Kan. Ce fut à ce moment et lorsque les envoyés de Perse étaient près de Kublaï, que Marco Polo y arriva aussi, revenant d’un grand voyage qu’il avait fait dans les îles voisines de la Chine. Il soumit à son souverain, selon sa coutume, les observations qu’il avait été à même de faire sur la navigation possible de ces mers. Ces renseignemens parvinrent jusqu’aux oreilles des ambassadeurs persans. Ils espérèrent trouver par cette nouvelle route un moyen plus sûr de regagner leur pays, et s’abouchèrent avec les voyageurs vénitiens. Rapprochées par un intérêt commun, l’ambassade persane et la famille vénitienne s’entendirent pour représenter au grand Kan que l’expérience des chrétiens dans les voyages par mer serait une raison pour qu’on les chargeât de conduire la jeune princesse et l’ambassade par la mer de l’Inde jusqu’au golfe Persique.
Quelque contrariété qu’occasionât cette demande à Kublaï, il ne put cependant, à cause de l’impossibilité où les Persans étaient de faire leur voyage par terre, la refuser. On fit donc des préparatifs extraordinaires pour cette expédition ; on équipa quatorze vaisseaux à quatre mâts, dont l’équipage de quelques-uns se montait à deux cent cinquante hommes, et l’on approvisionna cette flotte pour deux ans. Le grand Kan donna des passeports et des lettres de recommandation aux Vénitiens pour tous les lieux soumis à sa puissance ; puis, après leur avoir fait de riches présens en joyaux, il leur dit qu’il comptait sur leur retour et les autorisa à agir comme ses ambassadeurs auprès du pape, des rois de France et d’Espagne et de tous les princes chrétiens.
Cette expédition remarquable mit à la voile vers le commencement de l’an 1291, trois ans avant la mort de Kublaï, et quatre ans avant le retour de Maffio, Nicolo et Marco Polo, à Venise, en 1295. Depuis la rivière Pe-ho qui traverse le district de Pe-King et va se jeter dans la mer Jaune, voici la route que tint la flotte et que trace Marco Polo dans sa relation. Elle toucha d’abord au port de Zaitun dans la province de Fo-Kien, puis passa par l’île de Hai-nan et suivit la côte de Anan ou de la Cochinchine. Après avoir dépassé la côte de Kamboia, on se dirigea vers l’île de Bintan, située à la pointe méridionale de la péninsule Malaise (Malayan). Puis remontant vers le nord-ouest parle détroit que forment cette presqu’île et Sumatra, la flotte, après avoir été arrêtée pendant cinq mois pour attendre un vent favorable, passa près des îles Nicobar et Andamans, et traversa la baie du Bengale, en se dirigeant vers l’île de Ceylan, et de là à Olmuz dans le golfe Persique, où se termina cette grande navigation qui dura dix-huit mois.
A peine la jeune princesse, les ambassadeurs persans et nos Vénitiens étaient-ils débarqués, que l’on apprît qu’Arghun, ce roi mongol pour qui on avait amené une fiancée avec tant de peine, était mort depuis quelque temps (1291) ; que le pays était gouverné par un régent, un protecteur, qui passait pour être disposé à s’emparer de la souveraineté, et que le fils d’Arghun le dernier roi, Ghazan, qui par la suite s’est rendu célèbre en remontant sur le trône de son père, était à la tête d’une armée dans le Korasan, attendant l’occasion de faire valoir ses droits. Nos voyageurs, ainsi que la fiancée et les ambassadeurs, dirigèrent leurs marche vers ce prince, et lorsque les Vénitiens eurent remis entre les mains de Ghazan le dépôt royal qui leur avait été confié par Kublaï, ils allèrent à Tauris où ils se reposèrent des fatigues de leur long voyage, pendant neuf mois. De là ils atteignirent Trébizonde sur les bords de la mer Noire, où ils s’embarquèrent pour retourner à Venise, leur patrie. Ces trois célèbres voyageurs revirent leur pays en 1295, après une absence de vingt-quatre ans.
Au récit qui précède et qui est extrait de la relation même de Marco Polo, on ajoutera ce que les traditions vénitiennes ont conservé de la vie et des aventures de ces voyageurs, lorsqu’ils furent rentrés dans leur pays, en Europe. On prétend qu’à leur arrivée à Venise, on leur fit une réception à-peu-près semblable à celle qu’Ulysse éprouva en abordant à lthaque. Ils ne furent reconnus par personne, pas même par leurs plus proches parens ; car, pendant leur longue absence, on avait répandu le bruit de leur mort, et on la regardait généralement comme certaine. D’ailleurs les fatigues des voyages, les inquiétudes d’esprit qu’ils avaient éprouvées, et le changement que vingt-quatre années avaient apporté sur leurs visages, rendaient l’incrédulité de leurs compatriotes assez naturelle ; leur langage italien, corrompu par l’usage des langues de l’Asie ; leurs manières tant soit peu tartares et leur costume étranger, tout enfin contribuait à les faire méconnaître pour des Italiens.
Le beau palais de la famille Polo, habité par ceux des parens qui n’étaient point sortis de Venise, était situé dans la rue Saint-Jean Chrysostome. Quand nos voyageurs demandèrent à y être admis, ceux de leurs pareils qui occupaient la maison eurent toutes les peines du monde à se persuader que ces hommes si bizarrement vêtus, dont les manières leur paraissaient si étranges, et qu’enfin ils tenaient pour morts, fussent des leurs. Ils ne voulaient pas les reconnaître.
Placés dans cette situation fausse, et désirant se faire reconnaître, nos trois voyageurs eurent recours à un expédient assez singulier. Ils firent faire dans leur palais les apprêts d’une fête magnifique, à laquelle ils invitèrent tous leurs pareils et leurs anciennes connaissances. Lorsque l’heure de se mettre à table fut arrivée, Maffio, Nicolo et Marco Polo sortirent d’un appartement intérieur, vêtus de grandes simarres couleur de pourpre et traînant jusqu’à terre, telles qu’il était d’usage d’en porter alors dans les grandes cérémonies. Après que le lavement des mains fut terminé, comme chacun se mettait en devoir de prendre place à table, ils ôtèrent eux-mêmes ces vêtemens et en mirent d’autres semblables, mais en damas cramoisi. Les premiers habits ayant été déchirés en pièces, on en distribua les morceaux aux serviteurs. Après le premier service, ils se déshabillèrent encore, passèrent de nouvelles simarres de velours cramoisi, partagèrent de nouveau entre les domestiques celles qu’ils venaient de quitter. Enfin, quand le repas fut terminé, on distribua également les robes de velours cramoisi. Alors les trois hôtes parurent vêtus d’habillemens simples et semblables à tous ceux que portait la compagnie. Tous les assistans, fort étonnés de ce qu’ils avaient déjà vu, attendaient avec impatience ce qui allait s’ensuivre. Aussitôt donc que le repas fut terminé et que l’on eut donné l’ordre aux domestiques de se retirer, Marco Polo, comme le plus jeune, se leva de table, passa dans une pièce voisine d’où il revint bientôt, tenant les trois vêtemens sales et usés avec lesquels les trois voyageurs étaient arrivés d’abord dans le palais après leur débarquement. Les trois Polo prirent alors des couteaux et se mirent à découdre la doublure de leurs vieux haillons d’où ils tirèrent, au grand étonnement de la société, une grande quantité de pierreries, telles que rubis, saphirs, escarboucles, diamans, émeraudes etc..
En quittant la cour du grand Kan, ils avaient reçu des richesses immenses de ce prince. Mais comme le transport de si grandes sommes eût été impraticable pendant un aussi long voyage que celui qu’ils avaient à faire, ils avaient converti l’or en pierreries.
Cet amas de bijoux précieux qu’ils offrirent sur la table aux regards des assistans, jeta ces derniers dans la stupéfaction. Cependant, quand ils furent revenus de leur extase, ils commencèrent à croire que les trois voyageurs étaient en effet ces gentilshommes de la maison Polo qu’ils avaient cru morts depuis long-temps, et ils finirent par donner les témoignages du plus profond respect à leurs trois hôtes.
On ne donne pas ce fait comme avéré, mais en diminuant un peu l’exagération romanesque qui s’y trouve, on peut regarder cette anecdote traditionnelle comme fondée sur la vérité ; car de quelque manière que les trois Polo s’y soient pris pour se faire reconnaître à leur compatriotes et à leurs parens, après un voyage dans le fond de l’Inde, qui avait duré 24 ans, il est difficile de croire qu’ils y soient parvenus sans causer d’abord un grand étonnement.
Sitôt que le bruit du retour et du singulier voyage des Polo fut répandu à Venise, il n’y eut personne dans la ville qui ne voulût les voir et leur parler. Depuis les premiers seigneurs jusqu’aux artisans, tous recherchèrent leur conversation et eurent à se louer de leur complaisance. Enfin cette curiosité a laquelle se mêlait un intérêt réel, valut à Maffio, le frère aîné, un emploi important dans la magistrature. Quant au jeune Marco Polo, il était constamment entouré de la jeunesse vénitienne qui ne pouvait se lasser de faire des questions sur le grand Kan et sur le royaume de Cathay. Comme Marco avait, à ce qu’il paraît, une complaisance égale à la curiosité de ceux qui le questionnaient, il arriva qu’à force de répéter dans ses récits que les revenus du grand Kan montaient à dix ou quinze millions de ducats d’or, et d’évaluer toutes les richesses de ces contrées en employant fréquemment le mot million, l’on donna à Marco Polo le surnom de Marco Milione. En effet, ce surnom lui resta, mais il y a des auteurs qui prétendent qu’il lui fut donné seulement à cause des richesses que son oncle, son père et lui avaient rapportées de l’Inde.
Il était de la destinée de Marco Polo de mener une vie toujours agitée. A peine s’était-il écoulé quelques mois depuis son arrivée à Venise, que la république eut avis qu’une flotte génoise, commandée par Lampa Doria, s’était montrée vers l’île de Curzola, sur les côtes de la Dalmatie. Aussitôt les Vénitiens mirent à la mer une flotte composée de galères, en nombre supérieur à celui des ennemis. cette flotte fut confiée au commandement d’Andréa Dandolo, et Marco Polo, connu comme un excellent homme de mer, fut nommé capitaine d’une des galères. Les deux flottes ne tardèrent pas à se trouver en présence, et il y eut un engagement à la suite duquel celle des Vénitiens fut dispersée avec une grande perte. Parmi les prisonniers qui furent faits, outre A. Dandolo lui-même, se trouva aussi notre célèbre voyageur, qui, placé parmi les galères formant la division la plus avancée, se porta en avant avec une bravoure remarquable, et n’ayant point été soutenu, fut obligé de se rendre après avoir reçu une blessure grave.
On l’envoya à Gènes avec les autres prisonniers, ses compagnons d’infortune. Mais sa bravoure, ses qualités personnelles et le bruit qui se répandit de ses longs voyages et des récits qu’il en faisait, contribuèrent bientôt à adoucir les rigueurs de sa captivité. Il fut visité par toutes les personnes les plus distinguées de la ville de Gênes, et chacun se fit un point d’honneur de lui offrir, dans sa position, ce qui pouvait lui être nécessaire et même agréable : c’était à qui parviendrait à entendre parler Marco Polo, du royaume de Cathay et de la puissance du grand Kan Kublaï. Cette nécessité de répéter si souvent la même chose devint sans doute insupportable à Marco Polo, et c’est vraisemblablement à cette cause secondaire que nous sommes redevables de la relation de ses voyages, qu’il dicta pour contenter la curiosité de ses contemporains, et s’épargner de si fréquentes redites. Lorsqu’il prit ce parti, il fit venir de Venise toutes les notes qu’il avait faites en voyage, et que son père avait entre les mains. Avec ces documens, dont il parle plus d’une fois dans son livre, et aidé de sa mémoire, il dicta sa relation, qui fut écrite par un certain Rustighello ou Rustigiello, noble génois. Cet homme, par suite du vif désir qu’il avait de s’instruire dans la connaissance des différentes parties du monde, avait lié une amitié intime avec Marco Polo, et passait presque tout son temps avec lui dans l’endroit où il était retenu prisonnier. Cependant Apostolo Zeno pense, d’après l’autorité d’un des manuscrits de Marco, que le livre a été originairement écrit sous la dictée de l’auteur, par un Pisan prisonnier de guerre avec Marco. Quoi qu’il en soit de ces deux conjectures, le manuscrit a été terminé, et a commencé à circuler dans toute l’Italie et l’Europe en 1298.
Cependant Nicolo Polo, le père de notre auteur, avait formé des projets de mariage pour son fils ; mais la prolongation de sa captivité, dont la fin devenait toujours plus incertaine, lui fit renoncer à cette espérance. Après avoir fait des offres de rançon considérables, le tout sans succès, le vieux Nicolo, craignant de ne pas laisser son immense fortune à des héritiers directs, se décida à se remarier.
Il arriva qu’au bout de quatre ans de captivité, Marco Polo, par suite d’arrangemens entre les deux républiques, recouvra sa liberté. Il retourna donc à Venise et trouva son vieux père, qui était vert encore, entouré de trois fils en bas âge. Marco était un homme de sens et qui avait beaucoup vu ; il ne témoigna aucune humeur de cet accident et résolut de prendre femme aussi, ce qu’il fit. Il n’a point laissé de race masculine. On sait que son testament était daté de 1323, et que sa naissance a eu lieu vers 1254, d’où il suit que l’on peut évaluer la durée de son existence à soixante-dix ans.
Lorsque le livre de Marco Polo parut, on le lut avec une grande avidité, mais personne alors ne crut à la vérité de cette relation. Les poètes, les romanciers, s’emparèrent du personnage du grand Kan et du royaume de Cathay, pour embellir et égayer leurs récits. Cette machine poétique fut mise en usage jusqu’au temps de l’Arioste qui, comme l’on sait, parle souvent de la reine de Cathay. De la lecture du livre de Marco Polo résulta encore une opinion qui s’accrédita dans l’esprit de tous les peuples occidentaux : c’est qu’il y avait au milieu de l’Asie un grand monarque, que l’on désignait sous le nom de grand Kan, qui était chrétien, qui appelait vers lui, par ses vœux, tous ceux des chrétiens occidentaux qui voudraient entreprendre le voyage de Tartarie pour y propager la foi catholique et y instruire les peuples idolâtres dans la religion chrétienne. Les richesses immenses que possédait ce grand Kan n’étaient point oubliées. Dans tous ces désirs vagues que l’on formait pour aller convertir les païens, il se joignait toujours une espérance d’en être largement récompensé par les rubis, les émeraudes et l’or du grand Kan, du prêtre Jean ou du roi des Hassacis dont le vulgaire ne faisait qu’un seul personnage. Les croisades et les relations diplomatiques qui s’étaient établies entre saint Louis et les princes tartares, avaient commencé à répandre toutes ces idées en Europe ; la relation de Marco Polo les y fixa.
Outre ces résultats, ce livre eut encore celui de porter l’attention de quelques savans, et particulièrement celle de Christophe Colomb, sur les études géographiques. On ne peut douter, en lisant la relation originale du premier voyage que fit Christophe Colomb de 1492 à 1504, que toutes les études préliminaires, que toutes les spéculations qu’il avait faites sur l’étendue de la terre et la position relative des différentes contrées, ne fussent calculées d’après les renseignemens que lui avait fournis l’ouvrage de Marco Polo. Voici les propres paroles du fameux voyageur, qui, lorsqu’il venait de découvrir ce nouveau monde, portant aujourd’hui le nom d’Amérique, croyait avoir trouvé un chemin, en traversant la mer dans la direction du couchant, pour arriver à l’extrémité orientale de l’Inde et pénétrer par ce côté dans l’intérieur de ce vieux continent.
« Très hauts, très chrétiens, très excellens et très puissans princes, roi et reine des Espagnes et des îles de la mer, notre seigneur et notre souveraine, cette présente année 1492, après que vos altesses eurent mis fin à la guerre entre les Maures qui régnaient en Europe, et eurent terminé cette guerre dans la très grande cité de Grenade, où, cette présente année, le deuxième jour du mois de janvier, je vis arborer, par la force des armes, les bannières royales de vos altesses sur les tours de l’Alhambra, et où je vis le roi maure se rendre aux portes de la ville et y baiser les mains royales de vos altesses ; aussitôt dans ce présent mois et d’après les informations que j’avais données à vos altesses des terres de l’Inde et d’un prince qui est appelé grand Kan, ce qui veut dire en notre langue vulgaire roi des rois, et de ce que plus leurs fois lui et ses prédécesseurs avaient envoyé à Rome y demander des docteurs en notre sainte foi, pour qu’ils la lui enseignassent ; comme le Saint Père ne l’en avait jamais pourvu, et que tant de peuples se perdaient en croyant aux idolâtries et recevant en eux des sectes de perdition, vos altesses pensèrent, en leur qualité de catholiques chrétiens et de princes amis et propagateurs de la sainte foi chrétienne et ennemis de la secte de Mahomet et de toutes les idolâtries et hérésies, à envoyer moi, Christophe Colomb, auxdites contrées de l’Inde pour voir lesdits princes et les peuples, pour savoir de quelle manière on pourrait s’y prendre pour les convertir à notre sainte foi. Elles m’ordonnèrent de ne point aller par terre à l’Orient, mais de prendre, au contraire, la route de l’Occident, par laquelle nous ne savons pas, jusques aujourd’hui, d’une manière positive que personne ait jamais passé. » (Vol. II, pages 3 et 4.)
Tout plein de cette idée pendant le cours de son voyage de découverte, Colomb, arrivé aux premières îles américaines, dit (vol. Ile, page 77) : « Je voulais remplir d’eau toutes les tonnés des vaisseaux, pour partir d’ici si le temps me le permettait, et faire le tour de cette île jusqu’à ce que j’eusse pu prendre langue avec ce roi et voir si je puis avoir de lui l’or qu’il porte, et partir après pour une autre très grande île, qui doit être, à ce que je crois, (ipango (Zipangu), d’après les renseignemens que me donnent mes Indiens, qui l’appellent Colba, (Cuba). »
Arrivé à l’île de Cuba, il pense qu’il y a la ville de ce nom ; que le pays est un grand continent s’étendant beaucoup au nord ; que le roi de cette contrée est en guerre avec le grand Kan. L’amiral (Colomb) se disposa à envoyer un présent au roi du pays. « Il ajoute qu’il faisait tous ses efforts pour se rendre auprès du grand Kan, qu’il pensait devoir habiter dans les environs ou dans la ville de Cathay, appartenant à ce prince qui est fort puissant, ainsi qu’on le lui assura avant son départ d’Espagne. » (Page 94.)
« On tirera aussi beaucoup de coton de ce pays, ajoute-t-il en parlant de Cuba ; et je crois qu’il s’y vendrait très bien sans qu’on eût besoin de le porter en Espagne, mais seulement dans les grandes villes du grand Kan que nous découvrirons sans doute, et dans plus leurs autres appartenant à d’autres grands seigneurs qui seraient heureux de servir vos altesses. » (Volume II, page 114)-
Plus d’une fois encore, il parle de l’île de Cipango (Zipangu) qu’il compte sans cesse trouver. Au surplus, l’illusion de ce navigateur à l’égard de l’Inde est complète ; et dans une lettre qu’il écrivit à l’intendant en chef du roi et de la reine catholiques, il dit : « Lorsque j’arrivai à l’île la Juana, j’en suivis la côte vers le couchant, et je la trouvai si grande, que je pensais que c’était la Terre-Ferme, LA PROVINCE DU CATHAY ! »
Colomb dans sa relation semble toujours être poussé par l’envie de trouver de l’or, des perles et toute sorte de richesses de cette nature. Quand on ne connaît pas le voyage de Marco Polo et la connexité qu’il a avec celui du Génois, on pourrait accuser ce dernier d’avoir été mu particulièrement par une cupidité tout–à-fait désagréable. Mais avec un peu de réflexion, on s’aperçoit que les notions qu’il avait recueillies en Europe sur l’Inde, sur le royaume du Cathay et du grand Kan, sur les richesses immenses qui s’y trouvaient, lui ont fait rechercher toutes ces matières précieuses comme un renseignement qui pouvait lui indiquer qu’il était effectivement dans le pays, dans cette Inde enfin qu’il cherchait.
En somme, c’est une chose assez remarquable que ce soit un simple négociant de Venise, qui le premier ait fait connaître à l’Europe l’extrémité orientale de l’Inde, et qu’un autre Italien, Colomb, ait découvert l’Amérique presque par hasard, et en voulant aller par mer où Marco Polo était parvenu par terre.
L’homme ne peut réellement s’enorgueillir de rien de ce qu’il fait. Les plus grands génies dans leurs plus grandes entreprises sont les instrumens de la Providence ou les dupes du destin ; car, enfin, sans vouloir diminuer en rien le mérite de Christophe Colomb, mérite immense, toutefois lorsqu’il était à Cuba et qu’il nommait cette île Cipango, il faisait une erreur de tout l’espace que couvre le golfe du Mexique, le continent américain et la mer Pacifique.