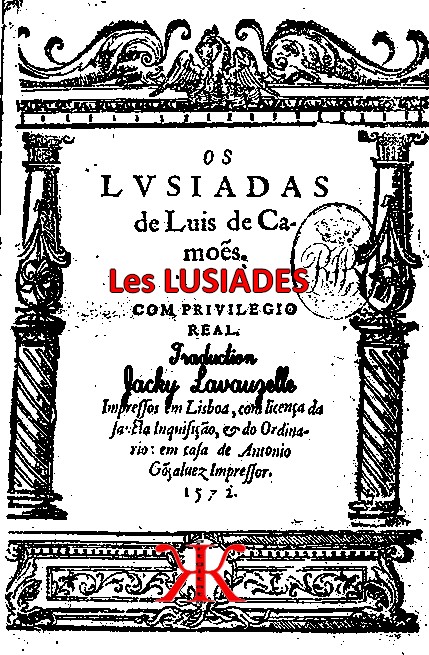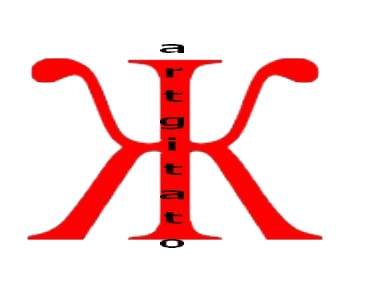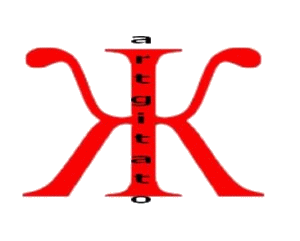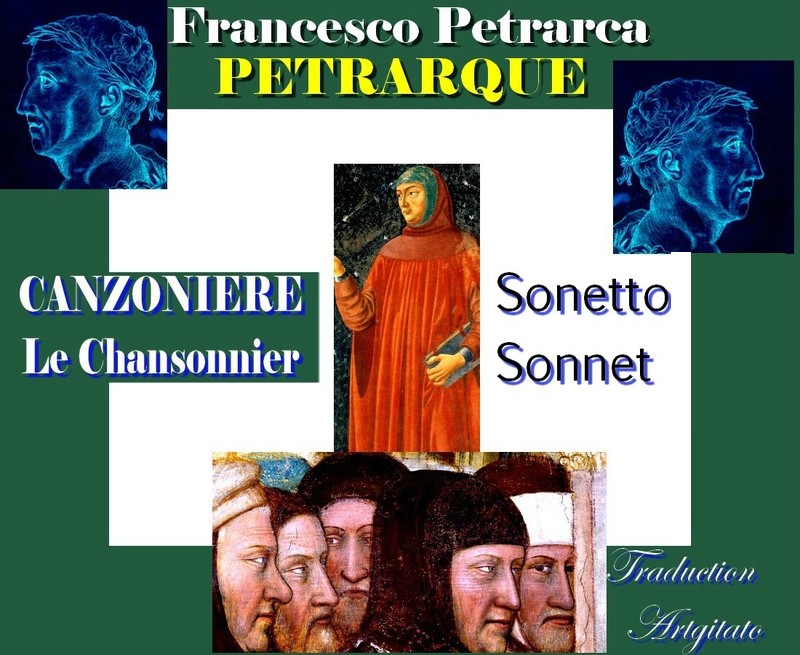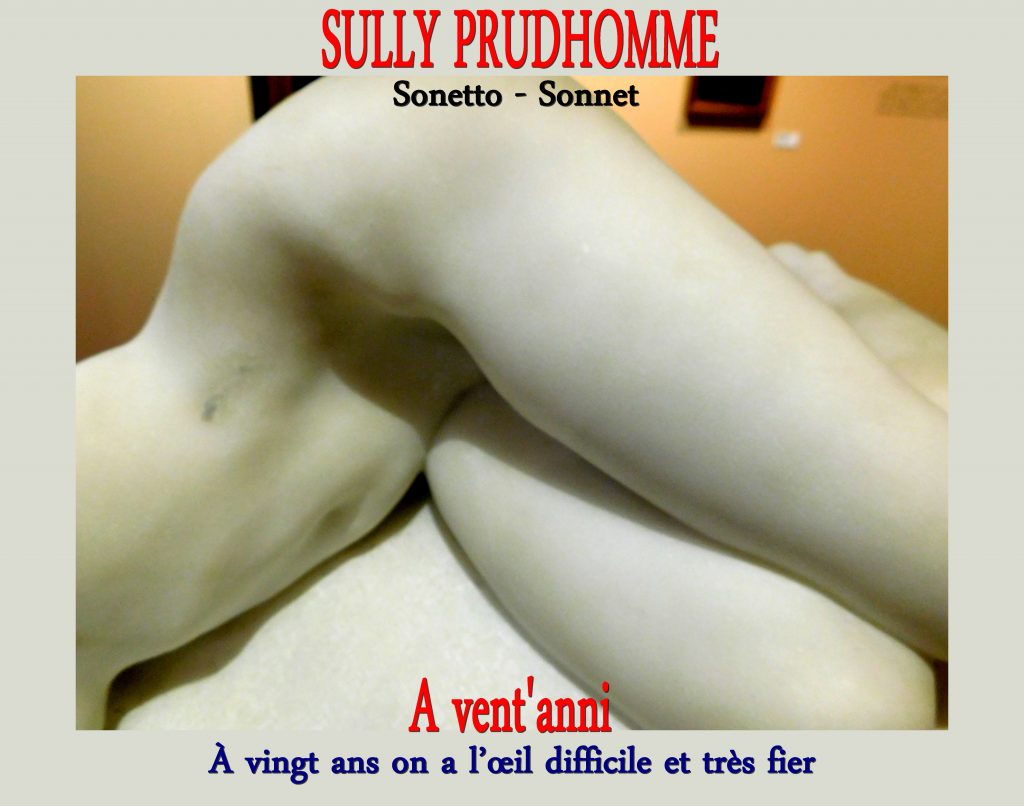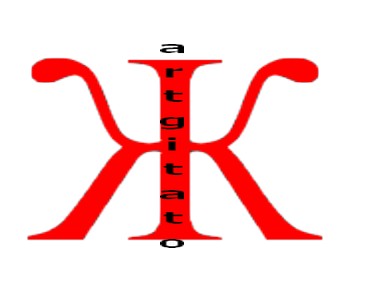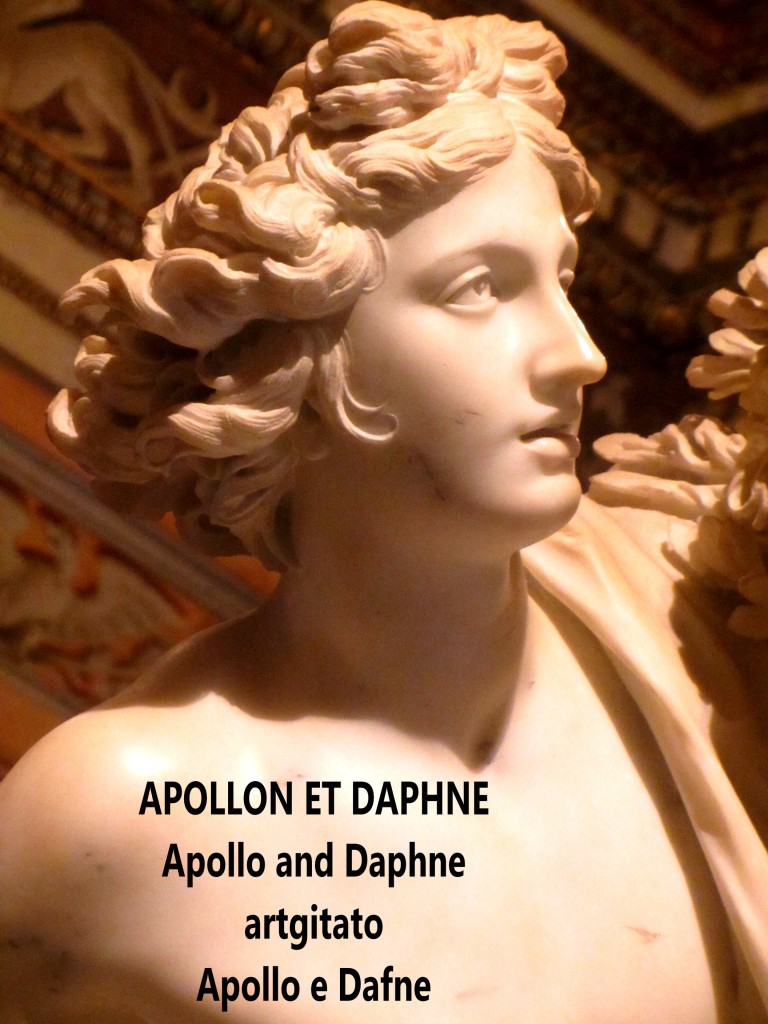Représentée pour la première fois par les comédiens français le 2 février 1694.
PRÉFACE
Les comédies d’un acte sont aussi anciennes que le théâtre. Celles des Grecs se représentaient tout de suite ; et la méthode de les partager en cinq actes est une pratique ingénieuse, inconnue aux premiers poètes, et dont l’honneur n’est proprement dû qu’à leurs scholiastes. Le chant des chœurs, dont les derniers se sont servis pour marquer le repos de l’action, et qui faisaient une des plus grandes beautés de l’ancienne comédie, n’y fut d’abord conservé que par respect pour l’origine du poème dramatique, qui, comme tout le monde sait, n’était autre chose, dans ses commencements, qu’une ou plusieurs chansons rustiques à l’honneur de Bacchus, auxquelles on joignit avec le temps des épisodes, qui, en se perfectionnant peu à peu, y introduisirent l’action qui y manquait.
Nos petites comédies ont commencé en France à peu près de la même manière. Ce n’était d’abord qu’une chanson grossière, dont quelque acteur enfariné venait régaler le peuple après la représentation d’une pièce sérieuse. Les Gros-Guillaume, les Jodelet, les Guillot-Gorjus y mêlèrent leurs bouffonneries et il se trouva des auteurs complaisants qui voulurent bien y mettre la main, en les liant par une espèce d’action exprimée le plus souvent en petits vers. C’est ce qu’on appelait la farce. L’impression en conserve encore quelques-unes qui, à dire le vrai, méritaient fort peu de nous être conservées.
Molière, que nous pouvons regarder comme le créateur de la comédie moderne, s’avisa le premier de faire de ces petites pièces un spectacle digne des honnêtes gens, et le grand succès des comédies qu’il fit, en un acte et en trois actes, justifia bientôt qu’il ne manquait à celles qu’on avait faites avant lui, que de la noblesse et de la régularité, pour être d’excellentes pièces de théâtre. Car c’est une pure imagination de croire que le temps d’une comédie doive être déterminé par autre chose que par le temps de son action ; et si on regarde comme une faute de donner vingt quatre heures de durée à une action qui se représente en deux heures et demie, c’en serait une bien plus grande de donner deux heures et demie de représentation à une action qui ne doit durer qu’une demi-heure. Il n’est donc pas question de savoir si une comédie d’un acte peut être parfaite ; il ne s’agit que de distraire celles qui sont parfaites, d’avec celles qui ne le sont pas ; et comme ce qui constitue le poème n’est autre chose que l’instruction qui en est la fin, et le plaisir qui en est le moyen, on peut dire que ceux en qui ces deux conditions se rencontrent sont des poèmes parfaits, et que ceux à qui l’une des deux manque, ne le sont point car il est inutile de parler des poèmes à qui elles manquent toutes deux, puisqu’ils ne peuvent jamais rien valoir. Or, il est certain que l’imitation vive et naturelle d’une chose qui mérite d’être imitée, ne saurait manquer de plaire et d’instruire ; et sur ce principe, je ne craindrai point de dire que de petites comédies, comme les Précieuses ou la Comtesse de d’Escarbagnas, et quelques autres qui représentent dans un tableau achevé des ridicules dignes de correction, méritent autant de louanges que les plus grandes pièces du même genre, quoiqu’il y ait peut-être plus de travail dans celles-ci que dans les premières.
J’ai cru devoir cet éclaircissement au public, en faveur de plusieurs pièces auxquelles quelques savants semblent ne refuser la justice qui leur est due, que parce qu’elles n’ont point leurs cinq actes bien comptés. Je n’ai point eu d’autre vue en écrivant ces réflexions ; et, bien loin d’en vouloir tirer quelque avantage pour moi même, j’avouerai de bonne foi que si j’avais été capable de les faire dans l’âge où j’ai composé la petite comédie suivante, j’aurais choisi un sujet plus digne, de l’attention du public. Car quoiqu’elle représente assez naturellement les personnages qui hantaient les cafés de ce temps-là, il est toujours vrai qu’elle peint une chose qui ne mérite pas d’être peinte ; et que quand même elle n’aurait d’autre défaut, on ne pourrait la ranger tout au plus que dans la seconde classe des petites pièces, puisqu’il ne suffit pas, dans la comédie, de faire rire le public, mais qu’il faut encore, si on peut, le faire rire utilement. C’est tout ce que j’ai à dire de ce petit ouvrage. J’ajouterai seulement qu’en établissant ici des règles qui sont plus anciennes que moi, je n’ai pas prétendu ôter à toutes les pièces qui n’instruisent point le mérite de leur agrément et de leur vivacité. Ce serait faire un trop grand tort à quantité de bonnes comédies anciennes et modernes. Ce que je veux dire, c’est que pour les rendre absolument parfaites il serait à souhaiter qu’elles fussent aussi utiles qu’agréables ; et qu’en faisant rire leurs lecteurs, elles eussent encore l’avantage de leur apprendre quelque chose qui fût digne de leur être appris.
Ergo, non satis est diducere rictum
Auditoris ; et est in hoc quoedam quoque virtus.
LES PERSONNAGES
MADAME JÉROME,
marchande de café.
LOUISON,
sa fille.
DORANTE,
amant de Louison.
MONSIEUR JOBELIN,
notaire.
LA SOURDIÈRE,
ami de Monsieur Jobelin.
LE CHEVALIER,
ami de Dorante.
CORONIS,
gascon, ami de Dorante.
L’ABBÉ,
ami de Dorante.
CARONDAS,
poète.
LA FLÈCHE,
valet de Dorante.
PREMIER JOUEUR de dames.
SECOND JOUEUR de dames.
****
Scène I
La Sourdière, Coronis, Carondas, L’Abbé, Deux joueurs.
Le théâtre représente une salle de café, meublée de plusieurs tables. Le Poète paraît rêvant d’un côté auprès de deux joueurs de dames. L’Abbé dort dans le fond ; et de l’autre côté, Coronis et La Sourdière disputent ensemble assis, en prenant leur café.
LA SOURDIÈRE
Oh parbleu ! Je vous soutiens que si.
CORONIS
Et moi, mordi, je vous soutiens que non et je mets cent pistoles que nous n’aurons rien cette année en Hongrie.
LA SOURDIÈRE
Vous me feriez enrager, monsieur Coronis. Vous voulez savoir cela mieux que moi qui vois tous les jours aux Tuileries un homme qui reçoit toutes les semaines la gazette de Constantinople.
CORONIS
Quand ce serait celle de Babylone.
LA SOURDIÈRE
C’est être bien têtu. Et moi, je vous dis que je vis hier, entre ses mains, une lettre de l’aumônier d’un des principaux bâchas, qui marque expressément que le grand vizir est en marche avec deux cent mille hommes, et qu’il va droit à Belgrade, pour l’assiéger par terre et par mer.
CORONIS
Belgrade par mer et par terre ! Où avez-vous appris la géographie, s’il vous plaît ?
LA SOURDIÈRE
Comment, Belgrade n’est pas un port de mer ?
CORONIS
Non pas, que je sache ou bien c’est depuis fort peu de temps.
LA SOURDIÈRE
Morbleu, je sais la carte, et j’ai voyagé. Je parie que monsieur Carondas sera de mon avis. Monsieur, holà ! Monsieur Carondas, réveillez-vous.
CARONDAS
Ah morbleu ! Que la peste soit de votre babil ! Est-il possible qu’on ne puisse faire ici quatre vers en repos, et que les plus belles pensées du monde y soient sans cesse immolées à la pétulante loquacité du premier importun !
CORONIS
Quoi ! Vous faites des vers au café ? Voilà un plaisant Parnasse !
CARONDAS
Je revois a l’épithalame (1) de monsieur Jobelin le notaire et de la fille du logis. Ils attendent qu’elle soit faite pour se marier ; et j’ai bien voulu y donner un de ces quarts d’heure précieux que j’emploie à chanter les louanges des dieux et des héros.
CORONIS
Comment ! La petite Louison se marie ! Et que deviendra le pauvre Dorante ?
LA SOURDIÈRE
Il prendra la peine de s’en passer. Monsieur Jobelin est mon ancien ami, et je dois prendre part à tout ce qui regarde ce mariage. Monsieur Carondas, peut-on voir votre épithalame ?
CARONDAS.
Je n’en ai fait encore que la première strophe. La voici :
Hymen ïo, ô Hyménée !
Célébrons la douce journée,
Où deux amants heureux s’unissent pour toujours.
Venez, tendres Amours, combler la destinée
De cette épouse fortunée.
Que de ses flancs féconds, puisse dans peu de jours
Sortir une heureuse lignée
Hymen ïo, ô Hyménée !
LA SOURDIÈRE
Diable, voilà du sublime, et cela s’appelle un début magnifique.
CORONIS
Et très avantageux pour le futur époux.
CARONDAS
Vous verrez bien autre chose, si je puis obtenir des libraires qu’ils impriment mon incomparable traduction de la Batrachomyomachie (2) d’Homère, car j’excelle dans les traductions des anciens auteurs, et je travaille actuellement à mettre en vers grecs l’Énéide de Virgile, pour la commodité de ceux qui n’entendent point la langue latine. Mais laissez-moi songer à ma seconde strophe.
LA SOURDIÈRE
C’est bien dit ; aussi bien notre café refroidit.
CARONDAS
Du flambeau de l’hymen.
LE SECOND JOUEUR
Attendez, monsieur, ce n’est pas cela ; vous dérangez le jeu.
LE PREMIER JOUEUR
Pardonnez-moi. J’ai joué là vous avez jouez ici ; je vous ai donné à prendre ; vous avez mis dans le coin ; et je vous souffle.
LE SECOND JOUEUR
Ah ventrebleu ! On n’a jamais joué du malheur dont je joue.
CARONDAS.
Eh quoi toujours du bruit ?
Scène II
Le Chevalier, Coronis, La Sourdière, L’Abbé, Carodas, Les Joueurs.
LE CHEVALIER
entre en chantant et dansant.
La, la, la, la, ra, ré. Allons hé du café.
CARONDAS
Encore, de tous côtés ?
LE CHEVALIER
chante.
Que chacun me suive.
Trinquons hardiment,
Point de ménagement ;
Je ne bois jamais autrement.
Je hais un convive
Qui dans un repas
Ne boit que par compas,
Et craindrait de faire un faux pas.
Que chacun me suive.
Trinquons hardiment,
Point de ménagement ;
Je ne bois jamais autrement.
CARONDAS.
Ah ! Je n’y puis plus tenir. Sortons, fuyons : ultra sauromatas hinc libet (3).
LE CHEVALIER
Adieu donc, monsieur Carondas.
À Coronis.
Bonjour, mon ami.
À la Sourdière.
Eh, te voilà, vieux pécheur !
L’ABBÉ
se réveillant et bâillant tout haut.
Ahi ! Ouf !
LE CHEVALIER
Ah parbleu ! Petit Abbé, mon mignon, je ne vous voyais pas. Comment te portes-tu ?
L’ABBÉ
Quelle heure est-il ?
LE CHEVALIER
brouillant le jeu.
Ah ! Ah ! Messieurs, vous jouez aux dames.
LE PREMIER JOUEUR
Morbleu, monsieur, cela ne se fait point ; vous avez tort. Attendez, Monsieur, j’avais gagné. Vous me devez une tasse de café au moins.
LE SECOND JOUEUR
Oui ! Tarare.
Scène III
L’Abbé, Le Chevalier, Coronis, La Sourdière.
L’ABBÉ
Dites-moi un peu, jeunes gens, Dorante n’est-il point venu ici pendant que je dormais ? En cas qu’il vienne, je vous prie monsieur Coronis, de lui dire que je me suis informé de son monsieur Jobelin, et que je suis instruit à fond de tout ce qui regarde cet homme-là.
LA SOURDIÈRE
à part.
Oh, oh ! voici bien d’autres affaires. Malepeste ! Ceci ne vaut pas le diable. Allons l’avertir de ce qui se passe.
Il s’en va.
L’ABBÉ
Pour moi j’ai rendez-vous chez Forel. Il est tard, et j’ai peur qu’on ne soupe sans moi. Je n’ai point dîné.
CORONIS
Comment, monsieur l’Abbé, à dix heures du soir n’avoir point dîné, et être ivre ! Quelle bénédiction !
L’ABBÉ
Je me suis mis à table ce matin entre sept et huit, et nous avons déjeuné jusqu’à l’heure qu’il est.
LE CHEVALIER
Voilà un pauvre garçon qui me fait pitié.
L’ABBÉ
Nous n’avons bu qu’environ vingt-cinq bouteilles de vin à quatre. J’ai fait un petit somme ; me voilà prêt à recommencer.
CORONIS
Quel heureux naturel ! Quel tempérament !
L’ABBÉ
Pour vingt-cinq bouteilles s’enivrer ! Quelle honte est-ce là ? Il n’y a plus d’hommes, mes amis, et le monde va toujours en déclinant. Je soutiens encore un peu noblesse ; mais je m’en irai comme les autres. Bonsoir, messieurs, je m’en vais boire à votre santé.
Scène IV
Coronis, Le Chevalier, Dorante.
LE CHEVALIER
Où diable trouverons-nous Dorante ?
CORONIS
Eh donc ! Le voici, Dieu me damne ! D’où viens tu, grand bélître (4) ? L’Abbé te cherchait tout à l’heure ; il a des nouvelles à t’apprendre.
DORANTE
Où est-il allé ?
CORONIS
Il vient de sortir. Tu le trouveras chez Forel.
DORANTE
Il faut nécessairement que je lui parle ce soir.
LE CHEVALIER
Qu’est-ce, mon ami ; on dit que tu n’épouses plus en ce pays-ci ?
DORANTE
Ma foi, cela m’intrigue un peu, franchement.
CORONIS
Comment tu serais amoureux ? Oh le fat !
DORANTE
Amoureux ou non, je t’assure que la petite personne est fort aimable ; et, sa beauté à part, elle a vingt mille écus. Cela ne messiérait point à un cadet qui n’a que la cape et l’épée.
LE CHEVALIER
Tu n’es pas riche, nous le savons ; mais un gentilhomme se noyer dans une chocolatière ! Il y a de la folie, ma foi ; il y a de la folie.
DORANTE
De la folie ! Va, va, mon pauvre Chevalier, l’intérêt a rapproché les conditions, et nous voyons bien des gentilshommes qui vivraient en roturiers, s’ils n’avaient épousé des roturières.
CORONIS
Sans doute ; et la délicatesse sur les mésalliances ne subsiste plus que chez les Allemands.
DORANTE
Au bout du compte, qu’est-ce que je risque ? Je suis gentilhomme et gueux : elle est roturière et riche ; j’aurai de l’argent pour ma noblesse la compensation ne m’est pas désavantageuse ; Vous êtes tous deux mes amis. Je ne désespère pas encore, et si vous voulez me seconder, avant qu’il soit peu nous ferons bien tourner la chance.
LE CHEVALIER
Oui-da ! De quoi s’agit-il ? Tu sais que je suis à toi, à vendre et à engager.
CORONIS
Tu sais combien je t’aime, et avec quelle fidélité nous avons toujours partagé les émoluments du lansquenet (5).
DORANTE
Voici ce que je veux faire. Vous savez que notre notaire est joueur, et que la confiance qu’il a en son habileté, fait qu’il s’embarque le plus aisément du monde. Or, j’ai un valet, qui assurément est un des plus adroits fripons qu’il y ait à vingt lieues à la ronde. J’ai concerté avec lui qu’il engagerait mon homme au jeu, et que pendant que vous amuseriez ce vieux renard de La Sourdière qui ne le quitte jamais. Mais voici mon valet.
Scène V
La Flèche, Dorante, Le Chevalier, Coronis.
LA FLÈCHE
Monsieur, je n’ai pu trouver votre gros Abbé ; et si, j’ai été dans tous les cabarets de la ville.
DORANTE
Je sais où il est ; il suffit. Va-t’en étudier ton personnage, et reviens quand il sera temps.
LA FLÈCHE
Étudier, dites-vous ? Vraiment, voilà bien de quoi, et j’en ai bien fait d’autres il n’y a que huit jours que j’ai l’honneur de vous servir ; mais quand nous nous connaîtrons mieux, vous verrez qu’en fait de fourberie, personne, Dieu merci, n’est capable de me faire la leçon. S’agit-il de déniaiser quelque étranger nouvellement débarqué de faire mordre un jeune homme à l’hameçon d’une coquette, ou de maquignonner un mariage impromptu c’est moi qu’on vient chercher, j’excelle, je triomphe. Mais surtout pour enfiler une dupe à quelque jeu que ce soit, et lui, tirer par cent moyens ingénieux tout l’argent de sa bourse, je suis le garçon de France le plus en réputation.
LE CHEVALIER
Vertubleu voilà un joli garçon.
DORANTE
Dis-moi ! N’es-tu jamais venu ici ?
LA FLÈCHE
Oh vraiment, monsieur, pardonnez-moi. J’ai été autrefois un des principaux marguilliers du café et j’avais droit de séance à ce banc redoutable, d’où il part tous les jours tant d’arrêts contre la réputation des femmes ; où les mystères du gouvernement sont si bien développés et les intérêts des princes de l’Europe si savamment approfondis. Vous moquez-vous ? Je suis plus connu dans les cafés que Pilot-Bouffi dans les cabarets.
CORONIS
Je gagerais, à l’entendre, qu’il est de quelque province au-delà de la Loire. Il n’est pas permis d’avoir tant d’esprit autrement.
LA FLÈCHE
Je suis de Dauphiné, à vous rendre mes services.
CORONIS
Malepeste ! Joli pays. De l’argent peu, à la vérité mais de l’esprit, beaucoup. C’est l’apanage de la nation.
DORANTE
Mais on te reconnaîtra.
LA FLÈCHE
Point du tout, monsieur ; c’est mon fort que le déguisement, et je suis un petit Protée. Est-il question de représenter un partisan par exemple ; j’ai des secrets pour me noircir la barbe, épaissir ma taille, me rendre l’œil hagard et grossir mon ton de voix. Faut-il faire un jeune abbé ; qui sait mieux que moi rapetisser sa bouche, rire des épaules, marmoter (6) une chanson, faire la main potelée, prendre un visage gai et un ton radouci ? Par cent petites métamorphoses de cette nature, j’avais amassé quelque argent, et je serais à mon aise, sans un revers de fortune qui m’a coulé a fond.
DORANTE
Comment, un revers de fortune ?
LA FLÈCHE
Oui : un fils de famille, à qui j’avais gagné un soir mille écus au jeu s’avisa d éplucher ma conduite dans un procès qu’il me fit ; la justice donna une mauvaise tournure à la chose, et cela m’a ruiné. J’ai été oblige de revenir à la livrée.
DORANTE
Fort bien. Mais voici monsieur Jobelin ; retire-toi, et va te préparer.
Scène VI
Monsieur Jobelin, Le Chevalier, Coronis, Dorante.
JOBELIN
à part.
Il me semble que je suis assez propre, et qu’en cet état je puis aller faire le galant auprès d’une maîtresse.
LE CHEVALIER
à Dorante.
Comme le voilà beau ! Il vient ici pour coqueter. Oh parbleu, il faut que je dérange l’économie de sa parure. Bonsoir, monsieur Jobelin. Vous ne faites pas semblant de nous voir !
JOBELIN
Serviteur, je n’ai pas le temps de m’amuser.
LE CHEVALIER
en l’amusant de son galimatias, lui chiffonne son rabat, le déboutonne, et le met en désordre.
Eh que diable ! Ne saurait-on vous dire un mot ? Je suis bien aise de vous faire compliment sur vos noces ; car enfin il serait fort extraordinaire que dans un café il ne se trouvât pas une fille dont l’esprit pût entrer en concurrence, pour la préférence… de votre indifférence. Vous me direz que quand il s’agit de se marier, il y a peu de conformité entre le douaire de votre affection et le préciput de vos sentiments ; mais aussi vous m’avouerez que quand on veut se retirer dans son ménage, la comédie, le bal et les promenades sont des choses qui divertissent beaucoup. Pour ce qui est de l’opéra, comme je vous dis, je n’aime guère à aller aux Tuileries mais à cela près, je trouve, tout compté, tout rabattu, que c’est fort bien fait à vous de vous marier.
JOBELIN
Que diantre me dit-il là ? J’écoute de toutes mes oreilles, et je n’y comprends rien.
LE CHEVALIER
Mais, à propos de tapisserie, on est quelquefois bien aise de se mettre dans ses meubles. Par exemple, voilà une tabatière qui est assez jolie mais si vous aviez vu les brocatelles de Venise, c’est tout autre chose. Je ne dis pas que Launay ne soit le premier homme que nous ayons en fait de vaisselle ; quoiqu’à le bien prendre, la manufacture des Gobelins ne laisse pas d’avoir son mérite. Mais après tout, depuis que les toiles des Indes sont défendues, je suis pour les bureaux de la Chine.
JOBELIN
Quel coq-à-l’âne est ceci ? Mais à quoi est-ce que je m’amuse ?
Scène VII
Louison, Dorante, Le Chevalier, Coronis, Jobelin.
JOBELIN
Voici ma maîtresse ; il faut la saluer. Mademoiselle…
LOUISON
et les autres.
Ah, ah, ah, ah, ah, ah !
JOBELIN
Qu’est-ce donc que vous avez à rire ? Mais que vois-je ? Comme me voilà débraillé ! Ah ! J’enrage de paraître comme cela. Morbleu, messieurs, je vous enverrai au diable avec vos sottises.
DORANTE
Laissez-moi seul, mes amis. Je vais vous joindre chez Principe et nous achèverons là de régler nos affaires.
Scène VIII
Dorante, Louison.
DORANTE
Hé bien, Louison, vous allez être mariée ; je perds toute espérance d’être à vous et vous avez consenti à un mariage qui me fera mourir.
LOUISON
Mon Dieu ! Pourquoi-me querellez-vous est-ce ma faute à moi ? Ma mère m’a menacée de me renvoyer dans le couvent, si je n’épousais monsieur Jobelin. Je serais bien aise d’être mariée avec vous ; mais je ne veux point retourner au couvent.
DORANTE
Quoi ! Vous verrez vos attraits en proie à un homme haïssable, et qui n’en connaîtra jamais le prix ; et moi, il faudra me résoudre à vous perdre, à ne vous jamais voir ? Ah Louison, je le vois bien, vous ne m’aimez plus.
LOUISON
Allez, allez, laissez faire ma mère, puisqu’elle veut que je me marie. Quand je ne serai plus sous sa conduite, nous nous verrons, et nous nous aimerons tant qu’il vous plaira.
DORANTE
Non, ce n’est pas là de quoi me contenter : et je ne saurais souffrir que votre personne et votre cœur soient partagés. Consentiriez-vous que je fisse en sorte d’empêcher votre mariage ?
LOUISON
Oui, pourvu que ma mère ne sût pas que je vous l’ai conseillé, car elle me querellerait bien fort.
DORANTE
Elle n’en saura rien. Aimez-moi toujours ; c’est tout ce que ma tendresse exige de vous.
LOUISON
Voyez-vous, elle m’a toujours tenue dans la dépendance, et elle ne veut pas seulement que je parle aux messieurs qui viennent ici, parce qu’elle dit que leurs discours font venir l’esprit aux filles. Elle ne veut pas que j’en aie.
DORANTE
Mais, Louison, si ce que je médite allait manquer, que feriez-vous ?
LOUISON
Ce que je ferais ? Dame, je vous l’ai déjà dit ; je ne veux point retourner au couvent. Ah, voilà ma mère. Ne lui dites pas que je vous aime, au moins !
DORANTE
Je vais rassembler les gens dont j’ai besoin pour mon entreprise.
Scène IX
Madame Jérôme, Louison.
MADAME JÉRÔME
Qu’est-ce donc, petite fille, vous parlez à des hommes quand je n’y suis pas ?
LOUISON
Je vous demande pardon, ma mère ; c’est lui qui me parlait.
MADAME JÉRÔME
Monsieur Jobelin est-il ici ?
LOUISON
Oui. Il m’a pensé faire mourir de rire, de la figure dont il était bâti. Apparemment, il est allé se raccommoder et, Dieu merci, il ne m’a point parlé.
MADAME JÉRÔME
Qu’est-ce à dire ? Est-ce ainsi qu’il faut parler d’un homme que vous allez épouser ? Il faut dire Ma mère il ne m’a point parlé j’en suis bien fâchée.
LOUISON
Moi, fâchée de cela ? Je n’aime point à mentir.
MADAME JÉRÔME
Ouais ! Qu’est-ce que tout ceci ? Vous ne l’aimez donc pas, à ce que je vois ?
LOUISON
Moi ma mère ? Hélas ! Non.
MADAME JÉRÔME
Non ?
LOUISON
Non. Vous m’avez dit qu’il ne fallait point qu’une fille aimât les hommes ; je fais ce que vous m’avez dit.
MADAME JÉRÔME
Mais il faut aimer celui-là, puisqu’il sera votre mari.
LOUISON
C’est donc une nécessité qu’il faille aimer son mari ? Si cela est, donnez-m’en un autre, je vous prie.
MADAME JÉRÔME
Comment dites-vous ? Ah, ah ! Petite impertinente, vous êtes entêtée, à ce que je vois ; et quelque colifichet blondin vous aura donné dans la vue. N’est-ce point Narcisse, ce petit fat, qui depuis le matin jusqu’au soir se fait l’amour à lui-même ; qui passe toute la journée à se mirer dans sa perruque, ajuster sa steinkerque, et se faire les yeux doux dans un miroir ?
LOUISON
Oh si ! Ma mère, j’aimerais autant aimer une femme.
MADAME JÉRÔME
Je parie que c’est ce jeune conseiller qui vient ici tous les soirs en épée et en chapeau bordé ?
LOUISON
Qui ? Ce bourgeois qui se croit de qualité, parce qu’il s’enivre avec ceux qui en sont ? Mon Dieu ! Il a mille défauts que je ne saurais souffrir.
MADAME JÉRÔME
Si bien donc que c’est Dorante qui vous tient au cœur ?
LOUISON
Dorante ?
MADAME JÉRÔME
Eh bien Dorante ? Vous ne lui trouvez point de défaut à celui-là ?
LOUISON
Hélas ! Pourquoi lui en trouverais-je ?
MADAME JÉRÔME
Je ne m’embarrasse pas que vous lui en trouviez. Je sais qu’il est assez honnête homme ; mais Monsieur Jobelin a une bonne charge par devers lui, et c’est mieux votre fait qu’un jeune homme qui n’a rien que son esprit et sa bonne mine. En un mot, c’est lui que je veux qui soit votre époux. Le voici qu’on lui fasse civilité, et qu’on réponde comme il faut à tout ce qu’il dira.
Scène X
Monsieur Jobelin, Madame Jérôme, Louison.
MADAME JÉRÔME
Monsieur, voilà ma fille, qui est ravie de vous voir, et qui se dispose le plus agréablement du monde à vous épouser.
LOUISON
Oui, voilà un beau magot, pour être ravie de l’épouser !
JOBELIN.
Mademoiselle, tout ainsi qu’ès-pays coutumiers, le vassal est tenu de prêter serment de foi et d’hommage-lige entre les mains de son seigneur féodal, avant qu’entrer en possession des terres acquises dans sa mouvance ; de même viens-je en qualité de votre vassal indigne, vous promettre foi et loyauté perpétuelle, avant qu’entrer en possession du fief seigneurial de vos beautés, à moi acquis par la cession de madame votre mère, et le contrat qui sera incessamment passé par-devant les notaires au Châtelet de Paris.
MADAME JÉRÔME
Allons, petite fille, répondez.
LOUISON
Moi, je ne sais ce qu’il me veut dire ; qu’il se réponde lui-même, s’il s’entend.
MADAME JÉRÔME
Impertinente ! Elle dit, monsieur, qu’elle vous est fort obligée, et que le don de votre cœur lui est extrêmement cher.
JOBELIN
Mon cœur, mademoiselle, est un immeuble qui vous appartient, et sur lequel vous avez hypothèque, depuis que j’ai eu l’honneur de vous voir.
MADAME JÉRÔME
Eh bien vous voilà muette ?
LOUISON
J’ai bien affaire à son hypothèque ! Je n’en bois jamais.
MADAME JÉRÔME
Ah ! monsieur, il faut l’excuser si elle ne répond pas aux choses que vous dites ; elle est un peu honteuse. Le mariage l’enhardira ; et demain à l’heure qu’il vous plaira nous ferons dresser le contrat. Allons, petite fille. Monsieur, je vous donne le bonsoir.
JOBELIN
après avoir salué Louison, qui détourne la tête.
Voilà ! Les affaires en bon train. La mère prévenue, la fille charmée de moi, le mariage prêt à se conclure, et vingt mille écus qui vont me sauter au collet. Oh parbleu je ne craindrai plus la persécution de mes créanciers, et j’aurai enfin de quoi payer ma charge. Ma foi, les habiles gens se tirent toujours d’intrigue, et l’esprit est le vrai passe-partout de la fortune.
Scène XI
La Sourdière, Jobelin.
LA SOURDIÈRE
Ah ! Vous voilà, à la fin ; il y a deux heures que je vous cherche.
JOBELIN
Ah ! Serviteur je suis bien aise de vous rencontrer.
LA SOURDIÈRE
J’ai bien des choses à vous dire.
JOBELIN
J’ai de bonnes nouvelles à vous apprendre.
LA SOURDIÈRE
La mine est éventée, et Dorante est instruit de toutes vos affaires.
JOBELIN
La bécasse est bridée, et demain le mariage doit être conclu.
LA SOURDIÈRE
Je vous dis encore une fois de prendre garde à vous, et qu’on songe à vous jouer un mauvais tour.
JOBELIN
Un mauvais tour, a moi ? Et qui cela, s’il vous plaît ?
LA SOURDIÈRE
Dorante.
JOBELIN
Dorante ? Ah parbleu c’est bien d’un novice comme lui que je m’embarrasse. Allez, allez, Monsieur de La Sourdière, nous sommes un peu Grecs ; et on ne prend pas des chats comme nous sans mitaines. J’ai mis ordre à tout ; ayez l’esprit en repos.
LA SOURDIÈRE
Vous me faites mourir, avec votre confiance imprudente, et… Mais quelle figure est ceci ?
Scène XII
Jobelin, La Sourdière, La Flèche.
LA FLÈCHE
à part.
Voici mes gens. Jouons bien notre rôle, et faisons les donner dans le panneau. Ah ! Messieurs, serviteur. J’interromps votre conversation, peut-être : mais tout coup vaille. On m’a dit que vous étiez Monsieur Jobelin. Est-il vrai ?
JOBELIN
Oui, c’est moi. Que me veut cet ivrogne-là ?
LA FLÈCHE
Je vous en sais bon gré car j’ai besoin de vous. Je vous ai tantôt été chercher dans votre étude ; mais comme vous n’y étiez pas, je ne vous y ai point trouvé, et je suis allé de là à l’Alliance, prendre un peu de nourriture, modérément pourtant.
JOBELIN
Je le vois bien.
LA FLÈCHE
La modération est une belle chose !
JOBELIN
De quoi s’agit-il ?
LA FLÈCHE
Attendez, que je rappelle mes idées. Ah ! m’y voici. Je voudrais que vous me fissiez un petit plaisir. Je vous demande pardon monsieur, si je parle de mes affaires devant vous. Vous le voulez bien ?
LA SOURDIÈRE
Ah ! Monsieur, de tout mon cœur.
LA FLÈCHE
De tout mon cœur fort bien. Vous êtes un brave homme. Or, comme vous savez, ou comme vous ne savez pas, je suis capitaine dans le régiment de Limoges.
JOBELIN
Vous êtes capitaine ? Et que faites-vous à Paris, pendant que tout le monde est en campagne ?
LA FLÈCHE
J’y suis venu pour faire une recrue ; et en attendant, je passe le temps au cabaret à faire mes observations sur la guerre présente.
JOBELIN
Voilà des observations d’un grand secours à la république !
LA FLÈCHE
D’un grand secours ? Je me donne au diable, si j’étais général d’armée et qu’on me laissât faire, j’ai un plan dans ma tête pour conquérir toute l’Europe en une campagne. Écoutez bien ce raisonnement-ci. Je voudrais avoir deux armées, l’une au midi, et l’autre au septentrion. Avec celle-ci, je marche en Allemagne et je commence par m’emparer de toutes les vignes qui bordent le Rhin. Les Allemands n’ayant plus de vin. Il faut qu’ils crèvent ; la mortalité se met dans leur armée, et par conséquent, me voilà maître de tout ce pays-là. J’y fais rafraîchir mes troupes, et de là je passe en Hollande. Allons, me voilà en Hollande ; qui m’aime me suive. Je vais d’abord… Attendez je crois que nous ferions mieux de conquérir auparavant la Turquie. Qu’en croyez-vous ? Oui, c’est bien dit. Allons, enfants, ne nous rebutons point nous arriverons bientôt. Nous voici déjà dans la Grèce. Ah, le beau pays ! Dieu sait comme nous allons souffler de ce bon vin grec ! Mais messieurs ne vous enivrez pas, au moins. Tudieu ! nous avons besoin de notre cervelle. Buvons seulement chacun notre bouteille, en chantant une petite chanson. Et brin, bron, brac, donnez-moi du tabac, la relera, etc.
JOBELIN
Voilà un pauvre diable qui est bien ivre !
LA SOURDIÈRE
Prenez haleine, monsieur, vous avez fait une assez belle campagne.
JOBELIN
Oui, mais voilà bien du pays battu et pour faire tout ce chemin-là, il faudrait donner des chevaux de poste à toute votre armée. Revenons à votre affaire s’il vous plaît. Que souhaitez-vous de moi ?
LA FLÈCHE
Je m’en vais vous le dire. J’ai quinze hommes à refaire à ma compagnie, avant de retourner à notre garnison ; et comme je n’ai point d’argent, voilà un diamant de cinq cents écus, que je vous prie de me faire mettre en gage pour deux ou trois cents pistoles.
JOBELIN
Pour deux ou trois cents pistoles ! Vous voulez dire deux ou trois cents écus ?
LA FLÈCHE
Eh oui, quelque chose comme cela.
JOBELIN
à part.
Peste voilà un fort beau diamant. Ce serait un vrai présent à faire à ma maîtresse. Tâchons d’empaumer cet ivrogne-là. Monsieur, vous ne trouverez guère que quatre cents francs là-dessus.
LA FLÈCHE
Quatre cents francs ? J’aimerais mieux que le diamant fût au fin fond de la mer Méditerranée. Allons, je m’en vais te jouer au piquet pour cent pistoles contre le premier venu. Je n’aime point à lanterner, moi.
JOBELIN
Parbleu ! Il ne faut point manquer l’occasion ; il est soûl comme une grive, embarquons-le dans le jeu. Monsieur, si vous êtes homme à jouer, je ferai votre affaire.
LA FLÈCHE
Oui ? Parbleu ! J’aime les gens d’accommodement ; touchez là. Je veux vous procurer la pratique du régiment, pour tous les contrats de mariage et d’acquisition de rente que feront nos officiers.
JOBELIN
Je vous remercie. Je crois que les acquisitions aussi bien que les mariages de ces messieurs-là se font aisément sans contrat.
LA FLÈCHE
Allons-nous-en là-dedans boire une bouteille de persicot.
JOBELIN
Volontiers.
À part.
Je tiens l’âne par la bride, et le diamant est bien aventuré.
LA FLÈCHE
Le poisson est dans la nasse, et nous allons voir beau jeu. Allons, mon ami lara, lera, lera.
LA SOURDIÈRE
Il faut que je conduise ceci de l’œil. Je serai bien aise de lui aider à gagner le diamant, afin d’être de moitié.
Scène XIII
Le Chevalier, Coronis, La Sourdière.
LE CHEVALIER. et CORONIS
Ah, ah, ah, ah, ah, ah !
LE CHEVALIER
Parbleu, cela est trop plaisant, ah, ah, ah ! Hé, bonsoir, La Sourdière, où vas-tu ?
LA SOURDIÈRE
Laisse-moi aller, j’ai affaire.
LE CHEVALIER
Je suis ton serviteur. Tu ne t’en iras pas que je ne t’aie conté ce qui vient de nous arriver ; cela mérite bien ton attention. Nous étions chez Principe.
LA SOURDIÈRE
Je n’ai pas le temps de t’entendre.
CORONIS
Oh ! Cadédis, vous nous écouterez, ou nous aurons du bruit.
LE CHEVALIER
Un de nos amis, qui se désennuyait à casser des vitres et des lanternes dans la rue Saint-Honoré, a été poursuivi par une compagnie du guet à pied. Les archers ont passé par devant la boutique. Nous les avons arrêtés en leur présentant du rossolis et de l’eau-de-vie. Ils y ont pris goût ; et pendant qu’ils buvaient, nous leur avons escamoté leurs armes. Ils s’en sont aperçus ; recours à la rasade. Ils ont voulu se fâcher, autre rasade si bien que de rasade en rasade, nous les avons tellement enivrés, qu’ils ont pris querelle ensemble, et se sont donné je ne sais combien de coups de poing. Le sergent, plus ivre qu’eux, les a tous menés au Chatelet, comme perturbateurs du repos public. Ne trouves-tu pas cela plaisant ?
LA SOURDIÈRE
Oui, fort plaisant. Vous jouez à vous faire de jolies affaires. Boire le jour, courir la nuit, casser des vitres, arracher des enseignes enivrer le guet : voilà le secret d’attraper un jour quelques bons coups de mousquet sur les oreilles.
LE CHEVALIER
Oh ! vous voilà, monsieur le Caton, qui parlez par sentences. Parbleu, vous ne le prenez pas mal. Sais-tu bien qu’il n y a rien de meilleur pour la santé, que de berner de temps en temps les gens qui nous déplaisent ? Demande aux médecins cela éclaircit les humeurs, cela rafraîchit le sang, et cela aide à la digestion.
CORONIS
Sans doute. Comment, mordi des coquins s’érigeront en perturbateurs des divertissements de tune, et nous ne réformerions pas cet abus ?
LA SOURDIÈRE
Ma foi, ce sont vos affaires. Serviteur.
LE CHEVALIER
Que diantre, tu es bien pressé ! Parlons un peu d’affaires. As-tu vu le nouvel opéra ?
LA SOURDIÈRE
Non, et n’ai nulle envie de le voir.
LE CHEVALIER
Et toi, l’as-tu vu ?
CORONIS
Oui, certes, je l’ai vu.
LE CHEVALIER
Hé bien ! Dis-nous un peu comment le trouves-tu ?
CORONIS
Cadédis ! Comment je le trouve ? Ravissant, merveilleux. Tout ce qui s’appelle opéra, voyez-vous, ne peut être que bon et agréable ; et la raison, la voici c’est que dans un opéra, vous trouvez de tout, vers, musique, ballets, machines, symphonies ; c’est une variété surprenante, il y a de quoi contenter tout le monde. Voulez-vous du grand, du tragique, du pathétique ?
Le perfide Renaud me fuit.
Tout perfide qu’il est, mon lâche cœur le suit.
Aimez-vous le tendre, le doux, le passionné ?
Non, je ne voudrais pas encor
Quitter mon berger pour Médor.
Voulez-vous du burlesque ?
Mes pauvres compagnons, hélas !
Le dragon n’en a fait qu’un fort léger repas.
Voulez-vous de la morale ?
Les dieux punissent la fierté ;
Il n’est point de grandeur que le ciel irrité
N’abaisse quand il veut, et ne réduise en poudre.
Et le reste. On y trouve jusqu’à des vaudevilles et des imitations naïves des airs du Pont-Neuf, si vous voulez.
Les rossignols, dès que le jour commence,
Chantent l’amour qui les anime tous.
En un mot, c’est un enchantement ; et ce serait une chose accomplie, si l’on pouvait faire encore que le chant fût fait pour les vers, et les vers pour le chant.
LE CHEVALIER
Pour moi, je ne me divertis point à l’Opéra ; et je n’y vais jamais que pour folâtrer dans les coulisses avec quelque danseuse.
CORONIS
Il est vrai que bien des gens y vont présentement pour tout autre plaisir que celui des oreilles.
Scène XIV
Madame Jérome, Le Chevalier, Coronis, La Sourdière.
MADAME JÉRÔME
Messieurs, il est minuit sonné ; faites-moi la grâce de vous retirer.
LA SOURDIÈRE
Volontiers.
LE CHEVALIER
Attends, attends. Et par quelle raison nous retirer, madame Jérôme ?
MADAME JÉRÔME
Par la raison, monsieur, que voici l’heure des femmes ; et puisqu’elles ne viennent pas vous incommoder le jour, il est bien juste que vous leur laissiez la nuit chacun le sien n’est pas trop.
LE CHEVALIER
Vous êtes pour les récréations nocturnes, madame Jérôme.
MADAME JÉRÔME
Oh vraiment, si on n’avait d’autres rentes que la dépense qui se fait ici de jour, et sans le casuel de la nuit, on courrait risque d’avoir les dents bien longues. Vous êtes cinq ou six, qui, pourvu que vous soyez toute une après-dînée ici à chanter des chansons, dire des fadaises, conter une histoire de celui-ci, une aventure de celle-là, et faire la chronique scandaleuse du genre humain, ne vous embarrassez pas du reste. Cependant ce n’est pas là mon compte, et je ne dîne pas de vos conversations. Vous voilà trois, par exemple, qui me devez de l’argent depuis longtemps, et qui ne me parlez non plus de payer, que si vous étiez ici logés par étape.
CORONIS
Quant à moi, madame Jérôme, je vous dois, je pense, trois écus mais j’attends ma lettre de change.
LE CHEVALIER
Pour moi je suis brouillé avec ma petite marchande de dorure, et je ne saurais vous payer qu’à la paix.
LA SOURDIÈRE
Et moi, je vous proteste que le premier argent que je gagnerai à trois dés, sera pour vous.
MADAME JÉRÔME
Voilà des dettes bien assurées.
Scène XV
Jobelin, La Flèche, Mme Jérôme, Coronis, Le Chevalier, La Sourdière.
CORONIS
au chevalier.
Voici nos gens. Songeons à ce que nous a recommandé Dorante.
LA FLÈCHE
Vous me devez six-vingts pistoles ; payez-moi, je ne joue plus.
JOBELIN
Comment vous ne me donnez pas ma revanche ?
LA FLÈCHE
De quoi vous plaignez-vous ? Je vous ai gagné au piquet vous me demandez votre revanche à pair et non, je vous la donne ; je ne vous gagne que douze cents livres ; et j’ai hasardé mon diamant, qui en vaut quinze cents c’est cent écus que je perds clairement. Il me semble que je fais assez bien les choses.
JOBELIN
Tudieu vous avez la parole bien libre, pour un homme qui était ivre il n’y a qu’un moment.
LA FLÈCHE
C’est que je me suis désenivre en gagnant votre argent. Allons, les bons comptes font les bons amis ; payez-moi tout à l’heure ou je vous passe mon épée au travers du corps.
JOBELIN
Messieurs séparez-nous, je vous prie.
LE CHEVALIER
Comment, morbleu, on insulte monsieur Jobelin.
CORONIS
Allons, sandis, coupons les oreilles à ce maraud.
LA SOURDIÈRE
Des épées tirées. Allons-nous-en d’ici.
MADAME JÉRÔME
Messieurs quel désordre je suis perdue.
LA FLÈCHE
Comment, canailles, deux contre un ? Ah, j’ai le corps percé ! Je suis mort ! Un chirurgien !
MADAME JÉRÔME
Miséricorde ! Un homme tué dans ma maison. Me voilà ruinée.
CORONIS
Sauvons-nous, messieurs.
Scène XVI
Dorante, L’Abbé, Mr Jérôme, Jobelin, La Flèche.
DORANTE
Quel bruit ai-je entendu ? Mais que vois-je ? Ah, ciel monsieur de Boisclair, qui vous a mis en cet état ?
LA FLÈCHE
Ah, mon cousin je me meurs. Trois coquins viennent de m’assassiner, et c’est ce scélérat de notaire qui les a fait agir. Eh, de grâce, qu’on me fasse venir le suceur du régiment.
Scène XVII
Dorante, Jobelin, L’Abbé, Madame Jérôme.
DORANTE
Un de mes parents assassinée. Ah ! Je vous apprendrai à qui vous vous jouez. Holà, laquais, qu’on m’aille quérir le commissaire.
JOBELIN
Ah ! Je tremble, et je voudrais être bien loin.
L’ABBÉ
Vous voilà dans un vilain cas, madame Jérôme, et j’en suis fâché pour l’amour de vous.
MADAME JÉRÔME
Monsieur Dorante, ne me perdez pas, je vous conjure.
DORANTE.
Non, non, cela ne passera pas ainsi. C’est mon cousin-germain on l’a assassiné chez vous ; c’est à vous à m’en répondre, et je prétends que justice soit faite.
MADAME JÉRÔME
Eh monsieur, voudriez-vous me ruiner ?
DORANTE
Vous n’en serez, pas quitte à si bon marché et je veux vous faire punir corporellement.
L’ABBÉ
Corporellement cela ne vaut pas le diable madame Jérôme.
Scène XVIII
Dorante, L’Abbé, Madame Jérôme, Jobelin, La Flèche, en commissaire avec un faux nez.
DORANTE
Voici, fort à propos, monsieur le commissaire. Monsieur, on vient de tuer ici un officier qui est de mes parents. Je vous prie de faire votre charge.
LA FLÈCHE
prenant une voix enrouée.
Votre laquais m’a informé de la chose, et j’amène des archers pour conduire les délinquants au Châtelet.
MADAME JÉRÔME
Au Chatelet !
JOBELIN
Monsieur, je suis notaire royal, et conseiller du roi.
LA FLÈCHE
N’importe ; le délit est flagrant il y a mort d’homme et vous viendrez au Châtelet.
MADAME JÉRÔME
Ah ! Je suis au désespoir. Monsieur l’Abbé, faites en sorte que je n’aille point au Châtetet.
L’ABBÉ
Attendez, je viens de trouver un moyen d’ajuster ceci. Dorante il faut accommoder cette affaire-là mon enfant. Il ne tient qu’à toi de ruiner madame Jérôme, mais en seras-tu mieux ? Elle a une jeune fille il faut qu’elle te la donne en mariage, et qu’il ne soit plus parlé de rien.
DORANTE
Non non, madame l’a promise à monsieur Jobelin il faut la laisser faire. Elle le croit riche, et je vois bien.
L’ABBÉ
Lui riche ! Il n’a point d’autre patrimoine que son industrie, et il y a actuellement une sentence contre lui pour le paiement de sa charge n’est-il pas vrai, monsieur Jobelin ?
JOBELIN
Ah ! Tout est découvert ; j’enrage.
MADAME JÉRÔME
Qu’entends-je ? Vous devez votre charge, monsieur ? Vraiment, un jour plus tard j’allais faire un joli marché !
L’ABBÉ
Eh bien madame, êtes-vous dans le goût de ma proposition ?
MADAME JÉRÔME
Oui, monsieur, puisque je suis détrompée, je serai ravie de donner ma fille à monsieur Dorante, pourvu qu’il apaise l’affaire qui vient d’arriver.
L’ABBÉ
Oh, pour cela, madame, il en est le maître, je vous assure. Çà, il n’y a qu’a dresser le contrat tout à l’heure. Monsieur Jobelin se trouve ici fort à propos.
JOBELIN
Moi dresser le contrat ?
DORANTE
Tout beau, ne vous faites pas tirer l’oreille ou je vais faire entrer les archers.
LA FLÈCHE
Et l’on vous mènera au Châtelet.
JOBELIN
Quoi j’aurais encore la mortification de faire le contrat de mariage de mon rival ? Ah maudit pair et non.
DORANTE
Allons, monsieur l’Abbé, et monsieur le Commissaire, venez servir de témoins et signer au contrat que nous allons passer tout à 1’heure.
LA FLÈCHE
Ma foi, voilà une véritable aventure de café.
**
Fin de la pièce.
**
Jean-Baptiste ROUSSEAU : OEUVRES.
Nouvelle édition, revuë, corrigée & augmentée sur les manuscrits de l’auteur, & conforme à l’édition in-quarto, donnée par M. SEGUY. Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1759.
Tome 2 : Pièces de théâtre : les ayeux chimériques, le capricieux, le flateur, le caffé, la ceinture magique, la dupe de soi-mesme, la mandragore, Jupiter et Semele, l’héliotrope, Faune et Omphale, Ariane et Bacchus.
***
NOTES
(1)
L’épithalame, poème lyrique composé chez les Anciens à l’occasion d’un mariage et à la louange des nouveaux époux. En Grèce antique, il était chanté par un chœur avec accompagnement de danses.
(2)
La Batrachomyomachia, épopée comique parodiant l’Iliade, de 303 hexamètres dactyliques. Les vers 9 à 88 présentent des similitudes fortes avec la fable d’Ésope : Le Rat et la grenouille. Elle fut largement attribuée, dans l’Antiquité, à Homère.
« En commençant, et avant tout, je supplie le chœur des Muses de descendre du Hélikôn en mon esprit, à cause d’un chant que j’ai mis dans mes tablettes, récemment, sur mes genoux ; guerre immense, œuvre pleine du tumulte guerrier d’Arès, me flattant de faire entrer dans les oreilles de tous les hommes comment les Rats, combattants intrépides, se ruèrent sur les Grenouilles, imitant les travaux des Géants nés de Gaia, ainsi qu’on le rapporte parmi les mortels. Et cette guerre eut cette origine. » (Batrakhomyomakhia – Homère -Traduction Leconte de Lisle)
(3)
Début de la seconde satire de Juvénal
« Ultra Sauromatas fugere hinc libet, et glacialem
Oceanum, quoties aliquid de moribus audent
Qui Curios simulant, et Bacchanalia vivent…
Je fuirais volontiers dans le fond des déserts,
Sur les monts de la Thrace et par delà les mers,
Quand j’entends ces Scaurus, effrontés sycophantes,
Qui prêchent la pudeur et vivent en bacchantes... »
(SATURA II / SATIRE II. (Traduction de L. V. RAOUL, 1812)
(4)
Bélître ou bélitre
Terme injurieux
« C’est un misérable, un homme vil. Ce mot, qu’on croit formé du latin balatro, qui signifie gueux, coquin, parasite, s’employait autrefois pour mendiant, dans une acception qui n’avait rien de reprochable. Les pèlerins de la confrérie de Saint-Jacques, à Pontoise, avaient pris le titre de Bélistres, et les quatre ordres mendiants s’appelaient les quatre ordres de Bélistres. Montaigne a donné un féminin au mot bélître dans cette phrase remarquable (Essais, liv. iii, chap. 10) : « Desdaignons cette faim de renommée et d’honneur, basse et bélistresse, qui nous le fait coquiner de toute sorte de gens par des moyens abjects et à quelque prix que ce soit. C’est déshonneur d’estre ainsi honoré. »
Pierre-Marie Quitard, Dictionnaire étymologique, historique et anecdotique des proverbes et des locutions proverbiales de la langue française – P. Bertrand, 1842 (p. 131).
(5)
Le Lansquenet
« LANSQUENET, (Jeu de hasard.) voici en général comme il se joue. On y donne à chacun une carte, sur laquelle on met ce qu’on veut ; celui qui a la main se donne la sienne. Il tire ensuite les cartes ; s’il amene la sienne, il perd ; s’il amene celles des autres, il gagne. Mais pour concevoir les avantages & desavantages de ce jeu, il faut expliquer quelques regles particulieres que voici. On nomme coupeurs, ceux qui prennent cartes dans le tour, avant que celui qui a la main se donne la sienne. On nomme carabineurs, ceux qui prennent cartes, après que la carte de celui qui a la main est tirée… » (Diderot, L’Encyclopédie, Première édition – 1765 (Tome 9, p. 275-276)).
(6)
Marmotter : parler confusément, en parlant entre ses dents.