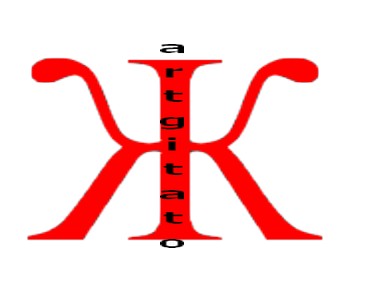Sénèque
DE BREVITATE VITAE
De la brièveté de la vie

Traduction Jacky Lavauzelle – artgitato.com
CHAPITRE I
Maior pars mortalium, Pauline, de naturae malignitate conqueritur,
La grande majorité des mortels, Paulinus, se plaignent de la malignité de la nature,
quod in exiguum aeui gignimur, quod haec tam uelociter,
que nous naissons pour une vie si courte, que les choses vont si vite
tam rapide dati nobis temporis spatia decurrant,
que le temps qui nous a été accordé passe si vite
adeo ut exceptis admodum paucis ceteros in ipso uitae apparatu uita destituat.
si bien qu’à l’exception d’une minorité, les hommes ne trouvent la vie que quand elle les abandonne.
Nec huic publico, ut opinantur, malo turba tantum et imprudens uulgus ingemuit :
Ce fait, selon l’opinion, ne concerne pas uniquement la foule et le vulgaire
clarorum quoque virorum hic affectus querelas evocavit.
Il est clair que les hommes célèbres sont aussi affectés par ces plaintes.
Inde illa maximi medicorum exclamatio est :
De là ce que s’écria le plus grand des médecins :
« Vitam brevem esse, longam artem« .
“La vie est courte, l’art est long.”
Inde Aristotelis cum rerum natura exigenti, minime conveniens sapienti viro lis est :
De là ce qu’Aristote, avec l’argument de la nature, incompatible avec la nature du sage, dit ;
illam animabilibus tantum indulsisse, ut quina aut dena secula educerent,
La nature a montré une telle faveur aux animaux, enfantant pendant cinq ou dix existences,
homini in tam multa genito, tanto citeriorem terminum stare.
l’homme aux multiples talents, lui doit se contenter d’un temps beaucoup plus court.
Non exiguum temporis habemus : sed multum perdimus.
Nous n’avons pas un manque de temps : nous en perdons seulement beaucoup.
Satis longa vita, et in maximarum rerum consumationem large data est,
La vie est assez longue, et un maximum de choses peut y être accompli,
si tota bene collocaretur.
si tout y est bien employé.
Sed ubi per luxum ac negligentiam defluit,
Mais quand c’est dans le luxe et l’insouciance,
ubi nulli rei bonae impenditur ;
il ne se consacre à rien de bon ;
ultima demum necessitate cogente,
Au dernier moment enfin,
quam ire non intelleximus, transisse sentimus.
celui que nous percevons, nous presse alors.
Ita est, non acceptimus brevem vitam, sed fecimus :
C’est la vérité, nous n’avons pas une vie courte, mais nous l’avons faite ainsi :
nec inopes ejus, sed prodigi sumus.
nous ne le voulons pas, mais nous la gaspillons.
Sicut amplae et regiae opes,
Tout comme de grandes et princières richesses,
ubi ad malum dominum pervenerunt,
qui sont données à un mauvais propriétaire,
momento dissipantur, at quamvis modicae,
dispersées en un moment, alors qu’une modeste fortune,
si bono custodi traditae sunt, usu crescunt :
à un bon gardien, croît avec l’usage :
ita aetas nostra bene disponenti multum patet.
de même notre vie sera assez longue si on en dispose avec sagesse.
CHAPITRE II
Quid de rerum natura querimur ?
Pourquoi se plaindre de la nature?
Illa se benigne gessit : vita, si scias uti, longa est.
Elle s’est montrée bienveillante, la vie, si on sait comment la vivre.
Alium insatiabilis tenet avaritia :
L’un est rongé par une insatiable cupidité,
alium in supervacius laborius operosa sedulitas :
un autre par une pénible dévotion à d’inutiles tâches,
alius vino madet :
un autre demeure aviné,
alius inertia torpet :
un autre paresseux,
alium defatigat ex alienis judiciis suspensa semper ambitio :
un autre fatigué d’ambition qui reste suspendu au jugement d’autrui,
alium mercandi praeceps cupiditas circa omnes terras,
un autre se targue de négoces et pousse son avidité sur toutes les terres,
omnia maria, spe lucri, ducit.
toutes les mers, dans l’espoir de gain.
Quosdam torquet cupido militae,
Certains tourmentés par la cupidité des combats,
nunquam non aut alienis periculis intentos, aut suis anxios :
n’ont jamais oublié de mettre les autres en péril, sans autre anxiété,
sunt quos ingratus superiorum cultus voluntaria servitute consumat.
Enfin certains se dévouent à d’illustres ingrats dans une servitude volontaire.
Multos aut affectatio alienae fortunae,
Beaucoup désirent s’aliéner les fortunes des autres hommes,
aut suae odium detinuit :
ou haïssent leur destinée :
plerosque nihil certum sequentes,
plusieurs sans but particulier suivent
vaga et inconstans et sibi displicens levitas per nova consilia jactavit.
une pente vague et inconstante, jettent leur dévolu sans cesse sur de nouveaux projets.
Quibusdam nihil quo cursum dirigant, placet,
Certains ne trouvent rien qui les attire, et les rend heureux,
sed marcentes oscitantesque fata deprehendunt :
mais la mort les ramasse sans qu’ils n’aient jamais eu de destinée,
adeo ut quo apud maximum poetarum more oraculi dictum est,
tant et si bien qu’il a été dit, à l’instar d’un oracle, par le plus grand des poètes,
verum esse non dubitem :
Je ne doute pas de cette vérité :
Exigua pars est vitae, quam nos vivimus ;
Nous ne vivons qu’une petite partie de notre vie
certum quidem pmne spatium,
Il est certain que toutes les autres parties,
non vita, sed tempus est.
ne sont pas de la vie, c’est du temps écoulé.
Urgentia circumstant vitia undique :
Le vice nous entoure partout,
nec resurgere, aut in dispectum veri attollere aculos sinunt,
il s’accroît tellement que nos yeux ne sont permettent plus de discerner la vérité,
sed mersos, et in cupiditabitus infixos premunt.
mais nous plonge dans le bain des victimes de la cupidité.
Nunquam illis recurrere ad se licet,
Nous ne sommes plus autorisés à retourner à notre moi véritable,
si quando aliqua quies fortuito contigit :
même quand le hasard fortuitement relâche l’étreinte des passions,
velut in profundo mari,
flottant comme sur une mer profonde,
in quo post ventum quoque volutatio est,
sur laquelle les vagues restent agitées même après que la tempête soit passée,
fluctuantur, nec unquam illis a cupiditabitus suis otium instat.
jamais à la folie des passions le calme ne fait suite.
De istis me putas disserere,
Vous pensez que je n’évoque que des personnes,
quorum in congesso mala sunt :
qui ont accumulés les maux :
aspice illos ad quorum felicitatem concurritur :
Regardez ces hommes qui vont vers la prospérité :
bonis suis effocantur.
étouffant sous leurs biens.
Quam multis graves sunt divitiae ?
Combien, nombreux, sont sous le poids des richesses ?
Quam multorum eloquentia,
Combien, nombreux, pour cette éloquence,
quotidiano ostentandi ingenii spatio, sanguinem educit ?
ont déployé leur génie, et fait couler le sang?
quam multi continuis voluptatibus pallent ?
combien sont épuisés de leurs continuels plaisirs voluptueux ?
quam multis nihil liberi relinquit circumfusus clientium populus ?
De nombreux clients se pressent à leur sujet ne leur laissant aucune liberté ?
Omnes denique istos, ad infimis usque ad summos, pererra :
Enfin, dans tout cela, en ce qui concerne la plus haute comme la plus basse société,
hic, advocat, hic adest, ille perilitatur, ille defendit, ille judicat.
l’un veut une sommation, un autre souhaite qu’on l’assiste, celui-ci s’estime être en péril, l’autre veut qu’on le défende, celui-là est juge.
Nemo se sibi vindicat :
Personne ne s’appartient :
alius in alium consumitur.
les uns se consument avec les autres.
Interroga de istis, quorum nomina ediscuntur :
Renseignez-vous sur ces hommes, dont les noms sont connus de tous :
his illos dignosci videbis notis :
vous les verrez différemment :
“hic illius cultor est, ille illus, suus nemo.”
«ici l’un rend ses devoirs à l’un, celui-ci à un autre, mais pas à soi-même. ».
Deinde dementissima quorundam indignatio est :
Ensuite, certains s’indignent dans des démentielles colères:
queruntur de superiorum fastidio,
se plaignant du faste des gens supérieurs,
quod ipsis adire volentibus non vacaverint.
qui n’ont pas eu le temps de les recevoir.
Audet quisquam de alterius superbia queri,
Comment ont-ils l’audace de se plaindre de la fierté d’un autre,
qui sibi ipse nunquam vacat ?
celui qui n’a jamais le temps pour soi ?
Ille tamen, quisquis est, insolenti quidem vultu,
Cet homme, quel qu’il soit, avec son visage insolent,
sed aliquando respexit :
vous a respecté,
ille aures suas ad tua verba demisit :
vous a écouté,
ille te ad latus suum recepit :
placé à ses côtés,
tu non inspicere te unquam,
alors que vous, vous ne vous êtes jamais regardé,
non audire dignatus es.
ni accordé une audience.