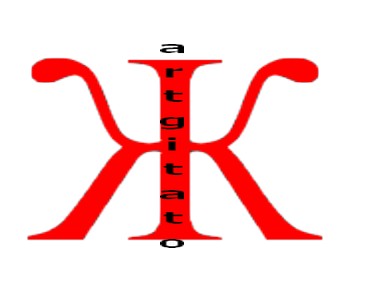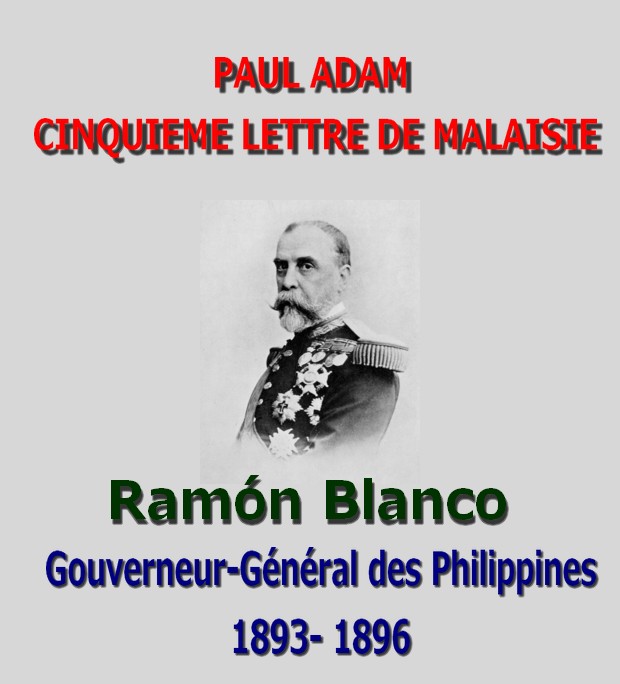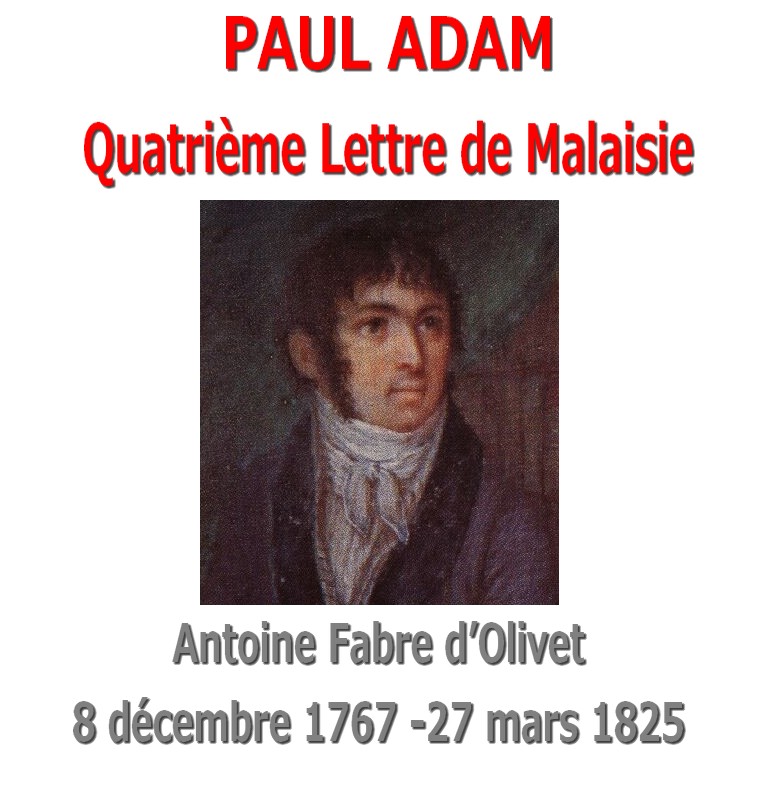MALAISIE – MALAYSIA
PAUL ADAM LETTRES DE MALAISIE
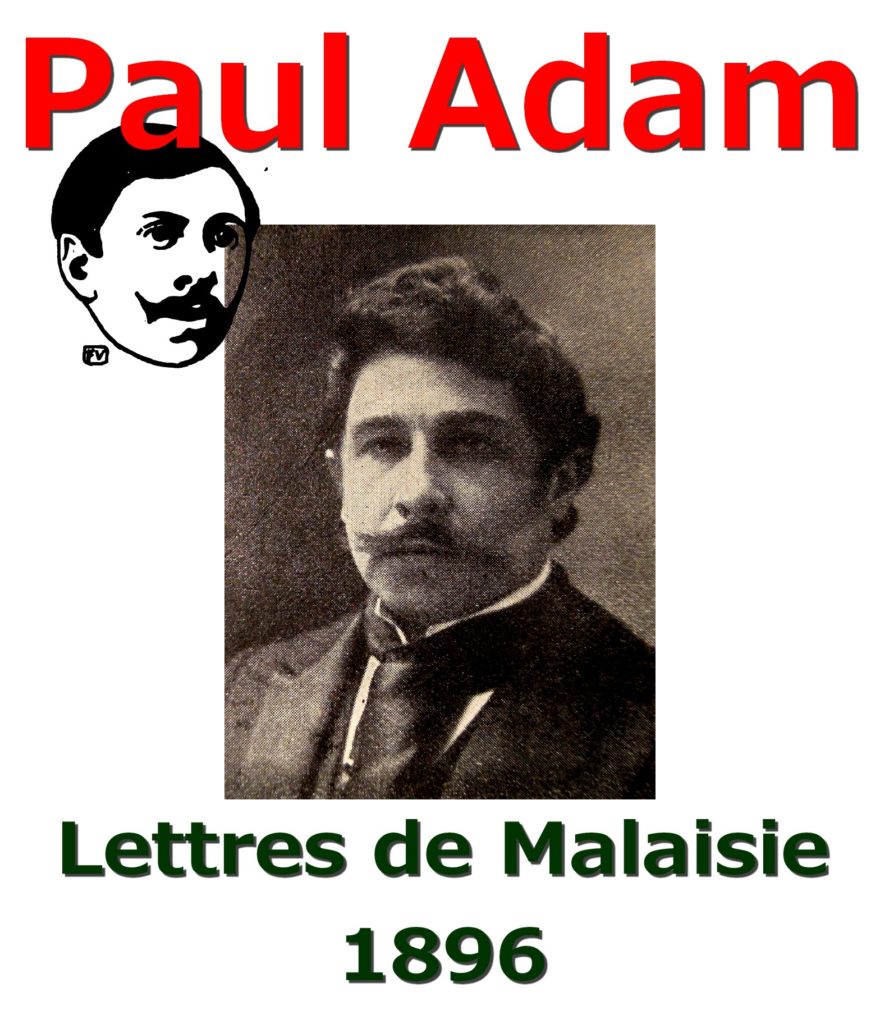
D’après une photo de Nadar et le portrait de Félix Valloton
—
PAUL ADAM
1862 – 1920
LETTRES DE MALAISIE
1896
CINQUIEME LETTRE
Texte paru dans La Revue Blanche
Paris
1898
*****
 Portrait de Paul Adam
Portrait de Paul Adam
Félix Vallotton paru
Le Livre des masques de Remy de Gourmont
1896
***
CINQUIEME LETTRE DE MALAISIE
Palais des Hôtes
Sous un soleil lourd, réfléchi dans les verreries des toits, des dômes, des baies, des serres ; la ville se fête.
De hauts pans de soie violette, pourpre et blanche frissonnent le long des façades. Sur beaucoup, les dieux sont peints. On retrouve sans cesse la grande figure de la Vierge avec sa robe pleine de cités et de peuples en marche. À la surface de ses yeux de métal, les navires voguent, gravés. Le lait fuyant de sa mamelle contient les noms des Noumènes, mêlés aux créatures des trois règnes, et Jésus, assis sur son giron, porte inscrites par toute la nudité de son corps les maximes qui résument les spéculations des philosophes. Généralement derrière Elle, les deux directions de la croix, se traversent. Peintes ou sculptées elles reproduisent l’emblémature de courants éthéréens. Les planètes semblent y être entraînées dans une course descendante, remontante, horizontale, qui les roule, et les unit aux comètes, aux soleils, aux noyaux des nébuleuses, aux hordes d’astres.
D’une aile, le Saint Esprit touche la cime de la Croix ; de l’autre il atteint le front du Christ. Les pennes de ce volatile sacré, vastes comme celles de nos archanges enveloppent le Fils et la Vierge-Mère d’une même protection presque blanche, bien que chaque septénaire de plumes porte les nuances du prisme. Enfin le triangle de la Trinité encadre lumineusement la complication du symbole.
Cela se répète partout, sur les pans de soie, hauts comme les façades, sur les litières où le clergé le porte en groupes de métal, d’ivoire, et de bois. La statue de Manès, celle du Bouddha, ornent aussi les reposoirs. Aux trépieds, enguirlandés de fleurs fraîches, de roses et de violettes, de dahlias, fument les parfums.
Le tramway qui entraîne mes deux amies et moi ne glisse point sur roues, mais sur une sorte de quille en acier s’emboîtant dans un seul rail. Les coussins sont moelleux. Avec rapidité nous filons parmi le murmure joyeux des avenues. Les uniformes corporatifs, s’assemblent sous les portiques, autour des nymphées : les scribes noirs, les usiniers cramoisis, les chinois des services publics en costume national, les malais de la voirie, porteurs de cannes, la tête sous une mitre jaune. Nous glissons entre les édifices, indéfinis, tout ouverts, et laissant voir, dans leurs salles, des assemblées. Naturellement, les orgues glorifient le jour. Les insurgés des Philippines viennent de battre nos troupes espagnoles ; et la Dictature oligarchique fête cette victoire qu’il nomme celle de la Liberté contre la Tyrannie. Voici la procession, pareille à toutes les processions catholiques. Seulement les costumes, et les objets du culte sont d’un luxe indicible. À cheval, cent très belles filles en bas de cuir violet, le torse nu, la tête couronnée de fleurs énormes, précèdent le Saint-Sacrement, et balancent des encensoirs d’or. Depuis les hanches jusque le dessous des seins, elles portent des corselets de tissus que garnissent des joyaux composant par leur assemblage la forme de plantes fabuleuses. Leur chevelure répandue coule d’un petit bonnet en treillis d’argent. Aux cimes de leurs seins de gros rubis scintillent. Les courtes jupes de lanières noires et vertes terminées par des boules d’or creux, flottent contre les selles de velours. Aux mors des chevaux se suspendent des éphèbes, nus également depuis les mamelles jusqu’aux caleçons de satin blanc qu’un soleil en pierreries illustre à l’endroit du sexe. Des bottes souples en peau blanche couvrent leurs jambes et leurs cuisses. Les dextres tiennent un thyrse, ou un caducée. Surmontés par les ailes décloses de colombes, de petits casques coiffent leurs chevelures.
D’autres, montés sur des chevaux noirs, soufflent dans de fines trompettes. Des femmes robustes marchent contre leurs étriers. Elles ont la gorge soutenue par des réseaux de pourpre, la robe faite de canevas noir où s’engagent des roses jaunes. À la tête, elles portent des tiares de myosotis.
Viennent des hommes géants, aux barbes ondulées et semées de paillettes. Des couronnes royales les sacrent. Les poils de leur torse sont jaunis de henné. Ils montrent toute la beauté de la vigueur virile. Ils retardent l’impatience des lévriers en laisse, des molosses, des lionceaux, des antilopes, et des cerfs. Certains portent des pelles, d’autres des pioches brillantes, ceux-ci des leviers de cuivre fourbi, ceux-là des marteaux dorés, d’autres élèvent des équerres et des truelles au bout de hampes écarlates. En un char bas qu’ils traînent, une machine de métal rouge s’avance. Son volant, ses bielles d’acier poli, luisent plus froidement contre l’autre métal qui garde l’éclat sombre du fer incandescent. Dans leurs vêtements cramoisis, les usiniers défilent, en armée, derrière ce char. Tous ont au chapeau la ramille verte et sur l’épaule un caducée de bois. Suivent les scribes, vêtus de noir, puis les chinois en robes de soie brune, et deux cents fillettes à pied, avec des oiseaux privés sur les doigts, des cannes d’ivoire, des tuniques blanches à traîne, des couronnes de lauriers aux cheveux. Ensuite mille ballerines, par essaims, qui dansent chacun, un pas différent. Les doigts sonnent sur les tambourins. Les ongles frôlent les cordes des lyres. Les poings menus agitent les sistres et choquent des cymbales. D’aucunes, dans des gaines écailleuses, se tordent comme les ophidiens ; et des perruques d’argent frissonnent contre leurs joues. Au milieu d’ailes violettes, d’autres bondissent sur leurs jambes vigoureuses, les seins passés à travers les ouvertures oblongues des corsets bleus. Corolles aux jambes vertes, des fleurs tournent. Tout un escadron représente les minéraux. Il passe des idoles de diamant, de topaze, de saphir ; de vivantes statues en granit, en malachite, en marbre clair. Avec une fille d’or, une d’argent, une de fer, une de cuivre, les métaux s’irradient. Des adolescentes simulent les créatures de l’eau, algues et poissons. Leur lente chorégraphie marque l’indolence des corps qui flottent.
O cette armée de danseuses ! Elle se déroule durant une heure entière. Hors des collèges, des lycées, des gymnases, toutes les filles de quelque beauté s’étaient rendues à la parade. Sur la nudité de leurs membres une sorte de fard met une moirure miraculeuse, en sorte que nul défaut d’épiderme ne se décela. Leurs chairs semblaient d’une fraîcheurs éclatante, un peu vernie. Parfums qui vous échappiez de leurs gestes, et vous, fleurs, fleurs, fleurs jetées, fleurs des costumes, fleurs des tiares, fleurs des guirlandes, fleurs de bouquets, couleurs innombrables des fleurs !
Entre les façades d’émail, les escouades de danseuses comblent l’avenue. Avec leurs évolutions, marchent des éléphants blancs porteurs de tours où s’ébattent, au faîte, des aigles apprivoisés. Il glisse sur la rainure du rail maintes quilles de hauts chars dont la file présente successivement les dieux de tous les cultes connus, avec leurs prêtres et leurs prêtresses en costume sacerdotal officiant autour des autels. Le palanquin d’une Mère oscille aux épaules de douze vierges en maillots de soie rayée. Parmi des voiles blancs et jaunes, la femme enceinte étendue, sous le dais, et sous le mouvement des chasse-mouches montre un visage pâli que bande un diadème. Autour d’elle, les danseuses vont, les chœurs chantent un hymne et des litanies ; les cymbales retentissent, les harpes vibrent. Brancards de fleurs, tentures d’étoffes lourdes à broderies illustrées, dais de brocart blanc, les palanquins se succèdent entre les chars des dieux, les bataillons de danseuses, les chœurs d’enfants aux robes de pourpre.
Enfin l’image colossale de la Vierges termine le centre du cortège, derrière un clergé d’évêques, de diacres, de bonzes, de lamas, de muftis, de softas, de bayadères entourant l’altière blancheur d’un vieillard qui, Pape, offre, sous un dais de métal rouge, l’Ostensoir, image des cycles universels, et du grand Feu Védique.
Sur son manteau bleu comme une montagne lointaine, la chevelure de La Mère, est une forêt d’arbres minuscules. Ses genoux sont deux cascades. Le miracle d’un parfait mécanisme lance, derrière elle, dans la haute croix de verre, les boules lumineuses des astres, des soleils, et des comètes.
Ensuite, se suivent encore des cavaleries de belles filles sur des étalons blancs. Elles sonnent par de longues trompettes fines. Et voici, de plus, les jeteuses de fleurs, les palanquins des Mères, les ballerines, les harpistes, les chœurs d’enfants somptueuses.
Et cela se perpétue. Je ne saurais tout vous dire. Mes yeux d’ailleurs se lassèrent. Je reportai mes regards sur Pythie et Théa. Elles me parurent en extases, ces créatures d’une froideur et d’un mépris insupportable envers toutes choses ! Je les interrogeai.
— Vous ne comprenez pas, me dirent-elles. Ces corps harmonieux, ces jeux de nuances unies aux plis des robes, ces symboles des religions évoquent en nous tant d’idées subtiles et universelles, à la fois. L’histoire totale des Évolutions se lit de geste en geste, de groupe en groupe. Le cortège est pour nous un volume qui se déroule. L’immense poème des Forces est chanté dans la splendeur des antilopes, des aigles, des ballerines, et des mâles. Nous sentons Dieu et Tout. Une semence vigoureuse jaillit dans nos imaginations, les féconde. Le point, le centre, l’i, le jod, le phallos et Dieu nous pénètrent à cet instant, et nous font hennir et cabrer pour des jouissances mémorables. Evidemment, avec votre éducation d’Europe, vous ne voyez ici que des femmes nues, et le passage des bêtes empruntées à un jardin zoologique. Pour nous c’est l’Harmonie qui passe, c’est le jet de la création qui fuse. Ne parlez plus. Laissez, nous vous en supplions, panteler nos Esprits…
Je me dressai sur la hauteur de la voiture. Alors je vis l’ensemble du défilé. À travers la courbe de l’avenue, cela s’étendait et se mouvait selon la forme du phallos créateur, le long de deux ou trois milles. Les groupes de statues, éternisant les visages des inventeurs, regardaient du haut de leurs socles, autour de leurs machines de bronze, ce passage monstrueux de La Vie.
Les grandes voix des phonographes alternaient avec celles des orgues, et déclamaient des strophes. Les chœurs répondaient, dans le cortège, puis les lyres, les trompettes et les danses.
Sottise ou bon sens, j’avoue ne pas m’être réjoui autant que mes compagnes, ni les autres gens amassés dans la voiture, Tout cela me parut bien obscur, bien pédant… et pas mal pornographique. Malgré tout, le cœur de l’honnête homme se révolte à ces spectacles de nudité. Si large d’esprit que l’on puisse se dire, il ne convient pas d’approuver la débauche, lorsqu’elle s’érige en principe de gouvernement et de religion.
Le lendemain, à l’audience qui me fut accordée par la Dictature, je ne pus m’empêcher de le soutenir à l’Oligarque me reprochant les pratiques usitées jadis par l’Inquisition et rétablies dans la province de Cavite, par notre général Blanco, afin de punir les insurgés philippins.
Grande femme, habillée en mousquetaire blanc, l’oligarque sourit à mon réquisitoire et changea la conversation.
On me recevait dans une pièce vaste, extrêmement simple. Les murs de stuc ne m’étonnèrent que par leur altitude élevant un dôme de verre bleuâtre. L’oligarque, m’examinait de ses petits yeux pareils à des parcelles d’argent vif. Elle se tenait dans un fauteuil de velours blanc et, derrière elle, contre la muraille se déployait la bannière de l’Etat, mi-noire, mi-rouge.
— Et si, me dit-elle brusquement, nous usions de notre supériorité mécanique, pour fondre sur l’Europe, anéantir ses armées à l’aide des projectiles lancés par nos frégates aériennes, lui imposer ce que nous croyons l’Intelligence, l’Harmonie, le Meilleur Sort ?..
— Bah !
— Ce serait ; ce sera notre devoir…
La grande femme se leva, et se mit à marcher de long en large sur le caoutchouc du plancher. Elle avait des cheveux incolores et roides, une figure défraîchie, des lèvres mortes, des mains osseuses. Une subite colère enflamma ses joues plates. Elle revint sur moi, criant :
— Oui, oui… Les temps viennent. Vous, les Espagnols, avec la cruauté des âges anciens, vous activez la hâte de nos projets. Ne croyez pas que notre âme voie sans passion votre injustice écraser l’ardeur cubaine depuis trente ans, fusiller les anarchistes de Xérès et de Barcelone, réinventer pour les Philippines les instruments de l’Inquisition. Le sang répandu sur le monde fume jusqu’à nous, et notre force tremble d’impatience. Le voile d’hypocrisie sera durement arraché de la figure du monde… L’immoralité de la Puissance devient trop grande partout. Ce n’est pas seulement pour nous réjouir et cesser de pâtir que Jérôme le Fondateur mena sur ce sol notre race, et sema la vérité dans les esprits de sa descendance. Il nous a créé des devoirs aussi. Cent trente mille Arméniens périssent égorgés, et les Pouvoirs Chrétiens, par une ignoble avidité et par une ignoble défiance mutuelle, menacent de guerre qui osera fermer l’écluse du sang faible. Jamais, en aucun temps, cela ne fut. L’histoire nomme les Croisades. Pour quel exemple ?…
— L’Europe serait bien heureuse, dis-je, ironiquement, si la Dictature pouvait prescrire un moyen de terminer ces massacres, sans ouvrir le conflit européen.
— La Belgique et la Suisse ne peuvent-elles agir au nom du Concert chrétien, puis établir la Confédération Byzantine sur l’exemple de la Fédération helvétique, avec les petits États des Balkans, la Grèce… Mais laissons cela. La note que l’on a fait remettre à la Dictature, de votre part, demande, au nom de l’Espagne, des explications sur l’aide prêtée aux libertaires de la province de Cavite. Notre Oligarchie compose en ce moment la réponse. Je crains qu’elle ne soit pas de nature à satisfaire entièrement les ministres de l’Espagne.
— Ah !
Je me levai. D’un signe la grande femme me fit rasseoir. Elle continua de marcher, gardant un silence fâcheux. Plus lointaine, elle me parut une autruche à ailes blanches, à pattes rouges ; ses guêtres étant de maroquin ainsi nuancé. De multiples pas étroits la faisaient sautillante. Elle atteignit le mur, et revint vers moi, rapidement, les mains étendues, tel un volatile en colère.
— Oui, oui ; il vaut mieux tout dire. Il faut tout dire, reprit-elle. Sachez-le donc. Il y a trois ans déjà, nos prédécesseurs préparèrent un plan pour la conquête de l’Europe et l’extinction graduelle de l’injustice sociale. Je ne vous parlerai pas des projets militaires, mais je puis indiquer les principes généraux qui doivent guider la conduite de nos stratèges au lendemain de la victoire.
— Cela m’intéresserait fort, dis-je,
— Dans un an ou deux, cela vous intéresserait plus encore, cria-t-elle durement, de sa voix aigre ; et un écho rejeta d’angle en angle la sonorité de sa prophétie.
Je laissai le sourire animer ma lèvre. La folle s’exaspérait, de plus en plus semblable à une autruche de basse-cour qu’un dindon frustra de sa provende.
Elle déclama tumultueusement :
— Supposez un instant ceci. Nos escadres aériennes planent sur Paris. Elles ont franchi toutes vos lignes militaires, réduit en miettes les forts, les parcs d’artillerie, les arsenaux, les casernes et les prisons, épargnant le plus possible la vie des soldats. L’épouvante produite par l’effet matériel de nos explosifs maîtrise l’opinion. Autour de la ville, nos torpilles défoncent encore les terrains inhabités, creusent dans le sol des strooms de cent mètres, font se briser toutes les vitres de la ville au bruit de leurs détonations qui, perturbant l’atmosphère, noient de pluie la contrée. La résistance est devenue évidemment impossible…
— La force prime le droit ! énonçai-je à propos.
— Oui, puisque les hommes ne reconnaissent que l’évidence de la force, puisque, sans la terreur d’une force plus grande, ils n’allégeraient pas le sort de ceux que leur propre force écrase. Qu’est-ce qu’une majorité et une minorité ? Deux armées en présence, dont la plus faible numériquement, trop lâche pour entreprendre la lutte, renonce tout d’abord. Qui triomphe là, sinon la stupide force numérique ; sans que la minorité vaincue obtienne rien de son espoir ?… Oui, nous serons la force des minorités, la force brutale des minorités enfin victorieuses. Nous jetterons dans le plateau le plus léger de la balance assez de poids pour que l’équilibre se rétablisse de manière stable… Sachez-le…
L’autruche battit comiquement des ailes devant moi. De la salive sautait de son bec avec les mots…
— Eh quoi, reprit-elle, craindrons-nous, en imposant notre force, d’écraser l’intelligence et l’esprit ? Non, vraiment. Il est des diplomates que vos journaux d’Europe louangent, que vos Académies invitent comme des esprits notables à siéger parmi elles. Ayant l’honneur de représenter la pensée chrétienne devant le monde, ils applaudissent à tous les massacres, à toutes les injustices des Pouvoirs. Les diplomaties s’arrangent pour laisser le Turc égorger, étriper, éventrer à l’aise, en lui opposant des phrases d’absurde élégie. On atteint à ce génie de protéger les Arméniens, en paroles, sans les protéger en fait, tout en les livrant au sabre du bachi-bouzouk, sans approuver un crime, dont on demeure les complices évidents. Cette sinistre niaiserie leur vaut la flatterie des lettres, des arts, des nations. Croyez-vous qu’en écrasant ces sortes d’intelligences notre force écrasera une pensée véritable, un honneur véritable, une noblesse d’âme ?… Oui, nous serons la force brutale contre l’idée basse de ceux-là… Mais notre force tuera moins qu’ils ne massacrent…
L’autruche s’arrêta, essoufflée. Elle tira de sa poche un mouchoir, s’éventa.
— Mais, dis-je, il est une chose que je m’explique peu. Soigneusement vous fermez aux intrus l’accès de notre pays. Comment parviennent les télégrammes qui vous avertissent de la physionomie du monde ?
— Nous avons à Hong-Kong une maison de correspondance et un câble sous-marin. Dans certains massifs inaccessibles des Alpes, de l’Himalaya, de l’Oural, des montagnes rocheuses, nous avons des postes qui communiquent avec les télégraphes des villes et nos nefs aériennes.
— Et aucune indiscrétion ?
— Nous payons assez cher pour que les consciences affidées restent hors de prix.
— Alors, si cette expédition eût été faite, si l’Europe, vaincue par les explosifs de frégates aériennes, eût imploré la paix, la Dictature faisait table rase de nos institutions latines, du jour au lendemain ?
— À peu près ; mais pas immédiatement. Vos foules sont encore si dépourvues d’altruisme et d’énergies quelles ne supporteraient pas l’opération de la table rase, sans périr dans les guerres civiles. Nos plans ménageraient une période transitoire… Oui. Si cela vous intéresse, je puis vous faire remettre une des affiches imprimées à l’avance et qui devaient être collées sur les murs de Paris, aux préliminaires de l’armistice.
— J’aimerais en connaître la teneur…
La dame me promit cet envoi.
— Vous verrez, ajouta-t-elle, que nous nous étions servis de l’organisation de l’armée, seule organisation fonctionnant bien, et mise à l’usage depuis des temps, pour les premières applications du nouveau régime. À l’armée militaire se substituait simplement, sans choc, l’armée agricole et industrielle. Les exercices étaient changés ; voilà tout.
— Alors, repris-je, rien de la mission que m’a conférée mon gouvernement, ne paraît devoir réussir.
— Vous m’excuserez, Monsieur. La Dictature ne peut encore répondre définitivement. Hier ont été fusillés, à Cavite, huit insurgés. Le gouverneur de Manille dénature la vérité dans les dépêches, comme son collègue de Cuba. Le Japon lui-même s’émeut de ces injustices et se prépare à doter le mouvement insurrectionnel d’une aide effective. Les conjonctures s’aggravent. Il faut de la prudence aux diplomates.
L’audience allait finir. La dame nerveuse se réinstalla dans son fauteuil blanc, s’éventa du mouchoir, croqua des pastilles, et, avec une de ces sautes de l’esprit familières à son sexe, me parla de mes compagnes, Pythie, Théa, demanda si leur fréquentation me séduisait. Je les louai de mon mieux.
Elle me dit encore que sa fonction sociale, à l’ordinaire l’occupait comme télégraphiste dans une gare de chemin de fer. Son groupe, ayant trouvé le moyen de simplifier la transmission téléphonique et télégraphique, avait été mis en candidature pour l’Oligarchie. On réforme partout les récepteurs des appareils, et c’est une œuvre énorme, d’autant que les pétitions publiques réclament la pose de téléphones en toutes les salles de tous les lieux habités.
La dame s’emballa sur la théorie téléphonique : non sans la pédanterie désobligeante dont semblent infectés tous les gens d’ici. Néanmoins je réussis à prendre congé.
La ville de Jupiter ne renferme rien de particulièrement remarquable. Elle possède un théâtre pareil à celui de Minerve, des restaurants-serres, des avenues courbes, des édifices à coupoles de verre, des nymphées, des docks énormes, des façades à émaux imagés, un temple assez riche, où l’on remise d’habitude la colossale image de la Vierge-Mère qui sert à orner les processions.
Dans les rues les vêtements blancs des oligarques n’attirent le respect ni le salut de personne, non plus que l’ironie. Ils sont des passants comme les autres. J’ai négligé de voir l’intérieur du théâtre, et de prendre part à la fête hebdomadaire, tant il est vrai que la pratique libre du plaisir vous lasse et rend vertueux.
Le nombre des statues de groupes est la chose curieuse de la cité. À tous les coins d’avenues, sur les places, au fond des squares innombrables, se dresse toujours un socle, où apparaissent, en taille naturelle, dix ou vingt figures d’hommes et de femmes portant le costume d’usinier. Ces images sont très proches du réel, trop proches même. On croirait voir les résultats de très habiles moulages pris sur les personnes. Généralement les corps et les habits sont de bronze, les têtes et les mains en pâte de verre colorée. Au centre du groupe s’élève le modèle de l’objet que créa l’invention. Du socle jaillissent des fontaines.
J’ai appris, en outre, que les splendides costumes de la procession ne se reverraient plus à Jupiter. En toutes les villes de la Dictature ils apparaîtraient successivement pour une cérémonie semblable, et puis seraient détruits. Les artistes imaginent, à chaque fête, une décoration nouvelle des créatures et des chars. Elle ne ressert jamais. Cela donne un motif d’apprécier la richesse folle de la production sociale. Comme je m’émerveillais, Théa dit :
— Ici nous produisons joyeusement pour consommer nous-mêmes. Vous produisez tristement pour vendre. Comment voulez-vous que notre labeur ne rende pas le centuple du vôtre.
À évaluer ce que coûterait en Europe, avec le système des salaires et du commerce, un cortège pareil, on atteint vite le chiffre de cinquante ou soixante millions.
La Semaine Sainte à Séville, ni votre Bœuf-Gras parisien ne rivaliseraient à leur avantage. Mais un tel travail est-il utile pour une joie si médiocre ? Je sais bien que j’ai prononcé le mot utile, et que Pythie m’a ri au nez en toute impertinence. L’une et l’autre me considèrent comme un indécrottable imbécile. Je les déteste à peu près.
Vous trouverez, ci-joint, un fragment de l’affiche imprimée d’avance et que les stratèges des nefs aériennes devaient coller sur les murs de Paris, lors de la prise… J’ai supprimé le préambule.
« Après les signatures de ces préliminaires, le gouvernement de Paris agira comme il suit :
Art. I. — Il prononcera la dissolution de la Chambre et du Sénat. Leurs membres actuels seront remplacés par les officiers les plus âgés des armées de terre et de mer.
Art. II. — Ces nouveaux fonctionnaires n’auront pas à délibérer sur les lois. Ils seront chargés de classer les pétitions des communes, sans les discuter.
Art. III. — Le mariage civil est aboli.
Art. IV. — L’imputation de la paternité étant illusoire et ne reposant sur aucune certitude naturelle, l’enfant nouveau-né prendra sur les registres de l’état civil, le nom de sa mère.
Art. V. — Le seul héritage légal est celui de la mère aux enfants.
Art. VI. — Cet héritage sera transmis dans les conditions suivantes :
A. Il sera fait une expertise de la valeur des biens légués, meubles et immeubles. L’héritier sera inscrit pour une somme correspondante sur le Grand-Livre. La rente au taux de trois pour cent, lui en sera versée sa vie durant. Cette rente ne sera pas transmissible.
B. Les autres legs à des tiers, ne seront valables que par clauses testamentaires. Ils subiront les mêmes formalités. Mais l’État prélèvera cinquante pour cent sur le tarif de la rente, et les sommes dues à ce prélèvement seront versées dans les caisses de l’Instruction publique.
Art. VII. — Toute femme qui se pourra croire en état de maternité prochaine devra déclarer sa situation à la mairie de l’arrondissement. Elle sera immédiatement hospitalisée dans une ville maritime au climat doux et salubre. Le temps de cette hospitalisation sera compté depuis le troisième mois de la grossesse jusqu’au sevrage du nourrisson. À cette époque l’enfant sera admis dans un établissement d’éducation publique pour être élevé, instruit aux frais de la Nation.
Art. VIII. — La mobilisation générale des armées françaises est décrétée.
Art. IX. — L’armée cultive le sol de la patrie, sème, laboure et récolte, élève les troupeaux, exploite les richesses des mines, produit dans les usines et ateliers, construit les édifices, partage et distribue entre les citoyens les richesses du pays.
Art. X. — Les usines de l’État et celles réquisitionnées à cet usage fabriqueront immédiatement un outillage agricole conforme aux progrès des sciences, tel que charrues et batteuses à vapeur, semoirs, herses, etc. Cet outillage sera livré dans l’espace de trois mois aux intendants militaires.
Art. XI. — Une commission d’agronomes et d’ingénieurs choisis au concours, pour la moitié des membres, élus par leurs collègues diplômés, pour l’autre moitié, dirigeront le travail de l’armée sociale, afin que le rendement du sol devienne le plus fort.
Art. XII. — Les années de stage à l’école de Saint-Cyr et à l’école Polytechnique sont portées à cinq ans. Les élèves devront, pendant ce laps, ajouter aux connaissances exigées jusqu’à ce jour, celles nécessaires à l’application générale des principes scientifiques pour améliorer la culture du sol, et la production de l’industrie.
Art. XIII. — Quiconque importera, fabriquera, vendra ou achètera de l’alcool, sera poursuivi conformément aux lois, sous le chef de tentative de meurtre, L’État pourvoira aux besoins des laboratoires de chimie et de pharmacie, pour la production de l’alcool.
Art. XIV. — Tout individu convaincu de vol, meurtre ou tentative de meurtre, incendie, banqueroute, abus de confiance, escroquerie, quiconque aura par des faits ainsi qualifiés, fait preuve du désir de conquête, sera incorporé, pour cinq ans au moins, dans les armées coloniales. Les armées coloniales jouent, sur leurs territoires militaires, ce même rôle que les armées régulières sur le territoire métropolitain.
Art. XV. — Par voie de décès du détenteur, tous les biens immeubles redeviennent propriété de l’État, seul possesseur légal du sol.
Art. XVI. — Les colonies sont soumises au même régime social transitoire que la métropole.
Art. XVII. — Le système du gouvernement direct par le peuple est substitué au système de la représentation parlementaire.
A. Tous les dimanches, sur un registre déposé à cet usage, dans les mairies, les citoyens de la commune écriront le texte des pétitions concernant les sujets qu’ils jugeront utile à l’intérêt général.
B. Le dimanche suivant, les citoyens de la commune voteront sur ces textes par oui et par non.
C. Les officiers du corps Législatif classeront par analogies les pétitions communales, en indiquant le nombre des suffrages exprimés, pour ou contre.
D. Dans un délai de six mois au plus, le Pouvoir fera connaître par le bulletin des Communes les raisons qu’il croit devoir favoriser ou combattre les principes des pétitions.
E. Après un nouveau vote communal, et la sanction du Conseil d’État, ces pétitions prendront force de loi ; mais leurs dispositions ne seront appliquées que dans les communes où elles auront été rédigées d’abord.
F. Néanmoins si d’autres communes réclament cette application, elle leur sera octroyée.
Art. XVIII. — Les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits civils et politiques.
Art. XIX. — Toute femme de vingt à quarante-cinq ans doit le service social à l’État.
Art. XX. — La journée de travail est de six heures. »
Telle est, mon cher ami, la loi du vainqueur dont je prie, fervemment Dieu, de vous faire grâce.
(Sera continué.)