**************************
Traduction Chinois Jacky Lavauzelle
ARTGITATO
中国文字翻译
**************************
*******
TRADUCTION CHINOIS
中国文字翻译
*******
Wang Wei
王維
Adieu 送彆
Souvenir de Li Yi sous la neige – 雪中憶李楫
**
LUO GUANGZHONG
罗贯中
三国志演义
LES TROIS ROYAUMES
**
LU XUN
鲁迅
LU XUN Proses Poèmes & Analyses – 鲁迅 – 散文 诗
EXPRESSIONS CHINOISES
中国表情
*******
Traduction Chinois
******
DE LA LANGUE CHINOISE
Analyse de 1736
de Jean-Baptiste Du Halde
Jésuite français
1674 –
Afin de donner une vraie idée de la langue de la Chine, je ferai connaître d’abord quel est le génie de cette langue ; ensuite comment on doit prononcer et écrire les mots chinois en caractères d’Europe. Enfin je finirai par un abrégé de grammaire chinoise.
Du génie de la langue chinoise.
La seule conformité qu’elle peut avoir avec nos langues d’Europe, est que comme l’alphabet est de vingt-quatre lettres, qui se forment de ces six ou sept traits ![]() savoir l’A des trois premiers ; le B du sixième et quatrième doublé ; le C du cinquième simple ; le D du sixième et du quatrième ; l’E du sixième et du troisième triplé ; l’O du quatrième et cinquième joints ensemble ; le Q de l’O et du septième trait, etc. De même tous les caractères chinois se forment à proprement parler des six seuls traits suivants.
savoir l’A des trois premiers ; le B du sixième et quatrième doublé ; le C du cinquième simple ; le D du sixième et du quatrième ; l’E du sixième et du troisième triplé ; l’O du quatrième et cinquième joints ensemble ; le Q de l’O et du septième trait, etc. De même tous les caractères chinois se forment à proprement parler des six seuls traits suivants.
Les Chinois ont deux sortes de langues ; l’une vulgaire et propre du peuple, qui est différente selon les diverses provinces ; l’autre qu’ils appellent, la langue mandarine, qui est à peu près ce qu’est parmi nous la langue latine pour les ecclésiastiques et les savants. Cependant le peu d’analogie de la langue chinoise avec toutes les autres langues mortes ou vivantes, fait que cette comparaison n’est pas juste : la langue mandarine est proprement celle qu’on parlait autrefois à la cour dans la province de Kiang nan, et qui s’est répandue dans les autres provinces parmi les personnes polies ; et de là vient que dans les provinces voisines de celle de Kiang nan, on la parle beaucoup mieux que partout ailleurs. Peu à peu elle s’est ainsi introduite partout ; ce qui est très utile pour le gouvernement. Elle paraît pauvre car elle n’a guère qu’environ 330 mots, qui sont tous monosyllabes et indéclinables, et qui se terminent presque tous par des voyelles, ou par cette consonne N, ou Ng.
Cependant ce peu de mots suffit pour s’expliquer sur toutes sortes de matières ; parce que, sans multiplier les paroles, le sens se multiplie presque à l’infini par la diversité des accents, des inflexions, des tons, des aspirations et d’autres changements de la voix : et c’est cette variété de prononciation qui est une occasion fréquente d’équivoque, à ceux qui ne sont pas bien versés dans la langue.
Un même mot a diverses significations.
Un exemple le fera comprendre : ce mot tchu prononcé en traînant et allongeant l’u, et éclaircissant la voix, signifie Seigneur, ou maître. S’il est prononcé d’un ton uniforme avec l’u prolongé, il signifie pourceau. Quand on le prononce légèrement et avec vitesse il veut dire cuisine. Si on le prononce d’une voix forte et d’un ton mâle, mais qui s’affaiblisse sur la fin, il signifie colonne.
De même cette syllabe, po, selon les différents accents, et les diverses inflexions de voix, dont on la prononce, a onze significations différentes. Elle signifie verre, bouillir, vanner du riz, sage ou libéral, préparer, vieille femme, rompre ou fendre, incliné, tant soit peu, arroser, esclave ou captif. D’où il est aisé de conclure que cette langue qui paraît si pauvre et si resserrée par le petit nombre de monosyllabes qui la composent, ne laisse pas d’être en effet riche, abondante, et expressive.
D’ailleurs le même mot, quand on lui joint d’autres mots différents, signifie une infinité de choses différentes. Mou par exemple, quand il est seul, signifie arbre, bois. Mais s’il est composé, il a beaucoup d’autres significations. Mou leao signifie du bois préparé pour un édifice. Mou ta signifie des barreaux, ou des grilles de bois ; mou hia, une boîte ; mou siang, une armoire ; mou tsiang, charpentier ; mou eul, champignon ; mou nu, une espèce de petite orange ; mou sing, la planète de Jupiter ; mou mien, le coton, etc. Ce mot se peut joindre de diverses autres manières, et a autant de significations qu’il est joint avec des mots différents.
C’est ainsi que les Chinois en assemblant différemment leurs monosyllabes, forment des discours suivis, et s’expliquent avec beaucoup de netteté et de grâce ; de même à peu près que nous formons tous nos mots par les diverses manières dont nous joignons ensemble les 24 lettres de notre alphabet.
De l’assemblage des monosyllabes.
Au reste les Chinois distinguent si naturellement les différents tons, attachés à la même monosyllabe, qu’ils en comprennent le sens, sans faire la moindre réflexion aux divers accents qui le déterminent. Et il ne faut pas s’imaginer, comme quelques auteurs l’ont avancé, qu’ils chantent en parlant, et qu’ils forment une espèce de musique, qui ne manquerait pas de choquer l’oreille, et d’être très désagréable. Ces différents tons se prononcent si finement, que les étrangers mêmes ont de la peine à s’en apercevoir, surtout dans la province de Kiang nan, où l’accent est meilleur qu’en nulle autre province. Il en faut juger par la prononciation gutturale, qui se trouve dans la langue espagnole, et par les différents tons dont on se sert dans la langue française et la langue italienne : ces tons sont presque imperceptibles, et ne laissent pas de signifier différemment ; ce qui a donné lieu au proverbe qui dit, que le ton fait tout.
Les Chinois se servent de figures pour exprimer leurs pensées.
L’art de joindre ensemble ces monosyllabes, surtout en écrivant, est très difficile, et demande beaucoup d’étude. Comme les Chinois n’ont que des figures pour exprimer leurs pensées, et qu’ils manquent d’accents qui varient sur le papier la prononciation, ils ont besoin d’autant de figures ou de caractères différents, qu’il y a de différents tons, qui donnent au même mot des significations si diverses.
Il y a d’ailleurs des caractères qui signifient deux ou trois paroles, et quelquefois des périodes entières : par exemple pour écrire ces paroles : bonjour, Monsieur : au lieu de joindre le caractère qui signifie, bon, et celui qui signifie jour, avec celui qui signifie Monsieur, on doit se servir d’un caractère différent, qui seul exprime ces trois paroles : et c’est ce qui multiplie si fort les caractères chinois. Il n’en est pas comme de nos langues d’Europe, où l’on connaît les diverses significations d’un même mot, par les divers accents qui en fixent la prononciation, ou bien par l’endroit où le mot est placé, et par la suite du discours.
Il est vrai qu’on ne laisserait pas de se faire entendre, en joignant ensemble les caractères de chaque monosyllabe : mais cette manière de s’exprimer en écrivant est triviale, et n’est en usage que parmi le peuple. Le style dont on écrit, lorsqu’on veut briller dans les compositions, n’a nul rapport avec celui dont on parle, quoique les paroles soient les mêmes : et un homme de lettres se rendrait ridicule s’il écrivait de la manière dont on a coutume de s’exprimer dans la conversation.
Rapport des caractères chinois avec ceux du Japon.
Il faut en écrivant se servir de termes plus choisis, d’expressions plus nobles, et de certaines métaphores qui ne sont pas de l’usage ordinaire ; mais qui sont propres à la matière qu’on traite, et aux livres qu’on compose. Les caractères de la Cochinchine, du Tong king, du Japon, sont les mêmes que ceux de la Chine, et signifient les mêmes choses, sans toutefois que ces peuples en parlant, s’expriment de la même sorte. Ainsi, quoique les langues soient très différentes, et qu’ils ne puissent pas s’entendre les uns les autres en parlant, ils s’entendent fort bien en s’écrivant, et tous leurs livres sont communs. Ces caractères sont en cela comme des chiffres d’arithmétique : plusieurs nations s’en servent : on leur donne différents noms ; mais ils signifient partout la même chose.
Devoir des lettrés à ce sujet.
C’est pourquoi les lettrés ne doivent pas seulement connaître les caractères, qui sont en usage dans le commerce ordinaire de la vie ; ils doivent savoir encore leurs diverses combinaisons, et les divers arrangements, qui de plusieurs traits simples, font des caractères composés : et comme l’on compte jusqu’à quatre-vingt mille de ces caractères, celui qui en sait le plus, est aussi le plus savant, et peut lire et entendre un plus grand nombre de livres : d’où l’on peut juger combien il faut d’années, pour connaître une multitude si prodigieuse de caractères, pour les démêler quand ils sont réunis, et pour en retenir la figure, et la signification.
Il faut avouer néanmoins que pourvu qu’on sache environ dix mille caractères, on est en état de s’expliquer en cette langue, et d’entendre un grand nombre de livres. Le commun des lettrés n’en sait guère plus de quinze ou vingt mille ; et il y a peu de docteurs qui soient parvenus jusqu’à en connaître quarante mille.
Du vocabulaire.
Ce nombre prodigieux de caractères est recueilli dans leur grand vocabulaire, qu’ils nomment Hai pien. Et de même que parmi les Hébreux, il y a des lettres radicales, qui marquent l’origine des mots, et font connaître ceux qui en sont dérivés, lorsqu’on les cherche dans leur dictionnaire, selon l’ordre de ces lettres radicales ; il y a aussi parmi les Chinois des figures radicales, qui sont par exemple, les lettres de montagnes, d’arbres, d’homme, de terre, de cheval, etc. sous lesquelles il faut chercher tout ce qui appartient aux montagnes, aux arbres, à l’homme, à la terre, et au cheval. De plus, il faut savoir distinguer dans chaque mot ces traits ou figures, qui sont au-dessus, au-dessous, à l’un des cotés, ou dans le corps de la figure radicale.
Outre ce grand vocabulaire, ils en ont un autre plus court, qui ne contient que huit ou dix mille caractères, qui leur sert pour lire, écrire, entendre ou composer des livres. Que s’ils n’y trouvent pas certaines lettres, dont ils ont besoin, ils ont recours à leur grand dictionnaire. Nos missionnaires ont recueilli de la même façon tous les termes qui peuvent leur servir à instruire les peuples des mystères de la foi, et qui sont en usage dans les entretiens et livres ordinaires, même dans les livres classiques.
Comme Clément d’Alexandrie attribue aux Égyptiens trois sortes de caractères, les premiers qu’il nomme épistolographiques, c’est-à-dire, propres à écrire des lettres, comme sont ceux de notre alphabet ; les autres sacerdotaux, propres seulement à des prêtres, pour écrire les choses sacrées, de même qu’il y a des notes pour la musique ; et les derniers hiéroglyphiques, propres à être gravés sur les monuments publics ; ce qui se faisait en deux manières : l’une, par des images propres, ou qui approchaient des choses que l’on voulait représenter, comme quand ils exprimaient la lune par un croissant ; l’autre, par des images énigmatiques et symboliques, comme serait un serpent qui se mord la queue, et qui est plié en rond, pour signifier l’année ou l’éternité : les Chinois ont eu de tout temps une semblable diversité de caractères. Dès le commencement de leur monarchie, ils communiquaient leurs idées, en formant sur le papier les images naturelles des choses qu’ils voulaient exprimer : ils peignaient, par exemple, un oiseau, des montagnes, des arbres, des lignes ondoyantes, pour exprimer des oiseaux, des montagnes, une forêt, et des rivières.
Cette manière d’expliquer sa pensée était fort imparfaite, et demandait plusieurs volumes pour exprimer assez peu de choses. D’ailleurs il y avait une infinité d’objets, qui ne pouvaient être représentés par la peinture, tels que sont l’âme, les sentiments, les passions, la beauté, les vertus, les vices, les actions des hommes et des animaux, et tant d’autres, qui n’ont ni corps, ni figures. C’est pourquoi insensiblement ils changèrent leur ancienne manière d’écrire : ils composèrent des figures plus simples, et en inventèrent plusieurs autres, pour exprimer les objets qui ne tombent point sous les sens.
Les lettres chinoises ont chacune leur signification.
Mais ces caractères plus modernes ne laissent pas d’être encore de vrais hiéroglyphes : premièrement, parce qu’ils sont composés de lettres simples, qui retiennent la même signification des caractères primitifs. Autrefois, par exemple, ils représentaient ainsi le soleil par un cercle![]() et l’appelaient Gé : ils le représentent maintenant par cette figure
et l’appelaient Gé : ils le représentent maintenant par cette figure![]() qu’ils nomment pareillement Gé. Secondement, parce que l’institution des hommes a attaché à ces figures la même idée, que ces premiers symboles présentaient naturellement, et qu’il n’y a aucune lettre chinoise qui n’ait sa propre signification, et qui ne la conserve, lorsqu’on la joint avec d’autres. Tsai, par exemple, qui veut dire, malheur, calamité, est composé de la lettre mien, qui signifie maison, et de la lettre ho, qui signifie feu ; parce que le plus grand malheur, est de voir sa maison en feu. On peut juger par ce seul exemple, que les caractères chinois n’étant pas des lettres simples, comme les nôtres, qui séparément ne signifient rien, et n’ont de sens que quand elles sont jointes ensemble, ce sont autant de hiéroglyphes qui forment des images, et qui expriment les pensées.
qu’ils nomment pareillement Gé. Secondement, parce que l’institution des hommes a attaché à ces figures la même idée, que ces premiers symboles présentaient naturellement, et qu’il n’y a aucune lettre chinoise qui n’ait sa propre signification, et qui ne la conserve, lorsqu’on la joint avec d’autres. Tsai, par exemple, qui veut dire, malheur, calamité, est composé de la lettre mien, qui signifie maison, et de la lettre ho, qui signifie feu ; parce que le plus grand malheur, est de voir sa maison en feu. On peut juger par ce seul exemple, que les caractères chinois n’étant pas des lettres simples, comme les nôtres, qui séparément ne signifient rien, et n’ont de sens que quand elles sont jointes ensemble, ce sont autant de hiéroglyphes qui forment des images, et qui expriment les pensées.
Du style des Chinois
Le style des Chinois dans leurs compositions, est mystérieux, concis, allégorique, et quelquefois obscur à l’égard de ceux qui n’ont pas une parfaite connaissance des caractères. Il faut être habile, pour ne pas se méprendre dans la lecture d’un ouvrage : ils disent beaucoup de choses en peu de paroles : leurs expressions sont vives, animées, et semées de comparaisons hardies, et de métaphores nobles. S’ils veulent marquer par exemple, qu’on ne doit point songer à détruire la religion chrétienne, que l’empereur a approuvée par un édit : ils diront : l’encre qui a écrit l’édit de l’empereur en faveur de la religion chrétienne, n’est pas encore sèche, et vous entreprenez de la détruire.
Surtout ils affectent de mêler dans leurs écrits beaucoup de sentences et de passages, qu’ils tirent des cinq livres canoniques ; et comme ils comparent leurs compositions à un tableau, ils comparent de même les sentences qu’ils tirent de leurs livres, aux cinq principales couleurs qui entrent dans la peinture. C’est en cela principalement que consiste leur éloquence. Du reste ils se piquent tous d’écrire proprement, et de peindre exactement leurs caractères ; et c’est à quoi l’on a de grands égards, lorsqu’on examine les compositions de ceux qui aspirent aux degrés.
Ils préfèrent même un beau caractère à la plus admirable peinture, et l’on en voit souvent qui achètent bien cher une page de vieux caractères, quand ils sont bien formés. Ils honorent leurs caractères jusque dans les livres les plus ordinaires : et si par hasard quelques feuilles étaient tombées, ils les ramassent avec respect : ce serait, selon eux, une grossièreté, et une impolitesse d’en faire un usage profane, de les fouler aux pieds en marchant, ou de les jeter même avec indifférence. Souvent il arrive que les menuisiers et les maçons n’osent pas déchirer une feuille imprimée, qui se trouve collée sur le mur ou sur le bois. Ils craignent de faire une faute.
Ainsi on peut distinguer trois sortes de langage chez les Chinois : celui du peuple, celui des honnêtes gens, et celui des livres. Bien que le premier ne soit pas si peigné que les deux autres, il ne faut pas croire qu’il soit si fort au-dessous de nos langues d’Europe, puisqu’il n’a certainement aucun des défauts qu’on lui a quelquefois prêtés en Europe. Les Européens qui viennent à la Chine et qui ne sont pas encore versés dans la langue, trouvent des équivoques, où il n’y en pas seulement l’ombre. Comme ils ne se sont point gênés d’abord à bien prononcer les mots chinois avec leurs aspirations et leurs accents, il arrive qu’ils n’entendent qu’à demi ce que disent les Chinois, et qu’ils ont de la peine à se faire entendre. C’est une faute dans eux, et non pas un défaut de la langue. On trouve dans quelques mémoires, que les lettrés tracent souvent avec le doigt ou avec l’éventail, des lettres sur leurs genoux, ou en l’air : s’ils le font, c’est par vanité ou par coutume, plutôt que par nécessité ; ou parce que ce sera un terme et un caractère peu usité, comme nos termes de marine, de musique, de chirurgie, etc.
Au-dessus de ce langage bas et grossier, qui, quant à la prononciation, se varie en cent manières, et dont on se sert pour les livres, il y en a une autre plus poli et plus châtié, qui s’emploie dans une infinité d’histoires vraies ou feintes, d’un goût très fin et très délicat. L’esprit des mœurs, les peintures vives, les caractères, les contrastes, rien n’y manque. Ces petits ouvrages se lisent et s’entendent sans beaucoup de peine : on y trouve partout une netteté, une politesse, qui ne cède point aux livres d’Europe les mieux écrits.
Après ces deux manières de s’exprimer, l’une pour le petit peuple, qui a le moins de soin de l’arrangement de ses paroles, et l’autre qui devrait être celle des mandarins et des lettrés, vient le langage des livres qui ne sont point écrits en style familier, et il y a dans ce genre-ci bien des degrés où il faut s’élever, jusqu’à ce qu’on parvienne à la brièveté majestueuse et sublime des Kings.
Ce n’est plus ici une langue qui se parle dans le discours ordinaire, mais seulement qui s’écrit, et qu’on n’entendrait pas aisément sans le secours des lettres qu’on a sous les yeux, et qu’on lit avec plaisir. Car on trouve un style net et coulant : chaque pensée est ordinairement exprimée en quatre ou en six caractères ; on ne sent rien qui choque une oreille délicate, et la variété des accents ménagés avec art rend toujours un son harmonieux et doux.
La différence qui se trouve entre ces livres et les King, consiste dans la matière dont ils parlent, qui n’est ni si auguste ni si haute ; et dans le style qu’ils emploient, qui est, et moins laconique, et moins grand. Dans les matières sublimes on ne se sert ni de points ni de virgules ; comme ces compositions ne sont que pour les lettrés, c’est à eux à juger où le sens finit, et les gens habiles ne s’y trompent jamais.
Vossius avait raison de dire que l’abondance de la langue chinoise vient de la multitude des caractères ; il faut ajouter qu’elle vient aussi des sens divers qu’on leur donne, et de l’assemblage qu’on en fait, en les joignant le plus ordinairement deux à deux, assez souvent trois à trois, et même quelquefois quatre à quatre. On a un dictionnaire fait par les ordres du feu empereur : il ne comprenait pas toute la langue, puisqu’on a été obligé d’y ajouter un supplément en vingt-quatre volumes, et cependant il y avait déjà quatre vingt quinze volumes de compte fait, la plupart fort épais, et d’une écriture menue. Il n’y a pas de langue au monde qu’on ne pût épuiser en beaucoup moins de tomes. Il n’y a donc point de langue, ni qui soit plus riche que la langue chinoise, ni qui puisse se vanter d’avoir régné trois à quatre mille ans, comme elle règne encore aujourd’hui.
Parallèle de cette langue avec celles dÉurope.
Tout ce que nous venons de dire, paraîtra sans doute étrange à des Européens, accoutumés aux vingt-quatre lettres qui composent notre alphabet : mais peut-être sera-t-on moins surpris, quand on fera réflexion que notre langue et toutes les autres, ont une infinité de figures pour s’exprimer, quoiqu’elles le puissent faire par ces vingt-quatre lettres : chaque art et chaque profession a des caractères qui lui sont propres.
Outre nos vingt quatre lettres que nous diversifions en plusieurs manières, en majuscules ou capitales, qui sont différentes des communes et ordinaires, en italiques et romaines, etc. Nous en avons pour écrire des lettres rondes, carrées, bâtardes, financières, et italiennes. Noms avons de plus les figures des nombres ou les chiffres, les interponctions qui sont le point, la virgule, l’apostrophe, les accents, la cédille, le tiret, les parenthèses, le point interrogatif et l’admiratif, les abréviations qui sont autant de caractères dont nous nous servons, pour marquer le repos du discours, la prononciation, la continuation, etc. Les astronomes ont des caractères pour les douze signes, pour les divers aspects de la lune et des astres. Les géomètres ont leurs figures ; les musiciens ont leurs notes blanches, noires, crochues, doubles crochues, etc. Enfin il y a peu d’arts et de sciences qui n’aient des figures propres, qui leur tiennent lieu de caractères pour exprimer leurs pensées.
Les Chinois ont encore aujourd’hui une ancienne espèce de langue, et de caractères, qui ne sont plus en usage que pour les titres, les inscriptions, les cachets et les devises, et dont ils ont d’anciens livres qu’il faut que les savants entendent. Ils ont aussi des lettres courantes et usuelles, dont ils se servent pour les actes publics, les contrats, les obligations, et autres actes de justice, comme il y a parmi nous une espèce de lettre qu’on nomme financière. Enfin ils ont une lettre qui demande une étude particulière, pour la diversité des traits et de ses abréviations, ou enlacements qui la rendent difficile. On s’en sert surtout, lorsqu’on veut écrire promptement. Ce qui concerne la manière de prononcer les mots chinois, et de les orthographier en caractères d’Europe, donnera un nouveau jour à ce qui vient d’être dit sur le génie de cette langue.
Jean-Baptiste Du Halde
Description de la Chine
Scheuerleer
1736
2, pp. 268-275
******
Traduction Chinois

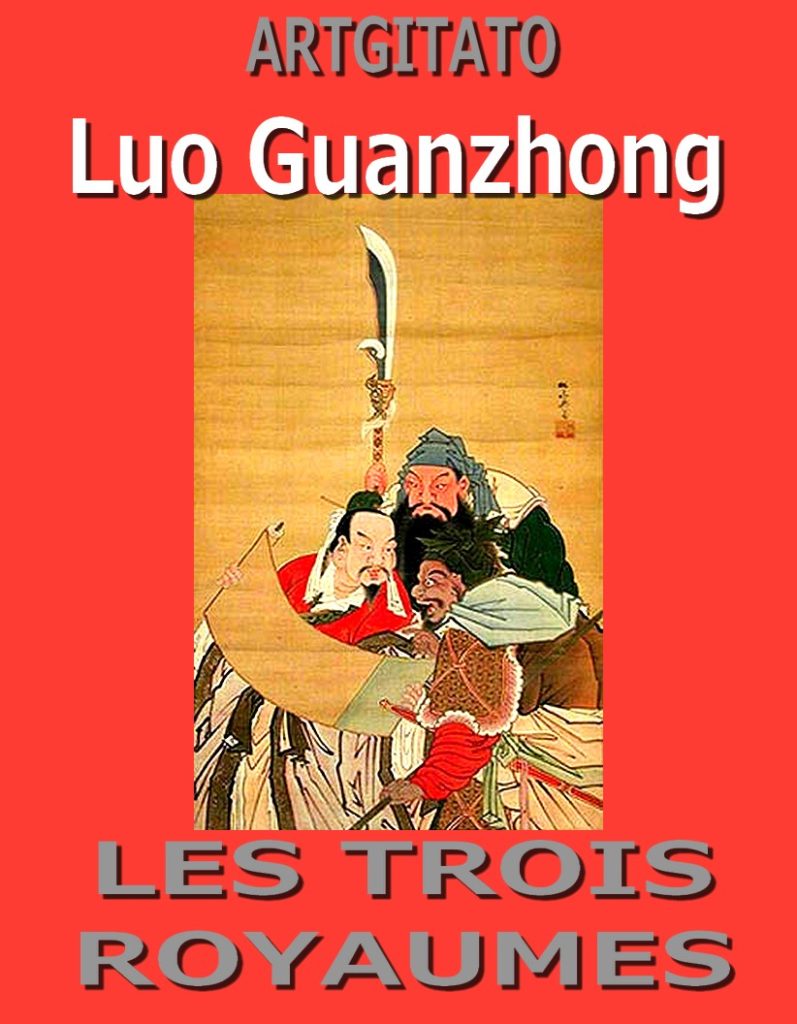
 **
**








