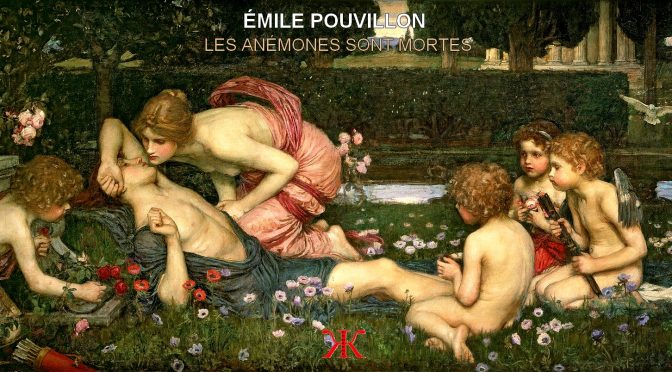LITTÉRATURE FRANÇAISE
ÉMILE POUVILLON
né le 10 octobre 1840 à Montauban et mort le 7 octobre 1906 à Jacob-Bellecombette
*
HANNETON, VOLE…
*
LISEZ-MOI
N°90
25 MAI 1909
_________________
I
Aimables, comme tous les étourdis, prompts à s’instruire, faciles à dissimuler dans les pupitres, les hannetons, jadis, m’ont donné bien des joies. Deux d’abord, que j’attelais ensemble à une voiture en papier ; un autre après, mort trop jeune, qui exécutait de magnifiques dessins à l’encre, du bout de la patte, mais très bien !
Et cet autre encore : le hanneton de Fine …
Fine ? La petite des métayers ; un rien fillette avec des cheveux couleurs de maïs, très sauvage et très maligne, instruite comme pas une à tous les jeux, chasses, amusettes et flibusteries campagnardes ; et rude ! sans chapeau, sans souliers, une loque sur le corps et un roseau en main pour conduire les oisons.
Je l’enviais cette Fine. Marcher pieds nus, mordre au pain de seigle noir, quel rêve ! Oui, mais pour moi, quand j’essayais, quel réveil ! Aïe ! mon talon qui s’entame ; ouf ! mon estomac qui dit : Non.
Mes paysanneries n’allaient jamais loin.
-Remets tes souliers, et allons aux hannetons, veux-tu ? disait la petite.
II
On partait. Une journée à souhait, douce, et dans le ciel tiède, des danses, des festonnements d’insectes folâtrant autour des jeunes ramées qui laissaient pendre des fils de la Vierge, balancés dans le bleu comme des escarpolettes à moucherons.
Nous suivons le ruisseau : les jeunes nichées pépiaient près de nous, dans les saules, et Fine chantait du haut du gosier, à la mode des enfants de campagne :
Hanneton, vole, vole, vole,
Ton mari est à l’école.
…………
Un hanneton, poursuivi par une hirondelle, vibra tout à coup au-dessus de nos têtes et s’abattit dans les feuilles de l’autre côté de la bordure…
–Dans le colza, peut-être...suggéra Fine.
Il était plus haut que nous d’un bon empan, ce colza. Au bout de deux pas nous y fûmes perdus, le visage dans les fleurs, investis comme d’une immense forêt jaune. Les hannetons travaillaient là dedans. En un tour de main nous en prîmes deux : des mâles, des élytres luisants, le damier bien marqué, les antennes pareilles à des bois de renne en miniature.
Mais, pendant que nous les admirions, voilà que le jour baissait tout à coup : une giboulée montait au front d’un nuage noir. Et déjà les premiers grêlons, les premières gouttes !
Vite, sous le pommier !
Mauvais abri, quoique très parfumé ; des fleurs partout, mais la pluie à travers ; elle fit bientôt une flaque à nos pieds, dans le creux du sillon ; et chaque fois qu’y tombaient les pétales blancs, les pétales roses, déchirés par la grêle :
–Encore une pomme dans l’eau ! soupirait Fine.
Pauvre petiote ! Elle frissonnait dans ses loques d’indienne percées par la pluie, tandis que, accroupie comme une mère poule, elle gardait sous elle et réchauffait ses oisons. C’est si délicat à la mouillure ses oisons. C’est si délicat à la mouillure, ces bestioles ! Une plus chétive grelottait encore et se traînait après les autres, quand, l’averse essuyée, nous quittâmes le pommier.
Inquiète, l’enfant la prit sur elle, la logea sous la chemise, à la bonne tiédeur de la peau.
Était-ce déjà la fièvre, ou la peur d’être grondée à cause de l’oison malade, ma petite amie tremblait comme la feuille, en rentrant à la maison.
III
Le lendemain, je n’aperçus pas Fine, le surlendemain, non plus. On me dit qu’elle était au lit, tourmentée par la fièvre. Je ne m’en inquiétai pas autrement et je ne demandai pas à la voir. S’enfermer dans l’obscur d’une chambre quand les grillons chantaient si gaiement dans le ciel !
Ils foisonnent dans la prairie ; leur bruissement léger croissait et se mourait avec les risées de vent frais qui passaient sur les herbes. L’oreille à l’affût, j’avançais à petits pas, et, l’un après l’autre, repliant leurs cymbales d’or, les petits musiciens se taisaient à mon approche, tandis qu’en avant, en arrière, l’orchestre, à larges ondées, jetait, comme une respiration énorme, sa sourde et lointaine rumeur.
Pas de bonheur aux grillons, ce jour là. Et mon hanneton était mort très misérablement la veille, étouffé sous sa litière de feuilles, asphyxié dans sa boîte.
–Demain, pensai-je, j’irai voir si Fine veut me donner le sien.
IV
Sitôt levé, le lendemain, je courus à la métairie. Personne. Le père, la mère, la grande sœur, la vieille ménine, tous s’en étaient allés au pré, dès la pointe du jour, laissant la petite malade à la garde du bon Dieu. On les entendait de loin ; rire des femmes en train de sauter le foin, tintement de la faux sur la pierre à aiguiser, le joli tapage de la fenaison s’éparpillait dans le frais du matin…
–Fine ? appelai-je à travers la porte.
Pas de réponse.
Je tirai la chevillette, et me trouvai dans le noir.
J’appelai de nouveau :
-Fine ?
–Ici…, répondit une voix faible, si faible !
En même temps, mes yeux s’accoutumaient à l’obscur, et je m’avançai vers le grand lit.
Les rideaux de serge tirés sur la malade faisaient comme une seconde épaisseur d’ombre, où, d’abord, je ne distinguai que le blanc du bénitier de faïence ; puis, la figure pâlotte et les mains de Fine m’apparurent au-dessus de l’immense couche sur laquelle l’attitude de son corps soulevait à peine un léger pli.
Elle s’était haussée un peu sur le traversin, et me regardait.
Je la trouvai enlaidie, les joues creusées, le nez mince et les yeux trop brillants.
Mais j’oubliai bientôt sa figure.
Là, près d’elle, j’avais aperçu le hanneton.
Des feuilles fraîches de peupliers jonchaient le drap de toile bise, et le prisonnier fourrageait là dedans, tirant le fil entortillé de l’autre bout au petit doigt de la malade.
–Pousse un peu le volet, je le verrai mieux...demandait Fine.
Elle parlait avec effort, jetant un mauvais sifflement entre deux pauses.
A un mouvement qu’elle risqua pour se pencher, je la vis fermer les yeux subitement et porter la main à son côté.
–Aïe ! gémit-elle !
V
Je ne m’enquis pas de ce qui la faisait souffrir. J’étais tout au hanneton ; elle aussi, d’ailleurs. Oh ! la gentille bestiole ! De quel appétit il vous grignotait les feuilles, et quelle amusante pantomime, quand il s’arrêtait de manger, comme quelqu’un qui réfléchit, allongeait le cou, développait ses antennes, entrouvrait le fin bout de de ses élytres, puis rentrait en lui-même, pour recommencer encore.
–Il compte ses pas ; il va partir ! disait Fine
D’un brusque élan, l’étourdi s’enlevait, se cognaient aux rideaux, et retombait en paquet sur le lit. Très comique ! Vraiment, j’en étais fou, de ce hanneton ; et, si j’avais osé…
Mais Fine ne le quittait pas des yeux. Elle jouait à le bercer, à le faire grimper en échelette sur ses doigts…
–N’est-ce pas qu’il est intelligent, mon hanneton ? me disait-elle. Tiens, veux-tu voir comme il aime la musique ?
Bien doucement alors, à cause de cette mauvaise toux qui lui déchirait la poitrine, elle chantonnait :
hanneton, vole, vole, vole…
Elle s’arrêtait un moment, mettait la main sur ses lèvres pour retenir une quinte, puis elle reprenait entre deux silences :
Ton mari est à l’école.
Elle n’alla pas plus loin. Un étouffement lui fit monter le rouge au visage. Elle s’était assise, angoissée, les mains crispées aux draps, la tête renversée en arrière avec sa bouche grande ouverte, cherchant l’air…
Un cri, un sanglot, puis rien.
Inerte, le regard fixe, elle était retombée sur le traversin.
Endormie, sans doute.
Sournoisement, j’allongeai la main sur le hanneton ; les doigts détendus de Fine avaient lâché le fil.
–Tu me les donnes ? dis-je tout bas, par acquit de conscience.
Et, sans attendre la réponse, je m’en allai doucement sur la pointe du pied, comme un voleur.
VI
Ces fièvres de poitrine, ça va vite.
Rentrant du pré, à l’heure du goûter, ceux de la métairie, trouvèrent l’enfant morte.
On parlait d’elle chez nous le soir, et moi, curieux :
–Que va-t-on faire de Fine ? questionnai-je.
–Son corps ira dans la terre et son âme au ciel, répondit ma mère.
Mais elle, où ira-t-elle ? pensai-je, n’osant pas demander d’autres explications.
Je m’endormis là-dessus.
Le lendemain, nous vîmes des choses bien étranges.
Nous, c’est-à-dire le hanneton et moi. Le hanneton m’habitait. Il était là sur moi, errant au bout du fil, quand le charpentier clouait le cercueil ; là, quand on couchait Fine, toute raide, toute pâle, dans la boîte neuve ; là encore, quand venaient les fillettes de l’école, en robe de calicot blanc, pour faire la conduite à leur amie.
Oh ! la belle journée de mai, paisible, avec son grand ciel duveté de nuages blancs !
Dans le petit clos, près de l’église, les tombes, les croix, tout disparaissait dans l’épaisseur de l’herbe, une herbe noire de sucs, fléchissant sous les fleurs.
Les hirondelles, avec de petits cris, glissaient dans l’air tiède, et les abeilles bourdonnaient autour des grappes odorantes des sureaux.
VII
Le cortège avait fait halte.
Qu’allait-il se passer ?
Fillettes et garçons, jeunes ou vieux, tout le monde se pressait autour du prêtre en surplis. Je fis comme les autres. Angoissé, sans trop savoir pourquoi, je regardais à pleins yeux la fosse étroite, courte, avec un peu de terre remuée au bord. Un homme se baissait, laissait aller la boîte dans le trou.
Et comme ma première pelletée de terre faisait vibrer les planchettes minces…
Bourr ! Le hanneton que j’avais oublié, ouvrant les doigts en même temps que j’écarquillais les yeux, le hanneton s’envolait, libre, dans l’azur.
Et, le regardant monter, tourner, monter encore :
–Qui sait ? me disais-je, s’il retrouvera, là-haut, l’âme de Fine ?…
**************************