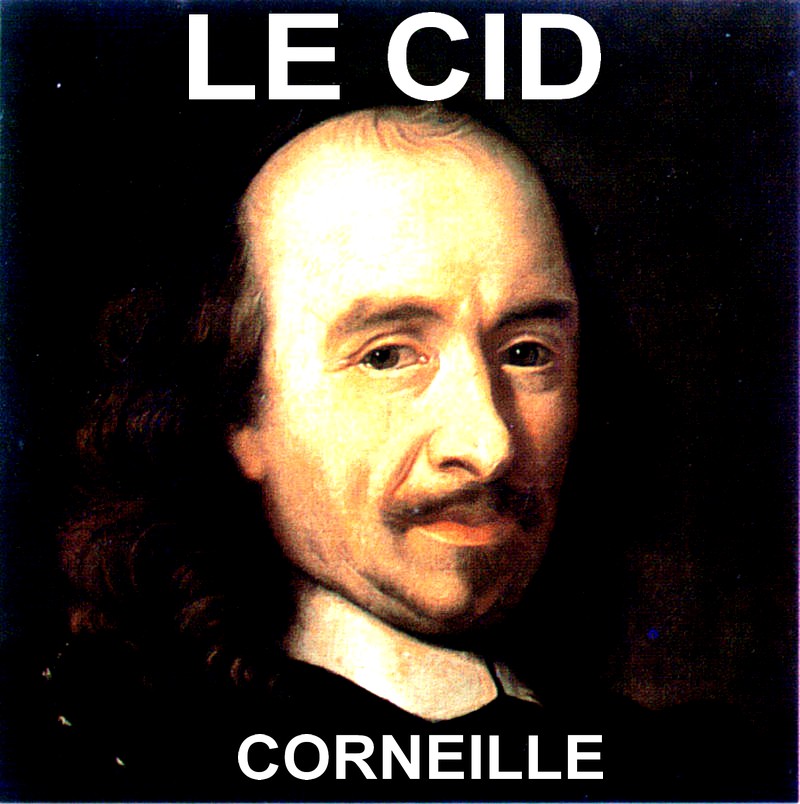Œdipe CORNEILLE
Œdipe CORNEILLE
LITTERATURE FRANCAISE
TRAGEDIE
EN CINQ ACTES
PIERRE CORNEILLE
1606 – 1684
Œdipe
1640
Œdipe Corneille
****************************

Œdipe, roi de Thèbes, fils et mari de Jocaste.
Thésée, prince d’Athènes, fils d’Egée et amant de Dircé.
Jocaste, reine de Thèbes, femme et mère d’Œdipe.
Dircé, princesse de Thèbes, fille de Laïus et de Jocaste, sœur d’Œdipe et amante de Thésée.
Cléante & Dymas, confidents d’Œdipe.
Phorbas, vieillard thébain.
Iphicrate, chef de Corinthe.
Nérine, dame d’honneur de la Reine.
Mégare, fille d’honneur de Dircé.
Page.
**********************
ACTE I
Scène première
.
Thésée.
N’écoutez plus, madame, une pitié cruelle,
Qui d’un fidèle amant vous ferait un rebelle :
La gloire d’obéir n’a rien qui me soit doux,
Lorsque vous m’ordonnez de m’éloigner de vous.
Quelque ravage affreux qu’étale ici la peste,
L’absence aux vrais amants est encor plus funeste ;
Et d’un si grand péril l’image s’offre en vain,
Quand ce péril douteux épargne un mal certain.
Dircé.
Le trouvez-vous douteux quand toute votre suite
Par cet affreux ravage à Phaedime est réduite,
De qui même le front, déjà pâle et glacé,
Porte empreint le trépas dont il est menacé ?
Seigneur, toutes ces morts dont il vous environne
Sont des avis pressants que de grâce il vous donne,
Et tant lever le bras avant que de frapper,
C’est vous dire assez haut qu’il est temps d’échapper.
Thésée.
Je le vois comme vous ; mais alors qu’il m’assiége,
Vous laisse-t-il, madame, un plus grand privilège ?
Ce palais par la peste est-il plus respecté ?
Et l’air auprès du trône est-il moins infecté ?
Dircé.
Ah ! Seigneur, quand l’amour tient une âme alarmée,
Il l’attache aux périls de la personne aimée.
Je vois aux pieds du roi chaque jour des mourants ;
J’y vois tomber du ciel les oiseaux expirants ;
Je me vois exposée à ces vastes misères ;
J’y vois mes soeurs, la reine, et les princes mes frères :
Je sais qu’en ce moment je puis les perdre tous ;
Et mon coeur toutefois ne tremble que pour vous,
Tant de cette frayeur les profondes atteintes
Repoussent fortement toutes les autres craintes !
Thésée.
Souffrez donc que l’amour me fasse même loi,
Que je tremble pour vous quand vous tremblez pour moi,
Et ne m’imposez pas cette indigne faiblesse
De craindre autres périls que ceux de ma princesse :
J’aurais en ma faveur le courage bien bas,
Si je fuyais des maux que vous ne fuyez pas.
Votre exemple est pour moi la seule règle à suivre ;
Éviter vos périls, c’est vouloir vous survivre :
Je n’ai que cette honte à craindre sous les cieux.
Ici je puis mourir, mais mourir à vos yeux ;
Et si malgré la mort de tous côtés errante,
Le destin me réserve à vous y voir mourante,
Mon bras sur moi du moins enfoncera les coups
Qu’aura son insolence élevés jusqu’à vous,
Et saura me soustraire à cette ignominie
De souffrir après vous quelques moments de vie,
Qui dans le triste état où le ciel nous réduit,
Seraient de mon départ l’infâme et le seul fruit.
Dircé.
Quoi ? Dircé par sa mort deviendrait criminelle
Jusqu’à forcer Thésée à mourir après elle,
Et ce coeur, intrépide au milieu du danger,
Se défendrait si mal d’un malheur si léger !
M’immoler une vie à tous si précieuse,
Ce serait rendre à tous ma mémoire odieuse,
Et par toute la Grèce animer trop d’horreur
Contre une ombre chérie avec tant de fureur.
Ces infâmes brigands dont vous l’avez purgée,
Ces ennemis publics dont vous l’avez vengée,
Après votre trépas à l’envi renaissants,
Pilleraient sans frayeur les peuples impuissants ;
Et chacun maudirait, en les voyant paraître,
La cause d’une mort qui les ferait renaître.
Oserai-je, seigneur, vous dire hautement
Qu’un tel excès d’amour n’est pas d’un tel amant ?
S’il est vertu pour nous, que le ciel n’a formées
Que pour le doux emploi d’aimer et d’être aimées,
Il faut qu’en vos pareils les belles passions
Ne soient que l’ornement des grandes actions.
Ces hauts emportements qu’un beau feu leur inspire
Doivent les élever, et non pas les détruire ;
Et quelque désespoir que leur cause un trépas,
Leur vertu seule a droit de faire agir leurs bras.
Ces bras, que craint le crime à l’égal du tonnerre,
Sont des dons que le ciel fait à toute la terre ;
Et l’univers en eux perd un trop grand secours,
Pour souffrir que l’amour soit maître de leurs jours.
Faites voir, si je meurs, une entière tendresse ;
Mais vivez après moi pour toute notre Grèce,
Et laissez à l’amour conserver par pitié
De ce tout désuni la plus digne moitié.
Vivez pour faire vivre en tous lieux ma mémoire,
Pour porter en tous lieux vos soupirs et ma gloire,
Et faire partout dire : » un si vaillant héros
Au malheur de Dircé donne encor des sanglots ;
Il en garde en son âme encor toute l’image,
Et rend à sa chère ombre encor ce triste hommage. »
Cet espoir est le seul dont j’aime à me flatter,
Et l’unique douceur que je veux emporter.
Thésée.
Ah ! Madame, vos yeux combattent vos maximes :
Si j’en crois leur pouvoir, vos conseils sont des crimes.
Je ne vous ferai point ce reproche odieux,
Que si vous aimiez bien, vous conseilleriez mieux :
Je dirai seulement qu’auprès de ma princesse
Aux seuls devoirs d’amant un héros s’intéresse,
Et que de l’univers fût-il le seul appui,
Aimant un tel objet, il ne doit rien qu’à lui.
Mais ne contestons point et sauvons l’un et l’autre :
L’hymen justifiera ma retraite et la vôtre.
Le roi me pourrait-il en refuser l’aveu,
Si vous en avouez l’audace de mon feu ?
Pourrait-il s’opposer à cette illustre envie
D’assurer sur un trône une si belle vie,
Et ne point consentir que des destins meilleurs
Vous exilent d’ici pour commander ailleurs ?
Dircé.
Le roi, tout roi qu’il est, seigneur, n’est pas mon maître ;
Et le sang de Laïus, dont j’eus l’honneur de naître,
Dispense trop mon coeur de recevoir la loi
D’un trône que sa mort n’a dû laisser qu’à moi.
Mais comme enfin le peuple et l’hymen de ma mère
Ont mis entre ses mains le sceptre de mon père,
Et qu’en ayant ici toute l’autorité,
Je ne puis rien pour vous contre sa volonté,
Pourra-t-il trouver bon qu’on parle d’hyménée
Au milieu d’une ville à périr condamnée,
Où le courroux du ciel, changeant l’air en poison,
Donne lieu de trembler pour toute sa maison ?
Mégare.
Madame.
Dircé.
Adieu, seigneur : la reine, qui m’appelle,
M’oblige à vous quitter pour me rendre auprès d’elle ;
Et d’ailleurs le roi vient.
Thésée.
Que ferai-je ?
Dircé.
Parlez.
Je ne puis plus vouloir que ce que vous voulez.
Scène II
.
Oedipe.
Au milieu des malheurs que le ciel nous envoie,
Prince, nous croiriez-vous capables d’une joie,
Et que nous voyant tous sur les bords du tombeau,
Nous pussions d’un hymen allumer le flambeau ?
C’est choquer la raison peut-être et la nature ;
Mais mon âme en secret s’en forme un doux augure
Que Delphes, dont j’attends réponse en ce moment,
M’envoiera de nos maux le plein soulagement.
Thésée.
Seigneur, si j’avais cru que parmi tant de larmes
La douceur d’un hymen pût avoir quelques charmes,
Que vous en eussiez pu supporter le dessein,
Je vous aurais fait voir un beau feu dans mon sein,
Et tâché d’obtenir cet aveu favorable
Qui peut faire un heureux d’un amant misérable.
Oedipe.
Je l’avais bien jugé, qu’un intérêt d’amour
Fermait ici vos yeux aux périls de ma cour ;
Mais je croirais me faire à moi-même un outrage
Si je vous obligeais d’y tarder davantage,
Et si trop de lenteur à seconder vos feux
Hasardait plus longtemps un coeur si généreux.
Le mien sera ravi que de si nobles chaînes
Unissent les états de Thèbes et d’Athènes.
Vous n’avez qu’à parler, vos voeux sont exaucés :
Nommez ce cher objet, grand prince, et c’est assez.
Un gendre tel que vous m’est plus qu’un nouveau trône,
Et vous pouvez choisir d’Ismène ou d’Antigone ;
Car je n’ose penser que le fils d’un grand roi,
Un si fameux héros, aime ailleurs que chez moi,
Et qu’il veuille en ma cour, au mépris de mes filles,
Honorer de sa main de communes familles.
Thésée.
Seigneur, il est tout vrai : j’aime en votre palais ;
Chez vous est la beauté qui fait tous mes souhaits.
Vous l’aimez à l’égal d’Antigone et d’Ismène ;
Elle tient même rang chez vous et chez la reine ;
En un mot, c’est leur soeur, la princesse Dircé,
Dont les yeux…
Oedipe.
Quoi ? Ses yeux, prince, vous ont blessé ?
Je suis fâché pour vous que la reine sa mère
Ait su vous prévenir pour un fils de son frère.
Ma parole est donnée, et je n’y puis plus rien ;
Mais je crois qu’après tout ses soeurs la valent bien.
Thésée.
Antigone est parfaite, Ismène est admirable ;
Dircé, si vous voulez, n’a rien de comparable :
Elles sont l’une et l’autre un chef-d’oeuvre des cieux ;
Mais où le coeur est pris on charme en vain les yeux.
Si vous avez aimé, vous avez su connaître
Que l’amour de son choix veut être le seul maître ;
Que s’il ne choisit pas toujours le plus parfait,
Il attache du moins les coeurs au choix qu’il fait ;
Et qu’entre cent beautés dignes de notre hommage,
Celle qu’il nous choisit plaît toujours davantage.
Ce n’est pas offenser deux si charmantes soeurs,
Que voir en leur aînée aussi quelques douceurs.
J’avouerai, s’il le faut, que c’est un pur caprice,
Un pur aveuglement qui leur fait injustice ;
Mais ce serait trahir tout ce que je leur doi,
Que leur promettre un coeur quand il n’est plus à moi.
Oedipe.
Mais c’est m’offenser, moi, prince, que de prétendre
À des honneurs plus hauts que le nom de mon gendre.
Je veux toutefois être encor de vos amis ;
Mais ne demandez plus un bien que j’ai promis.
Je vous l’ai déjà dit, que pour cet hyménée
Aux voeux du prince Aemon ma parole est donnée.
Vous avez attendu trop tard à m’en parler,
Et je vous offre assez de quoi vous consoler.
La parole des rois doit être inviolable.
Thésée.
Elle est toujours sacrée et toujours adorable ;
Mais ils ne sont jamais esclaves de leur voix,
Et le plus puissant roi doit quelque chose aux rois.
Retirer sa parole à leur juste prière,
C’est honorer en eux son propre caractère ;
Et si le prince Aemon ose encor vous parler,
Vous lui pouvez offrir de quoi se consoler.
Oedipe.
Quoi ? Prince, quand les dieux tiennent en main leur foudre,
Qu’ils ont le bras levé pour nous réduire en poudre,
J’oserai violer un serment solennel,
Dont j’ai pris à témoin leur pouvoir éternel ?
Thésée.
C’est pour un grand monarque un peu bien du scrupule.
Oedipe.
C’est en votre faveur être un peu bien crédule
De présumer qu’un roi, pour contenter vos yeux,
Veuille pour ennemis les hommes et les dieux.
Thésée.
Je n’ai qu’un mot à dire après un si grand zèle :
Quand vous donnez Dircé, Dircé se donne-t-elle ?
Oedipe.
Elle sait son devoir.
Thésée.
Savez-vous quel il est ?
Oedipe.
L’aurait-elle réglé suivant votre intérêt ?
À me désobéir l’auriez-vous résolue ?
Thésée.
Non, je respecte trop la puissance absolue ;
Mais lorsque vous voudrez sans elle en disposer,
N’aura-t-elle aucun droit, seigneur, de s’excuser ?
Oedipe.
Le temps vous fera voir ce que c’est qu’une excuse.
Thésée.
Le temps me fera voir jusques où je m’abuse ;
Et ce sera lui seul qui saura m’éclaircir
De ce que pour Aemon vous ferez réussir.
Je porte peu d’envie à sa bonne fortune ;
Mais je commence à voir que je vous importune.
Adieu : faites, seigneur, de grâce un juste choix ;
Et si vous êtes roi, considérez les rois.
Scène III
.
Oedipe.
Si je suis roi, Cléante ! Et que me croit-il être ?
Cet amant de Dircé déjà me parle en maître !
Vois, vois ce qu’il ferait s’il était son époux.
Cléante.
Seigneur, vous avez lieu d’en être un peu jaloux.
Cette princesse est fière ; et comme sa naissance
Croit avoir quelque droit à la toute-puissance,
Tout est au-dessous d’elle, à moins que de régner,
Et sans doute qu’Aemon s’en verra dédaigner.
Oedipe.
Le sang a peu de droits dans le sexe imbécile ;
Mais c’est un grand prétexte à troubler une ville ;
Et lorsqu’un tel orgueil se fait un fort appui,
Le roi le plus puissant doit tout craindre de lui.
Toi qui, né dans Argos et nourri dans Mycènes,
Peux être mal instruit de nos secrètes haines,
Vois-les jusqu’en leur source, et juge entre elle et moi
Si je règne sans titre, et si j’agis en roi.
On t’a parlé du Sphinx, dont l’énigme funeste
Ouvrit plus de tombeaux que n’en ouvre la peste,
Ce monstre à voix humaine, aigle, femme et lion,
Se campait fièrement sur le mont Cythéron,
D’où chaque jour ici devait fondre sa rage,
À moins qu’on éclaircît un si sombre nuage.
Ne porter qu’un faux jour dans son obscurité,
C’était de ce prodige enfler la cruauté ;
Et les membres épars des mauvais interprètes
Ne laissaient dans ces murs que des bouches muettes.
Mais comme aux grands périls le salaire enhardit,
Le peuple offre le sceptre, et la reine son lit ;
De cent cruelles morts cette offre est tôt suivie :
J’arrive, je l’apprends, j’y hasarde ma vie.
Au pied du roc affreux semé d’os blanchissants,
Je demande l’énigme et j’en cherche le sens ;
Et ce qu’aucun mortel n’avait encor pu faire,
J’en dévoile l’image et perce le mystère.
Le monstre, furieux de se voir entendu,
Venge aussitôt sur lui tant de sang répandu,
Du roc s’élance en bas, et s’écrase lui-même.
La reine tint parole, et j’eus le diadème.
Dircé fournissait lors à peine un lustre entier,
Et me vit sur le trône avec un oeil altier.
J’en vis frémir son coeur, j’en vis couler ses larmes ;
J’en pris pour l’avenir dès lors quelques alarmes ;
Et si l’âge en secret a pu la révolter,
Vois ce que mon départ n’en doit point redouter.
La mort du roi mon père à Corinthe m’appelle ;
J’en attends aujourd’hui la funeste nouvelle,
Et je hasarde tout à quitter les Thébains,
Sans mettre ce dépôt en de fidèles mains.
Aemon serait pour moi digne de la princesse :
S’il a de la naissance, il a quelque faiblesse ;
Et le peuple du moins pourrait se partager,
Si dans quelque attentat il osait l’engager ;
Mais un prince voisin, tel que tu vois Thésée,
Ferait de ma couronne une conquête aisée,
Si d’un pareil hymen le dangereux lien
Armait pour lui son peuple et soulevait le mien.
Athènes est trop proche, et durant une absence
L’occasion qui flatte anime l’espérance ;
Et quand tous mes sujets me garderaient leur foi,
Désolés comme ils sont, que pourraient-ils pour moi ?
La reine a pris le soin d’en parler à sa fille.
Aemon est de son sang, et chef de sa famille ;
Et l’amour d’une mère a souvent plus d’effet
Que n’ont… Mais la voici ; sachons ce qu’elle a fait.
Scène IV
.
Jocaste.
J’ai perdu temps, seigneur ; et cette âme embrasée
Met trop de différence entre Aemon et Thésée.
Aussi je l’avouerai, bien que l’un soit mon sang,
Leur mérite diffère encor plus que leur rang ;
Et l’on a peu d’éclat auprès d’une personne
Qui joint à de hauts faits celui d’une couronne.
Oedipe.
Thésée est donc, madame, un dangereux rival ?
Jocaste.
Aemon est fort à plaindre, ou je devine mal.
J’ai tout mis en usage auprès de la princesse :
Conseil, autorité, reproche, amour, tendresse ;
J’en ai tiré des pleurs, arraché des soupirs,
Et n’ai pu de son coeur ébranler les désirs.
J’ai poussé le dépit de m’en voir séparée
Jusques à la nommer fille dénaturée.
» le sang royal n’a point ces bas attachements
Qui font les déplaisirs de ces éloignements,
Et les âmes, dit-elle, au trône destinées
Ne doivent aux parents que les jeunes années. »
Oedipe.
Et ces mots ont soudain calmé votre courroux ?
Jocaste.
Pour les justifier elle ne veut que vous :
Votre exemple lui prête une preuve assez claire
Que le trône est plus doux que le sein d’une mère.
Pour régner en ces lieux vous avez tout quitté.
Oedipe.
Mon exemple et sa faute ont peu d’égalité.
C’est loin de ses parents qu’un homme apprend à vivre.
Hercule m’a donné ce grand exemple à suivre,
Et c’est pour l’imiter que par tous nos climats
J’ai cherché comme lui la gloire et les combats.
Mais bien que la pudeur par des ordres contraires
Attache de plus près les filles à leurs mères,
La vôtre aime une audace où vous la soutenez.
Jocaste.
Je la condamnerai, si vous la condamnez ;
Mais à parler sans fard, si j’étais en sa place,
J’en userais comme elle et j’aurais même audace ;
Et vous-même, seigneur, après tout, dites-moi,
La condamneriez-vous si vous n’étiez son roi ?
Oedipe.
Si je condamne en roi son amour ou sa haine,
Vous devez comme moi les condamner en reine.
Jocaste.
Je suis reine, seigneur, mais je suis mère aussi :
Aux miens, comme à l’état, je dois quelque souci.
Je sépare Dircé de la cause publique ;
Je vois qu’ainsi que vous elle a sa politique :
Comme vous agissez en monarque prudent,
Elle agit de sa part en coeur indépendant,
En amante à bon titre, en princesse avisée,
Qui mérite ce trône où l’appelle Thésée.|
Je ne puis vous flatter, et croirais vous trahir,
Si je vous promettais qu’elle pût obéir.
Oedipe.
Pourrait-on mieux défendre un esprit si rebelle ?
Jocaste.
Parlons-en comme il faut : nous nous aimons plus qu’elle ;
Et c’est trop nous aimer que voir d’un oeil jaloux
Qu’elle nous rend le change, et s’aime plus que nous.
Un peu trop de lumière à nos désirs s’oppose.
Peut-être avec le temps nous pourrions quelque chose ;
Mais n’espérons jamais qu’on change en moins d’un jour,
Quand la raison soutient le parti de l’amour.
Oedipe.
Souscrivons donc, madame, à tout ce qu’elle ordonne :
Couronnons cet amour de ma propre couronne ;
Cédons de bonne grâce, et d’un esprit content
Remettons à Dircé tout ce qu’elle prétend.
À mon ambition Corinthe peut suffire,
Et pour les plus grands coeurs c’est assez d’un empire.
Mais vous souvenez-vous que vous avez deux fils
Que le courroux du ciel a fait naître ennemis,
Et qu’il vous en faut craindre un exemple barbare,
À moins que pour régner leur destin les sépare ?
Jocaste.
Je ne vois rien encor fort à craindre pour eux :
Dircé les aime en soeur, Thésée est généreux ;
Et si pour un grand coeur c’est assez d’un empire,
À son ambition Athènes doit suffire.
Oedipe.
Vous mettez une borne à cette ambition !
Jocaste.
J’en prends, quoi qu’il en soit, peu d’appréhension ;
Et Thèbes et Corinthe ont des bras comme Athènes.
Mais nous touchons peut-être à la fin de nos peines :
Dymas est de retour, et Delphes a parlé.
Oedipe.
Que son visage montre un esprit désolé !
Scène V
.
Oedipe.
Eh bien ! Quand verrons-nous finir notre infortune ?
Qu’apportez-vous, Dymas ? Quelle réponse ?
Dymas.
Aucune.
Oedipe.
Quoi ? Les dieux sont muets ?
Dymas.
Ils sont muets et sourds.
Nous avons par trois fois imploré leur secours,
Par trois fois redoublé nos voeux et nos offrandes :
Ils n’ont pas daigné même écouter nos demandes.
À peine parlions-nous, qu’un murmure confus
Sortant du fond de l’antre expliquait leur refus ;
Et cent voix tout à coup, sans être articulées,
Dans une nuit subite à nos soupirs mêlées,
Faisaient avec horreur soudain connaître à tous
Qu’ils n’avoient plus ni d’yeux ni d’oreilles pour nous.
Oedipe.
Ah ! Madame.
Jocaste.
Ah ! Seigneur, que marque un tel silence ?
Oedipe.
Que pourrait-il marquer qu’une juste vengeance ?
Les dieux, qui tôt ou tard savent se ressentir,
Dédaignent de répondre à qui les fait mentir.
Ce fils dont ils avoient prédit les aventures,
Exposé par votre ordre, a trompé leurs augures ;
Et ce sang innocent, et ces dieux irrités,
Se vengent maintenant de vos impiétés.
Jocaste.
Devions-nous l’exposer à son destin funeste,
Pour le voir parricide et pour le voir inceste ?
Et des crimes si noirs étouffés au berceau
Auraient-ils su pour moi faire un crime nouveau ?
Non, non : de tant de maux Thèbes n’est assiégée
Que pour la mort du roi, que l’on n’a pas vengée ;
Son ombre incessamment me frappe encor les yeux ;
Je l’entends murmurer à toute heure, en tous lieux,
Et se plaindre en mon coeur de cette ignominie
Qu’imprime à son grand nom cette mort impunie.
Oedipe.
Pourrions-nous en punir des brigands inconnus,
Que peut-être jamais en ces lieux on n’a vus ?
Si vous m’avez dit vrai, peut-être ai-je moi-même
Sur trois de ces brigands vengé le diadème ;
Au lieu même, au temps même, attaqué seul par trois,
J’en laissai deux sans vie, et mis l’autre aux abois.
Mais ne négligeons rien, et du royaume sombre
Faisons par Tirésie évoquer sa grande ombre.
Puisque le ciel se tait, consultons les enfers :
Sachons à qui de nous sont dus les maux soufferts ;
Sachons-en, s’il se peut, la cause et le remède :
Allons tout de ce pas réclamer tous son aide.
J’irai revoir Corinthe avec moins de souci,
Si je laisse plein calme et pleine joie ici.
 *********
*********
ACTE II
Scène première
.
Oedipe.
Je ne le cèle point, cette hauteur m’étonne.
Aemon a du mérite, on chérit sa personne ;
Il est prince, et de plus étant offert par moi…
Dircé.
Je vous ai déjà dit, seigneur, qu’il n’est pas roi.
Oedipe.
Son hymen toutefois ne vous fait point descendre :
S’il n’est pas dans le trône, il a droit d’y prétendre ;
Et comme il est sorti de même sang que vous,
Je crois vous faire honneur d’en faire votre époux.
Dircé.
Vous pouvez donc sans honte en faire votre gendre :
Mes soeurs en l’épousant n’auront point à descendre ;
Mais pour moi, vous savez qu’il est ailleurs des rois,
Et même en votre cour, dont je puis faire choix.
Oedipe.
Vous le pouvez, madame, et n’en voudrez pas faire
Sans en prendre mon ordre et celui d’une mère.
Dircé.
Pour la reine, il est vrai qu’en cette qualité
Le sang peut lui devoir quelque civilité :
Je m’en suis acquittée, et ne puis bien comprendre,
Étant ce que je suis, quel ordre je dois prendre.
Oedipe.
Celui qu’un vrai devoir prend des fronts couronnés,
Lorsqu’on tient auprès d’eux le rang que vous tenez.
Je pense être ici roi.
Dircé.
Je sais ce que vous êtes ;
Mais si vous me comptez au rang de vos sujettes,
Je ne sais si celui qu’on vous a pu donner
Vous asservit un front qu’on a dû couronner.
Seigneur, quoi qu’il en soit, j’ai fait choix de Thésée ;
Je me suis à ce choix moi-même autorisée.
J’ai pris l’occasion que m’ont faite les dieux
De fuir l’aspect d’un trône où vous blessez mes yeux,
Et de vous épargner cet importun ombrage
Qu’à des rois comme vous peut donner mon visage.
Oedipe.
Le choix d’un si grand prince est bien digne de vous,
Et je l’estime trop pour en être jaloux ;
Mais le peuple au milieu des colères célestes
Aime encor de Laïus les adorables restes,
Et ne pourra souffrir qu’on lui vienne arracher
Ces gages d’un grand roi qu’il tint jadis si cher.
Dircé.
De l’air dont jusqu’ici ce peuple m’a traitée,
Je dois craindre fort peu de m’en voir regrettée.
S’il eût eu pour son roi quelque ombre d’amitié,
Si mon sexe ou mon âge eût ému sa pitié,
Il n’aurait jamais eu cette lâche faiblesse
De livrer en vos mains l’état et sa princesse,
Et me verra toujours éloigner sans regret,
Puisque c’est l’affranchir d’un reproche secret.
Oedipe.
Quel reproche secret lui fait votre présence ?
Et quel crime a commis cette reconnaissance
Qui par un sentiment et juste et relevé
L’a consacré lui-même à qui l’a conservé ?
Si vous aviez du Sphinx vu le sanglant ravage…
Dircé.
Je puis dire, seigneur, que j’ai vu davantage :
J’ai vu ce peuple ingrat que l’énigme surprit
Vous payer assez bien d’avoir eu de l’esprit.
Il pouvait toutefois avec quelque justice
Prendre sur lui le prix d’un si rare service ;
Mais quoiqu’il ait osé vous payer de mon bien,
En vous faisant son roi, vous a-t-il fait le mien ?
En se donnant à vous, eut-il droit de me vendre ?
Oedipe.
Ah ! C’est trop me forcer, madame, à vous entendre.
La jalouse fierté qui vous enfle le coeur
Me regarde toujours comme un usurpateur :
Vous voulez ignorer cette juste maxime,
Que le dernier besoin peut faire un roi sans crime,
Qu’un peuple sans défense et réduit aux abois…
Dircé.
Le peuple est trop heureux quand il meurt pour ses rois.
Mais, seigneur, la matière est un peu délicate ;
Vous pouvez vous flatter, peut-être je me flatte.
Sans rien approfondir, parlons à coeur ouvert.
Vous régnez en ma place, et les dieux l’ont souffert :
Je dis plus, ils vous ont saisi de ma couronne.
Je n’en murmure point, comme eux je vous la donne ;
J’oublierai qu’à moi seule ils devaient la garder ;
Mais si vous attentez jusqu’à me commander,
Jusqu’à prendre sur moi quelque pouvoir de maître,
Je me souviendrai lors de ce que je dois être ;
Et si je ne le suis pour vous faire la loi,
Je le serai du moins pour me choisir un roi.
Après cela, seigneur, je n’ai rien à vous dire :
J’ai fait choix de Thésée, et ce mot doit suffire.
Oedipe.
Et je veux à mon tour, madame, à coeur ouvert,
Vous apprendre en deux mots que ce grand choix vous perd,
Qu’il vous remplit le coeur d’une attente frivole,
Qu’au prince Aemon pour vous j’ai donné ma parole,
Que je perdrai le sceptre, ou saurai la tenir.
Puissent, si je la romps, tous les dieux m’en punir !
Puisse de plus de maux m’accabler leur colère
Qu’Apollon n’en prédit jadis pour votre frère !
Dircé.
N’insultez point au sort d’un enfant malheureux,
Et faites des serments qui soient plus généreux.
On ne sait pas toujours ce qu’un serment hasarde ;
Et vous ne voyez pas ce que le ciel vous garde.
Oedipe.
On se hasarde à tout quand un serment est fait.
Dircé.
Ce n’est pas de vous seul que dépend son effet.
Oedipe.
Je suis roi, je puis tout.
Dircé.
Je puis fort peu de chose ;
Mais enfin de mon coeur moi seule je dispose,
Et jamais sur ce coeur on n’avancera rien
Qu’en me donnant un sceptre, ou me rendant le mien.
Oedipe.
Il est quelques moyens de vous faire dédire.
Dircé.
Il en est de braver le plus injuste empire ;
Et de quoi qu’on menace en de tels différends,
Qui ne craint point la mort ne craint point les tyrans.
Ce mot m’est échappé, je n’en fais point d’excuse ;
J’en ferai, si le temps m’apprend que je m’abuse.
Rendez-vous cependant maître de tout mon sort ;
Mais n’offrez à mon choix que Thésée ou la mort.
Oedipe.
On pourra vous guérir de cette frénésie.
Mais il faut aller voir ce qu’a fait Tirésie :
Nous saurons au retour encor vos volontés.
Dircé.
Allez savoir de lui ce que vous méritez.
Scène II
.
Dircé.
Mégare, que dis-tu de cette violence ?
Après s’être emparé des droits de ma naissance,
Sa haine opiniâtre à croître mes malheurs
M’ose encore envier ce qui me vient d’ailleurs.
Elle empêche le ciel de m’être enfin propice,
De réparer vers moi ce qu’il eut d’injustice,
Et veut lier les mains au destin adouci
Qui m’offre en d’autres lieux ce qu’on me vole ici.
Mégare.
Madame, je ne sais ce que je dois vous dire :
La raison vous anime, et l’amour vous inspire ;
Mais je crains qu’il n’éclate un peu plus qu’il ne faut,
Et que cette raison ne parle un peu trop haut.
Je crains qu’elle n’irrite un peu trop la colère
D’un roi qui jusqu’ici vous a traitée en père,
Et qui vous a rendu tant de preuves d’amour,
Qu’il espère de vous quelque chose à son tour.
Dircé.
S’il a cru m’éblouir par de fausses caresses,
J’ai vu sa politique en former les tendresses ;
Et ces amusements de ma captivité
Ne me font rien devoir à qui m’a tout ôté.
Mégare.
Vous voyez que d’Aemon il a pris la querelle,
Qu’il l’estime, chérit.
Dircé.
Politique nouvelle.
Mégare.
Mais comment pour Thésée en viendrez-vous à bout ?
Il le méprise, hait.
Dircé.
Politique partout.
Si la flamme d’Aemon en est favorisée,
Ce n’est pas qu’il l’estime, ou méprise Thésée ;
C’est qu’il craint dans son coeur que le droit souverain
(car enfin il m’est dû) ne tombe en bonne main.
Comme il connaît le mien, sa peur de me voir reine
Dispense à mes amants sa faveur ou sa haine,
Et traiterait ce prince ainsi que ce héros,
S’il portait la couronne ou de Sparte ou d’Argos.
Mégare.
Si vous en jugez bien, que vous êtes à plaindre !
Dircé.
Il fera de l’éclat, il voudra me contraindre ;
Mais quoi qu’il me prépare à souffrir dans sa cour,
Il éteindra ma vie avant que mon amour.
Mégare.
Espérons que le ciel vous rendra plus heureuse.
Cependant je vous trouve assez peu curieuse :
Tout le peuple, accablé de mortelles douleurs,
Court voir ce que Laïus dira de nos malheurs ;
Et vous ne suivez point le roi chez Tirésie,
Pour savoir ce qu’en juge une ombre si chérie ?
Dircé.
J’ai tant d’autres sujets de me plaindre de lui,
Que je fermais les yeux à ce nouvel ennui.
Il aurait fait trop peu de menacer la fille,
Il faut qu’il soit tyran de toute la famille,
Qu’il porte sa fureur jusqu’aux âmes sans corps,
Et trouble insolemment jusqu’aux cendres des morts.
Mais ces mânes sacrés qu’il arrache au silence
Se vengeront sur lui de cette violence ;
Et les dieux des enfers, justement irrités,
Puniront l’attentat de ses impiétés.
Mégare.
Nous ne savons pas bien comme agit l’autre monde ;
Il n’est point d’oeil perçant dans cette nuit profonde ;
Et quand les dieux vengeurs laissent tomber leur bras,
Il tombe assez souvent sur qui n’y pense pas.
Dircé.
Dût leur décret fatal me choisir pour victime,
Si j’ai part au courroux, je n’en veux point au crime :
Je veux m’offrir sans tache à leur bras tout-puissant,
Et n’avoir à verser que du sang innocent.
Scène III
.
Nérine.
Ah ! Madame, il en faut de la même innocence
Pour apaiser du ciel l’implacable vengeance ;
Il faut une victime et pure et d’un tel rang,
Que chacun la voudrait racheter de son sang.
Dircé.
Nérine, que dis-tu ? Serait-ce bien la reine ?
Le ciel ferait-il choix d’Antigone, ou d’Ismène ?
Voudrait-il Étéocle, ou Polynice, ou moi ?
Car tu me dis assez que ce n’est pas le roi ;
Et si le ciel demande une victime pure,
Appréhender pour lui, c’est lui faire une injure.
Serait-ce enfin Thésée ? Hélas ! Si c’était lui…
Mais nomme, et dis quel sang le ciel veut aujourd’hui.
Nérine.
L’ombre du grand Laïus, qui lui sert d’interprète,
De honte ou de dépit sur ce nom est muette ;
Je n’ose vous nommer ce qu’elle nous a tu ;
Mais, préparez, madame, une haute vertu :
Prêtez à ce récit une âme généreuse,
Et vous-même jugez si la chose est douteuse.
Dircé.
Ah ! Ce sera Thésée, ou la reine.
Nérine.
Écoutez,
Et tâchez d’y trouver quelques obscurités.
Tirésie a longtemps perdu ses sacrifices
Sans trouver ni les dieux ni les ombres propices ;
Et celle de Laïus évoqué par son nom
S’obstinait au silence aussi bien qu’Apollon.
Mais la reine en la place à peine est arrivée,
Qu’une épaisse vapeur s’est du temple élevée,
D’où cette ombre aussitôt sortant jusqu’en plein jour
A surpris tous les yeux du peuple et de la cour.
L’impérieux orgueil de son regard sévère
Sur son visage pâle avait peint la colère ;
Tout menaçait en elle, et des restes de sang
Par un prodige affreux lui dégouttaient du flanc.
À ce terrible aspect la reine s’est troublée,
La frayeur a couru dans toute l’assemblée,
Et de vos deux amants j’ai vu les coeurs glacés
À ces funestes mots que l’ombre a prononcés :
» un grand crime impuni cause votre misère ;
Par le sang de ma race il se doit effacer ;
Mais à moins que de le verser,
Le ciel ne se peut satisfaire ;
Et la fin de vos maux ne se fera point voir
Que mon sang n’ait fait son devoir. »
Ces mots dans tous les coeurs redoublent les alarmes ;
L’ombre, qui disparaît, laisse la reine en larmes,
Thésée au désespoir, Aemon tout hors de lui ;
Le roi même arrivant partage leur ennui ;
Et d’une voix commune ils refusent une aide
Qui fait trouver le mal plus doux que le remède.
Dircé.
Peut-être craignent-ils que mon coeur révolté
Ne leur refuse un sang qu’ils n’ont pas mérité ;
Mais ma flamme à la mort m’avait trop résolue,
Pour ne pas y courir quand les dieux l’ont voulue.
Tu m’as fait sans raison concevoir de l’effroi ;
Je n’ai point dû trembler, s’ils ne veulent que moi.
Ils m’ouvrent une porte à sortir d’esclavage,
Que tient trop précieuse un généreux courage :
Mourir pour sa patrie est un sort plein d’appas
Pour quiconque à des fers préfère le trépas.
Admire, peuple ingrat, qui m’as déshéritée,
Quelle vengeance en prend ta princesse irritée,
Et connais dans la fin de tes longs déplaisirs
Ta véritable reine à ses derniers soupirs.
Vois comme à tes malheurs je suis toute asservie :
L’un m’a coûté mon trône, et l’autre veut ma vie.
Tu t’es sauvé du Sphinx aux dépens de mon rang ;
Sauve-toi de la peste aux dépens de mon sang.
Mais après avoir vu dans la fin de ta peine
Que pour toi le trépas semble doux à ta reine,
Fais-toi de son exemple une adorable loi :
Il est encor plus doux de mourir pour son roi.
Mégare.
Madame, aurait-on cru que cette ombre d’un père,
D’un roi dont vous tenez la mémoire si chère,
Dans votre injuste perte eût pris tant d’intérêt
Qu’elle vînt elle-même en prononcer l’arrêt ?
Dircé.
N’appelle point injuste un trépas légitime :
Si j’ai causé sa mort, puis-je vivre sans crime ?
Nérine.
Vous, madame ?
Dircé.
Oui, Nérine ; et tu l’as pu savoir.
L’amour qu’il me portait eut sur lui tel pouvoir,
Qu’il voulut sur mon sort faire parler l’oracle ;
Mais comme à ce dessein la reine mit obstacle,
De peur que cette voix des destins ennemis
Ne fût aussi funeste à la fille qu’au fils,
Il se déroba d’elle, ou plutôt prit la fuite,
Sans vouloir que Phorbas et Nicandre pour suite.
Hélas ! Sur le chemin il fut assassiné.
Ainsi se vit pour moi son destin terminé ;
Ainsi j’en fus la cause.
Mégare.
Oui, mais trop innocente
Pour vous faire un supplice où la raison consente ;
Et jamais des tyrans les plus barbares lois…
Dircé.
Mégare, tu sais mal ce que l’on doit aux rois.
Un sang si précieux ne saurait se répandre
Qu’à l’innocente cause on n’ait droit de s’en prendre ;
Et de quelque façon que finisse leur sort,
On n’est point innocent quand on cause leur mort.
C’est ce crime impuni qui demande un supplice ;
C’est par là que mon père a part au sacrifice ;
C’est ainsi qu’un trépas qui me comble d’honneur
Assure sa vengeance et fait votre bonheur,
Et que tout l’avenir chérira la mémoire
D’un châtiment si juste où brille tant de gloire.
Scène IV
.
Dircé.
Mais que vois-je ? Ah ! Seigneur, quels que soient vos ennuis,
Que venez-vous me dire en l’état où je suis ?
Thésée.
Je viens prendre de vous l’ordre qu’il me faut suivre ;
Mourir, s’il faut mourir, et vivre, s’il faut vivre.
Dircé.
Ne perdez point d’efforts à m’arrêter au jour :
Laissez faire l’honneur.
Thésée.
Laissez agir l’amour.
Dircé.
Vivez, prince ; vivez.
Thésée.
Vivez donc, ma princesse.
Dircé.
Ne me ravalez point jusqu’à cette bassesse.
Retarder mon trépas, c’est faire tout périr :
Tout meurt, si je ne meurs.
Thésée.
Laissez-moi donc mourir.
Dircé.
Hélas ! Qu’osez-vous dire ?
Thésée.
Hélas ! Qu’allez-vous faire ?
Dircé.
Finir les maux publics, obéir à mon père,
Sauver tous mes sujets.
Thésée.
Par quelle injuste loi
Faut-il les sauver tous pour ne perdre que moi ?
Eux dont le coeur ingrat porte les justes peines
D’un rebelle mépris qu’ils ont fait de vos chaînes,
Qui dans les mains d’un autre ont mis tout votre bien !
Dircé.
Leur devoir violé doit-il rompre le mien ?
Les exemples abjets de ces petites âmes
Règlent-ils de leurs rois les glorieuses trames ?
Et quel fruit un grand coeur pourrait-il recueillir
À recevoir du peuple un exemple à faillir ?
Non, non : s’il m’en faut un, je ne veux que le vôtre ;
L’amour que j’ai pour vous n’en reçoit aucun autre.
Pour le bonheur public n’avez-vous pas toujours
Prodigué votre sang et hasardé vos jours ?
Quand vous avez défait le Minotaure en Crète,
Quand vous avez puni Damaste et Périphète,
Sinnis, Phaea, Sciron, que faisiez-vous, seigneur,
Que chercher à périr pour le commun bonheur ?
Souffrez que pour la gloire une chaleur égale
D’une amante aujourd’hui vous fasse une rivale.
Le ciel offre à mon bras par où me signaler :
S’il ne sait pas combattre, il saura m’immoler ;
Et si cette chaleur ne m’a point abusée,
Je deviendrai par là digne du grand
Thésée.
Mon sort en ce point seul du vôtre est différent,
Que je ne puis sauver mon peuple qu’en mourant,
Et qu’au salut du vôtre un bras si nécessaire
À chaque jour pour lui d’autres combats à faire.
Thésée.
J’en ai fait et beaucoup, et d’assez généreux ;
Mais celui-ci, madame, est le plus dangereux.
J’ai fait trembler partout, et devant vous je tremble.
L’amant et le héros s’accordent mal ensemble ;
Mais enfin après vous tous deux veulent courir :
Le héros ne peut vivre où l’amant doit mourir ;
La fermeté de l’un par l’autre est épuisée ;
Et si Dircé n’est plus, il n’est plus de Thésée.
Dircé.
Hélas ! C’est maintenant, c’est lorsque je vous voi
Que ce même combat est dangereux pour moi.
Ma vertu la plus forte à votre aspect chancelle :
Tout mon coeur applaudit à sa flamme rebelle ;
Et l’honneur, qui charmait ses plus noirs déplaisirs,
N’est plus que le tyran de mes plus chers désirs.
Allez, prince ; et du moins par pitié de ma gloire
Gardez-vous d’achever une indigne victoire ;
Et si jamais l’honneur a su vous animer…
Thésée.
Hélas ! À votre aspect je ne sais plus qu’aimer.
Dircé.
Par un pressentiment j’ai déjà su vous dire
Ce que ma mort sur vous se réserve d’empire.
Votre bras de la Grèce est le plus ferme appui :
Vivez pour le public, comme je meurs pour lui.
Thésée.
Périsse l’univers, pourvu que Dircé vive !
Périsse le jour même avant qu’elle s’en prive !
Que m’importe la perte ou le salut de tous ?
Ai-je rien à sauver, rien à perdre que vous ?
Si votre amour, madame, était encor le même,
Si vous saviez encore aimer comme on vous aime…
Dircé.
Ah ! Faites moins d’outrage à ce coeur affligé
Que pressent les douleurs où vous l’avez plongé.
Laissez vivre du peuple un pitoyable reste
Aux dépens d’un moment que m’a laissé la peste,
Qui peut-être à vos yeux viendra trancher mes jours,
Si mon sang répandu ne lui tranche le cours.
Laissez-moi me flatter de cette triste joie
Que si je ne mourais vous en seriez la proie,
Et que ce sang aimé que répandront mes mains,
Sera versé pour vous plus que pour les Thébains.
Des dieux mal obéis la majesté suprême
Pourrait en ce moment s’en venger sur vous-même ;
Et j’aurais cette honte, en ce funeste sort,
D’avoir prêté mon crime à faire votre mort.
Thésée.
Et ce coeur généreux me condamne à la honte
De voir que ma princesse en amour me surmonte,
Et de n’obéir pas à cette aimable loi
De mourir avec vous quand vous mourez pour moi !
Pour moi, comme pour vous, soyez plus magnanime :
Voyez mieux qu’il y va même de votre estime,
Que le choix d’un amant si peu digne de vous
Souillerait cet honneur qui vous semble si doux,
Et que de ma princesse on dirait d’âge en âge
Qu’elle eut de mauvais yeux pour un si grand courage.
Dircé.
Mais, seigneur, je vous sauve en courant au trépas ;
Et mourant avec moi vous ne me sauvez pas.
Thésée.
La gloire de ma mort n’en deviendra pas moindre ;
Si ce n’est vous sauver, ce sera vous rejoindre :
Séparer deux amants, c’est tous deux les punir ;
Et dans le tombeau même il est doux de s’unir.
Dircé.
Que vous m’êtes cruel de jeter dans mon âme
Un si honteux désordre avec des traits de flamme !
Adieu, prince : vivez, je vous l’ordonne ainsi ;
La gloire de ma mort est trop douteuse ici ;
Et je hasarde trop une si noble envie
À voir l’unique objet pour qui j’aime la vie.
Thésée.
Vous fuyez, ma princesse, et votre adieu fatal…
Dircé.
Prince, il est temps de fuir quand on se défend mal.
Vivez, encore un coup : c’est moi qui vous l’ordonne.
Thésée.
Le véritable amour ne prend loi de personne ;
Et si ce fier honneur s’obstine à nous trahir,
Je renonce, madame, à vous plus obéir.
**********************
Œdipe CORNEILLE
***************
ACTE III
Scène première
.
Dircé.
Impitoyable soif de gloire,
Dont l’aveugle et noble transport
Me fait précipiter ma mort
Pour faire vivre ma mémoire,
Arrête pour quelques moments
Les impétueux sentiments
De cette inexorable envie,
Et souffre qu’en ce triste et favorable jour,
Avant que te donner ma vie,
Je donne un soupir à l’amour.
Ne crains pas qu’une ardeur si belle
Ose te disputer un coeur
Qui de ton illustre rigueur
Est l’esclave le plus fidèle.
Ce regard tremblant et confus,
Qu’attire un bien qu’il n’attend plus,
N’empêche pas qu’il ne se dompte.
Il est vrai qu’il murmure, et se dompte à regret ;
Mais s’il m’en faut rougir de honte,
Je n’en rougirai qu’en secret.
L’éclat de cette renommée
Qu’assure un si brillant trépas
Perd la moitié de ses appas
Quand on aime et qu’on est aimée.
L’honneur, en monarque absolu,
Soutient ce qu’il a résolu
Contre les assauts qu’on te livre.
Il est beau de mourir pour en suivre les lois ;
Mais il est assez doux de vivre
Quand l’amour a fait un beau choix.
Toi qui faisais toute la joie
Dont sa flamme osait me flatter,
Prince que j’ai peine à quitter,
À quelques honneurs qu’on m’envoie,
Accepte ce faible retour
Que vers toi d’un si juste amour
Fait la douloureuse tendresse.
Sur les bords de la tombe où tu me vois courir,
Je crains les maux que je te laisse,
Quand je fais gloire de mourir.
J’en fais gloire, mais je me cache
Un comble affreux de déplaisirs ;
Je fais taire tous mes désirs,
Mon coeur à soi-même s’arrache.
Cher prince, dans un tel aveu,
Si tu peux voir quel est mon feu,
Vois combien il se violente.
Je meurs l’esprit content, l’honneur m’en fait la loi ;
Mais j’aurais vécu plus contente,
Si j’avais pu vivre pour toi.
Scène II
.
Dircé.
Tout est-il prêt, madame, et votre Tirésie
Attend-il aux autels la victime choisie ?
Jocaste.
Non, ma fille ; et du moins nous aurons quelques jours
À demander au ciel un plus heureux secours.
On prépare à demain exprès d’autres victimes.
Le peuple ne vaut pas que vous payiez ses crimes :
Il aime mieux périr qu’être ainsi conservé ;
Et le roi même, encor que vous l’ayez bravé,
Sensible à vos malheurs autant qu’à ma prière,
Vous offre sur ce point liberté toute entière.
Dircé.
C’est assez vainement qu’il m’offre un si grand bien,
Quand le ciel ne veut pas que je lui doive rien ;
Et ce n’est pas à lui de mettre des obstacles
Aux ordres souverains que donnent ses oracles.
Jocaste.
L’oracle n’a rien dit.
Dircé.
Mais mon père a parlé ;
L’ordre de nos destins par lui s’est révélé ;
Et des morts de son rang les ombres immortelles
Servent souvent aux dieux de truchements fidèles.
Jocaste.
Laissez la chose en doute, et du moins hésitez
Tant qu’on ait par leur bouche appris leurs volontés.
Dircé.
Exiger qu’avec nous ils s’expliquent eux-mêmes,
C’est trop nous asservir ces majestés suprêmes.
Jocaste.
Ma fille, il est toujours assez tôt de mourir.
Dircé.
Madame, il n’est jamais trop tôt de secourir ;
Et pour un mal si grand qui réclame notre aide,
Il n’est point de trop sûr ni de trop prompt remède.
Plus nous le différons, plus ce mal devient grand.
J’assassine tous ceux que la peste surprend ;
Aucun n’en peut mourir qui ne me laisse un crime :
Je viens d’étouffer seule et Sostrate et Phaedime ;
Et durant ce refus des remèdes offerts,
La Parque se prévaut des moments que je perds.
Hélas ! Si sa fureur dans ces pertes publiques
Enveloppait Thésée après ses domestiques !
Si nos retardements…
Jocaste.
Vivez pour lui, Dircé :
Ne lui dérobez point un coeur si bien placé.
Avec tant de courage ayez quelque tendresse ;
Agissez en amante aussi bien qu’en princesse.
Vous avez liberté toute entière en ces lieux :
Le roi n’y prend pas garde, et je ferme les yeux.
C’est vous en dire assez : l’amour est un doux maître ;
Et quand son choix est beau, son ardeur doit paraître.
Dircé.
Je n’ose demander si de pareils avis
Portent des sentiments que vous ayez suivis.
Votre second hymen put avoir d’autres causes ;
Mais j’oserai vous dire, à bien juger des choses,
Que pour avoir reçu la vie en votre flanc,
J’y dois avoir sucé fort peu de votre sang.
Celui du grand Laïus, dont je m’y suis formée,
Trouve bien qu’il est doux d’aimer et d’être aimée ;
Mais il ne peut trouver qu’on soit digne du jour
Quand aux soins de sa gloire on préfère l’amour.
Je sais sur les grands coeurs ce qu’il se fait d’empire :
J’avoue, et hautement, que le mien en soupire ;
Mais quoi qu’un si beau choix puisse avoir de douceurs,
Je garde un autre exemple aux princesses mes soeurs.
Jocaste.
Je souffre tout de vous en l’état où vous êtes.
Si vous ne savez pas même ce que vous faites,
Le chagrin inquiet du trouble où je vous voi
Vous peut faire oublier que vous parlez à moi ;
Mais quittez ces dehors d’une vertu sévère,
Et souvenez-vous mieux que je suis votre mère.
Dircé.
Ce chagrin inquiet, pour se justifier,
N’a qu’à prendre chez vous l’exemple d’oublier.
Quand vous mîtes le sceptre en une autre famille,
Vous souvint-il assez que j’étais votre fille ?
Jocaste.
Vous n’étiez qu’un enfant.
Dircé.
J’avais déjà des yeux,
Et sentais dans mon coeur le sang de mes aïeux ;
C’était ce même sang dont vous m’avez fait naître
Qui s’indignait dès lors qu’on lui donnât un maître,
Et que vers soi Laïus aime mieux rappeler
Que de voir qu’à vos yeux on l’ose ravaler.
Il oppose ma mort à l’indigne hyménée
Où par raison d’état il me voit destinée ;
Il la fait glorieuse, et je meurs plus pour moi
Que pour ces malheureux qui se sont fait un roi.
Le ciel en ma faveur prend ce cher interprète,
Pour m’épargner l’affront de vivre encor sujette ;
Et s’il a quelque foudre, il saura le garder
Pour qui m’a fait des lois où j’ai dû commander.
Jocaste.
Souffrez qu’à ses éclairs votre orgueil se dissipe :
Ce foudre vous menace un peu plus tôt qu’Oedipe ;
Et le roi n’a pas lieu d’en redouter les coups,
Quand parmi tout son peuple ils n’ont choisi que vous.
Dircé.
Madame, il se peut faire encor qu’il me prévienne :
S’il sait ma destinée, il ignore la sienne ;
Le ciel pourra venger ses ordres retardés.
Craignez ce changement que vous lui demandez.
Souvent on l’entend mal quand on le croit entendre :
L’oracle le plus clair se fait le moins comprendre.
Moi-même je le dis sans comprendre pourquoi ;
Et ce discours en l’air m’échappe malgré moi.
Pardonnez cependant à cette humeur hautaine :
Je veux parler en fille, et je m’explique en reine.
Vous qui l’êtes encor, vous savez ce que c’est,
Et jusqu’où nous emporte un si haut intérêt.
Si je n’en ai le rang, j’en garde la teinture.
Le trône a d’autres droits que ceux de la nature.
J’en parle trop peut-être alors qu’il faut mourir.
Hâtons-nous d’empêcher ce peuple de périr ;
Et sans considérer quel fut vers moi son crime,
Puisque le ciel le veut, donnons-lui sa victime.
Jocaste.
Demain ce juste ciel pourra s’expliquer mieux.
Cependant vous laissez bien du trouble en ces lieux ;
Et si votre vertu pouvait croire mes larmes,
Vous nous épargneriez cent mortelles alarmes.
Dircé.
Dussent avec vos pleurs tous vos Thébains s’unir,
Ce que n’a pu l’amour, rien ne doit l’obtenir.
Scène III
.
Dircé.
À quel propos, seigneur, voulez-vous qu’on diffère,
Qu’on dédaigne un remède à tous si salutaire ?
Chaque instant que je vis vous enlève un sujet,
Et l’état s’affaiblit par l’affront qu’on me fait.
Cette ombre de pitié n’est qu’un comble d’envie :
Vous m’avez envié le bonheur de ma vie ;
Et je vous vois par là jaloux de tout mon sort,
Jusques à m’envier la gloire de ma mort.
Oedipe.
Qu’on perd de temps, madame, alors qu’on vous fait grâce !
Dircé.
Le ciel m’en a trop fait pour souffrir qu’on m’en fasse.
Jocaste.
Faut-il voir votre esprit obstinément aigri,
Quand ce qu’on fait pour vous doit l’avoir attendri ?
Dircé.
Faut-il voir son envie à mes voeux opposée,
Quand il ne s’agit plus d’Aemon ni de Thésée ?
Oedipe.
Il s’agit de répandre un sang si précieux,
Qu’il faut un second ordre et plus exprès des dieux.
Dircé.
Doutez-vous qu’à mourir je ne sois toute prête,
Quand les dieux par mon père ont demandé ma tête ?
Oedipe.
Je vous connais, madame, et je n’ai point douté
De cet illustre excès de générosité ;
Mais la chose après tout n’est pas encor si claire,
Que cet ordre nouveau ne nous soit nécessaire.
Dircé.
Quoi ? Mon père tantôt parlait obscurément ?
Oedipe.
Je n’en ai rien connu que depuis un moment.
C’est un autre que vous peut-être qu’il menace.
Dircé.
Si l’on ne m’a trompée, il n’en veut qu’à sa race.
Oedipe.
Je sais qu’on vous a fait un fidèle rapport ;
Mais vous pourriez mourir et perdre votre mort ;
Et la reine sans doute était bien inspirée,
Alors que par ses pleurs elle l’a différée.
Jocaste.
Je ne reçois qu’en trouble un si confus espoir.
Oedipe.
Ce trouble augmentera peut-être avant ce soir.
Jocaste.
Vous avancez des mots que je ne puis comprendre.
Oedipe.
Vous vous plaindrez fort peu de ne les point entendre :
Nous devons bientôt voir le mystère éclairci.
Madame, cependant vous êtes libre ici ;
La reine vous l’a dit, on vous a dû le dire ;
Et si vous m’entendez, ce mot vous doit suffire.
Dircé.
Quelque secret motif qui vous aye excité
À ce tardif excès de générosité,
Je n’emporterai point de Thèbes dans Athènes
La colère des dieux et l’amas de leurs haines,
Qui pour premier objet pourraient choisir l’époux
Pour qui j’aurais osé mériter leur courroux.
Vous leur faites demain offrir un sacrifice ?
Oedipe.
J’en espère pour vous un destin plus propice.
Dircé.
J’y trouverai ma place, et ferai mon devoir.
Quant au reste, seigneur, je n’en veux rien savoir :
J’y prends si peu de part, que sans m’en mettre en peine,
Je vous laisse expliquer votre énigme à la reine.
Mon coeur doit être las d’avoir tant combattu,
Et fuit un piége adroit qu’on tend à sa vertu.
Scène IV
.
Oedipe.
Madame, quand des dieux la réponse funeste,
De peur d’un parricide et de peur d’un inceste,
Sur le mont Cythéron fit exposer ce fils
Pour qui tant de forfaits avoient été prédits,
Sûtes-vous faire choix d’un ministre fidèle ?
Jocaste.
Aucun pour le feu roi n’a montré plus de zèle,
Et quand par des voleurs il fut assassiné,
Ce digne favori l’avait accompagné.
Par lui seul on a su cette noire aventure ;
On le trouva percé d’une large blessure,
Si baigné dans son sang, et si près de mourir,
Qu’il fallut une année et plus pour l’en guérir.
Oedipe.
Est-il mort ?
Jocaste.
Non, seigneur : la perte de son maître
Fut cause qu’en la cour il cessa de paraître ;
Mais il respire encore, assez vieil et cassé ;
Et Mégare, sa fille, est auprès de Dircé.
Oedipe.
Où fait-il sa demeure ?
Jocaste.
Au pied de cette roche
Que de ces tristes murs nous voyons la plus proche.
Oedipe.
Tâchez de lui parler.
Jocaste.
J’y vais tout de ce pas.
Qu’on me prépare un char pour aller chez Phorbas.
Son dégoût de la cour pourrait sur un message
S’excuser par caprice et prétexter son âge.
Dans une heure au plus tard je saurai vous revoir.
Mais que dois-je lui dire, et qu’en faut-il savoir ?
Oedipe.
Un bruit court depuis peu qu’il vous a mal servie,
Que ce fils qu’on croit mort est encor plein de vie.
L’oracle de Laïus par là devient douteux,
Et tout ce qu’il a dit peut s’étendre sur deux.
Jocaste.
Seigneur, ou sur ce bruit je suis fort abusée,
Ou ce n’est qu’un effet de l’amour de Thésée :
Pour sauver ce qu’il aime et vous embarrasser,
Jusques à votre oreille il l’aura fait passer ;
Mais Phorbas aisément convaincra d’imposture
Quiconque ose à sa foi faire une telle injure.
Oedipe.
L’innocence de l’âge aura pu l’émouvoir.
Jocaste.
Je l’ai toujours connu ferme dans son devoir ;
Mais si déjà ce bruit vous met en jalousie,
Vous pouvez consulter le devin Tirésie,
Publier sa réponse, et traiter d’imposteur
De cette illusion le téméraire auteur.
Oedipe.
Je viens de le quitter, et de là vient ce trouble
Qu’en mon coeur alarmé chaque moment redouble.
» ce prince, m’a-t-il dit, respire en votre cour :
Vous pourrez le connaître avant la fin du jour ;
Mais il pourra vous perdre en se faisant connaître.
Puisse-t-il ignorer quel sang lui donne l’être ! »
Voilà ce qu’il m’a dit d’un ton si plein d’effroi,
Qu’il l’a fait rejaillir jusqu’en l’âme d’un roi.
Ce fils, qui devait être inceste et parricide,
Doit avoir un coeur lâche, un courage perfide ;
Et par un sentiment facile à deviner,
Il ne se cache ici que pour m’assassiner :
C’est par là qu’il aspire à devenir monarque,
Et vous le connaîtrez bientôt à cette marque.
Quoi qu’il en soit, madame, allez trouver Phorbas :
Tirez-en, s’il se peut, les clartés qu’on n’a pas.
Tâchez en même temps de voir aussi Thésée :
Dites-lui qu’il peut faire une conquête aisée,
Qu’il ose pour Dircé, que je n’en verrai rien.
J’admire un changement si confus que le mien :
Tantôt dans leur hymen je croyais voir ma perte,
J’allais pour l’empêcher jusqu’à la force ouverte ;
Et sans savoir pourquoi, je voudrais que tous deux
Fussent, loin de ma vue, au comble de leurs voeux,
Que les emportements d’une ardeur mutuelle
M’eussent débarrassé de son amant et d’elle.
Bien que de leur vertu rien ne me soit suspect,
Je ne sais quelle horreur me trouble à leur aspect ;
Ma raison la repousse, et ne m’en peut défendre ;
Moi-même en cet état je ne puis me comprendre ;
Et l’énigme du Sphinx fut moins obscur pour moi
Que le fond de mon coeur ne l’est dans cet effroi :
Plus je le considère, et plus je m’en irrite.
Mais ce prince paraît, souffrez que je l’évite ;
Et si vous vous sentez l’esprit moins interdit,
Agissez avec lui comme je vous ai dit.
Scène V
.
Jocaste.
Prince, que faites-vous ? Quelle pitié craintive,
Quel faux respect des dieux tient votre flamme oisive ?
Avez-vous oublié comme il faut secourir ?
Thésée.
Dircé n’est plus, madame, en état de périr :
Le ciel vous rend un fils, et ce n’est qu’à ce prince
Qu’est dû le triste honneur de sauver sa province.
Jocaste.
C’est trop vous assurer sur l’éclat d’un faux bruit.
Thésée.
C’est une vérité dont je suis mieux instruit.
Jocaste.
Vous le connaissez donc ?
Thésée.
À l’égal de moi-même.
Jocaste.
De quand ?
Thésée.
De ce moment.
Jocaste.
Et vous l’aimez ?
Thésée.
Je l’aime
Jusqu’à mourir du coup dont il sera percé.
Jocaste.
Mais cette amitié cède à l’amour de Dircé ?
Thésée.
Hélas ! Cette princesse à mes désirs si chère
En un fidèle amant trouve un malheureux frère,
Qui mourrait de douleur d’avoir changé de sort,
N’était le prompt secours d’une plus digne mort,
Et qu’assez tôt connu pour mourir au lieu d’elle
Ce frère malheureux meurt en amant fidèle.
Jocaste.
Quoi ? Vous seriez mon fils ?
Thésée.
Et celui de Laïus.
Jocaste.
Qui vous a pu le dire ?
Thésée.
Un témoin qui n’est plus,
Phaedime, qu’à mes yeux vient de ravir la peste :
Non qu’il m’en ait donné la preuve manifeste ;
Mais Phorbas, ce vieillard qui m’exposa jadis,
Répondra mieux que lui de ce que je vous dis,
Et vous éclaircira touchant une aventure
Dont je n’ai pu tirer qu’une lumière obscure.
Ce peu qu’en ont pour moi les soupirs d’un mourant
Du grand droit de régner serait mauvais garant.
Mais ne permettez pas que le roi me soupçonne,
Comme si ma naissance ébranlait sa couronne ;
Quelque honneur, quelques droits qu’elle ait pu m’acquérir,
Je ne viens disputer que celui de mourir.
Jocaste.
Je ne sais si Phorbas avouera votre histoire ;
Mais qu’il l’avoue ou non, j’aurai peine à vous croire.
Avec votre mourant Tirésie est d’accord,
À ce que dit le roi, que mon fils n’est point mort.
C’est déjà quelque chose ; et toutefois mon âme
Aime à tenir suspecte une si belle flamme.
Je ne sens point pour vous l’émotion du sang,
Je vous trouve en mon coeur toujours en même rang ;
J’ai peine à voir un fils où j’ai cru voir un gendre ;
La nature avec vous refuse de s’entendre,
Et me dit en secret, sur votre emportement,
Qu’il a bien peu d’un frère, et beaucoup d’un amant ;
Qu’un frère a pour des soeurs une ardeur plus remise,
À moins que sous ce titre un amant se déguise,
Et qu’il cherche en mourant la gloire et la douceur
D’arracher à la mort ce qu’il nomme sa soeur.
Thésée.
Que vous connaissez mal ce que peut la nature !
Quand d’un parfait amour elle a pris la teinture,
Et que le désespoir d’un illustre projet
Se joint aux déplaisirs d’en voir périr l’objet,
Il est doux de mourir pour une soeur si chère.
Je l’aimais en amant, je l’aime encore en frère ;
C’est sous un autre nom le même empressement :
Je ne l’aime pas moins, mais je l’aime autrement.
L’ardeur sur la vertu fortement établie
Par ces retours du sang ne peut être affaiblie ;
Et ce sang qui prêtait sa tendresse à l’amour
A droit d’en emprunter les forces à son tour.
Jocaste.
Eh bien ! Soyez mon fils, puisque vous voulez l’être ;
Mais donnez-moi la marque où je le dois connaître.
Vous n’êtes point ce fils, si vous n’êtes méchant :
Le ciel sur sa naissance imprima ce penchant ;
J’en vois quelque partie en ce désir inceste ;
Mais pour ne plus douter, vous chargez-vous du reste ?
Êtes-vous l’assassin et d’un père et d’un roi ?
Thésée.
Ah ! Madame, ce mot me fait pâlir d’effroi.
Jocaste.
C’était là de mon fils la noire destinée ;
Sa vie à ces forfaits par le ciel condamnée
N’a pu se dégager de cet astre ennemi,
Ni de son ascendant s’échapper à demi.
Si ce fils vit encore, il a tué son père :
C’en est l’indubitable et le seul caractère ;
Et le ciel, qui prit soin de nous en avertir,
L’a dit trop hautement pour se voir démentir.
Sa mort seule pouvait le dérober au crime.
Prince, renoncez donc à toute votre estime :
Dites que vos vertus sont crimes déguisés ;
Recevez tout le sort que vous vous imposez ;
Et pour remplir un nom dont vous êtes avide,
Acceptez ceux d’inceste et de fils parricide.
J’en croirai ces témoins que le ciel m’a prescrits,
Et ne vous puis donner mon aveu qu’à ce prix.
Thésée.
Quoi ? La nécessité des vertus et des vices
D’un astre impérieux doit suivre les caprices,
Et Delphes, malgré nous, conduit nos actions
Au plus bizarre effet de ses prédictions ?
L’âme est donc toute esclave : une loi souveraine
Vers le bien ou le mal incessamment l’entraîne ;
Et nous ne recevons ni crainte ni désir
De cette liberté qui n’a rien à choisir,
Attachés sans relâche à cet ordre sublime,
Vertueux sans mérite, et vicieux sans crime.
Qu’on massacre les rois, qu’on brise les autels,
C’est la faute des dieux, et non pas des mortels.
De toute la vertu sur la terre épandue,
Tout le prix à ces dieux, toute la gloire est due ;
Ils agissent en nous quand nous pensons agir ;
Alors qu’on délibère on ne fait qu’obéir ;
Et notre volonté n’aime, hait, cherche, évite,
Que suivant que d’en haut leur bras la précipite.
D’un tel aveuglement daignez me dispenser.
Le ciel, juste à punir, juste à récompenser,
Pour rendre aux actions leur peine ou leur salaire,
Doit nous offrir son aide, et puis nous laisser faire.
N’enfonçons toutefois ni votre oeil ni le mien
Dans ce profond abîme où nous ne voyons rien :
Delphes a pu vous faire une fausse réponse ;
L’argent put inspirer la voix qui les prononce ;
Cet organe des dieux put se laisser gagner
À ceux que ma naissance éloignait de régner ;
Et par tous les climats on n’a que trop d’exemples
Qu’il est ainsi qu’ailleurs des méchants dans les temples.
Du moins puis-je assurer que dans tous mes combats
Je n’ai jamais souffert de seconds que mon bras ;
Que je n’ai jamais vu ces lieux de la Phocide
Où fut par des brigands commis ce parricide ;
Que la fatalité des plus pressants malheurs
Ne m’aurait pu réduire à suivre des voleurs ;
Que j’en ai trop puni pour en croître le nombre…
Jocaste.
Mais Laïus a parlé, vous en avez vu l’ombre :
De l’oracle avec elle on voit tant de rapport,
Qu’on ne peut qu’à ce fils en imputer la mort ;
Et c’est le dire assez qu’ordonner qu’on efface
Un grand crime impuni par le sang de sa race.
Attendons toutefois ce qu’en dira Phorbas :
Autre que lui n’a vu ce malheureux trépas ;
Et de ce témoin seul dépend la connaissance
Et de ce parricide et de votre naissance.
Si vous êtes coupable, évitez-en les yeux ;
Et de peur d’en rougir, prenez d’autres aïeux.
Thésée.
Je le verrai, madame, et sans inquiétude.
Ma naissance confuse a quelque incertitude ;
Mais pour ce parricide, il est plus que certain
Que ce ne fut jamais un crime de ma main.
*********
Œdipe CORNEILLE
**********
ACTE IV
Scène première
.
Dircé.
Oui, déjà sur ce bruit l’amour m’avait flattée :
Mon âme avec plaisir s’était inquiétée ;
Et ce jaloux honneur qui ne consentait pas
Qu’un frère me ravît un glorieux trépas,
Après cette douceur fièrement refusée,
Ne me refusait point de vivre pour Thésée,
Et laissait doucement corrompre sa fierté
À l’espoir renaissant de ma perplexité.
Mais si je vois en vous ce déplorable frère,
Quelle faveur du ciel voulez-vous que j’espère,
S’il n’est pas en sa main de m’arrêter au jour
Sans faire soulever et l’honneur et l’amour ?
S’il dédaigne mon sang, il accepte le vôtre ;
Et si quelque miracle épargne l’un et l’autre,
Pourra-t-il détacher de mon sort le plus doux
L’amertume de vivre, et n’être point à vous ?
Thésée.
Le ciel choisit souvent de secrètes conduites
Qu’on ne peut démêler qu’après de longues suites ;
Et de mon sort douteux l’obscur événement
Ne défend pas l’espoir d’un second changement.
Je chéris ce premier qui vous est salutaire.
Je ne puis en amant ce que je puis en frère ;
J’en garderai le nom tant qu’il faudra mourir ;
Mais si jamais d’ailleurs on peut vous secourir,
Peut-être que le ciel me faisant mieux connaître,
Sitôt que vous vivrez, je cesserai de l’être ;
Car je n’aspire point à calmer son courroux,
Et ne veux ni mourir ni vivre que pour vous.
Dircé.
Cet amour mal éteint sied mal au coeur d’un frère :
Où le sang doit parler, c’est à lui de se taire ;
Et sitôt que sans crime il ne peut plus durer,
Pour ses feux les plus vifs il est temps d’expirer.
Thésée.
Laissez-lui conserver ces ardeurs empressées
Qui vous faisaient l’objet de toutes mes pensées.
J’ai mêmes yeux encore, et vous mêmes appas :
Si mon sort est douteux, mon souhait ne l’est pas.
Mon coeur n’écoute point ce que le sang veut dire :
C’est d’amour qu’il gémit, c’est d’amour qu’il soupire ;
Et pour pouvoir sans crime en goûter la douceur,
Il se révolte exprès contre le nom de soeur.
De mes plus chers désirs ce partisan sincère
En faveur de l’amant tyrannise le frère,
Et partage à tous deux le digne empressement
De mourir comme frère et vivre comme amant.
Dircé.
Ô du sang de Laïus preuves trop manifestes !
Le ciel, vous destinant à des flammes incestes,
A su de votre esprit déraciner l’horreur
Que doit faire à l’amour le sacré nom de soeur ;
Mais si sa flamme y garde une place usurpée,
Dircé dans votre erreur n’est point enveloppée :
Elle se défend mieux de ce trouble intestin,
Et si c’est votre sort, ce n’est pas son destin.
Non qu’enfin sa vertu vous regarde en coupable :
Puisque le ciel vous force, il vous rend excusable ;
Et l’amour pour les sens est un si doux poison,
Qu’on ne peut pas toujours écouter la raison.
Moi-même, en qui l’honneur n’accepte aucune grâce,
J’aime en ce douteux sort tout ce qui m’embarrasse,
Je ne sais quoi m’y plaît qui n’ose s’exprimer,
Et ce confus mélange a de quoi me charmer.
Je n’aime plus qu’en soeur, et malgré moi j’espère.
Ah ! Prince, s’il se peut, ne soyez point mon frère,
Et laissez-moi mourir avec les sentiments
Que la gloire permet aux illustres amants.
Thésée.
Je vous ai déjà dit, princesse, que peut-être,
Sitôt que vous vivrez, je cesserai de l’être :
Faut-il que je m’explique ? Et toute votre ardeur
Ne peut-elle sans moi lire au fond de mon coeur ?
Puisqu’il est tout à vous, pénétrez-y, madame :
Vous verrez que sans crime il conserve sa flamme.
Si je suis descendu jusqu’à vous abuser,
Un juste désespoir m’aurait fait plus oser ;
Et l’amour, pour défendre une si chère vie,
Peut faire vanité d’un peu de tromperie.
J’en ai tiré ce fruit, que ce nom décevant
A fait connaître ici que ce prince est vivant.
Phorbas l’a confessé ; Tirésie a lui-même
Appuyé de sa voix cet heureux stratagème :
C’est par lui qu’on a su qu’il respire en ces lieux.
Souffrez donc qu’un moment je trompe encor leurs yeux ;
Et puisque dans ce jour ce frère doit paraître,
Jusqu’à ce qu’on l’ait vu permettez-moi de l’être.
Dircé.
Je pardonne un abus que l’amour a formé,
Et rien ne peut déplaire alors qu’on est aimé.
Mais hasardiez-vous tant sans aucune lumière ?
Thésée.
Mégare m’avait dit le secret de son père ;
Il m’a valu l’honneur de m’exposer pour tous ;
Mais je n’en abusais que pour mourir pour vous.
Le succès a passé cette triste espérance :
Ma flamme en vos périls ne voit plus d’apparence.
Si l’on peut à l’oracle ajouter quelque foi,
Ce fils a de sa main versé le sang du roi ;
Et son ombre, en parlant de punir un grand crime,
Dit assez que c’est lui qu’elle veut pour victime.
Dircé.
Prince, quoi qu’il en soit, n’empêchez plus ma mort,
Si par le sacrifice on n’éclaircit mon sort.
La reine, qui paraît, fait que je me retire :
Sachant ce que je sais, j’aurais peur d’en trop dire ;
Et comme enfin ma gloire a d’autres intérêts,
Vous saurez mieux sans moi ménager vos secrets :
Mais puisque vous voulez que mon esprit revive,
Ne tenez pas longtemps la vérité captive.
Scène II
.
Jocaste.
Prince, j’ai vu Phorbas ; et tout ce qu’il m’a dit
À ce que vous croyez peut donner du crédit.
Un passant inconnu, touché de cette enfance
Dont un astre envieux condamnait la naissance,
Sur le mont Cythéron reçut de lui mon fils,
Sans qu’il lui demandât son nom ni son pays,
De crainte qu’à son tour il ne conçût l’envie
D’apprendre dans quel sang il conservait la vie.
Il l’a revu depuis, et presque tous les ans,
Dans le temple d’élide offrir quelques présents.
Ainsi chacun des deux connaît l’autre au visage,
Sans s’être l’un à l’autre expliqués davantage.
Il a bien su de lui que ce fils conservé
Respire encor le jour dans un rang élevé ;
Mais je demande en vain qu’à mes yeux il le montre,
À moins que ce vieillard avec lui se rencontre.
Si Phaedime après lui vous eut en son pouvoir,
De cet inconnu même il put vous recevoir,
Et voyant à Trézène une mère affligée
De la perte du fils qu’elle avait eu d’Aegée,
Vous offrir en sa place, elle vous accepter.
Tout ce qui sur ce point pourrait faire douter,
C’est qu’il vous a souffert dans une flamme inceste,
Et n’a parlé de rien qu’en mourant de la peste.
Mais d’ailleurs Tirésie a dit que dans ce jour
Nous pourrons voir ce prince, et qu’il vit dans la cour ;
Quelques moments après on vous a vu paraître :
Ainsi vous pouvez l’être, et pouvez ne pas l’être.
Passons outre. À Phorbas ajouteriez-vous foi ?
S’il n’a pas vu mon fils, il vit la mort du roi,
Il connaît l’assassin : voulez-vous qu’il vous voie ?
Thésée.
Je le verrai, madame, et l’attends avec joie,
Sûr, comme je l’ai dit, qu’il n’est point de malheurs
Qui m’eussent pu réduire à suivre des voleurs.
Jocaste.
Ne vous assurez point sur cette conjecture,
Et souffrez qu’elle cède à la vérité pure.
Honteux qu’un homme seul eût triomphé de trois,
Qu’il en eût tué deux et mis l’autre aux abois,
Phorbas nous supposa ce qu’il nous en fit croire,
Et parla de brigands pour sauver quelque gloire.
Il me vient d’avouer sa faiblesse à genoux.
» d’un bras seul, m’a-t-il dit, partirent tous les coups ;
Un bras seul à tous trois nous ferma le passage,
Et d’une seule main ce grand crime est l’ouvrage. »
Thésée.
Le crime n’est pas grand s’il fut seul contre trois ;
Mais jamais sans forfait on ne se prend aux rois ;
Et fussent-ils cachés sous un habit champêtre,
Leur propre majesté les doit faire connaître.
L’assassin de Laïus est digne du trépas,
Bien que seul contre trois, il ne le connût pas.
Pour moi, je l’avouerai, que jamais ma vaillance
À mon bras contre trois n’a commis ma défense.
L’oeil de votre Phorbas aura beau me chercher,
Jamais dans la Phocide on ne m’a vu marcher.
Qu’il vienne : à ses regards sans crainte je m’expose ;
Et c’est un imposteur s’il vous dit autre chose.
Jocaste.
Faites entrer Phorbas. Prince, pensez-y bien.
Thésée.
S’il est homme d’honneur, je n’en dois craindre rien.
Jocaste.
Vous voudrez, mais trop tard, en éviter la vue.
Thésée.
Qu’il vienne ; il tarde trop, cette lenteur me tue ;
Et si je le pouvais sans perdre le respect,
Je me plaindrais un peu de me voir trop suspect.
Scène III
.
Jocaste.
Laissez-moi lui parler, et prêtez-nous silence.
Phorbas, envisagez ce prince en ma présence :
Le reconnaissez-vous ?
Phorbas.
Je crois vous avoir dit
Que je ne l’ai point vu depuis qu’on le perdit,
Madame : un si long temps laisse mal reconnaître
Un prince qui pour lors ne faisait que de naître ;
Et si je vois en lui l’effet de mon secours,
Je n’y puis voir les traits d’un enfant de deux jours.
Jocaste.
Je sais, ainsi que vous, que les traits de l’enfance
N’ont avec ceux d’un homme aucune ressemblance ;
Mais comme ce héros, s’il est sorti de moi,
Doit avoir de sa main versé le sang du roi,
Seize ans n’ont pas changé tellement son visage
Que vous n’en conserviez quelque imparfaite image.
Phorbas.
Hélas ! J’en garde encor si bien le souvenir,
Que je l’aurai présent durant tout l’avenir.
Si pour connaître un fils il vous faut cette marque,
Ce prince n’est point né de notre grand monarque.
Mais désabusez-vous, et sachez que sa mort
Ne fut jamais d’un fils le parricide effort.
Jocaste.
Et de qui donc, Phorbas ? Avez-vous connaissance
Du nom du meurtrier ? Savez-vous sa naissance ?
Phorbas.
Et de plus sa demeure et son rang. Est-ce assez ?
Jocaste.
Je saurai le punir si vous le connaissez.
Pourrez-vous le convaincre ?
Phorbas.
Et par sa propre bouche.
Jocaste.
À nos yeux ?
Phorbas.
À vos yeux. Mais peut-être il vous touche ;
Peut-être y prendrez-vous un peu trop d’intérêt,
Pour m’en croire aisément quand j’aurai dit qui c’est.
Thésée.
Ne nous déguisez rien, parlez en assurance, Que le fils de Laïus en hâte la vengeance.
Jocaste.
Il n’est pas assuré, prince, que ce soit vous,
Comme il l’est que Laïus fut jadis mon époux ;
Et d’ailleurs si le ciel vous choisit pour victime,
Vous me devez laisser à punir ce grand crime.
Thésée.
Avant que de mourir, un fils peut le venger.
Phorbas.
Si vous l’êtes ou non, je ne le puis juger ;
Mais je sais que Thésée est si digne de l’être,
Qu’au seul nom qu’il en prend je l’accepte pour maître.
Seigneur, vengez un père, ou ne soutenez plus
Que nous voyons en vous le vrai sang de Laïus.
Jocaste.
Phorbas, nommez ce traître, et nous tirez de doute ;
Et j’atteste à vos yeux le ciel, qui nous écoute,
Que pour cet assassin il n’est point de tourments
Qui puissent satisfaire à mes ressentiments.
Phorbas.
Mais si je vous nommais quelque personne chère,
Aemon votre neveu, Créon votre seul frère,
Ou le prince Lycus, ou le roi votre époux,
Me pourriez-vous en croire, ou garder ce courroux ?
Jocaste.
De ceux que vous nommez je sais trop l’innocence.
Phorbas.
Peut-être qu’un des quatre a fait plus qu’il ne pense ;
Et j’ai lieu de juger qu’un trop cuisant ennui…
Jocaste.
Voici le roi qui vient : dites tout devant lui.
Scène IV
.
Oedipe.
Si vous trouvez un fils dans le prince Thésée,
Mon âme en son effroi s’était bien abusée :
Il ne choisira point de chemin criminel,
Quand il voudra rentrer au trône paternel,
Madame ; et ce sera du moins à force ouverte
Qu’un si vaillant guerrier entreprendra ma perte.
Mais dessus ce vieillard plus je porte les yeux,
Plus je crois l’avoir vu jadis en d’autres lieux :
Ses rides me font peine à le bien reconnaître.
Ne m’as-tu jamais vu ?
Phorbas.
Seigneur, cela peut être.
Oedipe.
Il y pourrait avoir entre quinze et vingt ans.
Phorbas.
J’ai de confus rapports d’environ même temps.
Oedipe.
Environ ce temps-là fis-tu quelque voyage ?
Phorbas.
Oui, seigneur, en Phocide ; et là, dans un passage…
Oedipe.
Ah ! Je te reconnais, ou je suis fort trompé :
C’est un de mes brigands à la mort échappé,
Madame, et vous pouvez lui choisir des supplices ;
S’il n’a tué Laïus, il fut un des complices.
Jocaste.
C’est un de vos brigands ! Ah ! Que me dites-vous ?
Oedipe.
Je le laissai pour mort, et tout percé de coups.
Phorbas.
Quoi ? Vous m’auriez blessé ? Moi, seigneur ?
Oedipe.
Oui, perfide :
Tu fis, pour ton malheur, ma rencontre en Phocide,
Et tu fus un des trois que je sus arrêter
Dans ce passage étroit qu’il fallut disputer ;
Tu marchais le troisième : en faut-il davantage ?
Phorbas.
Si de mes compagnons vous peigniez le visage,
Je n’aurais rien à dire, et ne pourrais nier.
Oedipe.
Seize ans, à ton avis, m’ont fait les oublier !
Ne le présume pas : une action si belle
En laisse au fond de l’âme une idée immortelle ;
Et si dans un combat on ne perd point de temps
À bien examiner les traits des combattants,
Après que celui-ci m’eut tout couvert de gloire,
Je sus tout à loisir contempler ma victoire.
Mais tu nieras encore, et n’y connaîtras rien.
Phorbas.
Je serai convaincu, si vous les peignez bien :
Les deux que je suivis sont connus de la reine.
Oedipe.
Madame, jugez donc si sa défense est vaine.
Le premier de ces trois que mon bras sut punir
À peine méritait un léger souvenir :
Petit de taille, noir, le regard un peu louche,
Le front cicatrisé, la mine assez farouche ;
Mais homme, à dire vrai, de si peu de vertu,
Que dès le premier coup je le vis abattu.
Le second, je l’avoue, avait un grand courage,
Bien qu’il parût déjà dans le penchant de l’âge :
Le front assez ouvert, l’oeil perçant, le teint frais
(on en peut voir en moi la taille et quelques traits) ;
Chauve sur le devant, mêlé sur le derrière,
Le port majestueux, et la démarche fière.
Il se défendit bien, et me blessa deux fois ;
Et tout mon coeur s’émut de le voir aux abois.
Vous pâlissez, madame !
Jocaste.
Ah ! Seigneur, puis-je apprendre
Que vous ayez tué Laïus après Nicandre,
Que vous ayez blessé Phorbas de votre main,
Sans en frémir d’horreur, sans en pâlir soudain ?
Oedipe.
Quoi ? C’est là ce Phorbas qui vit tuer son maître ?
Jocaste.
Vos yeux, après seize ans, l’ont trop su reconnaître ;
Et ses deux compagnons que vous avez dépeints
De Nicandre et du roi portent les traits empreints.
Oedipe.
Mais ce furent brigands, dont le bras…
Jocaste.
C’est un conte
Dont Phorbas au retour voulut cacher sa honte.
Une main seule, hélas ! Fit ces funestes coups,
Et par votre rapport, ils partirent de vous.
Phorbas.
J’en fus presque sans vie un peu plus d’une année.
Avant ma guérison on vit votre hyménée.
Je guéris ; et mon coeur, en secret mutiné
De connaître quel roi vous nous aviez donné,
S’imposa cet exil dans un séjour champêtre,
Attendant que le ciel me fît un autre maître.
Thésée.
Seigneur, je suis le frère ou l’amant de Dircé ;
Et son père ou le mien, de votre main percé…
Oedipe.
Prince, je vous entends, il faut venger ce père,
Et ma perte à l’état semble être nécessaire,
Puisque de nos malheurs la fin ne se peut voir,
Si le sang de Laïus ne remplit son devoir.
C’est ce que Tirésie avait voulu me dire.
Mais ce reste du jour souffrez que je respire :
Le plus sévère honneur ne saurait murmurer
De ce peu de moments que j’ose différer ;
Et ce coup surprenant permet à votre haine
De faire cette grâce aux larmes de la reine.
Thésée.
Nous nous verrons demain, seigneur, et résoudrons…
Oedipe.
Quand il en sera temps, prince, nous répondrons ;
Et s’il faut, après tout, qu’un grand crime s’efface
Par le sang que Laïus a transmis à sa race,
Peut-être aurez-vous peine à reprendre son rang,
Qu’il ne vous ait coûté quelque peu de ce sang.
Thésée.
Demain chacun de nous fera sa destinée.
Scène V
.
Jocaste.
Que de maux nous promet cette triste journée !
J’y dois voir ou ma fille ou mon fils s’immoler,
Tout le sang de ce fils de votre main couler,
Ou de la sienne enfin le vôtre se répandre ;
Et ce qu’oracle aucun n’a fait encore attendre,
Rien ne m’affranchira de voir sans cesse en vous,
Sans cesse en un mari, l’assassin d’un époux.
Puis-je plaindre à ce mort la lumière ravie,
Sans haïr le vivant, sans détester ma vie ?
Puis-je de ce vivant plaindre l’aveugle sort,
Sans détester ma vie et sans trahir le mort ?
Oedipe.
Madame, votre haine est pour moi légitime ;
Et cet aveugle sort m’a fait vers vous un crime,
Dont ce prince demain me punira pour vous,
Ou mon bras vengera ce fils et cet époux ;
Et m’offrant pour victime à votre inquiétude,
Il vous affranchira de toute ingratitude.
Alors sans balancer vous plaindrez tous les deux,
Vous verrez sans rougir alors vos derniers feux,
Et permettrez sans honte à vos douleurs pressantes
Pour Laïus et pour moi des larmes innocentes.
Jocaste.
Ah ! Seigneur, quelque bras qui puisse vous punir,
Il n’effacera rien dedans mon souvenir :
Je vous verrai toujours, sa couronne à la tête,
De sa place en mon lit faire votre conquête ;
Je me verrai toujours vous placer en son rang,
Et baiser votre main fumante de son sang.
Mon ombre même un jour dans les royaumes sombres
Ne recevra des dieux pour bourreaux que vos ombres ;
Et sa confusion l’offrant à toutes deux,
Elle aura pour tourments tout ce qui fit mes feux.
Oracles décevants, qu’osiez-vous me prédire ?
Si sur notre avenir vos dieux ont quelque empire,
Quelle indigne pitié divise leur courroux ?
Ce qu’elle épargne au fils retombe sur l’époux ;
Et comme si leur haine, impuissante ou timide,
N’osait le faire ensemble inceste et parricide,
Elle partage à deux un sort si peu commun,
Afin de me donner deux coupables pour un.
Oedipe.
Ô partage inégal de ce courroux céleste !
Je suis le parricide, et ce fils est l’inceste.
Mais mon crime est entier, et le sien imparfait ;
Le sien n’est qu’en désirs, et le mien en effet.
Ainsi, quelques raisons qui puissent me défendre,
La veuve de Laïus ne saurait les entendre ;
Et les plus beaux exploits passent pour trahisons,
Alors qu’il faut du sang, et non pas des raisons.
Jocaste.
Ah ! Je n’en vois que trop qui me déchirent l’âme.
La veuve de Laïus est toujours votre femme,
Et n’oppose que trop, pour vous justifier,
À la moitié du mort celle du meurtrier.
Pour toute autre que moi votre erreur est sans crime,
Toute autre admirerait votre bras magnanime,
Et toute autre, réduite à punir votre erreur,
La punirait du moins sans trouble et sans horreur.
Mais, hélas ! Mon devoir aux deux partis m’attache :
Nul espoir d’aucun d’eux, nul effort ne m’arrache ;
Et je trouve toujours dans mon esprit confus
Et tout ce que je suis et tout ce que je fus.
Je vous dois de l’amour, je vous dois de la haine :
L’un et l’autre me plaît, l’un et l’autre me gêne ;
Et mon coeur, qui doit tout, et ne voit rien permis,
Souffre tout à la fois deux tyrans ennemis.
La haine aurait l’appui d’un serment qui me lie ;
Mais je le romps exprès pour en être punie ;
Et pour finir des maux qu’on ne peut soulager,
J’aime à donner aux dieux un parjure à venger.
C’est votre foudre, ô ciel, qu’à mon secours j’appelle :
Oedipe est innocent, je me fais criminelle ;
Par un juste supplice osez me désunir
De la nécessité d’aimer et de punir.
Oedipe.
Quoi ? Vous ne voyez pas que sa fausse justice
Ne sait plus ce que c’est que d’un juste supplice,
Et que par un désordre à confondre nos sens
Son injuste rigueur n’en veut qu’aux innocents ?
Après avoir choisi ma main pour ce grand crime,
C’est le sang de Laïus qu’il choisit pour victime,
Et le bizarre éclat de son discernement
Sépare le forfait d’avec le châtiment.
C’est un sujet nouveau d’une haine implacable,
De voir sur votre sang la peine du coupable ;
Et les dieux vous en font une éternelle loi,
S’ils punissent en lui ce qu’ils ont fait par moi.
Voyez comme les fils de Jocaste et d’Oedipe
D’une si juste haine ont tous deux le principe :
À voir leurs actions, à voir leur entretien,
L’un n’est que votre sang, l’autre n’est que le mien,
Et leur antipathie inspire à leur colère
Des préludes secrets de ce qu’il vous faut faire.
Jocaste.
Pourrez-vous me haïr jusqu’à cette rigueur
De souhaiter pour vous même haine en mon coeur ?
Oedipe.
Toujours de vos vertus j’adorerai les charmes,
Pour ne haïr qu’en moi la source de vos larmes.
Jocaste.
Et je me forcerai toujours à vous blâmer,
Pour ne haïr qu’en moi ce qui vous fit m’aimer.
Mais finissons, de grâce, un discours qui me tue :
L’assassin de Laïus doit me blesser la vue ;
Et malgré ce courroux par sa mort allumé,
Je sens qu’Oedipe enfin sera toujours aimé.
Oedipe.
Que fera cet amour ?
Jocaste.
Ce qu’il doit à la haine.
Oedipe.
Qu’osera ce devoir ?
Jocaste.
Croître toujours ma peine.
Oedipe.
Faudra-t-il pour jamais me bannir de vos yeux ?
Jocaste.
Peut-être que demain nous le saurons des dieux.
**********
Œdipe CORNEILLE
**********
ACTE V
Scène première
.
Dymas.
Seigneur, il est trop vrai que le peuple murmure,
Qu’il rejette sur vous sa funeste aventure,
Et que de tous côtés on n’entend que mutins
Qui vous nomment l’auteur de leurs mauvais destins.
D’un devin suborné les infâmes prestiges
De l’ombre, disent-ils, ont fait tous les prodiges :
L’or mouvait ce fantôme ; et pour perdre Dircé,
Vos présents lui dictaient ce qu’il a prononcé :
Tant ils conçoivent mal qu’un si grand roi consente
À venger son trépas sur sa race innocente,
Qu’il assure son sceptre, aux dépens de son sang,
À ce bras impuni qui lui perça le flanc,
Et que par cet injuste et cruel sacrifice,
Lui-même de sa mort il se fasse justice !
Oedipe.
Ils ont quelque raison de tenir pour suspect
Tout ce qui s’est montré tantôt à leur aspect ;
Et je n’ose blâmer cette horreur que leur donne
L’assassin de leur roi qui porte sa couronne.
Moi-même, au fond du coeur, de même horreur frappé,
Je veux fuir le remords de son trône occupé ;
Et je dois cette grâce à l’amour de la reine,
D’épargner ma présence aux devoirs de sa haine,
Puisque de notre hymen les liens mal tissus
Par ces mêmes devoirs semblent être rompus.
Je vais donc à Corinthe achever mon supplice.
Mais ce n’est pas au peuple à se faire justice :
L’ordre que tient le ciel à lui choisir des rois
Ne lui permet jamais d’examiner son choix ;
Et le devoir aveugle y doit toujours souscrire,
Jusqu’à ce que d’en haut on veuille s’en dédire.
Pour chercher mon repos, je veux bien me bannir ;
Mais s’il me bannissait, je saurais l’en punir ;
Ou si je succombais sous sa troupe mutine,
Je saurais l’accabler du moins sous ma ruine.
Dymas.
Seigneur, jusques ici ses plus grands déplaisirs
Pour armes contre vous n’ont pris que des soupirs ;
Et cet abattement que lui cause la peste
Ne souffre à son murmure aucun dessein funeste.
Mais il faut redouter que Thésée et Dircé
N’osent pousser plus loin ce qu’il a commencé.
Phorbas même est à craindre, et pourrait le réduire
Jusqu’à se vouloir mettre en état de vous nuire.
Oedipe.
Thésée a trop de coeur pour une trahison ;
Et d’ailleurs j’ai promis de lui faire raison.
Pour Dircé, son orgueil dédaignera sans doute
L’appui tumultueux que ton zèle redoute.
Phorbas est plus à craindre, étant moins généreux ;
Mais il nous est aisé de nous assurer d’eux.
Fais-les venir tous trois, que je lise en leur âme
S’ils prêteraient la main à quelque sourde trame.
Commence par Phorbas : je saurai démêler
Quels desseins…
Page.
Un vieillard demande à vous parler.
Il se dit de Corinthe, et presse.
Oedipe.
Il vient me faire
Le funeste rapport du trépas de mon père :
Préparons nos soupirs à ce triste récit.
Qu’il entre… Cependant fais ce que je t’ai dit.
Scène II
.
Oedipe.
Eh bien ! Polybe est mort ?
Iphicrate.
Oui, seigneur.
Oedipe.
Mais vous-même
Venir me consoler de ce malheur suprême !
Vous qui, chef du conseil, devriez maintenant,
Attendant mon retour, être mon lieutenant !
Vous, à qui tant de soins d’élever mon enfance
Ont acquis justement toute ma confiance !
Ce voyage me trouble autant qu’il me surprend.
Iphicrate.
Le roi Polybe est mort ; ce malheur est bien grand ;
Mais comme enfin, seigneur, il est suivi d’un pire,
Pour l’apprendre de moi faites qu’on se retire.
Oedipe.
Ce jour est donc pour moi le grand jour des malheurs,
Puisque vous apportez un comble à mes douleurs.
J’ai tué le feu roi jadis sans le connaître ;
Son fils, qu’on croyait mort, vient ici de renaître ;
Son peuple mutiné me voit avec horreur ;
Sa veuve mon épouse en est dans la fureur.
Le chagrin accablant qui me dévore l’âme
Me fait abandonner et peuple, et sceptre, et femme,
Pour remettre à Corinthe un esprit éperdu ;
Et par d’autres malheurs je m’y vois attendu !
Iphicrate.
Seigneur, il faut ici faire tête à l’orage ;
Il faut faire ici ferme et montrer du courage.
Le repos à Corinthe en effet serait doux ;
Mais il n’est plus de sceptre à Corinthe pour vous.
Oedipe.
Quoi ? L’on s’est emparé de celui de mon père ?
Iphicrate.
Seigneur, on n’a rien fait que ce qu’on a dû faire ;
Et votre amour en moi ne voit plus qu’un banni,
De son amour pour vous trop doucement puni.
Oedipe.
Quel énigme !
Iphicrate.
Apprenez avec quelle justice
Ce roi vous a dû rendre un si mauvais office :
Vous n’étiez point son fils.
Oedipe.
Dieux ! Qu’entends-je ?
Iphicrate.
À regret
Ses remords en mourant ont rompu le secret.
Il vous gardait encore une amitié fort tendre ;
Mais le compte qu’aux dieux la mort force de rendre
A porté dans son coeur un si pressant effroi,
Qu’il a remis Corinthe aux mains de son vrai roi.
Oedipe.
Je ne suis point son fils ! Et qui suis-je, Iphicrate ?
Iphicrate.
Un enfant exposé, dont le mérite éclate,
Et de qui par pitié j’ai dérobé les jours
Aux ongles des lions, aux griffes des vautours.
Oedipe.
Et qui m’a fait passer pour le fils de ce prince ?
Iphicrate.
Le manque d’héritiers ébranlait sa province.
Les trois que lui donna le conjugal amour
Perdirent en naissant la lumière du jour ;
Et la mort du dernier me fit prendre l’audace
De vous offrir au roi, qui vous mit en sa place.
Ce que l’on se promit de ce fils supposé
Réunit sous ses lois son état divisé ;
Mais comme cet abus finit avec sa vie,
Sa mort de mon supplice aurait été suivie,
S’il n’eût donné cet ordre à son dernier moment,
Qu’un juste et prompt exil fût mon seul châtiment.
Oedipe.
Ce revers serait dur pour quelque âme commune ;
Mais je me fis toujours maître de ma fortune ;
Et puisqu’elle a repris l’avantage du sang,
Je ne dois plus qu’à moi tout ce que j’eus de rang.
Mais n’as-tu point appris de qui j’ai reçu l’être ?
Iphicrate.
Seigneur, je ne puis seul vous le faire connaître.
Vous fûtes exposé jadis par un Thébain,
Dont la compassion vous remit en ma main,
Et qui, sans m’éclaircir touchant votre naissance,
Me chargea seulement d’éloigner votre enfance.
J’en connais le visage, et l’ai revu souvent,
Sans nous être tous deux expliqués plus avant :
Je luis dis qu’en éclat j’avais mis votre vie,
Et lui cachai toujours mon nom et ma patrie,
De crainte, en les sachant, que son zèle indiscret
Ne vînt mal à propos troubler notre secret.
Mais comme de sa part il connaît mon visage,
Si je le trouve ici, nous saurons davantage.
Oedipe.
Je serais donc Thébain à ce compte ?
Iphicrate.
Oui, seigneur.
Oedipe.
Je ne sais si je dois le tenir à bonheur :
Mon coeur, qui se soulève, en forme un noir augure
Sur l’éclaircissement de ma triste aventure.
Où me reçûtes-vous ?
Iphicrate.
Sur le mont Cythéron.
Oedipe.
Ah ! Que vous me frappez par ce funeste nom !
Le temps, le lieu, l’oracle, et l’âge de la reine,
Tout semble concerté pour me mettre à la gêne.
Dieux ! Serait-il possible ? Approchez-vous, Phorbas.
Scène III
.
Iphicrate.
Seigneur, voilà celui qui vous mit en mes bras ;
Permettez qu’à vos yeux je montre un peu de joie.
Se peut-il faire, ami, qu’encor je te revoie ?
Phorbas.
Que j’ai lieu de bénir ton retour fortuné !
Qu’as-tu fait de l’enfant que je t’avais donné ?
Le généreux Thésée a fait gloire de l’être ;
Mais sa preuve est obscure, et tu dois le connaître.
Parle.
Iphicrate.
Ce n’est point lui, mais il vit en ces lieux.
Phorbas.
Nomme-le donc, de grâce.
Iphicrate.
Il est devant tes yeux.
Phorbas.
Je ne vois que le roi.
Iphicrate.
C’est lui-même.
Phorbas.
Lui-même !
Iphicrate.
Oui : le secret n’est plus d’une importance extrême ;
Tout Corinthe le sait. Nomme-lui ses parents.
Phorbas.
En fussions-nous tous trois à jamais ignorants !
Iphicrate.
Seigneur, lui seul enfin peut dire qui vous êtes.
Oedipe.
Hélas ! Je le vois trop ; et vos craintes secrètes,
Qui vous ont empêchés de vous entr’éclaircir,
Loin de tromper l’oracle, ont fait tout réussir.
Voyez où m’a plongé votre fausse prudence :
Vous cachiez ma retraite, il cachait ma naissance ;
Vos dangereux secrets, par un commun accord,
M’ont livré tout entier aux rigueurs de mon sort :
Ce sont eux qui m’ont fait l’assassin de mon père ;
Ce sont eux qui m’ont fait le mari de ma mère.
D’une indigne pitié le fatal contre-temps
Confond dans mes vertus ces forfaits éclatants :
Elle fait voir en moi, par un mélange infâme,
Le frère de mes fils et le fils de ma femme.
Le ciel l’avait prédit : vous avez achevé ;
Et vous avez tout fait quand vous m’avez sauvé.
Phorbas.
Oui, seigneur, j’ai tout fait, sauvant votre personne :
M’en punissent les dieux si je me le pardonne !
Scène IV
.
Oedipe.
Que n’obéissais-tu, perfide, à mes parents,
Qui se faisaient pour moi d’équitables tyrans ?
Que ne lui disais-tu ma naissance et l’oracle,
Afin qu’à mes destins il pût mettre un obstacle ?
Car, Iphicrate, en vain j’accuserais ta foi :
Tu fus dans ces destins aveugle comme moi ;
Et tu ne m’abusais que pour ceindre ma tête
D’un bandeau dont par là tu faisais ma conquête.
Iphicrate.
Seigneur, comme Phorbas avait mal obéi,
Que l’ordre de son roi par là se vit trahi,
Il avait lieu de craindre, en me disant le reste,
Que son crime par moi devenu manifeste…
Oedipe.
Cesse de l’excuser. Que m’importe, en effet,
S’il est coupable ou non de tout ce que j’ai fait ?
En ai-je moins de trouble, ou moins d’horreur en l’âme ?
Scène V
.
Oedipe.
Votre frère est connu ; le savez-vous, madame ?
Dircé.
Oui, seigneur, et Phorbas m’a tout dit en deux mots.
Oedipe.
Votre amour pour Thésée est dans un plein repos.
Vous n’appréhendez plus que le titre de frère
S’oppose à cette ardeur qui vous était si chère :
Cette assurance entière a de quoi vous ravir,
Ou plutôt votre haine a de quoi s’assouvir.
Quand le ciel de mon sort l’aurait faite l’arbitre,
Elle ne m’eût choisi rien de pis que ce titre.
Dircé.
Ah ! Seigneur, pour Aemon j’ai su mal obéir ;
Mais je n’ai point été jusques à vous haïr.
La fierté de mon coeur, qui me traitait de reine,
Vous cédait en ces lieux la couronne sans peine ;
Et cette ambition que me prêtait l’amour
Ne cherchait qu’à régner dans un autre séjour.
Cent fois de mon orgueil l’éclat le plus farouche
Aux termes odieux a refusé ma bouche :
Pour vous nommer tyran il fallait cent efforts ;
Ce mot ne m’a jamais échappé sans remords.
D’un sang respectueux la puissance inconnue
À mes soulèvements mêlait la retenue ;
Et cet usurpateur dont j’abhorrais la loi,
S’il m’eût donné Thésée, eût eu le nom de roi.
Oedipe.
C’était ce même sang dont la pitié secrète
De l’ombre de Laïus me faisait l’interprète.
Il ne pouvait souffrir qu’un mot mal entendu
Détournât sur ma soeur un sort qui m’était dû,
Et que votre innocence immolée à mon crime
Se fît de nos malheurs l’inutile victime.
Dircé.
Quel crime avez-vous fait que d’être malheureux ?
Oedipe.
Mon souvenir n’est plein que d’exploits généreux ;
Cependant je me trouve inceste et parricide,
Sans avoir fait un pas que sur les pas d’Alcide,
Ni recherché partout que lois à maintenir,
Que monstres à détruire et méchants à punir.
Aux crimes malgré moi l’ordre du ciel m’attache :
Pour m’y faire tomber à moi-même il me cache ;
Il offre, en m’aveuglant sur ce qu’il a prédit,
Mon père à mon épée, et ma mère à mon lit.
Hélas ! Qu’il est bien vrai qu’en vain on s’imagine
Dérober notre vie à ce qu’il nous destine !
Les soins de l’éviter font courir au-devant,
Et l’adresse à le fuir y plonge plus avant.
Mais si les dieux m’ont fait la vie abominable,
Ils m’en font par pitié la sortie honorable,
Puisqu’enfin leur faveur mêlée à leur courroux
Me condamne à mourir pour le salut de tous,
Et qu’en ce même temps qu’il faudrait que ma vie
Des crimes qu’ils m’ont faits traînât l’ignominie,
L’éclat de ces vertus que je ne tiens pas d’eux
Reçoit pour récompense un trépas glorieux.
Dircé.
Ce trépas glorieux comme vous me regarde :
Le juste choix du ciel peut-être me le garde ;
Il fit tout votre crime ; et le malheur du roi
Ne vous rend pas, seigneur, plus coupable que moi.
D’un voyage fatal qui seul causa sa perte
Je fus l’occasion ; elle vous fut offerte :
Votre bras contre trois disputa le chemin ;
Mais ce n’était qu’un bras qu’empruntait le destin,
Puisque votre vertu qui servit sa colère
Ne put voir en Laïus ni de roi ni de père.
Ainsi j’espère encor que demain, par son choix,
Le ciel épargnera le plus grand de nos rois.
L’intérêt des Thébains et de votre famille
Tournera son courroux sur l’orgueil d’une fille
Qui n’a rien que l’état doive considérer,
Et qui contre son roi n’a fait que murmurer.
Oedipe.
Vous voulez que le ciel, pour montrer à la terre
Qu’on peut innocemment mériter le tonnerre,
Me laisse de sa haine étaler en ces lieux
L’exemple le plus noir et le plus odieux !
Non, non : vous le verrez demain au sacrifice
Par le choix que j’attends couvrir son injustice,
Et par la peine due à son propre forfait,
Désavouer ma main de tout ce qu’elle a fait.
Scène VI
.
Oedipe.
Est-ce encor votre bras qui doit venger son père ?
Son amant en a-t-il plus de droit que son frère,
Prince ?
Thésée.
Je vous en plains, et ne puis concevoir,
Seigneur…
Oedipe.
La vérité ne se fait que trop voir.
Mais nous pourrons demain être tous deux à plaindre,
Si le ciel fait le choix qu’il nous faut tous deux craindre.
S’il me choisit, ma soeur, donnez-lui votre foi :
Je vous en prie en frère, et vous l’ordonne en roi.
Vous, seigneur, si Dircé garde encor sur votre âme
L’empire que lui fit une si belle flamme,
Prenez soin d’apaiser les discords de mes fils,
Qui par les noeuds du sang vous deviendront unis.
Vous voyez où des dieux nous a réduits la haine.
Adieu : laissez-moi seul en consoler la reine ;
Et ne m’enviez pas un secret entretien,
Pour affermir son coeur sur l’exemple du mien.
Scène VII
.
Dircé.
Parmi de tels malheurs que sa constance est rare !
Il ne s’emporte point contre un sort si barbare ;
La surprenante horreur de cet accablement
Ne coûte à sa grande âme aucun égarement ;
Et sa haute vertu, toujours inébranlable,
Le soutient au-dessus de tout ce qui l’accable.
Thésée.
Souvent, avant le coup qui doit nous accabler,
La nuit qui l’enveloppe a de quoi nous troubler :
L’obscur pressentiment d’une injuste disgrâce
Combat avec effroi sa confuse menace ;
Mais quand ce coup tombé vient d’épuiser le sort
Jusqu’à n’en pouvoir craindre un plus barbare effort,
Ce trouble se dissipe, et cette âme innocente,
Qui brave impunément la fortune impuissante,
Regarde avec dédain ce qu’elle a combattu,
Et se rend toute entière à toute sa vertu.
Scène VIII
.
Nérine.
Madame…
Dircé.
Que veux-tu, Nérine ?
Nérine.
Hélas ! La reine…
Dircé.
Que fait-elle ?
Nérine.
Elle est morte ; et l’excès de sa peine,
Par un prompt désespoir…
Dircé.
Jusques où portez-vous,
Impitoyables dieux, votre injuste courroux !
Thésée.
Quoi ? Même aux yeux du roi son désespoir la tue ?
Ce monarque n’a pu…
Nérine.
Le roi ne l’a point vue,
Et quant à son trépas, ses pressantes douleurs
L’ont cru devoir sur l’heure à de si grands malheurs.
Phorbas l’a commencé, sa main a fait le reste.
Dircé.
Quoi ? Phorbas.
Nérine.
Oui, Phorbas, par son récit funeste,
Et par son propre exemple, a su l’assassiner.
Ce malheureux vieillard n’a pu se pardonner ;
Il s’est jeté d’abord aux genoux de la reine,
Où, détestant l’effet de sa prudence vaine :
» si j’ai sauvé ce fils pour être votre époux,
Et voir le roi son père expirer sous ses coups,
A-t-il dit, la pitié qui me fît le ministre
De tout ce que le ciel eut pour vous de sinistre,
Fait place au désespoir d’avoir si mal servi,
Pour venger sur mon sang votre ordre mal suivi.
L’inceste où malgré vous tous deux je vous abîme
Recevra de ma main sa première victime :
J’en dois le sacrifice à l’innocente erreur
Qui vous rend l’un pour l’autre un objet plein d’horreur. »
Cet arrêt qu’à nos yeux lui-même il se prononce
Est suivi d’un poignard qu’en ses flancs il enfonce.
La reine, à ce malheur si peu prémédité,
Semble le recevoir avec stupidité.
L’excès de sa douleur la fait croire insensible ;
Rien n’échappe au dehors qui la rende visible ;
Et tous ses sentiments, enfermés dans son coeur,
Ramassent en secret leur dernière vigueur.
Nous autres cependant, autour d’elle rangées,
Stupides ainsi qu’elle, ainsi qu’elle affligées,
Nous n’osons rien permettre à nos fiers déplaisirs,
Et nos pleurs par respect attendent ses soupirs.
Mais enfin tout à coup, sans changer de visage,
Du mort qu’elle contemple elle imite la rage,
Se saisit du poignard, et de sa propre main
À nos yeux comme lui s’en traverse le sein.
On dirait que du ciel l’implacable colère
Nous arrête les bras pour lui laisser tout faire.
Elle tombe, elle expire avec ces derniers mots :
» allez dire à Dircé qu’elle vive en repos,
Que de ces lieux maudits en hâte elle s’exile ;
Athènes a pour elle un glorieux asile,
Si toutefois Thésée est assez généreux
Pour n’avoir point d’horreur d’un sang si malheureux. »
Thésée.
Ah ! Ce doute m’outrage ; et si jamais vos charmes…
Dircé.
Seigneur, il n’est saison que de verser des larmes.
La reine, en expirant, a donc pris soin de moi !
Mais tu ne me dis point ce qu’elle a dit du roi ?
Nérine.
Son âme en s’envolant, jalouse de sa gloire,
Craignait d’en emporter la honteuse mémoire ;
Et n’osant le nommer son fils ni son époux,
Sa dernière tendresse a toute été pour vous.
Dircé.
Et je puis vivre encore après l’avoir perdue !
Scène IX
.
Cléante.
La santé dans ces murs tout d’un coup répandue
Fait crier au miracle et bénir hautement
La bonté de nos dieux d’un si prompt changement.
Tous ces mourants, madame, à qui déjà la peste
Ne laissait qu’un soupir, qu’un seul moment de reste,
En cet heureux moment rappelés des abois,
Rendent grâces au ciel d’une commune voix ;
Et l’on ne comprend point quel remède il applique
À rétablir sitôt l’allégresse publique.
Dircé.
Que m’importe qu’il montre un visage plus doux,
Quand il fait des malheurs qui ne sont que pour nous ?
Avez-vous vu le roi, Dymas ?
Dymas.
Hélas, princesse !
On ne doit qu’à son sang la publique allégresse.
Ce n’est plus que pour lui qu’il faut verser des pleurs :
Ses crimes inconnus avoient fait nos malheurs ;
Et sa vertu souillée à peine s’est punie,
Qu’aussitôt de ces lieux la peste s’est bannie.
Thésée.
L’effort de son courage a su nous éblouir :
D’un si grand désespoir il cherchait à jouir,
Et de sa fermeté n’empruntait les miracles
Que pour mieux éviter toute sorte d’obstacles.
Dircé.
Il s’est rendu par là maître de tout son sort.
Mais achève, Dymas, le récit de sa mort ;
Achève d’accabler une âme désolée.
Dymas.
Il n’est point mort, madame ; et la sienne, ébranlée
Par les confus remords d’un innocent forfait,
Attend l’ordre des dieux pour sortir tout à fait.
Dircé.
Que nous disais-tu donc ?
Dymas.
Ce que j’ose encor dire,
Qu’il vit et ne vit plus, qu’il est mort et respire ;
Et que son sort douteux, qui seul reste à pleurer,
Des morts et des vivants semble le séparer.
J’étais auprès de lui sans aucunes alarmes ;
Son coeur semblait calmé, je le voyais sans armes,
Quand soudain, attachant ses deux mains sur ses yeux :
» prévenons, a-t-il dit, l’injustice des dieux ;
Commençons à mourir avant qu’ils nous l’ordonnent ;
Qu’ainsi que mes forfaits mes supplices étonnent.
Ne voyons plus le ciel après sa cruauté :
Pour nous venger de lui dédaignons sa clarté ;
Refusons-lui nos yeux, et gardons quelque vie
Qui montre encore à tous quelle est sa tyrannie. »
Là, ses yeux arrachés par ses barbares mains
Font distiller un sang qui rend l’âme aux Thébains.
Ce sang si précieux touche à peine la terre,
Que le courroux du ciel ne leur fait plus la guerre ;
Et trois mourants guéris au milieu du palais
De sa part tout d’un coup nous annoncent la paix.
Cléante vous a dit que par toute la ville…
Thésée.
Cessons de nous gêner d’une crainte inutile.
À force de malheurs le ciel fait assez voir
Que le sang de Laïus a rempli son devoir :
Son ombre est satisfaite ; et ce malheureux crime
Ne laisse plus douter du choix de sa victime.
Dircé.
Un autre ordre demain peut nous être donné.
Allons voir cependant ce prince infortuné,
Pleurer auprès de lui notre destin funeste,
Et remettons aux dieux à disposer du reste.
************
Œdipe Corneille 1640
 LA PLACE ROYALE CORNEILLE
LA PLACE ROYALE CORNEILLE