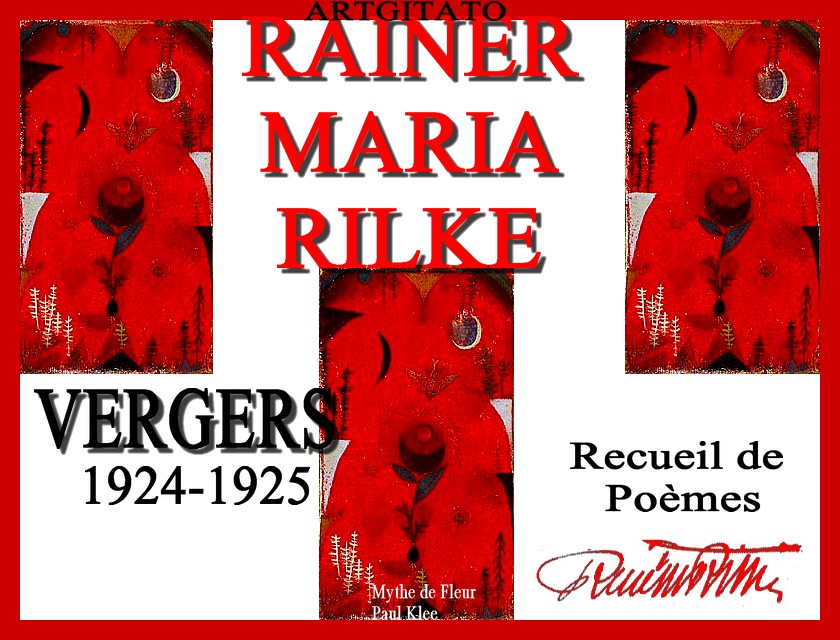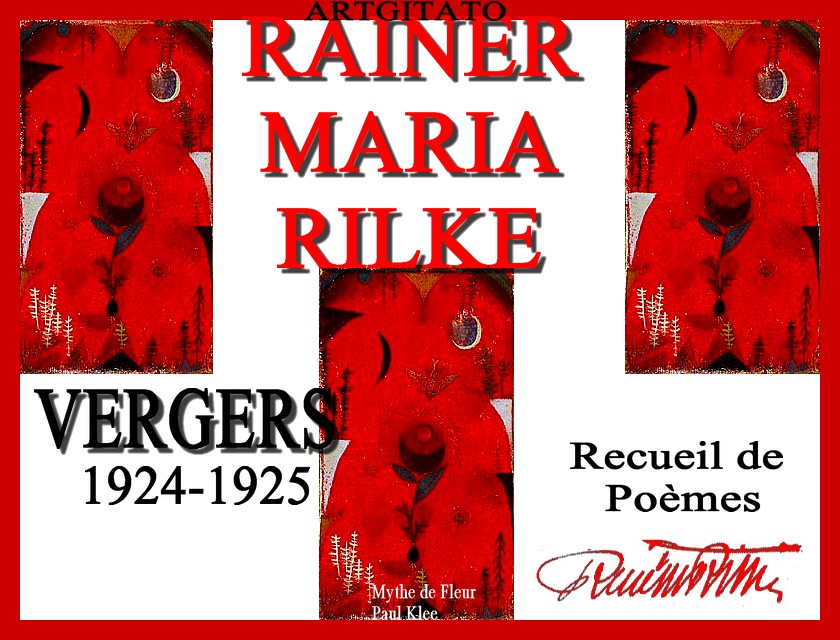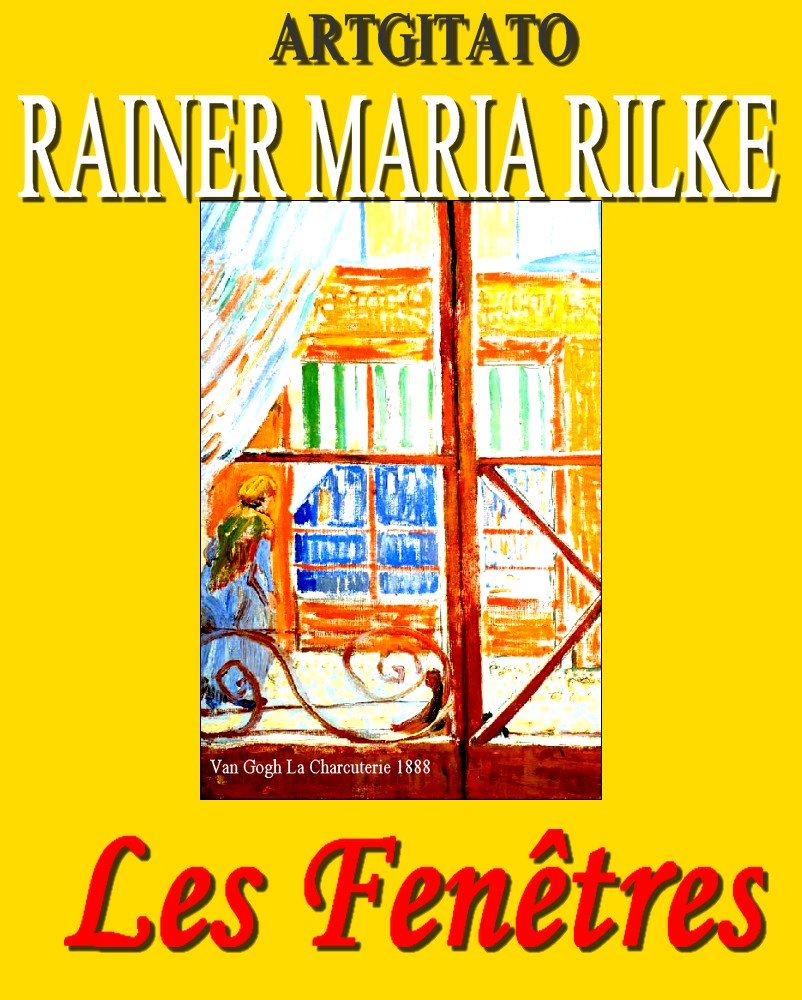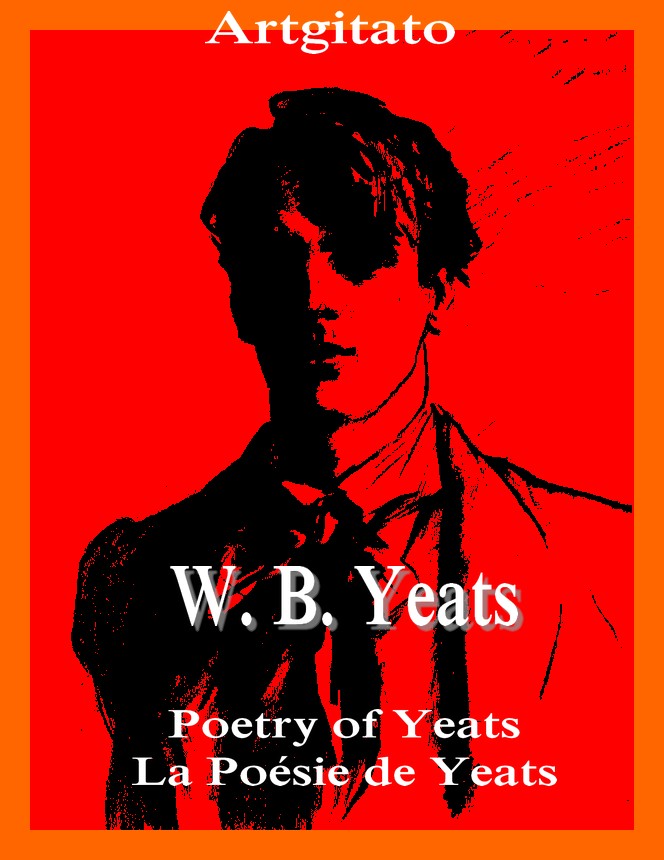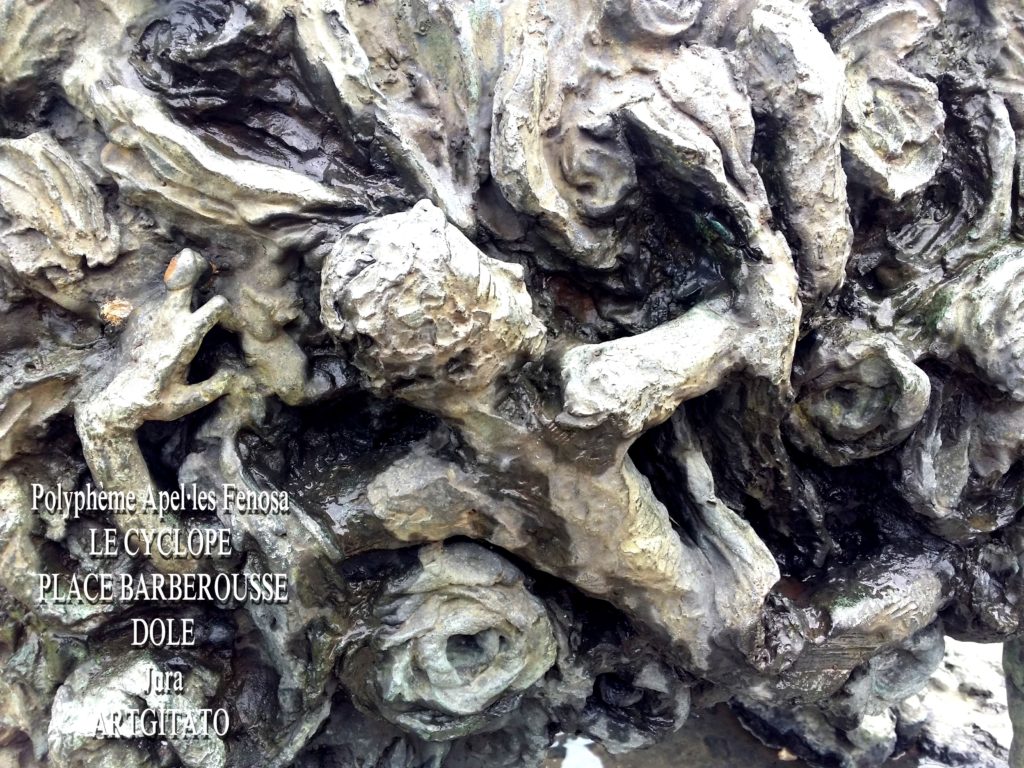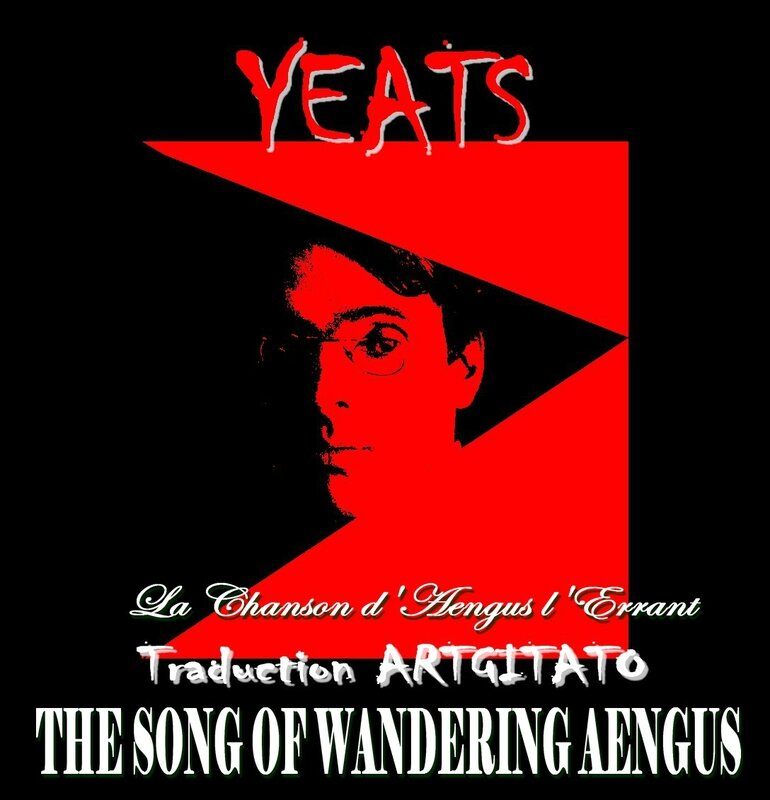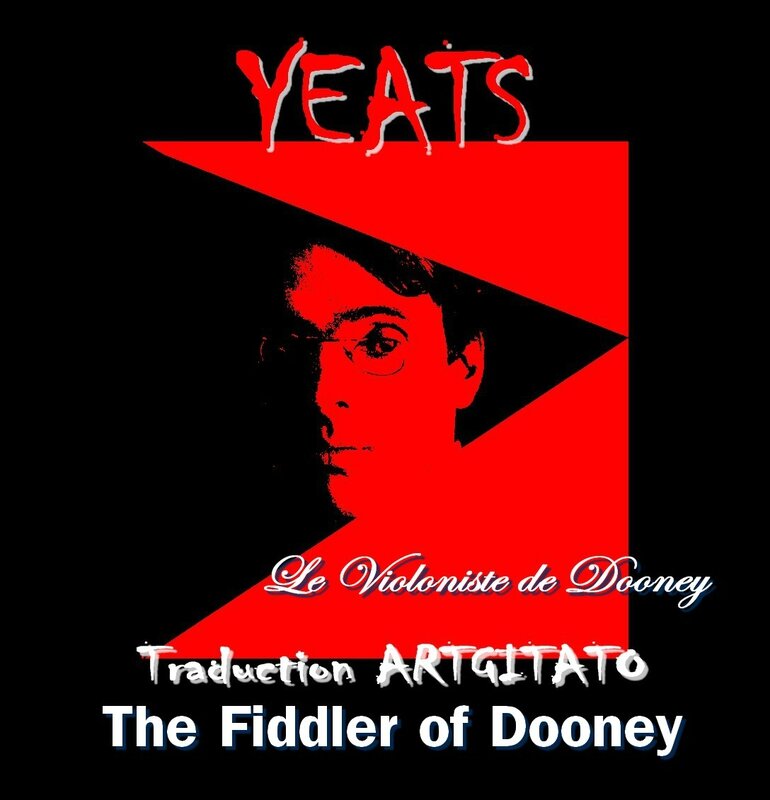Rainer Maria Rilke
VERGERS
VERGERS
1924-1925
Ecrits en Français

LITTERATURE ALLEMANDE
Deutsch Literatur
Gedichte – Poèmes

Portrait de Rainer Maria Rilke
1906
Par Paula Modersohn-Becker
*
*
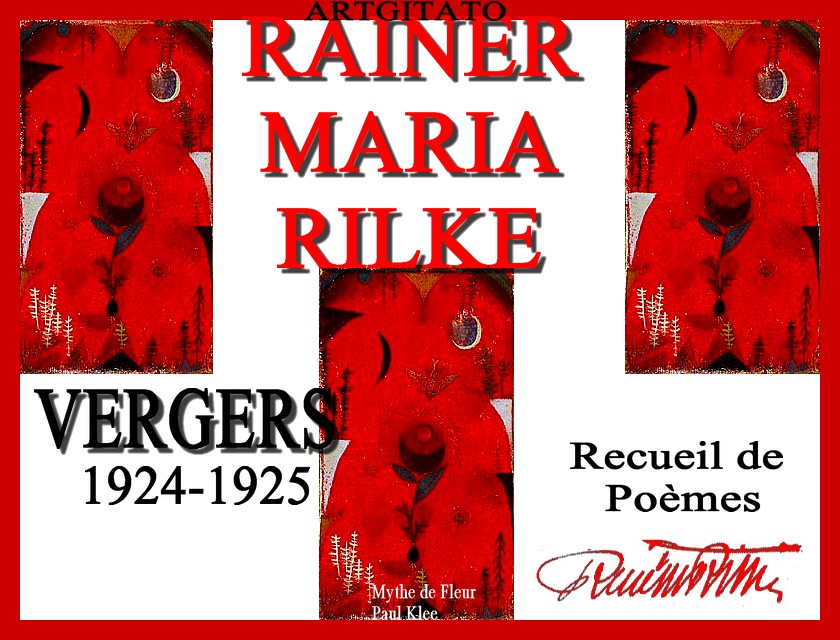
Mythe de Fleurs Paul Klee 1918
*
VERGERS
1
MON COEUR FAIT CHANTER DES ANGES
Ce soir mon cœur fait chanter
des anges qui se souviennent
Une voix, presque mienne,
par trop de silence tentée,
Monte et se décide
à ne plus revenir;
tendre et intrépide,
à quoi va-t-elle s’unir ?
2
LAMPE DU SOIR
Lampe du soir, ma calme confidente,
mon coeur n’est point par toi dévoilé;
(on s’y perdrait peut-être;) mais sa pente
du côté sud est doucement éclairée.
C’est encore toi, ô lampe d’étudiant,
qui veux que le liseur de temps en temps
s’arrête, étonné, et se d´range
sur son bouquin, te regardant.
(Et ta simplicité supprime un Ange.)
3
L’ANGE A TA TABLE
Reste tranquille, si soudain
l’Ange à ta table se décide;
efface doucement les quelques rides
que fait la nappe sous ton pain.
Tu offriras ta rude nourriture,
pour qu’il en goûte à son tour,
et qu’il soulève à la lèvre pure
un simple verre de tous les jours.
4
LES ETRANGES CONFIDENCES
Combien a-t-on fait aux fleurs
d’étranges confidences,
pour que cette fine balance
nous dise le poids de l’ardeur.
Les astres sont tous confus
qu’à nos chagrins on les mêle.
Et du plus fort au plus frêle
nul ne supporte plus
notre humeur variable,
nos révoltes, nos cris -,
sauf l’infatigable table
et le lit (table évanouie).
5
LES DANGERS DE LA POMME
Tout se passe à peu près comme
si l’on reprochait à la pomme
d’être bonne à manger.
Mais il reste d’autres dangers.
Celui de la laisser sur l’arbre,
celui de la sculpter en marbre,
et le dernier, le pire :
de lui en vouloir d’être en cire.
6
L’INVISIBLE
Nul ne sait, combien ce qu’il refuse,
l’Invisible, nous domine, quand
notre vie à l’invisible ruse
cède, invisiblement.
Lentement, au gré des attirances
notre centre se déplace pour
que le cœur s’y rende à son tour:
lui, enfin Grand-Maître des absences.
7
LES PLIS DES ETOILES DORMANTES
À Mme et M. Albert Vulliez.
Paume, doux lit froissé
où des étoiles dormantes
avaient laissé des plis
en se levant vers le ciel.
Est-ce que ce lit était tel
qu’elles se trouvent reposées,
claires et incandescentes,
parmi les astres amis
en leur élan éternel?
Ô les deux lits de mes mains
Abandonnés et froids,
légers d’un absent poids
de ces astres d’airain.
8
LES DERNIERS MOTS
Notre avant-dernier mot
serait un mot de misère,
mais devant la conscience-mère
le tout dernier sera beau.
Car il faudra qu’on résume
tous les efforts d’un désir
qu’aucun goût d’amertume
ne saurait contenir.
9
LE SILENCE DIVIN
Si l’on chante un dieu,
ce dieu vous rend son silence.
Nul de nous ne s’avance
que vers un dieu silencieux.
Cet imperceptible échange
qui nous fait frémir,
devient l’héritage d’un ange
sans nous appartenir.
10
C’EST LE CENTAURE QUI A RAISON
C’est le centaure qui a raison,
qui traverse par bonds les saisons
d’un monde à peine commencé
qu’il a de sa force comblé.
Ce n’est que l’Hermaphrodite
qui est complet dans son gîte.
Nous cherchons en tous les lieux
la moitié perdue de ces Demi-Dieux.
11
CORNE D’ABONDANCE
Ô belle corne, d’où
penchée vers notre attente?
Qui n’êtes qu’une pente
en calice, déversez-vous!
Des fleurs, des fleurs, des fleurs,
qui, en tombant font un lit
aux bondissantes rondeurs
de tant de fruits accomplis!
Et tout cela sans fin
nous attaque et s’élance,
pour punir l’insuffisance
de notre cœur déjà plein.
Ô corne trop vaste, quel
miracle par vous se donne !
Ô cor de chasse, qui sonne
des choses, au souffle du ciel !
12
COMME UN VERRE DE VENISE
Comme un verre de Venise
sait en naissant ce gris
et la clarté indécise
dont il sera épris,
ainsi tes tendres mains
avaient rêvé d’avance
d’être la lente balance
de nos moments trop pleins.
13
DOUX PÂTRE
Doux pâtre qui survit
tendrement à son rôle
avec sur son épaule
un débris de brebis.
Doux pâtre qui survit
en ivoire jaunâtre
à son jeu de pâtre.
Ton troupeau aboli
autant que toi dure
dans la lente mélancolie
de ton assistante figure
qui résume dans l’infini
la trêve d’actives pâtures.
14
LA PASSANTE D’ETE
Vois-tu venir sur le chemin la lente, l’heureuse,
celle que l’on envie, la promeneuse?
Au tournant de la route il faudrait qu’elle soit
saluée par de beaux messieurs d’autrefois.
Sous son ombrelle, avec une grâce passive,
elle exploite la tendre alternative:
s’effaçant un instant à la trop brusque lumière,
elle ramène l’ombre dont elle s’éclaire.
15
SUR LE SOUPIR DE L’AMIE
Sur le soupir de l’amie
toute la nuit se soulève,
une caresse brève
parcourt le ciel ébloui.
C’est comme si dans l’univers
une force élémentaire
redevenait la mère
de tout amour qui se perd.
16
PETITE ANGE EN PORCELAINE
Petit Ange en porcelaine,
s’il arrive que l’on te toise,
nous t’avions quand l’année fut pleine,
coiffé d’une framboise.
Ça nous semblait tellement futile
de te mettre ce bonnet rouge,
mais depuis lors tout bouge
sauf ton tendre tortil.
Il est desséché, mais il tient,
on dirait parfois qu’il embaume;
couronné d’un fantôme,
ton petit front se souvient.
17
LE TEMPLE DE L’AMOUR
Qui vient finir le temple de l’Amour?
Chacun en emporte une colonne;
et à la fin tout le monde s’étonne
que le dieu à son tour
de sa flèche brise l’enceinte.
(Tel nous le connaissons.)
Et sur ce mur d’abandon
pousse la plainte.
18
EAU QUI PRESSE
Eau qui se presse, qui court -, eau oublieuse
que la distraite terre boit,
hésite un petit instant dans ma main creuse,
souviens-toi!
Clair et rapide amour, indifférence,
presque absence qui court,
entre ton trop d’arrivée et ton trop de partance
Tremble un peu de séjour.
19
EROS
I
Ô toi, centre du jeu
où l’on perd quand on gagne;
célèbre comme Charlemagne,
roi, empereur et Dieu, –
tu es aussi le mendiant
en pitoyable posture,
et c’est ta multiple figure
qui te rend puissant. –
Tout ceci serait pour le mieux;
mais tu es, en nous (c’est pire)
comme le noir milieu
d’un châle brodé de cachemire.
II
Ô faisons tout pour cacher son visage
d’un mouvement hagard et hasardeux,
il faut le reculer au fond des âges
pour adoucir son indomptable feu.
Il vient si près de nous qu’il nous sépare
de l’être bien-aimé dont il se sert;
il veut qu’on touche, c’est un dieu barbare
que des panthères frôlent au désert.
Entrant en nous avec son grand cortège,
il y veut tout illuminé, –
lui, qui après se sauve comme d’un piège,
sans qu’aux appâts il ait touché.
III
Là, sous la treille, parmi le feuillage
il nous arrive de le deviner:
son front rustique d’enfant sauvage,
et son antique bouche mutilée …
La grappe devant lui devient pesante
et semble fatiguée de sa lourdeur,
un court moment on frôle l’épouvante
de cet heureux été trompeur.
Et son sourire cru, comme il l’infuse
à tous les fruits de son fier décor;
partout autour il reconnaît sa ruse
qui doucement le berce et l’endort.
IV
Ce n’est pas la justice qui tient la balance préciser
c’est toi, ô Dieu à l’envie indivise,
qui pèses nos torts,
et qui de deux cœurs qu’il meurtrit et triture
fais un immense cœur plus grand que nature,
qui voudrait encor
grandir…Toi, qui indifférente et superbe,
humilies la bouche et exaltes le verbe
vers un ciel ignorant…
Toi qui mutiles les êtres en les ajoutant
à l’ultime absence dont ils sont des fragments.
20
QUE LE DIEU SE CONTENTE DE NOUS
Que le dieu se contente de nous,
de notre instant insigne,
avant qu’une vague maligne
nous renverse et pousse à bout.
Un moment nous étions d’accord :
lui, qui survit et persiste,
et nous dont le cœur triste
s’étonne de son effort.
21
DANS LA MULTIPLE RENCONTRE
Dans la multiple rencontre
faisons à tout sa part,
afin que l’ordre se montre
parmi les propos du hasard.
Tout autour veut qu’on l’écoute -,
écoutons jusqu’au bout;
car le verger et la route
c’est toujours nous !
22
LA DISCRETION DES ANGES
Les Anges, sont-ils devenus discrets !
Le mien à peine m’interroge.
Que je lui rende au moins le reflet
d’un émail de Limoges.
Et que mes rouges, mes verts, mes bleus
son œil rond réjouissent.
S’il les trouve terrestres, tant mieux
pour un ciel en prémisses.
23
LE MOUVANT EQUILIBRE
Combien le pape au fond de son faste,
sans être moins vénérable,
par la sainte loi du contraste
doit attirer le diable.
Peut-être qu’on compte trop peu
avec ce mouvant équilibre;
il y a des courants dans le Tibre,
tout jeu veut son contre-jeu.
Je me rappelle Rodin
qui me dit un jour d’un air mâle
(nous prenions, à Chartres, le train)
que, trop pure, la cathédrale
provoque un vent de dédain.
24
CE QU’IL NOUS FAUT CONSENTIR
C’est qu’il nous faut consentir
à toutes les forces extrêmes;
l’audace est notre problème
malgré le grand repentir.
Et puis, il arrive souvent
que ce qu’on affronte, change:
le calme devient ouragan,
l’abîme le moule d’un ange.
Ne craignons pas le détour.
Il faut que les Orgues grondent,
pour que la musique abonde
de toutes les notes de l’amour.
26
LA FONTAINE
Je ne veux qu’une seule leçon, c’est la tienne,
fontaine, qui en toi-même retombes, –
celle des eaux risquées auxquelles incombe
ce céleste retour vers la vie terrienne.
Autant que ton multiple murmure
rien ne saurait me servir d’exemple;
toi, ô colonne légère du temple
qui se détruit par sa propre nature.
Dans ta chute, combien se module
chaque jet d’eau qui termine sa danse.
Que je me sens l’élève, l’émule
de ton innombrable nuance!
Mais ce qui plus que ton chant vers toi me décide
c’est cet instant d’un silence en délire
lorsqu’ à la nuit, à travers ton élan liquide
passe ton propre retour qu’un souffle retire.
27
MON CORPS
Qu’il est doux parfois d’être de ton avis ;
frère aîné, ô mon corps,
qu’il est doux d’être fort
de ta force,
de te sentir feuille, tige, écorce
et tout ce que tu peux devenir encor,
toi, si près de l’esprit.
Toi, si franc, si uni
dans ta joie manifeste
d’être cet arbre de gestes
qui, un instant, ralentit
les allures célestes
pour y placer sa vie.
28
LA DEESSE
Au midi vide qui dort
combien de fois elle passe,
sans laisser à la terrasse
le moindre soupçon d’un corps.
Mais si la nature la sent,
l’habitude de l’invisible
rend une clarté terrible
à son doux contour apparent.
29
LE VERGER
I
Peut-être que si j’ai osé t’écrire,
langue prêtée, c’était pour employer
ce nom rustique dont l’unique empire
me tourmentait depuis toujours: Verger.
Pauvre poète qui doit élire
pour dire tout ce que ce nom comprend,
un à peu près trop vague qui chavire,
ou pire: la clôture qui défend.
Verger: ô privilège d’une lyre
de pouvoir te nommer simplement;
nom sans pareil qui les abeilles attire,
nom qui respire et attend…
Nom clair qui cache le printemps antique,
tout aussi plein que transparent,
et qui dans ses syllabes symétriques
redouble tout et devient abondant.
II
Vers quel soleil gravitent
tant de désirs pesants?
De cette ardeur que vous dites,
où est le firmament?
Pour l’un à l’autre nous plaire,
faut-il tant appuyer?
Soyons légers et légères
à la terre remuée
par tant de forces contraires.
Regardez bien le verger:
c’est inévitable qu’il pèse;
pourtant de ce même malaise
il fait le bonheur de l’été.
III
Jamais la terre n’est plus réelle
que dans tes branches, ô verger blond,
ni plus flottante que dans la dentelle
que font tes ombres sur le gazon.
Là se rencontre ce qui nous reste,
ce qui pèse et ce qui nourrit
avec le passage manifeste
de la tendresse infinie.
Mais à ton centre, la calme fontaine,
presque dormant en son ancien rond,
de ce contraste parle à peine,
tant en elle il se confond.
IV
De leur grâce, que font-ils,
tous ces dieux hors d’usage,
qu’un passé rustique engage
à être sages et puérils?
Comme voilés par le bruit
des insectes qui butinent,
ils arrondissent les fruits;
(occupation divine).
Car aucun jamais ne s’efface,
tant soit-il abandonné;
ceux qui parfois nous menacent
sont des dieux inoccupés.
V
Ai-je des souvenirs, ai-je des espérances,
en te regardant, mon verger?
Tu te repais autour de moi, ô troupeau d’abondance
et tu fais penser ton berger.
Laisse-moi contempler au travers de tes branches
la nuit qui va commencer.
Tu as travaillé; pour moi c’était un dimanche, –
mon repos, m’a-t-il avancé?
D’être berger, qu’y a-t-il de plus juste en somme?
Se peut-il qu’un peu de ma paix
aujourd’hui soit entrée doucement dans tes pomme
Car tu sais bien, je m’en vais…
VI
N’était-il pas, ce verger, tout entier,
ta robe claire, autour de tes épaules?
Et n’as-tu pas senti combien console
son doux gazon qui pliait sous ton pied?
Que de fois, au lieu de promenade,
il s’imposait en devenant tout grand;
et c’était lui et l’heure qui s’évade
qui passaient par ton être hésitant.
Un livre parfois t’accompagnait…
Mais ton regard, hanté de concurrences,
au miroir de l’ombre poursuivait
un jeu changeant de lentes ressemblances.
VII
Heureux verger, tout tendu à parfaire
de tous ses fruits les innombrables plans,
et qui sait bien son instinct séculaire
plier à la jeunesse d’un instant.
Quel beau travail, quel ordre que le tien!
Qui tant insiste dans les branches torses,
mais qui enfin, enchanté de leur force,
déborde dans un calme aérien.
Tes dangers et les miens, ne sont-ils point
tout fraternels, ô verger, ô mon frère?
Un même vent, nous venant de loin,
nous force d’être tendres et austères.
30
TOUTES LES JOIES DES AÏEUX
Toutes les joies des aïeux
ont passé en nous et s’amassent;
leur cœur, ivre de chasse,
leur repos silencieux
devant un feu presque éteint…
Si dans les instants arides
de nous notre vie se vide,
d’eux nous restons tout pleins.
Et combien de femmes ont dû
en nous se sauver, intactes,
comme dans l’entr’acte
d’une pièce qui n’a pas plu -,
parées d’un malheur qu’aujourd’hui
personne ne veut ni ne porte,
elles paraissent fortes
appuyées sur le sang d’autrui.
Et des enfants, des enfants!
Tous ceux que le sort refuse,
en nous exercent la ruse
d’exister pourtant.
31
PORTRAIT INTERIEUR
Ce ne sont pas des souvenirs
qui, en moi, t’entretiennent;
tu n’es pas non plus mienne
par la force d’un beau désir.
Ce qui te rend présente,
c’est le détour ardent
qu’une tendresse lente
décrit dans mon propre sang.
Je suis sans besoin
de te voir apparaître;
il m’a suffi de naître
pour te perdre un peu moins.
32
LA DOUCE VIE
Comment encore reconnaître
ce que fut la douce vie?
En contemplant peut-être
dans ma paume l’imagerie
de ces lignes et de ces rides
que l’on entretient
en fermant sur le vide
cette main de rien.
33
LE SUBLIME EST UN DEPART
Le sublime est un départ.
Quelque chose de nous qui au lieu
de nous suivre, prend son écart
et s’habitue aux cieux.
La rencontre extrême de l’art
n’est-ce point l’adieu le plus doux?
Et la musique: ce dernier regard
que nous jetons nous-mêmes vers nous !
34
COMBIEN DE PORTS
Combien de ports pourtant, et dans ces ports
combien de portes, t’accueillant peut-être.
combien de fenêtres
d’où l’on voit ta vie et ton effort.
Combien de grains ailés de l’avenir
qui, transportés au gré de la tempête,
un tendre jour de fête
verront leur floraison t’appartenir.
Combien de vies qui toujours se répondent;
et par l’essor que prend ta propre vie
en étant de ce monde,
quel gros néant à jamais compromis.
35
L’OFFRANDE
N’est-ce pas triste que nos yeux se ferment ?
On voudrait avoir les yeux toujours ouverts,
pour avoir vu, avant le terme,
tout ce que l’on perd.
N’est-il pas terrible que nos dents brillent ?
Il nous aurait fallu un charme plus discret
pour vivre en famille
en ce temps de paix.
Mais n’est-ce pas le pire que nos mains se cramponnent,
dures et gourmandes ?
Faut-il que des mains soient simples et bonnes
pour lever l’offrande !
36
LA MELODIE PASSAGERE
Puisque tout passe, faisons
la mélodie passagère ;
celle qui nous désaltère,
aura de nous raison.
Chantons ce qui nous quitte
avec amour et art ;
soyons plus vite
que le rapide départ.
37
L’ÂME-OISEAU
Souvent au-devant de nous
l’âme-oiseau s’élance;
c’est un ciel plus doux
qui déjà la balance,
pendant que nous marchons
sous des nuées épaisses.
Tout en peinant, profitons
de son ardente adresse.
38
VUE DES ANGES
Vues des Anges, les cimes des arbres peut-être
sont des racines, buvant les deux;
et dans le sol, les profondes racines d’un hêtre
leur semblent des faîtes silencieux.
Pour eux, la terre, n’est-elle point transparente
en face d’un ciel, plein comme un corps?
Cette terre ardente, où se lamente
auprès des sources l’oubli des morts.
39
LES INCONNUS
Mes amis, vous tous, je ne renie
aucun de vous; ni même ce passant
qui n’était de l’inconcevable vie
qu’un doux regard ouvert et hésitant.
Combien de fois un être, malgré lui,
arrête de son œil ou de son geste
l’imperceptible fuite d’autrui,
en lui rendant un instant manifeste.
Les inconnus. Ils ont leur large part
à notre sort que chaque jour complète.
Précise bien, ô inconnue discrète,
mon cœur distrait, en levant ton regard.
40
LE CYGNE
Un cygne avance sur l’eau
tout entouré de lui-même,
comme un glissant tableau;
ainsi à certains instants
un être que l’on aime
est tout un espace mouvant.
Il se rapproche, doublé,
comme ce cygne qui nage,
sur notre âme troublée…
qui à cet être ajoute
la tremblante image
de bonheur et de doute.
41
NOSTALGIE DES LIEUX
Ô nostalgie des lieux qui n’étaient point
assez aimés à l’heure passagère,
que je voudrais leur rendre de loin
le geste oublié, l’action supplémentaire !
Revenir sur mes pas, refaire doucement
– et cette fois, seul – tel voyage,
rester à la fontaine davantage,
toucher cet arbre, caresser ce banc…
Monter à la chapelle solitaire
que tout le monde dit sans intérêt;
pousser la grille de ce cimetière,
se taire avec lui qui tant se tait.
Car n’est-ce pas le temps où il importe
de prendre un contact subtil et pieux ?
Tel était fort, c’est que la terre est forte;
et tel se plaint: c’est qu’on la connaît peu.
42
LE SORT IMMOBILE
Ce soir quelque chose dans l’air a passé
qui fait pencher la tête;
on voudrait prier pour les prisonniers
dont la vie s’arrête.
Et on pense à la vie arrêtée…
À la vie qui ne bouge plus vers la mort
et d’où l’avenir est absent ;
où il faut être inutilement fort
et triste, inutilement.
Où tous les jours piétinent sur place,
où toutes les nuits tombent dans l’abîme,
et où la conscience de l’enfance intime
à ce point s’efface,
qu’on a le cœur trop vieux pour penser un enfant
Ce n’est pas tant que la vie soit hostile;
mais on lui ment,
enfermé dans le bloc d’un sort immobile.
43
TEL CHEVAL QUI BOIT A LA FONTAINE
Tel cheval qui boit à la fontaine,
telle feuille qui en tombant nous touche,
telle main vide, ou telle bouche
qui nous voudrait parler et qui ose à peine -,
autant de variations de la vie qui s’apaise,
autant de rêves de la douleur qui somnole:
ô que celui dont le coeur est à l’aise,
cherche la créature et la console.
45
LUMIERE
Cette lumière peut-elle
tout un monde nous rendre ?
Est-ce plutôt la nouvelle
ombre, tremblante et tendre,
qui nous rattache à lui ?
Elle qui tant nous ressemble
et qui tourne et tremble
autour d’un étrange appui.
Ombres des feuilles frêles,
sur le chemin et le pré,
geste soudain familier
qui nous adopte et nous mêle
à la trop neuve clarté.
46
LA BLONDEUR DU JOUR
Dans la blondeur du jour
passent deux chars pleins de briques ;
ton rosé qui revendique
et renonce tour à tour.
Comment se fait-il que soudain
ce ton attendri signifie
un nouveau complot de vie
entre nous et demain.
47
LE SILENCE UNI DE L’HIVER
Le silence uni de l’hiver
est remplacé dans l’air
par un silence à ramage;
chaque voix qui accourt
y ajoute un contour,
y parfait une image.
Et tout cela n’est que le fond
de ce qui serait l’action
de notre cœur qui surpasse
le multiple dessin
de ce silence plein
d’inexprimable audace.
48
LA NATURE
Entre le masque de brume
et celui de verdure,
voici le moment sublime où la nature
se montre davantage que de coutume.
Ah, la belle! Regardez son épaule
et cette claire franchise qui ose …
Bientôt de nouveau elle jouera un rôle
dans la pièce touffue que l’été compose.
49
LE DRAPEAU
Vent altier qui tourmente le drapeau
dans la bleue neutralité du ciel,
jusqu’à le faire changer de couleur,
comme s’il voulait le tendre à d’autres nations
par-dessus les toits. Vent impartial,
vent du monde entier, vent qui relie,
évocateur des gestes qui se valent,
ô toi, qui provoques les mouvements interchangeables
Le drapeau étale montre son plein écusson, –
mais dans ses plis quelle universalité tacite !
Et pourtant quel fier moment
lorsqu’un instant le vent se déclare
pour tel pays: consent à la France,
ou subitement s’éprend
des Harpes légendaires de la verte Irlande.
Montrant toute l’image, comme un joueur de cartes
qui jette son atout,
et qui de son geste et de son sourire anonyme,
rappelle je ne sais quelle image
de la Déesse qui change.
50
LA FENÊTRE
I
N’es-tu pas notre géométrie,
fenêtre, très simple forme
qui sans effort circonscris
notre vie énorme?
Celle qu’on aime n’est jamais plus belle
que lorsqu’on la voit apparaître
encadrée de toi; c’est, ô fenêtre,
que tu la rends presque éternelle.
Tous les hasards sont abolis. L’être
se tient au milieu de l’amour,
avec ce peu d’espace autour
dont on est maître.
II
Fenêtre, toi, ô mesure d’attente,
tant de fois remplie,
quand une vie se verse et s’impatiente
vers une autre vie.
Toi qui sépares et qui attires,
changeante comme la mer, –
glace, soudain, où notre figure se mire
mêlée à ce qu’on voit à travers ;
échantillon d’une liberté compromise
par la présence du sort ;
prise par laquelle parmi nous s’égalise
le grand trop du dehors.
III
Assiette verticale qui nous sert
la pitance qui nous poursuit,
et la trop douce nuit
et le jour, souvent trop amer.
L’interminable repas,
assaisonné de bleu -,
il ne faut pas être las
et se nourrir par les yeux.
Que de mets l’on nous propose
pendant que mûrissent les prunes;
ô mes yeux, mangeurs de rosés,
vous allez boire de la lune !
51
A LA BOUGIE ETEINTE
À la bougie éteinte,
dans la chambre rendue à l’espace,
on est frôlé par la plainte
de feu la flamme sans place.
Faisons-lui un subtil
tombeau sous notre paupière,
et pleurons comme une mère
son très familier péril.
52
L’APPROCHE
C’est le paysage longtemps, c’est une cloche,
c’est du soir la délivrance si pure -;
mais tout cela en nous prépare l’approche
d’une nouvelle, d’une tendre figure…
Ainsi nous vivons dans un embarras très étrange
entre l’arc lointain et la trop pénétrante flèche;
entre le monde trop vague pour saisir l’ange
et Celle qui, par trop de présence, l’empêche.
53
LA ROSE
On arrange et on compose
les mots de tant de façons,
mais comment arriverait-on
à égaler une rosé ?
Si on supporte l’étrange
prétention de ce jeu,
c’est que, parfois, un ange
le dérange un peu.
54
L’IMPERTUBABLE NATURE
J’ai vu dans l’œil animal
la vie paisible qui dure,
le calme impartial
de l’imperturbable nature.
La bête connaît la peur ;
mais aussitôt elle avance
et sur son champ d’abondance
broute une présence
qui n’a pas le goût d’ailleurs.
55
OBJETS OBSCURS
Faut-il vraiment tant de danger
à nos objets obscurs?
Le monde serait-il dérangé,
étant un peu plus sûr?
Petit flacon renversé,
qui t’a donné cette mince base?
De ton flottant malheur bercé,
l’air est en extase.
56
LA DORMEUSE
Figure de femme, sur son sommeil
fermée, on dirait qu’elle goûte
quelque bruit à nul autre pareil
qui la remplit toute.
De son corps sonore qui dort
elle tire la jouissance
d’être un murmure encor
sous le regard du silence.
57
LA BICHE
Ô la biche : quel bel intérieur
d’anciennes forêts dans tes yeux abonde ;
combien de confiance ronde
mêlée à combien de peur.
Tout cela, porté par la vive
gracilité de tes bonds.
Mais jamais rien n’arrive
à cette impossessive
ignorance de ton front.
58
SOUS CES BEAUX ARBRES
Arrêtons-nous un peu, causons.
C’est encore moi, ce soir, qui m’arrête,
c’est encore vous qui m’écoutez.
Un peu plus tard d’autres joueront
aux voisins sur la route
sous ces beaux arbres que l’on se prête.
59
LES ADIEUX
Tous mes adieux sont faits. Tant de départs
m’ont lentement formé dès mon enfance.
Mais je reviens encor, je recommence,
ce franc retour libère mon regard.
Ce qui me reste, c’est de le remplir,
et ma joie toujours impénitente
d’avoir aimé des choses ressemblantes
à ces absences qui nous font agir.
*