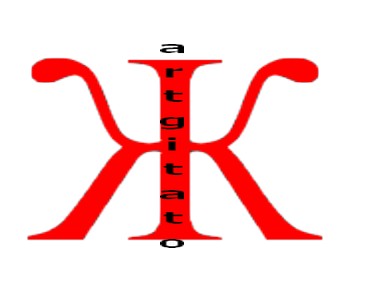MALAISIE – MALAYSIA
PAUL ADAM LETTRES DE MALAISIE
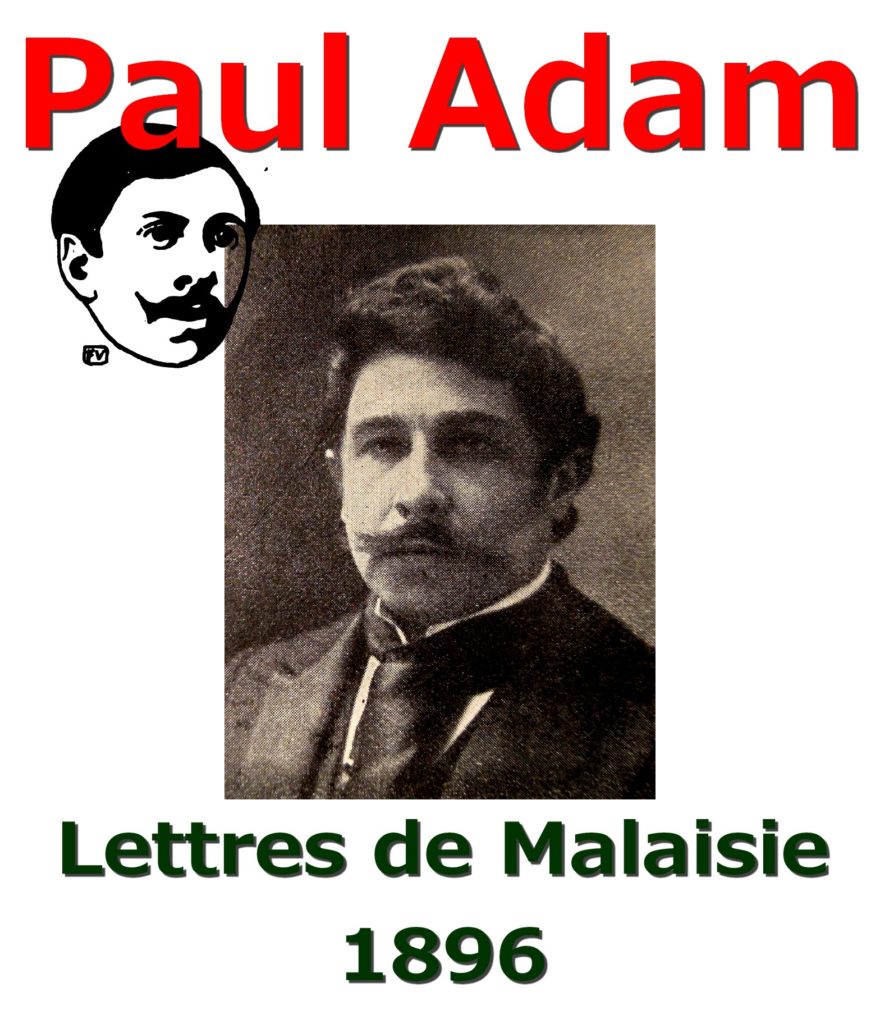
D’après une photo de Nadar et le portrait de Félix Valloton
—
PAUL ADAM
1862 – 1920
LETTRES DE MALAISIE
1896
TROISIEME LETTRE
Texte paru dans La Revue Blanche
Paris
1898
*****
 Portrait de Paul Adam
Portrait de Paul Adam
Félix Vallotton paru
Le Livre des masques de Remy de Gourmont
1896
***
TROISIEME LETTRE DE MALAISIE
Palais des Voyageurs
Rien, parmi les impressions qui m’assaillent ici, ne m’étonne plus que la déviation des idées socialistes. Le principe de la liberté semble avoir été nié tout d’abord à la descente même de Jérôme le Fondateur en ce pays. Militairement et tyranniquement il mena les révolutionnaires à leur idéal. Au reste il suffit de considérer ses statues, où il apparaît en une attitude martiale, les guêtres jusqu’aux genoux, les cheveux en coup de vent, les favoris rudes et courts, les sourcils joints, la lèvre mauvaise et rasée. Sous le plastron de sa redingote à jupe plissée, une poitrine maigre justifie les plis du bronze. Un geste historique lance sur l’espace la première poignée des semailles. L’autre poing serre comme une arme le manche de la charrue. Les pieds enfoncent dans le sol. À l’ombre d’arcades sourcilières très creuses, les yeux, petits, visent. Le nez lourd surplombe la fente de la bouche ricaneuse. Ces caractères de l’effigie désignent assez la rudesse de l’âme.
Son œuvre, aux premiers temps, fut d’ailleurs toute guerrière. Les tribus malaises s’inquiétèrent de ces hommes venus, sans marchandises, de la côte chinoise où les avaient laissés les bâtiments à voiles du commerce britannique. À peine hors des jonques qui les débarquèrent, ils connurent la traîtrise des embuscades, pendant les longues marches ténébreuses dans l’humidité des forêts. Cinq ans, il fallut, étape par étape, se frayer passage, en remontant le cours de fleuves nouveaux qui, par de soudaines inondations noyaient les camps provisoires ; et ces hommes fuyant l’Europe par haine de l’injustice, de la guerre sociale, trouvèrent, au seuil du paradis attendu, les batailles, les cruautés de supplices asiatiques pour les prisonniers et les traînards.
L’imminence du péril contraignit donc à la plus stricte discipline ces libertaires. Autour d’eux rodait la sanction de la mort. Il fallut oublier toutes les revendications, tous les espoirs d’individualité solitaire. Quand on eût conquis les hauts plateaux, établi la défense des accès, découvert enfin un pays salubre, des eaux propices, des gisements de houille et de métal, un humus fertile, et battu les épis de la première moisson, ce sens d’obéir occupait la raison de tous. Jérôme n’eût qu’à promulguer ses lois.
Ce fils de maquignon picard eût-il couvé la vulgaire ambition des généraux et nourri le sot désir de rentrer, triomphateur, à Paris, rien ne lui eût été moins difficile. Il ne souhaita point ce misérable privilège. Au contraire, lors de l’expédition française en Chine, il édicta des décrets sévères interdisant toute imprudence capable de révéler l’empire mystérieux et déjà prospère. Telle fut son autorité, que nul ne transgressa les prescriptions ni ne tenta le retour en Europe, spontanément. Des émissaires y furent envoyés à bien des reprises pour les intérêts publics, sans que leur parole trahit le secret.
Peut-être le climat d’Asie favorable pendant le cours des histoires, au succès des autocraties absolues, modifia-t-il le caractère des pionniers, peut-être l’infiltration des races autochtones sut-elle insinuer aux conquérants le respect du destin qui impose la volonté d’un roi à des millions d’hommes. Il persiste en tous cas, aux yeux et aux allures des êtres, une singulière langueur. Leurs paupières semblent alourdies par la résignation ; leur sourire erre avec indulgence et scepticisme. Peu de choses les émeuvent. Que les gens, dans la rue, s’accouplent sur les divans de pierre installés au fond des arcades bornant les nombreux squares à vasques et à jets d’eau : que, même, l’élan d’un haut tramway coupe en deux le corps d’une personne imprudente ; cela ne suffit point à les détourner beaucoup du rêve intérieur. Une expression de dédain s’esquisse à peine sur leurs visages, pour le premier spectacle, et, pour le second, leur moue marque plus de dégoût procuré par le gâchis sanglant que de commisération envers la victime.
Je ne puis vous dire à quel point ce caractère agace nos impétueuses habitudes de participer à toutes les manifestations de l’existence chez autrui. Théa et Pythie, mes compagnes, finissent par me désoler. Je me sens prêt à les haïr. Si je leur parle de nos littératures, de notre politique, elles m’écoutent sans répondre, évidemment ennuyées. À mes interrogations elles ne manquent pas de satisfaire, mais sans que leur verbe s’anime pour exalter la merveille de leurs inventions, ou pour en dénigrer les abus. Elles ne s’enchantent pas de franchir avec tant de célérité l’étendue, ni de jouir des très beaux décors que font les villes. Elles ne se plaignent pas de cette vie tout ouverte qui les oblige à quitter leurs habits à la porte de la piscine précédant les salles de repas, pour en revêtir d’autres, de nouveaux, d’inconnus, imposés par l’administration. Tout leur venant à point, le sens de la lutte s’est perdu. Elles ne désirent rien avec assez de violence pour agir dans un espoir. La vie leur semble dénuée de valeur. Naguère je risquai de me tuer au sortir d’un ascenseur. Cela ne les fit point sourciller même. Bien que les rapports intimes de la sexualité me lient à l’une et à l’autre, maintenant, elles ne me confient pas de leurs gaietés ou de leurs craintes. Nous demeurons aussi étrangers qu’à la deuxième heure de la rencontre. Ici, chacun reste un passant pour chacun.
Figurez-vous que cette Pythie me passionne presque. Le charme intelligent de son silence, les cruautés de sa débauche et la supériorité de son mépris m’éblouirent. Son corps fatigué dégage des odeurs qui étourdissent. Il vous enlace de douceurs de tiédeurs. Elle lit à vos yeux toutes les convoitises secrètes, Théa et moi, nous sommes sans mystère devant elle. La parole cesse-t-elle, quelques instants, de fleurir nos lèvres, Pythie se met tout à coup à rire de ce que nous pensons, et nous décrit cette pensée dont elle peut se divertir. Rarement elle se trompe. Nous nous estimons ses inférieurs, à toute minute. Elle le voit trop pour tenter par ses allures de nous le faire sentir.
Avant la triple maternité qui l’exempte de service social, Pythie enseignait l’histoire aux jeunes filles du gymnase de Minerve. Sa mémoire connaît tous les travaux des érudits, les compilations des diplomates, les secrets des archives, les anecdotes des annalistes, les causes sentimentales des guerres, les vertus et les faiblesses des cités. Lorsqu’elle se décide à parler, elle découvre l’origine, le développement, l’apogée et la décadence d’une idée sociale s’exprimant par les actions des peuples, de siècle en siècle. Elle suit cette idée dans ses voyages. Elle la montre partie d’orient pour l’occident avec les migrations des races, puis revenue, grandie, de l’Atlantique vers la Chine avec le nouvel afflux européen qui recommence les migrations inverses du cycle de Ram. Sa voix généralise les efforts de l’âme planétaire qui a pour organisme vital les peuples, et pour unité de cellule cérébrale, la personne humaine. Pythie ne s’attarde point à compter les exploits des conquérants ou les amours des rois, comme nos professeurs d’Europe. Elle vise à de plus hautes tâches.
Quand je l’écoute je comprends la supériorité dévolue, par cinquante années d’une pareille éducation, à l’âge fort de ce jeune peuple.
Minerve est la ville des bureaucraties et des bibliothèques, de l’imprimerie. Les écoles, les collèges, les lycées et les gymnases féminins occupent des villages à des distances environnant la ville sur un circuit de vingt-cinq ou trente kilomètres. C’est encore la ville des ministères et des administrations. À une lieue de son enceinte, au milieu d’une foret très belle, éclaircie par la hache et la dynamite, l’Université dresse ses monuments somptueux, au bout d’allées d’eaux et de charmilles sévères.
L’élément mâle se présente en petit nombre dans la cité. Il se compose d’inventeurs ou de travailleurs en congé qui viennent dans les bibliothèques parfaire leur connaissance des indications scientifiques. Aussi le Palais des Voyageurs est-il de vastes proportions. Les femmes des bureaux emplissent les avenues de leurs vastes habits noirs, de leurs rabats blancs, de leurs feutres durs. À toutes les fenêtres des hauts édifices on les voit traverser l’intérieur, des papiers à la main.
En groupes, elles jouissent du soleil sous les arcades de fer élancé qui couvrent les serres précédant les édifices du Laboratoire.
Contre les pluies trop fréquentes ces serres protègent des fleurs hypertrophiques, d’inconcevables orchidées, des chrysanthèmes monstrueux, et de délicates graminées aussi ; des corolles qu’on croirait des ailes folles d’oiseaux minuscules. Par les sentes de sable écarlate les dames se promènent, sans rires ni éclats de voix, les yeux battus, deux à deux.
Aux restaurants publics, elles mangent avec plaisir, mais hâtives. Ce sont de vastes serres encore, pleines de fleurs et d’arbustes et sablées d’écarlate. Les tables occupent des sortes de bosquets. Elles sont à deux, à trois, à dix et à vingt couverts. Par ce plafond de verre jaune et rouge, le jour se répand, traverse des vélums blancs. Des orgues mécaniques chantent dans les sous-sols : et leurs grandes voix se développent à travers les séries de sveltes colonnes métalliques à revêtements de faïence où paradent des oiseaux émaillés.
Il y a toujours du silence, des sourires, un murmure, point de propos bruyants. La franchise de la lumière laisse paraître aux figures des femmes toutes les petites flétrissures de l’âge, d’autant que nulle ne semble user de fards ni de cosmétiques. Leurs cheveux raides, gonflés par des eaux hygiéniques, enodorent assez finement. Mais les tannes déparent leurs peaux rudes et sombres. Peu de blondes subsistèrent aux mélanges des races durant trois générations ; mais il se rencontre des chinoises avérées, aux yeux malicieux, aux gestes mièvres, à la petite taille, des malaises lentes et sournoises. Ce monde s’étire avec nonchalance dans de larges fauteuils de bambou et de joncs tressés. Les domestiques mâles ou femelles ne se distinguent pas des dîneuses au moyen du costume. Ils apportent les mets dans des terrines closes, la boisson dans des cruches simples. On boit, au cristal des coupes, certaine eau miellée et des bières capiteuses, du thé froid, des sorbets fondants. Dans une vaisselle de métal pareil à l’or, on mange des pâtés exquis, des chairs froides, des gelées, des volailles. Pour éviter l’odeur des sauces, les cuisines n’apprêtent rien de chaud. Du reste les narines de ce peuple sont devenues fort susceptibles. Personne ne souffre la moindre émanation. Les effluves de grillades et de rôtis qui nous réjouissent leur donneraient mal au cœur. Mais on se partage avec appétit des salades, des tomates, des piments, et une grande variété de fruits que le climat favorise sur les espaliers. Point de légumes cuits. Ces pâtés, ces volailles, ces rosbifs sont donc servis en terrine par les « commis à la bouche ». Loin des villes, au fond de fermes isolées, une classe décriée de femmes prépare et cuisine ces victuailles. Les soldats font le service des abattoirs dont ne se chargeraient pas les honnêtes gens. Les cuisines, à ce que j’ai compris, sont des sortes de prisons pour femmes.
Au-dessus du restaurant, dans les étages élevés, des machinismes simples et rapides pincent les assiettes, les présentent à des jets d’eau bouillante, les font tourner vivement dessous, les glissent dans les fours séchoirs, d’où elles ressortent nettes et claires, beau métal pareil à l’or. Deux surveillantes appuient sur des leviers, à manches de porcelaine, sur des boutons, et, automatiquement, le nettoyage de plusieurs centaines de plats s’accomplit en moins d’une heure sans salir l’ongle d’une seule servante. Ah, me voici loin de notre famille européenne, de son foyer, de la bonne odeur de la soupe et de nos relaveuses. Finie l’existence modeste et simple, un peu crasseuse, de notre vieux monde. Ici les serveurs nous reçoivent en camarades polis. Il n’est point permis de leur adresser directement une observation qui les offenserait. On écrit sur un papier le choix du menu, et sa réclamation contre la souillure du cristal.
Le soir, les groupes de travail se visitent dans les théâtres.
N’imaginez point que ces théâtres ressemblent aux nôtres. Ce sont d’immenses édifices à coupoles et à souterrains, qui tiennent à la fois du jardin d’hiver, de la salle de bal et du lupanar. Le principal, à Minerve, possède une façade en faïence émaillée fort artistement de grappes de femmes et d’hommes qui semblent se précipiter du ciel. Cela se rapproche du Jugement Dernier dû à Michel-Ange. Chacune des figures représente la passion d’un des types de la littérature des nations, et ils tombent, semble-t-il, à travers les profondeurs étoilées du firmament, le long de cette énorme façade luisante, qu’aucune fenêtre ne troue. C’est un miracle d’art fort admiré ici-même où les belles œuvres ne manquent pas. Dix-huit jeunes femmes le composèrent dans les ateliers décorateurs de la ville de Diane. Trois ans passèrent à l’exécuter.
Avec Pythie et Théa j’entrai, vers le crépuscule, par la porte basse et large du lieu, dans un vestibule en mosaïque d’argent. Des gestes indicateurs nous séparèrent, pour le bain qui précède toute action importante, en cet hygiénique pays. Un Chinois m’introduisit dans une chambre circulaire où un mètre et demi d’eau tiède couvrait les faïences bleues du parquet. Savonné, massé, les cheveux et la barbe égalisés par le ciseau, enduit de parfums, je fus en outre couronné, comme les effigies de César, de bandelettes pourpres et d’une double palme. Le serviteur m’adapta des bottines de souple soie rouge lacée jusque mi-cuisses, et me passa une sorte de chlamyde bleuâtre à raies noires, qu’une ceinture de brocart colla sur ma taille. Prévenu par mes compagnes, je ne m’étonnai pas de cet affublement, costume de fête.
Un instant après je fus au seuil d’un édifice plus haut que les plus hautes cathédrales gothiques. Les haies des colonnes jaillies soutiennent sur les palmes de leurs chapiteaux cinq coupoles de verre orangé. La voix d’orchestres invisibles montait du sol. Une joyeuse lumière s’épanouissait à travers des vélums roses et verts jusqu’à une foule vêtue comme moi de chlamydes en tissus changeants, de hautes bottines rouges à semelle mince et sourde, coiffée comme moi d’une double palme impériale, parfumée comme moi d’odeurs fines et pénétrantes. Les poitrines nues de Théa et de Pythie, de mille autres femmes tremblaient à leurs pas, sous la transparence de l’étoffe. On se sentait la chair près de la chair, l’odeur dans l’odeur. D’énervantes musiques se perpétuèrent, couvrant le bruit des jets d’eau qui creusaient les mares des vasques, entre les colonnes. Des divans couverts de fourrures, des tapis de laines colorées, des coussins de soie accueillirent les attitudes de tous. Avec de jolis cris, cent oiseaux lâchés parcoururent la nef, volèrent jusqu’aux verdures hérissées contre les murailles. Un murmure de joie frémit dans l’assistance. Des yeux de femmes se répondirent. Beaucoup se couchèrent, en s’enlaçant, les lèvres aux lèvres ; et alors, devant nous, une fresque représentant le cortège de Bacchus, s’abîma sous les dalles de turquoise. La scène parut.
Son décor prolongeait des perspectives agrestes, jusque vers un paysage de montagnes dorées, jusque vers une ligne marine d’eaux violettes, évoquant une heureuse plage de l’Hellade. Des cytises bordaient un ruisseau. Des chèvres broutaient les lauriers-roses. Un satyre aux poils argentés souffla dans la flûte de Pan une mélodie qui répéta le rire du ruisseau, les propos du vent, la querelle des fauvettes.
C’était un vieux faune. Sa barbe en boucles grisonnait comme sa chevelure crépue percée de deux cornes d’or ; et le pelage de son estomac était un peu plus noir. Virtuose extraordinaire, il souffla dans cette flûte à sept trous le chant de la nature totale. Des soupirs ravis révélèrent, autour de moi, le bonheur de l’auditoire. On faisait avec lui un long voyage. On affrontait la tempête dans la montagne. On descendait contre la cascade, par un chemin de cailloux sonores. On rencontrait les bêtes, le froufrou de leurs fuites entre les arbustes, la galopade du troupeau. L’aigle cria sur nos têtes ; et puis il y eut des voix plus familières, celles des pinsons et des coucous, des caresses de la brise dans les feuillages légers, le trot du cheval, la course de l’homme. Plus tard l’eau du fleuve clapota contre les berges, des cris d’enfants s’appelèrent ; puis des voix confuses de vierges, de femmes jeunes, de matrones, de vieilles… Du silence à nouveau ; la chute d’une pomme dans l’herbe ; l’essor de colombes…
À cet instant, la timidité d’une nymphe écarta le buisson. Elle inspecta la scène, et n’aperçut point le faune qui s’accroupit traîtreusement derrière le laurier. Ballerine, la nymphe, à pas menus entre, écoute. La flûte reprend la querelle des fauvettes. Une seconde nymphe franchit le buisson, une troisième, cinq, vingt, et les voici écoutant la dispute des oiseaux.
Je ne vous retracerai pas, mon cher ami, les phases du spectacle. Imaginez cette immense scène, peu à peu remplie par des quadrilles de danseuses en maillot collant contre leur nudité. Leur cortège trace des figures merveilleuses. Le faune reprend sur sa flûte la symphonie du début amplifiée par tous les moyens d’un puissant orchestre invisible. Avec un art inexprimable, les danseuses deviennent elles-mêmes les forces naturelles qu’il chante. Elles filent comme les nuées sous le vent, elles s’unissent et imitent l’eau, avec la houle de leurs hanches, de leurs gorges. Elles sont la cascade et la rivière ; puis les biches du troupeau effaré, puis les enfants, les filles, les femmes, des voix au bord du fleuve.
Soudain le faune surgit, les nymphes fuient, reviennent, l’entourent. Un dialogue s’engage. Il leur montre la puissance de son art avec lequel il pourrait, aveugle et sans forces, visiter cependant par suggestion les plus beaux aspects du monde. Voilà que de sa flûte il tire le son d’un baiser. Elles rient ; elles frissonnent. Elles lui représentent qu’il est trop vieux, trop laid. Il veut en étreindre une. Les autres la dérobent à ce désir. Alors, il reprend sa flûte et en tire l’imitation de ce que l’amour a de baisers sonnants, de murmures, de rires énervés, de soupirs, de râles, de hoquets et de cris. À l’entendre les nymphes d’abord se moquent, puis s’étonnent, puis s’exaspèrent. Une embrasse l’autre ; et commence une autre phase du ballet, où les corps s’étreignent, se roulent, où la passion s’assouvit dans les postures. D’autres faunes se ruent. La priapée folle se noue, pleine de mots gais, de réparties savantes et fines. Ces nymphes et ces faunes connaissent la raison du monde. Ils prévoient l’effort ridicule des peuples qui leur succéderont sur la terre d’Hellé. De leurs amours les hommes vont naître qui abandonneront la joie de la nature pour dominer ou servir… Le deuxième acte montra un cirque de rochers, l’homme fauve, le chef de horde, qui rentre avec ses prisonniers, des faibles : adolescents, femmes, vieillards. Avec sa hache sanglante, il oblige les vieillards à réparer ses armes, les femmes à satisfaire sa luxure, les adolescents à bâtir pour lui. Il fonde la famille en tuant qui résiste ; et, quand il part, ayant retiré l’arbre qui sert de pont pour franchir l’abîme, un magnifique chœur de lamentations s’éplore.
Le troisième acte montre le repaire du héros, vers le sommet d’une colline que les serfs labourent, en haillons. Vêtu de son armure, le faune, l’homme, est assis sous le chêne de justice, et s’appuie sur son glaive. À genoux, le vaincu lui fait hommage, et, pour seller la paix, donne en épousailles sa fille, de l’or, des chevaux, des châsses d’argent, des armes, dot et butin. Esclave, la femme ment et trompe. Le serf pèche avec la châtelaine.
Aux actes suivants, tous les avatars de l’amour sont représentés, d’époques en époques, de race en race. Œdipe erre. Othello étrangle Desdémone. Roméo et Juliette se chérissent. Antony poignarde. Armé de la religion et de la loi, le mari remplace le chef de horde, l’homme faune, et sans moins de férocité.
Ainsi le spectacle se poursuit, traversant la série des siècles. Les scènes d’amour y sont mimées chaque fois jusqu’à la réalité la plus humble du dénouement ; et cela finit par le retour du faune et de son cortège de nymphes. Il reprend sa flûte. Il rappelle les cris entendus dans les affres de la passion éternelle. Il dit les actes du monde s’enroulant et se déroulant autour du Phallos divin, et le ballet recommence, que complètent des tableaux vivants d’un érotisme féerique.
D’autres pièces que j’ai vues résument ainsi la passion à travers les âges. Cela justifie des décors merveilleux et divers, d’acte en acte, des façons multiples de dialogue, des études de mœurs hétérogènes. Un drame se passant, comme chez nous, selon les unités de temps et de lieu ne plairait pas. L’esprit bien plus synthétique de la foule aime cette négation du temps, et cette recherche de la transformation d’une idée, d’un instinct au cours des sociétés successives. Cela contient de la féerie, du drame lyrique, de la comédie sentimentale, de la farce, des priapées et de somptueuses danses.
Ce fut après l’un de ces spectacles que je constatai la force de mon inclination à l’égard de Pythie. Comme la foule remuait, se regardait, se saluait à l’éclat des mille fleurs électriques tout à coup en incendie sur les arbres de fer qui forment la végétation fabuleuse des colonnes, un homme s’approcha d’elle, le sourire dans la barbe. Elle le reconnut ; ils se tendirent la main ; elle lui fit place au long d’elle sur la fourrure du divan. Ils ne tardèrent pas à rire en chuchotant, et il fallut bien prévoir, aux baisers qu’ils prolongèrent les yeux clos, des intimités prochaines. Sans doute l’altération de mon visage avertit Théa de ma peine. Elle me dit de la suivre jusque les salles souterraines où la fête continuait. J’obéis, non sans me retourner encore, avant de descendre, pour savourer la douleur de voir la barbe dorée de l’intrus contre le visage de Pythie, sa couronne de palmes unie à la couronne de palmes, et sa forte musculature empreinte aux douceurs des lignes onduleuses. Une angoisse physique m’abîma le corps. Je respirai mal. Dans la main de Théa la mienne s’amollit. Les veines gonflèrent à mes tempes. Je ressaisis très lentement mon énergie qui fuyait. À cette minute, mon cher ami, je me rappelai ce que vous m’avez dit à Biarritz sur la torture passionnelle. Oui, la douleur de se voir abandonné cause un mal physique. Ce n’est pas seulement notre orgueil qui pleure, ce sont nos fibres, nos os, notre sang. Je le sentis alors, et je m’épouvantai de mon état.
Elle me rasséréna peu, la contemplation des salles souterraines aux murs de miroirs éclairés par des corbeilles de fleurs versicolores dont les pistils sont des feux lumineux. Je vis sans joie les femmes et les hommes se blottir au fond des loges sombres, sur l’ouverture desquelles retombaient les plis de toiles peintes. Je goûtai d’une lèvre fade les breuvages d’or que des enfants chinoises versèrent dans nos coupes. Le délire fringant des musiques frappa mon oreille de sons inutiles. Bien que j’eusse consenti à ces voluptés, les caresses tour à tour bestiales, légères, énervantes d’une femme à la gorge roide et aux mains crispées, si elles secouèrent mon corps de spasmes imprévus et firent crier ma bouche, n’effacèrent pas l’image de Pythie aux bras de l’autre, ni la colère que me laissait son indifférence. En vain Théa me fit boire les lèvres d’une malaise serpentine et les seins d’une grasse chinoise, en vain elle enveloppa mes reins avec l’étreinte d’une blonde fleurant la chaleur du lait. J’y gagnai la fatigue du corps sans obtenir la lassitude de mon angoisse.
Nous quittâmes les matelas de soie violette qui garnissaient notre loge, et nous restâmes sous la tenture levée. Derrière nous, à la lueur de la veilleuse rouge, la blonde, épuisée de plaisir, sommeilla. Des salles octogones convergeaient de leurs murs en miroirs jusqu’au carrefour où nous nous tenions. Ivres de cette liqueur d’or dont nous avions bu, aphrodisiaque certain, les femmes coururent en farandole, les seins tremblants, nues jusque la ceinture qui retenait leurs chlamydes roulées. Vers le signe des hommes, trop peu nombreux, elles se glissaient sous les portières des loges ouvertes aux angles des salles octogones. Des glaces multipliaient les rires vermeils de leurs bouches, l’éclat de leurs dentures, les gestes blancs ou bruns de leurs bras, les danses rythmiques de leurs jambes en bas écarlates. Des ventilateurs soufflèrent des bouffées de parfums sur le murmure de la cohue chaude. Un moment on admira la science d’une danseuse qui ranimait la vigueur des hommes, en mimant avec les spasmes de son ventre une rage de désirs. Plus tard, une grappe de femmes se noua, blanches et brunes. Des soupirs gonflèrent l’ivoire des poitrines. Les pointes mauves et roses des seins se baisaient. À des trapèzes des filles maigres se balancèrent, tournèrent, offrirent aux yeux les lignes tendues de leurs hanches arides.
Gémissantes, hurlantes, furieuses et joyeuses, les femmes s’écrasaient, s’abattaient, se dressaient pour atteindre les reins d’un éphèbe monté sur une escabelle, et qui se promettait à la plus alerte. Une seconde, il me sembla voir Pythie entre elles, ses seins mûrs, ses aisselles fauves, sa croupe large. Mais Théa me couvrit le visage de son visage, et me repoussant dans notre loge, laissa retomber la tenture peinte sur la lumière des fleurs incendiées.
Nous nous retrouvâmes dans la pénombre rouge, à genoux sur la soie des coussins. D’autres femmes s’étaient glissées, râlaient. Une odeur de chairs brûlantes, un parfum d’éther et de roses m’étouffa. Des mains me happèrent. Des bouches se collèrent à ma peau. Je tombai entre des bras. Des étreintes se refermèrent. Il y eut les feux noirs des yeux, les haleines, le rampement des peaux veloutées, la griffure des mains cruelles, les morsures des bouches sèches, l’afflux et le reflux des chairs contre ma chair, la succion de bouches-ventouses, des gorges molles aplaties dans mes mains, des baisers extraordinaires, le grattement des toisons. Étranglée de douleur ou de joie une brama lamentablement. Des femmes chaudes me noyèrent. J’étouffai. Mon corps se tendit en arc. J’eus peur de mourir, je me débattis ; je repoussai cet amas vermiculaire de bacchantes ; je tirai mon corps des mains, des bras, des jambes ; j’atteignis la tenture et l’écartai. Partout grognait la luxure de couples informes ; et devant moi, une enfant collée au miroir tout embu par sa tiédeur, sanglotait voluptueusement contre son image… Je complétai son rêve avec ma force.
En haut, dans la salle aux coupoles, on retrouve les voiles des musiques, des tables mises, des boissons fortifiantes. On reprend la mesure des choses. On s’apaise devant l’harmonie architecturale des nefs infinies, devant les couleurs des fleurs de verre où l’électricité brille.
Ces sortes de cérémonies ont lieu une fois la semaine. Je m’explique bien que, comparées à ces somptueuses luxures, les petites niaiseries du sentiment paraissent rien. Allez donc parler clair de lune, passion éternelle, âmes sœurs à des gaillardes ainsi rassasiées, une fois la semaine. Elles vous regardent comme un enfant benêt. Mais cela réduit au minimum les drames passionnels. Ce communisme de sensations érotiques, détruit le désir de propriété sur l’amante ou sur l’amant. On se laisse libre d’offrir le baiser à qui bon semble, sans qu’une connivence première entraîne l’obligation de connivences futures. L’amour ne tient pas ici, la place qu’il occupe dans le vieux monde. Et cependant, je vous l’assure, on sait mieux profiter des plaisirs qu’il comporte.
Aussi les romans, les livres sentimentaux n’attirent-ils l’attention de personne. Les femmes, comme les hommes, réclament, aux bibliothèques, les ouvrages d’histoire, de linguistique, de géographie, de science. De là l’extrême intelligence de tous. N’ayant plus à se munir contre les combats nécessités chez nous par la conquête de l’amour et du pain, les peuples de Jérôme le Fondateur passent leurs loisirs à fortifier leur âme par le savoir. Ils parlent des problèmes de science, comme les joueurs européens parlent des problèmes du baccara, des échecs, ou de l’écarté. Ils s’amusent à rivaliser de connaissances. Vous l’imaginez facilement. À la suite des orgies hebdomadaires qui lassent, dans les théâtres, leur instinct sexuel, ni les hommes ni les femmes ne combinent de rendez-vous dans l’intervalle de ces fêtes. S’ils accordent des politesses, ce n’est pas avec fièvre, mais par bonne grâce.
Vous n’entendrez personne, ici, se complaire à narrer les péripéties de ces aventures communes, comme vous n’entendez personne, en Europe, insister sur les menus de ses repas. C’est, en cette contrée de Malaisie, un peuple aux instincts rassasiés, et qui n’a plus de convoitises, sinon pour l’esprit.
Dans ma prochaine missive, je vous entretiendrai de l’éducation reçue par les enfants ; vous verrez avec quel art les institutrices et les professeurs leur donnent le goût et l’avidité de connaître le plus.
Je vous envoie mes vœux de bonheur et de santé. Votre ami.