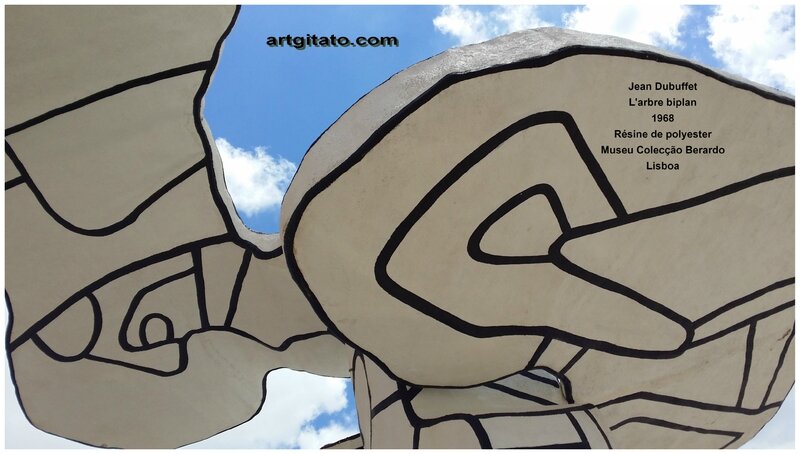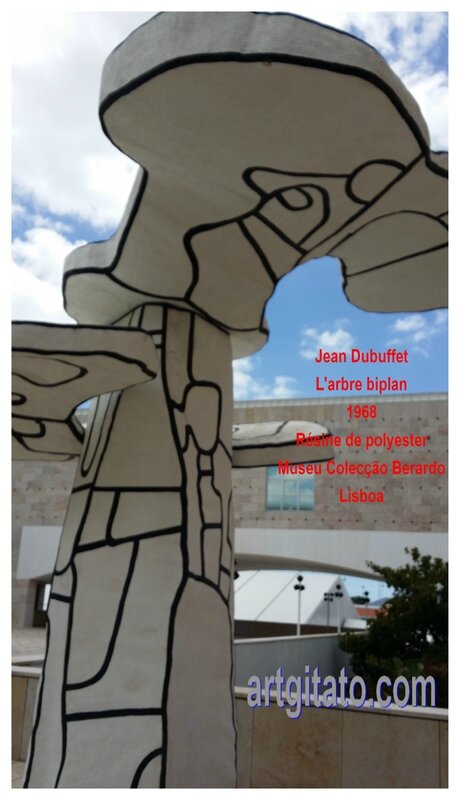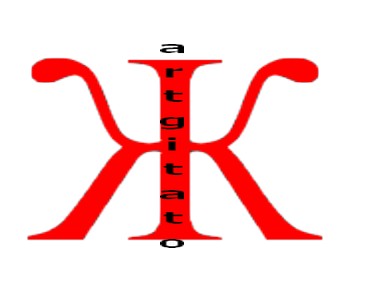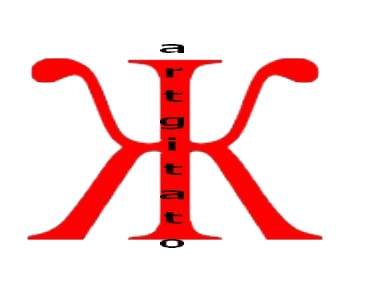Claude GORETTA
LA DENTELLIERE (1977)
La solitude au carré
LE MYSTERE DE LA SOLITUDE
Le salon de coiffure qui ouvre le film laisse la caméra filer les angles durs des corps des « vieilles rombières, des vieilles radoteuses » qui se curent, se manucurent, qui se nettoient et se noient dans les silences de la caisse. Coule la caméra. Passe la caméra comme coule l’eau sur des têtes de ces dames. Nouveaux fonts baptismaux qui relavent encore et encore le poids du monde. Mais les mots qui pourraient s’échapper se calfeutrent, s’inhibent. Le salon est silencieux du silence des mots qui chutent à l’ombre des vies oubliées. La parole est creuse. Personne ici ne se confesse. Le salon est triste, mécanique. « – Une couple, une mise en pli, une manucure. – Vous êtes précise à une minute près ! » Les gestes sont répétés, toujours identiques, chirurgicaux. Ce n’est pas l’âme que l’on répare. Les âmes se sont perdues, il y a longtemps déjà. Les corps, peut-être. A la surface.
« Il est plus d’un silence, il est plus d’une nuit, car chaque solitude a son propre mystère. » (Sully Prudhomme) Ici, nul mystère. Même pas des solitudes. La solitude. Seule. Générale. La précision a rendez-vous avec la technique, le vide, l’ennui, le néant. L’enfer n’est plus l’autre mais cet espace invraisemblablement vide et froid. L’humain n’est plus au milieu de ces êtres abimés par le rien ; il est ailleurs, peut-être. Rien ne flotte que l’ennui. Les êtres ne sont mêmes pas désespérés. Ils sont là par habitude, sans y prendre garde.
53 KG DE SOLITUDE
Béatrice, Isabelle Huppert, est pudique, timide. Elle travaille pour « mille balles par mois ». C’est « son monde ». Elle « ramasse les touffes de cheveux et tend la main pour trois francs de pourboire. » Les restes de ces restes. Par touffes.
Elle a honte de son corps et regarde avec étonnement celui de son amie, impudique et démonstrative. Cette amie de circonstance, si différente, sur le même radeau, Marylène, Florence Giorgetti, la patronne du salon, qui attend encore et toujours le prince charmant. 53 kg ! Depuis plusieurs années ! Elle est disponible. Elle attend. Jouer et faire semblant de s’en offusquer : « Il faudrait qu’on soit toujours prête avec eux ! » Mais elle n’attend que d’être prête. Sa vie s’éclaire de cette attente idéalisée. Dans l’océan, elle voit cette bouée si proche et toujours plus lointaine. Interminablement, presque du bout des doigts. Un cheval blanc et ce Prince charmant qui brille des feux de l’adultère. Le meilleur n’est pas en soi. La terre est tellement devenue aride que rien n’y pousse plus. Faire illusion, encore une fois. Tendre sa toile. Il vient de cet ailleurs que l’on ne connait pas mais auquel on croit aveuglément. De toutes les façons, quoi faire d’autre ?
Béatrice est seule, avec ce corps trop lourd pour elle, qu’elle cache. Béatrice s’ennuie, mais elle est gentille. Elle finit les plats que sa mère lui présente, en faisant bien attention à ne pas tacher son chemisier. Elle écoute son amie. Et elle attend.
QUAND LES ARBRES EUX-MÊMES CHANCELLENT
Une musique passe : « dans la forêt de notre enfance…des étoiles pleins les branches…puis des hommes sont venus…les arbres ont chancelé… » Les étoiles ont disparu et les hommes ne viennent pas. Un ciel sans lumière et sans vie. Si « la tristesse vient de la solitude du cœur » (Montesquieu), elle a dépassé ce stade. L’indifférence. Presque.
Béatrice fête sa dix-neuvième année avec sa mère et Marylène. Un gilet vert comme cadeau. « Il est vraiment très beau… » Une balade en bateau. C’est la fête ! Et le retour à sa chambre. Et de la chambre au salon. Elle attend le lendemain, où elle retrouvera Marylène et ses clientes.
Son amie se retrouve, encore une fois, « larguée au téléphone. Ça fait trois ans… J’ai perdu trois ans, comme une imbécile…Espèce de salaud, tu as bousillé ma vie…Espèce de salaud, tu veux que je crève…Pauvre con !» Et elle en crève d’être prise ou d’attendre, d’espérer ou de désespérer ? Marylène a des ennuis, alors Béatrice s’occupe d’elle. Elle n’a rien d’autre à faire.
Marylène a de la chance ; dans sa tristesse, elle vit. Des histoires glauques et médiocres. Mais des histoires quand même. S’énerver c’est se débattre. C’est se savoir en vie. Même si cette vie s’effondre. Béatrice la réconforte, sans y croire. Personne n’y croit plus. « Il va peut-être venir ! Tu veux que j’aille chercher ton ours ! » Béatrice se sent vivre aussi. Un peu.
DE CABOURG A BALBEC
Et la mer ! Les corps nus, l’infini, le désir, l’impossible, la liberté, l’horizon si loin que l’espace s’y perd. Cabourg. Seules, les deux filles sont sur la plage, même « s’il fait meilleur à Paris ». Une plage infinie, « elle va jusqu’où la plage ? » Les coquillages que l’on ramasse. Et la chambre triste. Derrière le mur, dans l’autre chambre d’à côté, un couple qui rit. Puis des ébats. Le malaise qui s’installe. Et nos deux filles qui rangent. A la radio, une publicité sur un champoing, pour changer du travail. Et les rires d’à côté qui embarrassent les filles. La chambre ne veut plus d’elles. « Tu viens ! On va prendre quelque chose de chaud. »
Cabourg. Balbec. Béatrice ou Swann. Une longue errance des sentiments introvertis. Swann analyse et décortique. Béatrice cherche sans comprendre. Elle passe. Béatrice est une anti-Swann- Pour Swann le presque-rien devenait un tout infini et complexe. Pour Béatrice, la totalité ne représente rien. Dans le grand restaurant, pas de clients. Elles se retrouvent naufragées sur le rivage normand « Ils sont où les gens ici? – Par ce temps, ils restent dans les villas ! – Et ceux qui n’ont pas de villa? … – Pour s’amuser vraiment, il faut aller jusqu’à Deauville ! C’est plutôt guindé ici, vous savez !» Elles ne font pas non plus parties des cercles fermés. Elles ne sont d’aucun cercle. En dehors. Bien décalées. Exclues, elles suivent le mouvement des vagues en parcourant la plage. Une seule vaguelette pourrait les emporter loin dans les bas-fonds des océans. Mais elles y sont déjà au fond.
Béatrice apprend à nager. Elle qui déjà, dans le quotidien, se noie, se lance dans les éléments et dans l’infini. Marylène est là qui la supporte. Mais Marylène est fascinée par son obsession des hommes jouant au ballon.
La boîte de nuit. Marylène danse quand Béatrice reste seule. Elle ne sait pas danser et elle baisse la tête. Béatrice s’agite encore, même quand la musique s’arrête. Il n’y a plus de temps à perdre. Il lui en faut un. Marylène ne voit plus Béatrice. Elle attend son homme. Malgré tout, personne ne veut d’elle. Abandonnée, elle fait sa crise sur la plage.
LE REFOULEMENT DES COEURS
Une autre boîte de nuit. Encore et encore. A la solitude proustienne qui drague la mort et le suicide, la solitude de Béatrice, dans les mains moites et en transe de Mylène, qui se saoule d’un triste divertissement. « N’ayant plus d’univers, plus de chambre, plus de corps que menacé par les ennemis qui m’entouraient, qu’envahi jusque dans les os par la fièvre, j’étais seul, j’avais envie de mourir. Alors, ma grand-mère entra ; et à l’impression de mon cœur refoulé s’ouvrirent aussitôt des espaces infinis. » (Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, II, Noms de pays : le pays) 293
Une musique plus langoureuse. Dans le slow, Marylène attrape enfin un homme dans ses filets. Le lendemain, elle est rayonnante. « – Il a demandé d’habiter chez lui ! – Tu seras mieux ! T’auras plus de place !» Il n’y a déjà plus de copine qui vaille. Son corps est ailleurs. Un autre en a pris possession. Elle vit enfin.
A la plage, le lendemain, Béatrice est seule au milieu des corps. Elle repart, mal à l’aise, dans un café. A manger des glaces, encore. « Je restai dans mon isolement comme un naufragé de qui a paru s’approcher un vaisseau, lequel a disparu ensuite sans s’être arrêté. » (Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, II, Noms de pays : le pays) Mais là, un autre, un être, un homme s’arrête. Elle ne le voit pas. Elle ne sait pas voir. Mais lui est intrigué par cette étrange créature qui ne ressemble à rien d’autre. Il vient de découvrir une nouvelle espèce. Proche de la sienne.
UN ENNUI MONUMENTAL
Le jeune homme qui s’assied à ses côtés, installe sa raquette. C’est François, Yves Beneyton, « brillantes études de lettres à Paris ». C’est le premier homme qui la remarque. Enfin. Il faut briser la glace de cet iceberg. Au chalumeau. « – Beau temps pour manger des glaces ! Vous êtes en vacances ? Vous n’allez pas à la plage ? Vous n’aimez pas ? A cette heure-ci, c’est la fourmilière. La plage, il faut y aller tôt le matin, c’est complétement vide…Je passe mes vacances dans ce trou depuis ma plus tendre enfance, hélas !… Cabourg, perle de la côte normande. Sa digue de 1800 mètres, son casino et ses jardins aux parterres admirables couverts de fleurs. Son avenue de la Mer, son grand hôtel avec sa chambre de Marcel Proust. Ses spécialités de caramel mou. Son garden tennis-Club. Son golf à dix-huit trous. Pour les moins fortunés, son golf miniature. Son cercle hippique. Son marchand de cycles. Sa poste. Sa promenade des Anglais. Son boulevard des Belges. Et puis surtout, son ennui monumental. »
LA VACANCE DE L’AMOUR
Lui aussi est seul. Riche, mais seul. Il joue au tennis contre un filet. Il se balade seul sur la plage. Et elle le cherche sur les courts de tennis. Et lui, sur la plage. Au café. Mais elle reste dans sa chambre. Et François passe le boulevard de la Mer au peigne fin, à la recherche de l’inconnue, le cœur battant. La rencontre enfin « –ça fait bien plaisir de vous revoir ! C’est vrai ! Si, si, c’est vrai ! » Ce n’est peut-être pas de l’amour mais une méconnaissance du sentiment amoureux à l’écoute de ce cœur qui depuis trop longtemps était devenu si calme. « J’étais dans une de ces périodes de la jeunesse, dépourvues d’un amour particulier, vacantes, où partout – comme un amoureux, la femme dont il est épris – on désire, on cherche, on voit la Beauté. Qu’un seul trait réel – le peu qu’on distingue d’une femme vue de loin, ou de dos – nous permette de projeter la Beauté devant nous, nous nous figurons l’avoir reconnue, notre cœur bat, nous pressons le pas, et nous resterons toujours à demi persuadés que c’était elle, pourvu que la femme ait disparu ; ce n’est que si nous pouvons la rattraper que nous comprenons notre erreur. » (Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, II, Noms de pays : le pays)
IN CASINO FORTUNA
Nos solitaires s’éloignent du monde. « – Ici, il n’y a déjà plus personne. Ils préfèrent s’entasser devant le casino – Vous n’aimez pas quand il y a du monde ? – Vous, non plus, non ? – Non, j’aime pas beaucoup !» Ils se sentent plus vivants et plus forts, ensemble.
In casino fortuna – La Chance est dans cette maison. La chance n’est pas au rendez-vous et le homard se transforme en boîte de conserve. Les corps se rapprochent. Mais ne se touchent pas. « – Vous voulez une pêche ? – Non, merci. Je ne supporte pas la peau. Ça me fait frissonner ! – Je vais vous en épluchez une ! » On pense alors à un vieux couple. « –rien que de vous voir l’éplucher, ça me donne la chair de poule ! » Mais à côté, les amants font du bruit, encore. Les corps du monde inondent la chambre dans un cri de jouissance interminable. Béatrice, mal à l’aise, met la musique. Lui préfère la musique classique. Alors elle cherche la bonne fréquence. Un livre sur les lits. Les contes de Maupassant. Elle sourit. Elle pense se rapprocher de lui. «Juste penchée au-dessus d’un désordre qui les abritait, l’oiseau s’égosillait toujours. Ils ne parlaient pas de peur de le faire fuir… » Elle ne fuira pas. Il y a trop longtemps qu’elle a perdu ses ailes et ses jambes.
ET TA VIE ? C’EST QUOI
Une route. Un cimetière américain. « Il y dix mille rien qu’ici ! Il n’y a pas que des baigneurs sur la plage ! ». Marylène retrouve son amie. « –C’est impressionnant tous ces américains. Qu’est-ce qu’ils étaient jeunes ! » Au cœur de cette jeunesse abattue en plein vol, Marylène a rencontré John, le bon, peut-être ? Elle se rassure. C’est un américain. Marylène semble étonnée que Béatrice ai pu attraper un homme, elle si prude. «- Dans le fond, vous étiez venues à Cabourg pour draguer ? – On été venues pour voir la mer ! – Tu ne l’avais jamais vu ? – Ben non ! – Tu ne connais rien, alors ! Et ta vie, alors, c’est quoi ? – Le travail, et puis la maison – Et les garçons ? – Non ! – Tu n’en as jamais eu ? – Non, jamais ! – Tu es vierge, alors ? – Oui ! – Et avec Marylène, tu n’as jamais rencontré de garçons ? – Elle n’en connaît pas beaucoup, je crois ! – Et tes parents ? Qu’est-ce qu’ils font ? – Je vis avec ma mère, elle travaille dans un magasin. – Et les gars dans la rue, dans le métro, ils ne te baratinent pas ? – Si, ils essaient. – Ben, alors ? – Ben, rien ! Ils ne m’intéressent pas. Je ne les connais pas. -Et moi ? – Toi, c’est différent. Je ne sais pas, tu es poli ! »
Dans les terres, à la campagne. On dirait un tableau de Renoir. François semble jaloux. Un type semble s’intéresser à Béatrice. C’est un peintre. Il offre les deux dessins. Elle ne sait pas lequel prendre. En voulant déchirer son portrait, elle montre ses premiers sentiments.
QUELLE GRÂCE DANS LE TRAVAIL
Dans sa chambre, elle se dénude et positionne sa robe au-dessus du lit. Le jeu de l’aveugle. De la confiance au bord du précipice. « –un quart de tour à gauche…un demi-tour à droite…Tu as peur…un petit pas…Tu peux ouvrir les yeux maintenant…tu as confiance en moi – Bien sûr. » Elle apprend à faire confiance. Elle se donne. La maison des parents. Les draps que l’on tend. Les regrets de ne pas se voir si souvent. « –viens m’aider à plier celui-là, on va voir ce que tu sais faire ! » Le drap se plie « –Quelle grâce dans le travail ! – Ne te moque pas ! » Elle a tant et tant plié, tant tendu et rangé. La grâce n’y est pour rien. Mais lui y trouve de la beauté.
FAIRE DES CHOSES INTERESSANTES
Le désir. L’envie de passer une nuit ensemble. « -si tu ne veux pas…je en veux pas que ça soit pour me faire plaisir…tu as froid. Tu veux ton châle. » Le châle que l’on pose à la nuit tombée.
La chambre. La lumière que l’on éteint. Que l’on rallume. Le désir. L’intimité. La honte. Une lumière glauque. François s’assied au bord du lit et découvre peu à peu Béatrice. Les bras s’enlacent.
La plage. Il fait froid. La visite chez la mère de Béatrice. Les petits gestes du quotidien. Les dessins de jeunesse que l’on feuillette et les photos anciennes que l’on passe.
Nouvel appartement. Nouvelle peinture. Elle a même marqué les livres qui étaient ouverts avant de les refermer pour les ranger. Ce poids devient lourd. Elle doit s’ouvrir. Elle n’est pas que ça. Il faut qu’elle fasse autres choses pour que sauver ce couple qui déjà patine. Il faut « faire des choses plus intéressantes, prendre des cours … – J’aime bien ma vie avec toi. J’apprends plein de choses. » C’est déjà plus qu’elle n’a jamais espéré. Pourquoi plus encore.
DU CARRE AU CARRE, ET TOUJOURS UN PEU PLUS DE SOLITUDE
Les amis. Les intellos. Les conceptuels. Et des mots qui enveloppent. Qui à force de vouloir dire et donner du sens politique, des mots qui restent-là sans ne plus servir à rien. On classifie, structure, range. C’est un nouveau salon de coiffure pour jeunes étudiants en mal d’affirmation. La caméra ne filme plus les corps du salon de coiffure mais les mots anguleux du salon où l’on cause et où l’on refait la vie « – Ça, c’est ta voiture, ça, c’est ta maison, ton bureau, ton lit, le métro, l’avion, l’ascenseur, le cercueil. T’es toujours dans la boîte ! Regarde ! On n’a pas l’air gai là-dedans ! T’as tout là-dedans ! Le boulot, la bouffe, la baise !…Il y a eu l’âge d’or, l’âge de fer, maintenant l’âge de la boîte. L’âge de la boîte, de la standardisation. Si t’es pas conforme, si t’as pas la dimension, que tu ne rentres pas dans la boîte, t’as qu’à crever ! Sauf la boîte, c’est pourtant évident, l’âge de la boîte est venue…
SIMPLE EFFICACE IMPARABLE
…La boîte c’est 6 cloisons et 24 angles droits, c’est simple, efficace, imparable ! C’est la solution à tous tes problèmes ! Qu’est-ce qu’y reste comme place pour la promenade, plus d’horizon. Parce que l’horizon, c’est pas droit, c’est fantaisiste. La vie, maintenant, c’est fait pour le rendement. Pas pour vivre ! Tu ne t’en rends même pas compte. Ça vient tout doucement. Un beau matin jour, tu découvres un nouveau feu rouge en bas de chez toi, une interdiction de stationner, un sens unique. Tout ça, tu te dis, c’est pour faciliter la circulation…alors tu t’arrêts au feu, tu vas dans le bon sens …la boîte se referme sur toi. »
Mais les pensées éloignent les couples et les corps. Les mondes ne se croisent pas. Se sont-ils une fois croisés ? Mais la pensée de Béatrice implose. Elle ne comprend plus. Cet espoir qui est entré dans sa vie finira par la tuer. Sèchement. La raison vacille et flanche. Le corps n’a plus d’envies. Et le temps s’est arrêté. Elle est dans la boîte. Seule.
Jacky Lavauzelle