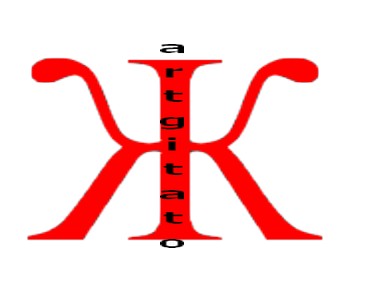
 LITTERATURE ALLEMANDE
LITTERATURE ALLEMANDE
Deutsch Literatur
Friedrich Hölderlin
1770-1843
Traduction Jacky Lavauzelle
——–
die Gedichte
Les Poèmes
Friedrich Hölderlin
An Zimmer
à Zimmer
Von einem Menschen sag ich, wenn der ist gut
D’un homme je dis, s’il est bon
Und weise, was bedarf er? Ist irgend eins
Et sage, de quoi a-t-il besoin? Que faut-il donc
*
Buonaparte
Bonaparte
Heilige Gefäße sind die Dichter,
Les poètes sont des vases sacrés,
Worin des Lebens Wein, der Geist
Où le vin de la vie, l’esprit
**
AUSSICHT
Vue
Wenn Menschen fröhlich sind, ist dieses vom Gemüte,
Quand les gens sont heureux, cela provient de l’esprit,
Und aus dem Wohlergehn, doch aus dem Felde kommet,
Et du bien-être, pourtant dans les champs
**
Der Herbst
L’Automne
Die Sagen, die der Erde sich entfernen,
Les légendes, celles qui de la Terre s’éloignent,
Vom Geiste, der gewesen ist und wiederkehret,
De l’esprit qui a été et qui est de retour,
*
Le Printemps
Der Frühling
Es kommt der neue Tag…
Es kommt der neue Tag aus fernen Höhn herunter,
Le nouveau jour descend des hauteurs lointaines,
Der Morgen, der erwacht ist aus den Dämmerungen,
Le matin qui s’est réveillé du crépuscule

*
LE PRINTEMPS
DER FRÜHLING
Wie selig ists, zu sehn…
Wie selig ists, zu sehn, wenn Stunden wieder tagen,
Quelle joie de voir, quand les heures se réunissent à nouveau,
Wo sich vergnügt der Mensch umsieht in den Gefilden,
L’homme regardant joyeusement les contrées
*
DER SOMMER
L’été
Das Erntefeld erscheint
Das Erntefeld erscheint, auf Höhen schimmert
Le champ des récoltes apparaît, scintille des hauteurs
Der hellen Wolke Pracht, indes am weiten Himmel
Dans la splendeur des nuages lumineux, dans le grand ciel,
*
DER SOMMER
L’été
Noch ist die Zeit des Jahrs zu sehn
Noch ist die Zeit des Jahrs zu sehn, und die Gefilde
L’an encore montre ses attraits, quand les rayons
Des Sommers stehn in ihrem Glanz, in ihrer Milde ;
De l’été brillent dans leur grandeur, dans une infinie douceur ;

*
Der Mensch
L’Homme
1842
Wenn aus sich lebt der Mensch und wenn sein Rest sich zeiget,
Quand homme vit en autarcie et quand son reste apparaît,
So ist’s, als wenn ein Tag sich Tagen unterscheidet,
C’est comme si un jour se différenciait des autres jours,
*
Der Neckar
Le Neckar
In deinen Tälern wachte mein Herz mir auf
Dans tes vallées, mon cœur se réveilla
Zum Leben, deine Wellen umspielten mich,
A la vie, tes vagues jouaient tout autour de moi,
*
Die Aussicht
La Perspective
If geht in die Ferne der Menschen wohnend Leben,
Si vous allez loin de la grouillante vie des hommes,
Wo Ferne in sterben Šich erglänzt Zeit der Reben sterben,
Où au loin luit la vigueur des vignes,
*
Die Kürze
La Brièveté
„Warum bist du so kurz? liebst du, wie vormals, denn
« Pourquoi es-tu si bref ? aimes-tu, comme jadis
„Nun nicht mehr den Gesang? fandst du, o Jüngling, doch
« Encore aujourd’hui, le chant ? tu te souviens, ô jeunesse, encore
*
Das Mädchen von Orleans
JEANNE D’ARC
1810
Das edle Bild der Menschheit zu verhöhnen,
Moquant la noble image de l’humanité,
Im tiefsten Staube wälzte dich der Spott,
Dans la poussière la plus infâme, la moquerie t’a roulée
*
CONVICTION
BERZEUGUNG
Als wie der Tag die Menschen hell umscheinet,
Comme le jour qui brille sur les hommes,
Und mit dem Lichte, das den Höhn entspringet,
Avec sa lumière qui vient des hauteurs,
*
RETOUR AU PAYS
Rückkehr in die Heimat
Ihr milden Lüfte! Boten Italiens!
Ô vous doux airs ! Messagers d’Italie !
Und du mit deinen Pappeln, geliebter Strom!
Et toi, avec tes peupliers, ô fleuve bien-aimé !

*
LES LUNATIQUES
Die Launischen
Hör’ ich ferne nur her, wenn ich für mich geklagt,
Dans ma plainte, J’entends d’ici
Saitenspiel und Gesang, schweigt mir das Herz doch gleich;
Le jeu des cordes et les chants ; mon cœur devient alors silencieux ;

huile sur toile, 60 × 80 cm, Orangerie, Paris
*
LE DESTIN DE L’ESPRIT
Des Geistes Werden…
Des Geistes Werden ist den Menschen nicht verborgen,
Le destin de l’esprit n’est pas caché aux hommes,
Und wie das Leben ist, das Menschen sich gefunden,
Tout comme la vie que se sont trouvés les hommes,
*
ELEGIE
Menons Klagen um Diotima
MENON ET DIOTIMA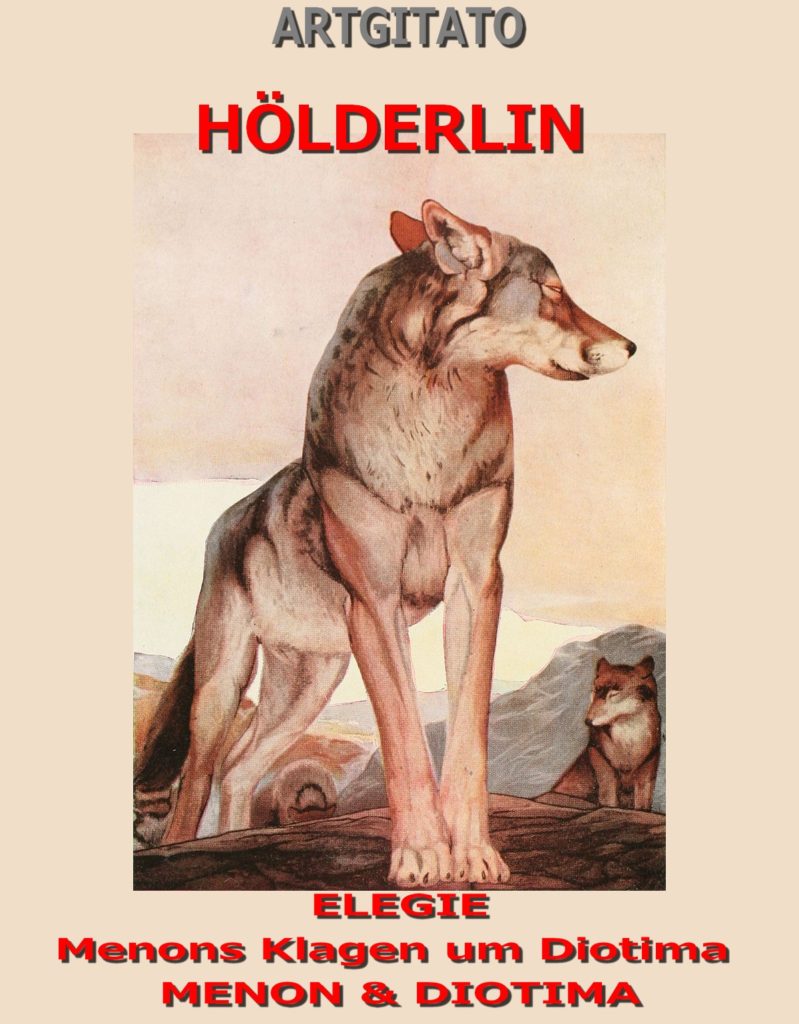
*
Empedokles
Empédocle
Das Leben suchst du, suchst, und es quillt und glänzt
La vie tu la cherches, cherche ! et s’amplifie et brille
Ein göttlich Feuer tief aus der Erde dir,
Un feu divin des profondeurs de la terre pour toi,
*
Ganymed
Ganymède
1803
Was schläfst du, Bergsohn, liegest in Unmuth, schief,
Quoi ? tu dors, fils de ce mont affalé dans la mauvaise humeur,
Und frierst am kalten Ufer, Gedultiger!
Et glacé tu reposes sur les rives froides, patient !
*
Hälfte des Lebens
Moitié de Vie
Mit gelben Birnen hänget
Suspendu avec des poires jaunes
Und voll mit wilden Rosen
Et plein de roses sauvages
*
Über Achill
Sur Achille
I
Mich freut es, daß du von Achill sprichst.
Je suis heureux que tu aies parlé d’Achille.
II
Am meisten aber lieb’ ich und bewundere den Dichter aller Dichter um des Achilles willen.
Mais l’admiration que je voue au poète des poètes me vient de l’admiration et de l’amour que je porte à Achille.
**
ANDENKEN
SOUVENIR
Der Nordost wehet,
Celui du nord-est souffle,
*******
*******
SUR HÖLDERLIN
***************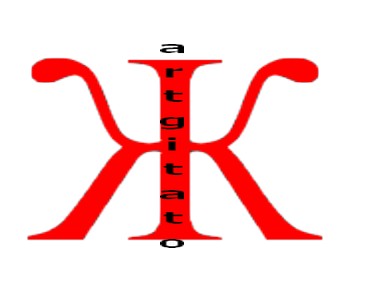 La Poésie païenne en Allemagne au XIXe siècle
La Poésie païenne en Allemagne au XIXe siècle
Frédéric Hœlderlin
P-A Challemel-Lacour
Revue des Deux Mondes T.69
15 juin 1867
…Frédéric Hœlderlin était né dans le Wurtemberg, en 1770, à Lauffen, sur les bords du Neckar. Son père, simple pasteur de campagne, était mort deux ans après sa naissance, laissant une femme et deux enfans sans fortune. Celle-ci s’était remariée, et bientôt après, devenue veuve une seconde fois, elle s’était retirée avec sa mère dans la petite ville champêtre de Nurtingen, où elle dut pourvoir, à force de privations, à l’éducation de quatre enfans mineurs. Cette éducation rustique sous la conduits de deux femmes distinguées par l’élévation des sentimens et par un tour poétique dans l’imagination, exerça sur Hoelderlin une influence décisive ; il y prit quelque chose de la délicatesse féminine. En même temps, n’ayant pas à compter avec la volonté plus ferme d’un père, il contracta l’habitude d’une indépendance ombrageuse ; l’assujettissement le plus léger lui devint une douleur. Il vagabondait avec ses frères le long des haies et des rivières, dans une contrée pleine de légendes et de souvenirs qui déjà le faisaient rêver étrangement. Dès qu’il sut épeler, il lut les poètes ; comme Goethe, il déclamait Klopstock à ses jeunes frères.
Il commença le latin dans l’école élémentaire de Nurtingen. L’amour de l’antiquité y était une tradition : c’est là qu’un des plus passionnés philhellènes du XVIe siècle, Martin Crusius, l’Hérodote de la Souabe, avait composé ses sermons en grec. Malgré quelque différence d’âge, Hœlderlin se lia dès lors avec un de ses plus jeunes camarades, que son esprit éveillé faisait recevoir parmi les grands, et qui était destiné à jouir bientôt d’une renommée précoce et à illustrer le nom de Schilling. De Nurtingen, Hœlderlin, après un examen brillant, passa au séminaire de Deukendorf, puis à celui de Maulbronn, où ceux qui voulaient embrasser l’état ecclésiastique étaient instruits gratuitement. Éloigné pour la première fois de sa famille, naturellement solitaire et sauvage, il put s’abandonner à la pente romanesque de son caractère ; il chercha une de ces amitiés idéales si chères aux étudians allemands, et qui sont pour eux l’occasion d’une correspondance intarissable. De ce même temps date aussi son premier amour, autre prétexte à correspondance. L’objet de cet amour était une gentille enfant, cousine d’un de ses amis, fille d’un fonctionnaire de Maulbronn. Il lui écrivait des lettres sans fin, lettres qu’on trouverait aujourd’hui bien naïves pour un garçon de seize ans. Les grands événemens de cet amour sont une rencontre dans un corridor ou dans le jardin de la maison ; mais, tout plein d’Ossian, qu’il lisait alors, il ne lui en coûtait pas beaucoup de s’identifier avec ces héros brumeux et de rêver les aventures de Fingal et de Malvina.
Quoiqu’il éprouvât beaucoup de répugnance à entrer dans la carrière ecclésiastique, il se rendit en 1788 à Tubingue pour y faire ses études de théologie ; mais bientôt son goût pour la littérature et la poésie l’emporta. Avec quelques jeunes gens de son âge, animés de la même passion et qui sont presque tous arrivés dans la suite à une certaine notoriété, il forma une société où l’enthousiasme était le ton habituel. D’une timidité qu’il ne parvint jamais à surmonter complètement, il n’en prit pas moins sur ses camarades un ascendant singulier. La remarquable beauté de ses traits, à travers lesquels on voyait briller le feu intérieur, exerçait un attrait irrésistible. « Lorsqu’après dîner, écrit un de ses amis de ce temps-là, il se promenait en long et en large dans la salle à manger, on eût dit un Apollon exilé, regardant la terre du haut de sa dignité et attristé d’être obligé d’entrer en contact avec elle. » Il faisait des vers comme la plupart de ses amis et se livrait en même temps avec ardeur aux études philosophiques. Il avait rencontré sur les bancs un jeune homme appelé Hegel, et peu après Schelling était venu le rejoindre à l’université en quittant Nurtingen. Souabes de naissance tous les trois, comme l’était Schiller, ils offrent tous, ainsi que lui, les traits caractéristiques et si tranchés de cette partie de la population allemande. Le caractère souabe est fait de bonhomie et de malice, de sentimentalité et de réflexion ; il cache une ardeur inextinguible sous des formes pesantes, et laisse échapper des étincelles à travers la fumée d’un langage embarrassé ; il n’a pas le persiflage prétentieux et la raideur du Berlinois par exemple, mais il a plus de grâce et trahit plus d’esprit. Il résulte de là un mélange d’abstraction et de poésie qu’on retrouverait chez tous les écrivains de ce pays, sans en excepter Hegel. Ce dernier n’était pas brillant à l’époque dont nous parlons, il ne le fut jamais ; c’était un étudiant laborieux, passant sa vie à « piocher Kant, » au reste bon compagnon, grand joueur de tarot, s’amusant volontiers et ne choisissant pas avec trop de soin ses amis. Au contraire Schelling, quoique plus jeune avait enlevé tout le monde dès son apparition : brillant, affairé, beau diseur, affirmatif, il eut bientôt un cercle d’admirateurs. Hœlderlin avait pour Hegel une amitié plus particulière ; l’identité de l’âge, l’analogie des goûts, surtout, une même passion pour l’antiquité grecque et pour les tragédies de Sophocle, les rapprochaient. Si l’on embrasse dans son entier l’œuvre philosophique d’Hegel depuis la Logique jusqu’aux leçons sur la religion et l’art, on voit que la pensée qui la domine est celle d’une division profonde introduite dans les forces morales de l’homme, du conflit entre la raison et l’imagination ou le sentiment, l’harmonie aujourd’hui détruite, Hegel croyait la trouver à un certain moment de l’hellénisme. L’unité des forces morales dans l’homme, puis la rupture qui a éclaté entre elles et qui subsiste encore, caractérisent à ses yeux les deux grandes situations de l’esprit désignées sous les noms de classique et de romantique, et forment l’idée qui préside, à ses théories sur la religion, l’histoire et l’esthétique. Or cette idée n’est pas chez Hegel une conception tardive ; elle remonte au temps de ses études universitaires, à ces études faites en commun avec Hœlderlin, à la lente contagion de l’enthousiasme de celui-ci, qui était comme une incarnation allemande de l’hellénisme ressuscité. On ne peut guère contester cette participation inattendue d’un poète à l’élaboration de la pensée hégélienne, quand on voit Hegel, plusieurs années après sa sortie de l’université, adresser à son ami Hœlderlin une hymne à Éleusis, mélancolique élégie sur l’anéantissement d’une foi plus belle que la notre et sur l’invasion d’une science superficielle et prosaïque. Des vers d’Hegel sont chose assez rare pour qu’on ne nous sache pas mauvais gré d’en citer quelques-uns :
« Ô Cérès, qui trônes en souveraine à Éleusis, — pourquoi les portes de ton sanctuaire ne peuvent-elles plus s’ouvrir devant moi ? — Ivre d’enthousiasme, je sentirais alors — le frisson sacré de ta présence, — je comprendrais tes révélations, — je saisirais le sens sublime de tes symboles, — j’entendrais les hymnes chantés à la table des dieux, — et les suprêmes arrêts de leur sagesse. »
Mais les temples de la déesse sont muets, ses fêtes abolies, ses images brisées et ensevelies dans le sol. Il reste encore des initiés, gardiens des secrets d’Éleusis, opposés, comme ils le furent dans tous les temps, à la foule profane qu’abusent des clartés superficielles et qui rabaisse à son niveau la sainteté des mystères. Ces initiés, est-il besoin de le dire ? c’est le poète, c’est le philosophe aussi sans doute. Hegel ne le nomme point, mais il n’est pas à croire, que dans cette poésie, qu’on n’eût pas attendue du plus glacé des abstracteurs de quintessence, il voulût simplement flattée son ami, et il entendait bien assurément réunir dans le même sanctuaire et honorer de la même inspiration le philosophe et le poète. Au moment où Hœlderlin et Hegel approchaient du terme de leurs études universitaires, dans cette terrible année 1793, l’Allemagne était en proie à une agitation qui soulevait à la fois tous les sentimens et toutes les idées. Le bruit de ce qui se passait au-delà du Rhin, troublant l’uniformité séculaire de la vie allemande, retentissait dans les cœurs comme l’écho grossi de quelque chose d’étrange et de colossal ; la stagnation dans laquelle les esprits languissaient sous le poids d’un despotisme toujours irritant les disposait d’autant plus à s’ouvrir à l’espérance. Poètes, philosophes et publicistes, Klopstock et Stolberg, Kant et Fichte, Forster et Gentz, tous ou presque tous, quel que fût leur âge, saluaient avec une joie unanime, comme une fête pour le genre humain, les premières scènes de la grande tragédie. Au sein du séminaire de Tubingue, plus la règle était oppressive et rétrograde, plus la vie était triste, et plus on se tournait avec ardeur vers la nouvelle aurore. Un club d’étudians s’était formé dans lequel le Contrat social et les droits de l’homme étaient une espèce de religion. On y lisait le compte-rendu des séances de l’assemblée nationale et de la convention ; les étudians faisaient des démonstrations publiques dont le sens était des plus clairs, et qui provoquèrent plus d’un conflit entre eux et les émigrés de Tubingue. Hegel, qui dans la suite n’eut jamais la parole facile, était un des orateurs ordinaires du club et passait pour un jacobin violent ; ses cahiers de cette époque sont pleins d’épigraphes héroïques et de symboles républicains. Schelling et lui faisaient partie d’une bande d’étudians qui, en 1793, à l’anniversaire de la fondation de la république française, allèrent planter un arbre de la liberté dans un pré non loin de la ville. Hœlderlin était plein des mêmes idées, et, associant en pensée son culte pour l’antiquité grecque et son admiration pour les vainqueurs républicains du 10 août, quand il se séparait de ses amis, il ne manquait jamais de leur jurer fidélité « par ceux qui étaient tombés à Marathon. »
Tandis que la révolution française communiquait à l’Europe, par l’admiration d’abord et bientôt par l’épouvante, un ébranlement si profond, une autre agitation plus secrète, d’un ordre tout intellectuel et d’une origine purement nationale, créait une Allemagne philosophique et littéraire dont la grandeur improvisée allait former un frappant contraste avec l’affaissement du vieil empire germanique. À ce moment, pour la première fois le génie allemand se reconnaissait dans celui de deux grands hommes qui associaient pour une lâche commune les facultés les plus différentes ; dans des œuvres multipliées, ils posaient les indestructibles assises d’une littérature indigène et pourtant supérieure aux diversités de religion, de gouvernement et de mœurs, d’une littérature humaine faite d’inspiration hellénique et de sentimens modernes, préparée pour servir de levier moral à un peuple ébranlé dans sa foi séculaire, pour lui offrir un centre commun et le consoler de l’oisiveté politique à laquelle il était condamné.
L’admiration de la Grèce, commune à tous les promoteurs de cette grande rénovation littéraire et qui atteint dans Hœlderlin son paroxysme, n’était pas même alors chose absolument nouvelle. C’est à ce flambeau que s’était allumé en Italie le génie de la renaissance ; le théâtre français, au XVIIe siècle, s’inspirait du même sentiment, et, quoique discréditée par les abus d’une imitation servile, la Grèce trouvait encore chez nous à la fin du XVIIIe un de ses plus gracieux interprètes, André Chénier. Cette admiration a en Allemagne toute une histoire, Wieland est le premier représentant d’un paganisme épicurien, où l’on sent la gaucherie d’un homme fraîchement émancipé de ses premières habitudes sentimentales et piétistes. Ses grâces lourdes trahissent à chaque pas les méprises d’un esprit initié à l’antiquité religieuse par les Métamorphoses d’Ovide et à la Grèce par les fadeurs de l’Anthologie. Wieland n’emprunte au génie antique qu’un seul trait, la facilité des mœurs. Un de ses disciples, auteur de romans bizarres qui respirent un enthousiasme de commande mêlé à des dissertations sociales et à des récits plus que libres, Heinse, représente déjà le dilettantisme pseudo-grec tel que nous pouvons l’observer autour de nous. Il y a un amour de l’antiquité plus sincère et plus contagieux dans les traductions en vers de l’Odyssée et de l’Iliade et dans les Lettres mythologiques de Voss. Grâce aux travaux d’une philologie attentive et moins verbale, le génie grec se dégageait des chefs-d’œuvre littéraires dans toute sa pureté ; l’Introduction à l’étude de l’antique de Heyne, le savant professeur d’Iéna, imprimait aux recherches de cette nature une impulsion énergique, et suggérait quelques années après à Guillaume de Humboldt l’idée d’un livre qui eût été le tableau complet de la civilisation hellénique. L’admiration partielle d’autrefois avait fait place à l’examen plus large de tout ce qui composait la société antique, de sa religion et de ses institutions, principes de ses arts. On en était venu à ne plus séparer ces chefs-d’œuvre des idées morales ou sociales dont ils étaient l’expression, et, à force de proclamer la supériorité des uns, on se vit amené à rendre aux autres une justice qu’on leur avait trop longtemps refusée. Goethe et Schiller ne craignirent pas de se faire les promoteurs de cette réparation, et, au scandale de la foule étonnée comme aux applaudissemens des initiés, ils en déposèrent dans la Fiancée de Corinthe et dans les Dieux de la Grèce le magnifique témoignage. On conçoit ce que cette humiliante comparaison sans cesse renouvelée entre la civilisation de la Grèce et la civilisation moderne telle qu’elle apparaissait en Allemagne, dans une nation dispersée et muette, en face d’une religion déclinante et pourtant oppressive, avec une littérature sans action et comme exilée au milieu de la torpeur et de l’ignorance générales, on conçoit ce que les tentatives de la révolution française, celles de la philosophie et celles de la poésie, se rencontrant par un concert imprévu pour clore un âge de l’humanité et ouvrir à la pensée une nouvelle ère, devaient produire d’exaltation dans la jeunesse des universités, allumer d’espérances, fomenter d’orgueils maladifs, suggérer de beaux rêves. On le comprend mieux encore en lisant une œuvre d’Hœlderlin longtemps élaborée en silence, mais achevée dès cette époque, son roman d’Hypérion, dont nous essaierons bientôt de donner une idée.
Au sortir de l’université, Hœlderlin, riche de connaissances variées et d’un talent déjà mûr, semblait en droit d’espérer une carrière facile ; mais il avait le malheur, assez ordinaire et toujours funeste aux organisations idéalistes, d’entrer dans le monde sans s’être arrêté à une profession déterminée, qui, en calmant les inquiétudes d’une intelligence trop ardente, eût fixé ses irrésolutions et l’eût armé par la perspective d’un avenir contre les mauvaises chances du présent. On le voit au contraire pendant ces premières années sans cesse agité par ses chimères et son indécision. Il accepte d’abord une place de précepteur dans la maison de Mme Charlotte de Kalb, la noble amie de Schiller. Découragé au bout d’un an du peu de succès de ses soins, entraîné par un impérieux besoin d’études moins solitaires, il renonce à cette place, et va s’établir à Iéna pour être à portée des leçons de Fichte, et surtout dans l’espoir que les ressources de l’enseignement particulier lui suffiraient pour le moment. L’expérience l’ayant bientôt détrompé, il avait repris cette délicate position de précepteur dans une famille de Francfort, où il avait à faire l’éducation de deux jeunes enfans. Leur mère était une femme aussi distinguée par l’intelligence que séduisante par sa douceur et sa grâce ; elle ne tarda pas à faire sur l’esprit du jeune précepteur une impression profonde. Devenue sans le savoir l’objet de son culte secret, l’inspiratrice de sa pensée, célébrée sous le nom platonicien de Diotime dans des poésies brûlantes et dans le roman toujours caressé d’Hypérion, elle ne put toutefois ignorer longtemps la passion qu’elle avait allumée, et commit l’imprudence de ne pas décourager assez tôt cet amour, d’autant plus dangereux qu’il ne demandait rien et s’enveloppait naïvement des apparences du plus pur enthousiasme. Il semblerait que les premiers effets de ce sentiment dans une âme jusque-là si agitée furent d’y répandre une paix inconnue. Hœlderlin se livre dès lors, avec une suite et une vivacité qu’on prendrait pour l’indice d’une tranquillité profonde, non-seulement à la poésie, mais aux études les plus ardues et les plus réfrigérantes, les mathématiques, la botanique, le droit. L’avenir se présentait à lui sous un aspect agréable. Toujours en correspondance avec son ami Hegel, qui se trouvait alors relégué à Berne comme en exil, Hœlderlin lui avait découvert à Francfort une éducation à faire, et il l’avait décidé sans peine à s’en charger. Il allait pouvoir renouer ces entretiens philosophiques qui n’avaient jamais entièrement cessé, même de loin, et en effet, au commencement de l’année 1797, Hegel était à Francfort et traçait, sans doute avec le concours et les encouragemens de son ami, les premiers linéamens de son système. Mille occasions leur procuraient la visite des anciens camarades de Tubingue et leur servaient de prétexte pour rattacher au présent les souvenirs encore frais de la vie d’étudiant. Goethe, alors à l’apogée de sa gloire, étant venu à Francfort, Hœlderlin se décida, non sans effort, à lui rendre visite. « Hier, écrit Goethe à Schiller, Hœlderlin est venu chez moi. Il a l’air un peu abattu et malade ; mais il est réellement aimable. Il est discret, timide même, et pourtant ouvert. Il s’est expliqué sur différens sujets dans des termes où j’ai reconnu un de vos disciples ; il s’est parfaitement assimilé quelques-unes de vos idées, et il peut avancer encore. Il ferait bien, je pense, de s’essayer à de petits poèmes sur des sujets humains ; il m’a paru avoir un goût pour le moyen âge que je n’ai pu encourager. » Quelque temps après, Hœlderlin publiait la première partie de son roman. Sa vie paraissait calme au dehors ; déjà pourtant elle était troublée par le plus douloureux des orages. On devine facilement que l’espérance de s’arrêter toujours à la limite des douceurs permises avait été trompée, et que l’amour était devenu promptement une source de joies amères pour deux êtres honnêtes assiégés par le remords et la terreur. Ils comprirent que cette liaison, si elle se prolongeait, ne pouvait avoir qu’une issue fatale, et qu’une séparation était nécessaire. Ils eurent le courage de s’y résigner. Après quelles luttes et quelles résistances, les traces incomplètes qu’on en a recueillies ne le disent qu’à demi ; mais Hœlderlin en sortit brisé.
Le déchirement ne se fit pas sentir immédiatement. Au contraire Hœlderlin travaille avec une énergie qui pourrait donner le change et faire croire à sa guérison ; de cette époque datent ses compositions les plus importantes. Cependant les débris d’une correspondance dont la plus grande partie est perdue trahissent la douleur qui subsistait dans ces deux cœurs dévastés. « Je voudrais rêver sans cesse, écrit Diotime, et pourtant rêver est s’anéantir, et s’anéantir est lâcheté… » Il lui échappe ailleurs ce cri amer contre quelque intervention inconnue, qui avait contribué à les séparer : « Il est bien facile aux hommes de laisser en paix ce dont en réalité ils ne se soucient point ; mais, ce qui mérite leur envie, voilà ce qu’ils aiment à troubler et à détruire. » Il ne reste rien des réponses d’Hœlderlin ; mais des poésies où le désespoir coule en torrens avec l’enthousiasme attestent assez qu’il n’était pas plus heureux. Dans des strophes tracées d’une main fiévreuse sur l’enveloppe d’une lettre qui lui était adressée par Diotime, il s’écrie :
« Oublie-moi, oublie-moi, renonce, toi aussi, — cœur bien-aimé, à sauver mon nom du néant. — Garde-toi pourtant de rougir — de ce que tu daignas m’aimer. »
Il ne faut pas croire au surplus que dans ce travail forcené Hœlderlin ne cherchât qu’un divertissement matériel à sa douleur ; meurtri par la réalité, il la fuit et se plonge éperdu dans le monde éternellement regretté de l’hellénisme. Tout ce qu’il fait se rapporte à cet ordre de pensées. Il commence une tragédie d’Agis, où il représentait, jetant son dernier éclat, la liberté lacédémonienne près d’expirer. Il continue son grand drame d’Empédocle, il compose nombre de poésies, ses plus belles assurément, où, s’efforçant d’une aile infatigable à monter toujours plus haut, il ne s’arrête que lorsqu’il touche aux confins du vertige. Il médite le projet de fonder un recueil périodique qui se serait appelé Hébé ou bien encore le Banquet ; tout témoigne du parti-pris de se réfugier, de s’enfermer à jamais dans la Grèce antique comme dans un monde de beauté, de liberté, d’activité héroïque et féconde, devant lequel tout le présent pâlit. Déjà pourtant les ravages du mal étaient visibles sur ses traits vieillis avant l’âge. Il courait de projet en projet, de lieu en lieu, sans se fixer nulle part, avec l’agitation d’une âme acharnée à se fuir elle-même. Il accompagne au congrès de Rastadt son ami le plus dévoué, Sinclair, un homme distingué qui était à la fois soldat, diplomate, poète, et dont la mort étrange fut plus tard un des incidens du congrès de Vienne. Il s’établit pendant quelques mois en Suisse, où on lui avait procuré une position ; il revient bientôt dans sa ville natale, et au bout de peu de temps il accepte de nouveau la place de précepteur chez le consul de Hambourg à Bordeaux.
Ce fut sa dernière tentative pour se rattacher à la vie. En se rendant à Bordeaux, il s’était arrêté à Paris, où la collection des antiques l’avait rempli d’enthousiasme ; le spectacle de la vie méridionale, qui lui offrait une lointaine image de la vie grecque, la clémence d’un ciel plus doux que le ciel natal, l’avaient d’abord charmé. On pouvait le croire heureux, quand ses lettres à sa famille et à ses amis cessèrent tout à coup. Plusieurs mois s’étaient écoulés sans qu’on eût de lui aucune nouvelle, lorsqu’un jour d’été il apparut chez sa mère à l’improviste, la tête nue, couvert de haillons, les yeux hagards et les cheveux en désordre, dans un état d’exaltation indescriptible. Que s’était-il passé ? On ne l’a jamais su, car dans les rapides intervalles de raison qui lui revinrent de loin en loin il garda toujours un profond silence sur deux choses, son séjour à Francfort et son voyage en France. On parvint seulement à savoir qu’il était parti de Bordeaux sans rien dire, et qu’il avait traversé la France, presque d’un bout à l’autre en quelques jours, seul, sans argent, au milieu des chaleurs du mois de juillet. Il semble avoir été dépouillé en route. Il avait passé par Stuttgart, s’était présenté à la porte de son ami Matthisson, avait prononcé un seul mot : « Hœlderlin, » puis avait aussitôt disparu. Diotime était morte au mois de juin, victime, comme l’héroïne de Rousseau, de son dévouement maternel. Cette nouvelle était-elle parvenue à Hœlderlin et avait-elle achevé la ruine d’une intelligence déjà ébranlée ?
Il eut dans le commencement des retours de raison assez fréquens pour donner l’espérance de le sauver. Quand il était en proie à ses accès les plus violens, une lecture d’Homère faite à haute voix suffisait souvent à le calmer, comme si elle lui eût apporté l’écho d’un autre monde ; Il lisait Pindare durant des journées entières, et il traduisit quelques pièces de Sophocle, imprimées plus tard à Francfort et dédiées à la princesse de Hombourg. Il composait même des poésies qui existent, où des pensées sublimes se perdent tout à coup dans de profondes ténèbres, comme un fleuve magnifique qui s’engloutit sous terre. On se flatta qu’il pourrait remplir une place de bibliothécaire ; il en eut le titre, dont il se montra heureux jusqu’à la fin de sa vie. La vue de la nature paraissant lui faire du bien, on voulut le placer à la campagne chez un pasteur ; mais il manifesta une crainte si vive qu’on ne songeât à l’engager malgré lui dans la carrière ecclésiastique, qu’il fallut l’établir ailleurs. Peu à peu les lueurs devinrent plus rares, et en 1805, les ténèbres enveloppèrent pour jamais une des imaginations les plus gracieuses et les plus hautes qu’ait eues l’Allemagne.
Il vécut ainsi pendant quarante ans, semblable à une ombre inoffensive. Établi à Tubingue dans la maison d’un ébéniste, il faisait souvent de la musique, jouait du clavecin ou de la flûte, répétant sans se lasser pendant de longues heures quelque thème simple et mélancolique, sur lequel il se livrait à d’interminables variations. D’étranges échos des événemens passés ou des amitiés d’autrefois, surtout de cette passion pour la Grèce qui avait été pour ainsi dire tout son génie, semblaient résonner en lui de loin en loin. Un jour qu’il revenait de cueillir des prunes dans le jardin de l’ébéniste, il rencontra sur la route le professeur Conz, son ancien camarade, qui lui souhaita le bonjour en l’appelant « monsieur le licencié. » Comme ce titre avait fâché Hœlderlin, Conz, tirant un livre de sa poche, le lui montra ; c’était un Homère. « Vous voyez, lui dit-il, j’ai toujours avec moi notre vieil ami. » Hœlderlin prit le livre, y chercha vivement un passage qu’il se fit lire et qu’il parut écouter avec ravissement ; deux jours après, il eut un de ses plus violens accès. Une autre fois, ayant trouvé dans l’atelier de l’ébéniste le dessin d’un temple grec, il demanda au patron de lui en faire un en bois. « Je travaille pour gagner mon pain, dit l’ébéniste ; je n’ai, pas le bonheur de vivre à rien faire, en philosophe, comme M. Hœlderlin. » — « Ah ! Hœlderlin, dit celui-ci, est pourtant un pauvre homme. » Et, prenant un crayon, il traça sur une planche un quatrain qui disait :
Les lignes de la vie sont différentes, — comme les sentiers sur la terre et les contours des monts ; — ce que nous sommes ici-bas, un Dieu l’achève ailleurs, — Il y met l’harmonie et l’éternelle paix.
Lors de la guerre de l’indépendance en Grèce, il commença par s’y intéresser beaucoup, et manifesta une joie très vive quand il apprit que les Grecs étaient maîtres de la Morée ; puis peu à peu il retomba dans son indifférence. Souvent silencieux, le regard tourné en dedans, on eût dit qu’il suivait quelque rêve intérieur ; il laissait échapper, comme en se parlant à lui-même, des mots toujours magnifiques, qui exprimaient des idées sans lien, brillantes et vagues comme des nébuleuses. Il se rappelait ses amis les plus illustres, Schiller, Heinse, Schelling, et un jour que le nom de Hegel était prononcé devant lui, il dit qu’il l’avait beaucoup connu, et on l’entendit murmurer longtemps entre ses dents des paroles où revint plus d’une fois le mot d’absolu. Le 29 mars 1843, anniversaire de sa naissance, L. Uhland lui envoya un bouquet, attention dont il parut, selon son expression, fou de joie.
Il serait bien inutile assurément de chercher une cause singulière à la folie de Hœlderlin. Combien en est-il parmi ces poètes, surtout en Allemagne et en Angleterre, combien en pourrait-on nommer de ces intelligences qui se sont ainsi consumées en un moment dans leur propre flamme ! Il suffit de dire que la nature l’avait formé de cette molle argile qu’elle semble réserver pour ses essences les plus précieuses, qu’elle en avait fait une de ces exquises et frêles organisations que tout ébranle à l’excès, le bien comme le mal. Ses malheurs ne sont point d’une espèce bien extraordinaire ni qui dépasse les forces humaines ; et les compensations ne lui ont pas manqué. Ce qu’il faut cependant remarquer, c’est que le plus réel de ses malheurs fut peut-être celui qu’il s’était forgé lui-même, et qui peut paraître le plus inconcevable. Tourmenté d’un vague besoin d’héroïsme et condamné à vivre dans un temps de servitude et d’inaction, il s’était attaché au rêve, d’une république idéale, dont il salua l’ombre avec ardeur quand elle lui apparut en France, et qu’il alla chercher ensuite dans la Grèce ancienne. Là seulement, sur cette terre sacrée où il voit s’épanouir entrelacés le beau et le divin, il trouve de quoi satisfaire ses besoins philosophiques, ses aspirations morales, son amour de l’art. Au lieu d’une admiration mesurée, il s’abandonne à des regrets maladifs qui le désenchantent du monde actuel et lui en dérobent les ressources. Il y a en lui comme le sentiment d’une énergie captive, que l’obstacle invisible surexcite jusqu’au délire, qui rugit et tournoie dans sa cage jusqu’à ce qu’elle la brise. De là dans sa vie ce long malaise qui troubla par degrés l’équilibre de ses facultés, et dont la folie ne fut que le dernier terme.
Dans cet éparpillement des activités et des fonctions humaines qui caractérise éminemment la société moderne, il n’y a pas d’opposition plus forte que celle qui coupe pour ainsi dire la pensée en deux, et qui met d’un côté les hommes d’imagination, de l’autre les hommes de réflexion. La poésie philosophique où ces deux facultés s’amusent étroitement n’est pas inconnue en France : les Méditations et les Harmonies de Lamartine, beaucoup de poésies de Victor Hugo depuis les Feuilles d’automne jusqu’aux Contemplations, quelques-unes des pièces les plus célèbres d’Alfred de Musset, offrent de beaux exemples de cette poésie qui roule sur le grand mystère des choses. On verra cependant, si l’on y regarde de près, que ce qu’elles contiennent de philosophie ne procède pas d’une pensée qui se soit d’abord rendu d’elle-même un compte sévère, et qui soit en état de résister à l’examen de ceux qui cherchent avant tout la vérité. Aussi n’avons-nous rien d’analogue à ces poésies de Schiller qui ont pour titre la Promenade, les Artistes, la Cloche, rien qui ressemble à cette combinaison de philosophie et de lyrisme qu’on peut passer à la coupelle de la plus exacte analyse. Une telle combinaison est souvent laborieuse, l’idée et le sentiment atteignent rarement et n’atteignent jamais sans effort ce point où ils coïncident et se fondent dans l’expression poétique ; il faut pour y arriver une pensée puissante avec la vigueur d’une imagination toujours maîtresse d’elle-même.
Hœlderlin ne se crut pas incapable de cet effort où le génie de Schiller avait failli s’épuiser. On a vu la curiosité philosophique et la poésie marcher constamment chez lui du même pas. Peut-être n’est-ce qu’en Allemagne que se puisse rencontrer au même degré cette intime union de la réflexion abstraite avec l’enthousiasme lyrique. Goethe, si bon juge qu’il fût, se méprenait assurément sur la nature du talent d’Hœlderlin en lui conseillant de l’appliquer à des sujets empruntés à la vie réelle ; il se méprenait, dis-je, à moins qu’avec sa pénétration de froid observateur et sa profonde sagesse pratique il n’eût vu en lui un esprit en péril prêt à se perdre dans l’abîme tumultueux de ses rêves. Il est certain que le génie d’Hœlderlin était impérieusement lyrique. Il ne cherchait pas même un point d’appui dans les accidens de la vie ordinaire ; la pensée, la philosophie, les souvenirs antiques, les sciences même, telles que l’astronomie et la botanique, c’est à cela qu’il demandait de soutenir son essor. Sa poésie s’élance d’un jet à des hauteurs souvent sublimes, mais elle s’élance du fond de son âme et en épuise la sève, montant toujours jusqu’à ce que sa tête, épanouie dans le ciel, trop pesante pour la frêle tige qui la porte, s’incline et retombe.
Le roman d’Hypérion est une œuvre essentiellement lyrique. Il appartient à la grande famille moderne d’Obermann, de Jacopo Ortis et de Lélia, à cette classe de romans où l’action, sans être nulle, est tout intérieure et se réduit presque à un douloureux dialogue entre le héros et cet autre mystérieux personnage qui s’appelle le destin ou la nature des choses, à une lutte solitaire de la pensée livrée au doute contre les énigmes de la société et de la vie. La forme fragmentaire et personnelle de tous ces romans manifeste, à ne point s’y méprendre, le caractère qui leur est commun. On les a plus d’une fois considérés comme procédant de Werther en ligne directe ; on ne s’est pas assez souvenu qu’entre cet ouvrage et ceux dont nous parlons il y a l’abîme d’une révolution. Qu’on ne s’arrête pas en effet aux analogies extérieures, et l’on découvre aussitôt la différence qui sépare le héros de Goethe de ceux qu’on rattache à lui. Nature ombrageuse et contemplative, Werther, fatigué avant de connaître l’action et même de la soupçonner, se plaint de la destinée sans avoir contre elle de grief positif à élever. Vingt-cinq ou trente ans plus tard, quelle différence ! et si les héros de Hœlderlin, de Senancour et d’Ugo Foscolo se montrent comme Werther enclins au découragement, combien ce découragement est plus justifié ! Ils viennent d’assister au cataclysme d’un monde ; la plus colossale entreprise que l’orgueil humain pût rêver à échoué sous leurs yeux ; la société s’est entr’ouverte, et une lueur sinistre en a éclairé les profondeurs, montrant aux regards les maux qui la travaillent, les problèmes qui la tourmentent, les contradictions qui la rongent ; la mince pellicule qui sépare la réalité du néant a été crevée, et la stérilité des volontés humaines est apparue dans tout son jour. L’action que Werther n’a point connue, Obermann, Jacopo Ortis et Hypérion ont pu y prendre part, et l’action les a déçus. Après une lutte de géans, ils ont vu toute société dissoute, l’individu laissé à son isolement, à sa faiblesse, au sentiment amer de ses efforts avortés. L’échec de la révolution, tel qu’on pouvait se l’imaginer au commencement de ce siècle, n’était pas seulement la condamnation du monde par la philosophie, il était la condamnation de la philosophie elle-même, l’arrêt porté contre la pensée et la volonté de l’homme, également convaincues d’impuissance. On conçoit les lamentations de ces grands désabusés, leur amertume, leurs ressentimens contre l’action, leur ardeur à se jeter dans le sein de la nature paisible et muette. Du reste le monde nouveau qui leur a manqué et à la recherche duquel ils se sont perdus est parfois assez indistinct. Jacopo Ortis est moins vague à cet égard que ne l’est Obermann ; mais Hypérion, malgré la poésie des sentimens et du style, les dépasse l’un et l’autre en précision : rien de plus nettement déterminé que l’idéal au nom duquel il rompt avec le monde actuel. S’il commence et finit par le découragement, ce n’est point chez lui langueur incurable d’une organisation qui n’aurait pu vivre dans aucune condition. Nous savons à merveille quelle société lui aurait convenu ; Hypérion n’est qu’un Grec dépaysé, atteint de la nostalgie du paganisme.
Cette différence en a produit une essentielle dans la conception du roman. Dans Jacopo Ortis comme dans Obermann, le romancier et son héros sont contemporains et compatriotes, ce qui a permis de ne voir sous le nom de celui-ci que les sentimens et l’histoire de celui-là. Pour rendre naturel ce singulier amour de la Grèce républicaine, Hœlderlin a dû le confondre avec le sentiment patriotique, et il a choisi pour héros non point un Allemand, mais un Grec. Tout se passe dans des localités dont les noms immortels évoquent à chaque pas les souvenirs de l’héroïsme antique, parmi des ruines si vivantes qu’elles semblent abriter un monde de demi-dieux assoupis, prêts à se lever au premier appel. Nous sommes transportés vers l’année 1770, à l’époque où la grande Catherine, avide de couvrir de quelque gloire le crime de son avènement, excitée par les jeunes favoris qu’amène ce nouveau règne, s’aidant des manœuvres du Thessalien Gregori Papapoulo, met à profit les mécontentemens des Grecs et fait briller à leurs yeux l’espoir d’une prochaine délivrance. C’est le temps de cette insurrection ensanglantée par des massacres, — glorifiée par quelques beaux faits d’armes, souillée par des crimes, qui eut pour dénoûment la retraite précipitée des Russes et la dévastation de la Morée, livrée aux Albanais. Hypérion est un des insurgés. Initié dès l’enfance aux héroïques traditions de la Grèce ancienne, il a jugé de bonne heure à cette lumière le monde et la vie modernes. De cette comparaison est né en son âme un désenchantement précoce, qui assombrit tout à ses yeux, et il a contracté, à force de se replier sur lui-même, une disposition à se préoccuper des mystères de l’existence qui est moins peut-être d’un fils des pallikares du XVIIIe siècle que d’un Allemand du XIXe. Tandis qu’il promène de lieu en lieu son inquiétude, se nourrissant partout des souvenirs fabuleux, il rencontre dans une course sur les côtes de l’Asie-Mineure un homme, Alabanda, vers qui l’entraînent d’irrésistibles sympathies. Beau, mûri par les épreuves, savant dans les choses de la vie, cet homme bientôt le captive en se montrant à lui tourmenté des mêmes désirs et des mêmes pensées, épris du même amour pour la grandeur morale, dévoré des mêmes souffrances à la vue de la patrie asservie. Ils se jurent solennellement une amitié sans réserve, à la manière antique. Déjà ils sont devenus inséparables, lorsqu’un jour Hypérion rencontre chez Alabanda des hommes que celui-ci lui présente comme ses amis ; leur air mystérieux, leurs discours empreints d’une ironie glaciale, faite pour flétrir la foi dans le cœur d’Hypérion, alarment son amitié ; il interroge Alabanda, qui élude ses questions ou n’y répond que par des moqueries légères, puis par un silence injurieux. Cette réserve, qu’Hypérion prend pour une indigne défiance, amène une rupture, et les deux amis se séparent en échangeant pour adieux des paroles de colère et de dédain : déception cruelle, qui allait plonger Hypérion dans une incurable mélancolie, si dans l’île de Kalaurée il n’eût rencontré Diotime. Diotime est la sérénité, la beauté, la grâce, elle est aussi la pudeur et l’enthousiasme ; aux séductions de la Vénus Anadyomène elle unit la majesté sainte de la Panagia. Ils s’aiment bientôt d’un amour où l’intelligence a autant de part que le cœur, et dans cet amour de la beauté, unique débris échappé au naufrage de la vie antique, Hypérion retrouve le calme et le bonheur. Tout à coup il reçoit d’Alabanda, enrôlé depuis longtemps dans une société qui lui faisait du secret une loi inviolable, la nouvelle que l’heure du réveil va sonner, que la délivrance se prépare ; le moment est venu pour ceux dont le cœur palpite encore, de paraître et d’agir. Hypérion n’hésite pas, il obéit sans réplique à cette sommation de l’amitié retrouvée, il s’arrache aux enchantemens de Kalaurée, aux entretiens de Diotime, et bientôt dans les champs de la Morée il combat contre les barbares. Après l’horrible prise de Misitra, désespéré de voir la sainte cause de la patrie souillée par les excès de ceux qui la soutiennent, il prend la résolution de se faire tuer dans le prochain combat. Il n’est que blessé, et, rappelé à la vie par le dévouement d’Alabanda, il est sur le point d’aller rejoindre Diotime, lorsqu’il apprend qu’elle a succombé à sa douleur. Sans patrie et sans amour, il embrasse l’exil et va cacher son désespoir parmi les nations du nord.
Dans ce livre, éclatant de couleurs et plein de juvéniles élans, où des pensées profondes apparaissent à travers la transparence cristalline et les nuances irisées d’un style ravissant, on voit se croiser les inspirations les plus contraires, l’idéalisme de Jean-Paul et la tension surhumaine des héros de Plutarque. Hœlderlin a entassé dans cette encyclopédie sentimentale, pêle-mêle avec les passions qu’il a connues ou rêvées, ses interprétations de la nature, sa philosophie de la vie universelle et de l’histoire, ses visions d’une fraternité cosmopolite, par-dessus tout son admiration pour l’hellénisme. Si son âme est pénétrée de toutes les aspirations modernes, la simplicité de ressorts et l’énergie active de l’âme antique n’en est pas moins l’objet de ses regrets ; son langage a souvent le ton d’une diatribe contre le monde actuel, mais il respire toujours le culte d’une vie plus complète, que la Grèce a connue. La grande douleur d’Hypérion est de vivre avec sa foi dans un monde en proie à un scepticisme latent, et qui ne comprend plus rien à tout ce qui est héroïque. « De grandes actions, s’écrie quelque part un des personnages, racontées à un peuple sans noblesse, c’est un coup frappé sur le crâne desséché d’un squelette, et de grandes paroles, quand elles n’ont pas d’écho dans de grands cœurs, sont comme la feuille morte qui se traîne en bruissant sur la fange du chemin. »
En face de ce monde incroyant, où les accens de l’âme inspirée s’éteignent sans écho, où il n’y a place que pour l’action réglée et machinale, Hœlderlin voit surgir dans sa pensée la société grecque, prompte à l’admiration, sensible au beau, ouvrant ses temples aux grands noms, dans laquelle toute action retentit en poèmes, se fixe à jamais dans le marbre, s’embellit d’un reflet immortel dans les œuvres de l’art, a la beauté pour inspiratrice et pour récompense. Il y a là, selon Hœlderlin, un principe de vie qui a donné chez les Grecs son fruit le plus parfait et ne nous a été transmis qu’épuisé pour toujours. De là mille aperçus pleins de hardiesse sur l’histoire, sur les institutions sociales, sur la nature humaine. Il ne serait pas impossible d’en dégager avec un degré suffisant de netteté la pensée génératrice de la première philosophie de Schelling, celle d’un principe qui se développe à la fois dans la nature et dans la pensée, et qu’on ne saisit dans sa plénitude qu’en l’élevant au-dessus de ces deux aspects partiels de son développement. On y trouverait aussi, rencontre non moins curieuse, les idées élémentaires que Hegel a déroulées plus tard dans l’Esthétique, la Philosophie de la religion et la Philosophie de l’histoire. Un soir, en face des ruines d’Athènes baignées dans les lueurs du couchant, Hypérion ranime pour un instant le peuple athénien, interprète privilégié de l’harmonie éternelle, et il traduit le principe qui a engendré ses arts et sa religion dans ces pensées d’une forme presque sibylline :
« Le premier-né de la beauté est l’art ; dans l’art, l’homme se rajeunit et se reflète : il veut se sentir lui-même, et, c’est pourquoi il pose en face de lui sa propre beauté. C’est ainsi qu’il s’est donné des dieux, car au commencement l’homme et les dieux étaient un, puisque déjà, quoique inconnue à elle-même, la beauté éternelle existait. — Je profère des mystères, mais ils sont. — La seconde fille de la beauté est la religion, car l’amour de la beauté est religion. Le sage aime en elle-même la beauté infinie, universelle ; le peuple aime les enfans de la beauté, les dieux, qui lui apparaissent dans leurs formes variées. Sans cet amour de la beauté, sans cette religion, tout état est un squelette inanimé, toute pensée, toute action est un arbre découronné, une colonne dont le chapiteau est tombé. » Pour combler le vide fait par l’absence des dieux en exil, pour animer la nature, pour remplacer l’art chassé de la vie, pour tenir lieu de patrie, l’homme n’a plus que l’amour, ressource précaire qui lui manque souvent et qui le trahit de bonne heure. Les promesses de l’amour ne suffisent pas à consoler le désespoir d’Hypérion, désespoir réel, désespoir d’un homme entraîné par le torrent des siècles loin d’une Ithaque à jamais regrettée, vers laquelle il tend vainement les bras et qui se perd dans la brume. Ce désespoir longtemps contenu finit par s’exhaler en colères violentes ; le masque tombe et le poète apparaît à la place du héros, quand les hasards de l’exil amènent celui-ci chez les Allemands. Qu’on se figure l’Allemagne de 1798, d’autant plus humiliée de son abaissement réel que déjà les esprits s’y sont élevés plus haut, inerte et divisée, tandis que l’agitation héroïque de ses voisins ébranle le monde ; qu’on se la figure coupée en petites souverainetés où l’oppression est à la fois accablante et ridicule, où un horizon infranchissable borne les regards, où les hommes sont séparés par les mille barrières du rang, de la profession, de la culture. On comprendra qu’à côté de la sérénité d’un Goethe il y eût place alors pour des sentimens comme ceux qui poussèrent le noble G. Forster à renier sa patrie et à adopter la France. On concevra qu’Hypérion, obligé de se consoler dans la société d’un tel peuple, laisse échapper un cri comme celui-ci :
« Barbares dès l’origine, devenus plus barbares à force d’étude, de science et même de religion, profondément incapables d’un sentiment divin, perdus jusqu’au cœur pour les Grâces sacrées, également blessans pour toute âme bien faite par l’emphase et par la pauvreté, rendant un son aussi faux et aussi sourd que les têts d’un vase brisé, — tels étaient ces consolateurs.
« Cette parole est dure, elle m’échappe parce qu’elle est vraie ; je ne saurais imaginer de peuple plus mutilé que les Allemands. Tu vois chez eux des artisans, mais point d’hommes ; des prêtres, mais point d’hommes ; des maîtres et des valets, de jeunes fous et des gens posés, mais point d’hommes. — N’est-ce pas comme un champ de bataille où gisent, épars et séparés l’un de l’autre, des mains, des bras, des membres, tandis que le sang de la vie s’écoule et se perd dans le sable ? »
Plus tard un sentiment analogue, quoique tempéré cette fois par une lointaine espérance, lui inspirait ces strophes mordantes :
« Ne riez pas de l’enfant qui, avec un fouet et des éperons — sur son cheval de bois, se croit courageux et grand, — car vous, Allemands, vous êtes aussi — pleins de pensées et pauvres d’action. — Ou bien le fait, comme le rayon sort du nuage, — sortira-t-il enfin de la pensée ? — Les livres vont-ils prendre vie ? — Ô mes amis, démentez-moi, — faites-moi repentir de ma calomnie. »
Hœlderlin souffre déjà de cette fatigue de la spéculation qui se manifestera plus tard si hautement, de cette impatience de toucher terre qui provoqua, vers 1840, l’explosion belliqueuse des Freiligrath, des Herwegh et de tant d’autres poètes. L’action à tout prix, c’est ce qu’appelait Hœlderlin en termes si amers, et c’est le même besoin, irrité jusqu’à l’aveuglement, qui a précipité les Allemands tête baissée à la suite du premier venu qui s’est chargé de l’assouvir.
Une pensée en apparence toute contraire, mais identique au fond, préside à sa tragédie de la Mort d’Empédocle, où il montre le philosophe en butte à la haine des chefs du peuple, se dérobant par une mort volontaire aux injustices et aux superstitions sociales. Il semble qu’ici, bien loin de glorifier l’action, Hœlderlin ait voulu mettre en lumière le conflit naturel du génie contemplatif et du génie politique, cet antagonisme présenté sous de si vives couleurs dans plusieurs dialogues de Platon, si souvent repris dans la suite, et qu’Alfred de Vigny a reproduit de nos jours en exagérant les incompatibilités naturelles du poète et de l’homme d’état. Hœlderlin montre bien l’humiliante victoire de l’habileté subalterne et du savoir-faire sans scrupules sur la vraie sagesse ; il ne conclut pas pour cela au dédain de l’action ; il célèbre seulement la lutte hardie et finalement impuissante d’un idéal social et religieux, représenté par le poète, le philosophe et le réformateur politique confondus dans le même homme, contre les tyrannies de la tradition historique. C’est la même idée sans doute qui le préoccupait lorsqu’il avait songé à mettre sur le théâtre Socrate, puis Agis, roi de Sparte. Tous deux représentent aussi sous des formes différentes l’idée d’une rénovation sociale, et tous deux succombent, après d’inutiles efforts, sous le poids des servitudes intellectuelles et politiques de leur temps. C’est un choix assez bizarre au premier coup d’œil que celui d’un sujet qui, malgré l’éclat légendaire dont la vie et la mort d’Empédocle ont été de bonne heure entourées, n’offre au poète aucun élément dramatique. La tragédie en effet se déroule tout entière dans une sphère de sentimens et d’idées qui n’ont rien à démêler avec le théâtre et sont à peu près inaccessibles à la foule : elle est purement lyrique. C’est là précisément ce qui a déterminé le choix d’Hœlderlin. Médecin, sorcier, faiseur de miracles, traînant après lui tout un peuple enchaîné à sa parole et à ses prodiges, tel apparaît Empédocle, investi de l’autorité d’un confident favori de la nature, habitent d’un monde supérieur en visite sur la terre, et qui semble, quand il se plonge dans le sein fumant de l’Etna, rentrer dans sa vraie patrie. Le poète voulait d’abord lui donner une femme et des enfans, pour faire sentir de quel poids les liens de famille pèsent sur le penseur voué par son génie à la tâche ingrate de presser de l’aiguillon de sa parole ceux qui traînent le char social et de le pousser dans de nouvelles voies. Il a fini par renoncer à le charger de ce fardeau superflu ; il le présente luttant seul contre un monde, grandi par cet isolement, mais payant par des souffrances qui ont plus d’un trait d’analogie avec la passion évangélique la rançon de sa grandeur.
Agrigente, délivrée de la tyrannie, n’a pu cependant parvenir au repos ; elle est troublée par ses prêtres, qui agitent la foule de leurs superstitions, fomentent sourdement les discordes et favorisent de coupables ambitions. Un seul homme, sans être revêtu d’aucune dignité publique, armé de la seule autorité de la sagesse, tient les ambitieux en échec et paralyse les mauvais desseins ; son œil vigilant, que n’endorment ni la flatterie ni l’intérêt, pénètre les manœuvres les plus secrètes ; sa voix les dénonce et les fait châtier avant qu’elles éclatent. Non-seulement son éloquence apaise les émotions populaires, mais il guérit les malades par sa parole, il sème partout les bienfaits ; une vertu salutaire émane de sa personne. La fille de l’archonte, qu’il a dérobée à la mort, vient pour contempler de loin, à travers les arbres qui abritent ses méditations, les traits presque divins du philosophe ; le peuple tout entier le révère comme un demi-dieu. Cette puissance du génie, d’autant plus grande qu’elle ne tient pas à des titres empruntés, émeut et rapproche dans une même haine tous ceux qui ne peuvent vivre que des erreurs publiques. Il faut qu’Empédocle périsse : n’est-il pas coupable du plus grand des crimes, celui de rappeler les esprits au sentiment de la vérité ? « L’esprit de l’homme, s’écrie un prêtre, est bienfaisant quand il tait ce qu’il faut taire ; mais, s’il met au jour le secret de son âme et publie ses dieux, il est plus funeste que le fer et le feu ; il est mortel et destructeur, le cœur téméraire qui laisse couler comme l’eau ses pensées dangereuses. » Tout à l’heure les paroles d’Empédocle, ces paroles dont les âmes s’abreuvaient avidement, transformées en poison, vont appeler sur lui la vengeance du peuple. Aux approches du danger, son âme est envahie de pressentimens que les discours du plus cher de ses disciples ne parviennent pas à calmer ; il a son agonie du jardin des Oliviers ; son cœur refroidi par l’âge n’entend plus aussi clairement la voix de la grande nature ; il se prend à douter de son œuvre et s’apprête à laisser le champ libre à ses ennemis. En effet, Hermocrate et Critias, le prêtre et l’archonte, viennent élever contre lui l’accusation fatale à tous les réformateurs, celle d’avoir trompé le peuple par des prestiges, d’avoir calomnié les dieux, de s’être donné lui-même pour un dieu. Empédocle est banni comme blasphémateur, mais il n’ira pas traîner sa vieillesse dans l’exil ; ce n’est pas Agrigente seulement qu’il va quitter. Son projet, encore secret, perce dans les paroles qu’il adresse à ses esclaves éplorés en les affranchissant, dans ses adieux à sa demeure, aux arbres de son jardin, à la nature hospitalière qui lui a si longtemps prodigué ses douceurs. Il s’éloigne enfin, et en partant il pleure sur la Sicile, comme Jésus sur Jérusalem, et voit s’élever à l’horizon lointain le jour où, de l’Afrique et de l’Italie, l’ennemi viendra ensanglanter la terre des moissons odorantes et fouler aux pieds de ses armées les raisins dorés.
Dès les premiers pas, aucune des humiliations de l’exil ne lui est épargnée ; le désert se fait autour du maudit, le voyageur évite son sentier, le berger auquel il demande un abri et un verre d’eau lui ferme sa chaumière ou s’enfuit avec horreur. Cependant le vent populaire a déjà tourné ; les Agrigentins, plus troublés qu’auparavant, ont éprouvé les effets de l’absence du grand homme ; ils ont redemandé leur bienfaiteur et leur idole. Il faut que ceux qui ont obtenu son bannissement, viennent le supplier de rentrer dans Agrigente. Le prêtre Hermocrate, couvrant d’un langage orgueilleux l’affront qu’il est obligé de dévorer, apporte à Empédocle un pardon insolent que celui-ci rejette avec mépris. La foule le presse, l’implore et lui offre enfin d’être le Numa de la cité. « Non, répond-il, le temps des rois est passé. » Et, comme le peuple s’étonne, il ajoute :
« L’aigle couve-t-il toujours ses aiglons — dans le nid ? Il en a soin lorsqu’ils sont aveugles. — Tant qu’ils sont encore nus, il abrite doucement — sous ses ailes leur vie obscure et sommeillante ; — mais dès qu’ils ont regardé la lumière du soleil, — dès que le temps a grandi leurs ailes, — il les chasse du berceau pour qu’ils volent à leur tour. — Rougissez de vouloir un roi ; vous êtes — trop vieux. Au temps de vos pères, — cela était permis ; c’est fait de vous aujourd’hui, — si vous ne savez pas vous sauver vous-mêmes. »
Quant à lui, son rôle terrestre est achevé ; il n’a plus qu’à mourir. Il apparaît bientôt sur le sommet de l’Etna. Au moment de consommer avec la nature ses noces éternelles, un enthousiasme sacré s’empare de lui, et il chante en termes magnifiques son propre épithalame. « L’heure est venue… L’Etna paternel apprête à son hôte la coupe de flamme que l’esprit intérieur remplit jusqu’aux bords ; elle est couronnée de fleurs qu’il a enfantées lui-même, la tempête souterraine s’éveille pour la fête, et, sœur de la foudre, elle envoie ses éclats jusqu’aux nuages. Je sens mon cœur gonflé de joie et d’orgueil. » Un dernier combat lui reste à livrer. Au bord du cratère surgit à sa vue un vieillard, Manès l’Égyptien, symbole des terreurs orientales, qui essaie de l’arrêter par l’épouvante ; mais il se rit de ces peurs enfantines et s’abandonne avec confiance au mystère des abîmes.
L’accent des hymnes orphiques alterné dans cette œuvre singulière avec des invectives qui rappellent celles de l’Évangile contre les pharisiens. S’il fallait la caractériser d’un mot, je l’appellerais une tragédie hiératique. L’hypocrisie sacerdotale y est démasquée, le héros succombe à l’accusation d’impiété, la puissance qu’on lui attribue et la sagesse qui fait sa force reposent, non sur le culte de la tradition, mais sur une intelligence déjà scientifique des choses, et pourtant une sorte de terreur sacrée, un sentiment de profonde adoration s’en exhalent de toutes parts. N’était que le grand art tragique de Sophocle y fait complètement défaut, j’oserais dire que la tristesse sereine d’Empédocle, sa dévotion au dieu inconnu, sa renonciation aux intérêts terrestres, l’acceptation volontaire de son malheur, l’obscurité qui couvre sa destinée finale, donnent à sa figure la majesté religieuse d’Œdipe à Colone. Le paganisme d’Hœlderlin n’est pas un paganisme alexandrin s’amusant des superstitions gracieuses de la décadence ; il tient plutôt du génie sinistre des légendes primitives et des religions de Samothrace. Il est bien curieux au surplus de voir les philosophes de la fin du XVIIIe siècle, en possession de toutes les découvertes de la science moderne, se chercher des devanciers dans l’interprétation de la nature parmi les maîtres de l’Ionie ou de la Grande-Grèce. Quoiqu’il eût fait sur la nature des choses un poème si beau qu’il le lut aux jeux olympiques, Empédocle est déjà un savant ; en opposition à la vieille religion homérique, il pratique, comme bien d’autres, l’investigation libre, et la hardiesse de ces premières spéculations, le sentiment de l’unité universelle qu’elles respirent, la réduction qu’elles essaient témérairement de tous les phénomènes à quelques principes abstraits, tout cela présente une incontestable parenté avec les idées fondamentales de la philosophie de la nature, dont Schelling exposait la première ébauche au moment même où Hœlderlin s’en faisait le prophète.
Dans le déclin des croyances qui marque le siècle dernier, on voit poindre parfois chez les plus ardens à les combattre une sorte de religion nouvelle, — celle du panthéisme. Après que les découvertes modernes ont livré à la pensée l’espace infini et manifesté l’invariabilité des lois qui régissent les choses et l’homme comme tout le reste, le divin, qu’on croyait avoir banni du monde, y rentre triomphant. On dirait chez plusieurs d’un retour tardif aux religions naturalistes de l’antiquité ; mais ce panthéisme reste dans une indétermination nécessaire. Il se détruirait en se précisant ; on reconnaît, on salue dans l’univers une force diffuse et anonyme, on n’a garde de diviniser chacun des noms différens sous lesquels on la spécifie. Hœlderlin présente le cas peut-être unique d’une intelligence moderne, initiée aux résultats généraux des sciences, dans. laquelle les forces de la nature revêtent d’elles-mêmes une personnalité absolue. Ses poésies lyriques, dont la prose française est malheureusement incapable de rendre la beauté marmoréenne et l’harmonie musicale, fournissent à cet égard un témoignage certain ; elles proclament la spontanéité de ces regrets qui donnent à Hœlderlin l’air d’un étranger parmi ses contemporains. II n’y a pas à en douter : quand il célèbre « les Forces souveraines du Ciel ; l’Océan, père antique des choses, l’Éther, âme du Monde, le Soleil, puissance sacrée qui éveille la vie, » ce ne sont point là pour lui de purs noms ou des réalités inanimées. Ces abstractions vivent, elles agissent, elles veulent, elles comprennent ; il ne leur manque, pour qu’on y reconnaisse les divinités helléniques, que les noms mythologiques et les aventures légendaires créées et développées de siècle en siècle par la tradition. L’éther, la lumière, sont des êtres bienfaisans qui parlent à l’imagination du poète, qui le pénètrent de respect et d’amour, surtout l’éther nourricier, qui nous abreuve avant même que nous touchions aux mamelles maternelles, vers lequel le brin d’herbe et le cèdre aspirent, où tous les êtres se baignent, qui épand sans mesure ses torrens inépuisables et circule dans les canaux les plus secrets de la vie.
« Favoris du ciel, les oiseaux heureux — habitent et se jouent sous les lambris éternels du père. — Il y a place pour tous, il n’y a point de sentier tracé, — grands et petits se meuvent librement dans la demeure illimitée. — Ils s’ébattent sur ma tête, et, gonflé d’un désir impatient, — mon cœur s’élance vers eux ; la patrie hospitalière — m’appelle de loin ; je voudrais gravir — les sommets des Alpes et de là crier à l’aigle rapide — de me saisir, comme il saisit l’enfant favori de Jupiter, — et de m’emporter dans les palais de l’Éther. »
Il serait bien facile de trouver dans le rôle universel que la science actuelle reconnaît à l’éther une justification de cet enthousiasme ; mais le poète fait mieux que de prêter sa langue au savant. Ses vers ne s’adressent pas au symbole d’un agent abstrait et plus ou moins passif, ils s’adressent à une puissance vraiment divine. Comment ne pas se rappeler ici les fonctions que la mythologie prête à Jupiter et qui lui assurent le premier rang parmi les dieux, ces fonctions qui l’identifient presque avec le ciel, que la lumière inonde, et avec l’air respirable, principe de toute vie ? « Vois-tu, dit un fragment d’Euripide, cette immensité sublime de l’Éther, qui enveloppe la terre de toutes parts ? C’est là Zeus, c’est là le Dieu suprême. » Si ce qu’il y a de plus insaisissable dans la nature s’empare à ce point de la pensée d’Hoelderlin, on conçoit que des réalités bien plus concrètes s’animent dans son imagination. La planète n’est pas seulement un être organique, elle est une personne qui a ses parens, ses enfans, sa famille, qui jouit et qui souffre, qui a ses alternatives de richesse et de pauvreté. Quelque part il peint la nature polaire, la terre ensevelie sous des voiles de neige, que les chauds embrassemens de l’Olympe ne parviennent plus à réveiller. Ne rien engendrer, n’avoir rien à couver d’un soin maternel, vieillir sans se voir renaître dans des enfans, c’est la mort ; « mais un jour viendra, s’écrie-t-il comme s’il devançait certaines théories géologiques de nos jours, un jour viendra où les baisers du soleil réchaufferont tes membres, où son souffle dissipera ton sommeil glacé. Alors, pareille au grain de blé enfoui, tu briseras ta dure enveloppe, le timide bouton du monde se déroulera peu à peu, ta force longtemps épargnée se déploiera dans les pompes enflammées du printemps, les roses brilleront et la vie bouillonnera dans l’avare septentrion. » La vie végétale a part aussi à ses adorations ; il y a sous chaque écorce un dieu silencieux. Dans la plus belle peut-être de ses poésies, un poète contemporain, un des rénovateurs du genre païen, M. V. de Laprade, s’attendrit sur la mort du chêne, dont la sève ensanglante la cognée meurtrière ; mais ce qu’on sent ici, c’est l’amour druidique, des forêts profondes, et avant d’arriver au bout on voit le poète se démasquer sans le vouloir et trahir une pensée qui n’a rien de païen. Hœlderdin salue les chênes, jaloux de leur force et de leur indépendance, comme s’il reconnaissait en chacun d’eux un ami.
« Je quitte les jardins et viens à vous, fils des monts, — les jardins où vit la nature, soumise et familière, — rendant soins pour soins, compagne de l’homme industrieux. — Mais vous, arbres souverains, debout comme un peuple de Titans, — dans ce monde assujetti, vous n’appartenez qu’à vous et au ciel, — qui vous nourrit et vous éleva, et à la terre, dont vous êtes nés. — Nul de vous n’est allé à l’école des hommes ; — d’un libre et joyeux élan, vous jaillissez de vos fortes racines, — pressés et confondus ; comme l’aigle sa proie, — vous saisissez l’espace d’un bras robuste, et vers la nuée — se dresse, dans sa hauteur sereine, votre couronne illuminée. — Chacun de vous est un monde. Comme les étoiles du ciel, — vous vivez, dieux indépendans, en une libre alliance. — Si je pouvais supporter l’esclavage, je n’envierais pas — cette forêt, et je me plierais sans révolte à la vie sociale. — Ah ! si rien n’enchaînait à cette vie mon cœur, — qui ne peut se déprendre d’aimer, je voudrais demeurer parmi vous ! »
On a beaucoup parlé du paganisme de Goethe, et il y a du païen sans doute dans cet amour dominant de la beauté plastique, dans cette intelligence profonde qui ressuscite dès qu’il lui plaît les plus vieux symboles de la mythologie, dans cette grâce tranquille qui a été l’étude de toute sa vie ; il y a du païen dans cette impassibilité olympienne, bien moins réelle toutefois qu’on ne l’a dit, qui lui a été tant reprochée. Si païen qu’il soit pourtant, Goethe, amoureux des sciences, expérimentateur passionné, observateur infatigable du règne humain comme des règnes de la nature, Goethe, qui a toujours gouverné si pleinement les mouvemens de son imagination, ne s’est jamais élevé, même sous l’empire de l’illusion poétique, à cet enthousiasme qui suscite dans l’âme d’Hœlderlin la piété d’un ancien envers ses dieux. Cette étrange faculté a déconcerté Schiller et Goethe. « Il y a là plus d’histoire naturelle que de poésie, écrit Goethe à Schiller à propos de quelques pièces d’Hœlderlin. Ces morceaux me font l’effet des vieilles tentures où l’on voit les animaux rassemblés dans le paradis terrestre autour d’Adam. » Ce jugement étonne, et les meilleurs juges en Allemagne l’ont cassé depuis longtemps. Ce que Goethe appelle histoire naturelle est la métamorphose la plus hardie de la nature qu’aucun poète moderne ait osée, si toutefois il peut y avoir de l’audace à créer des dieux sans s’en douter. La place d’Hœlderlin est parmi les grands lyriques, non pas seulement de son pays, mais de tous les temps. Le lyrisme familier, celui qui se nourrit des joies, des chagrins de tous les jours et des sentimens ordinaires que la vie apporte, est commun au-delà du Rhin ; il a produit une moisson de lieds et de ballades incomparables. L’Allemagne a peu de ces lyriques dont l’enthousiasme a besoin pour s’exprimer de l’ode et de l’hymne, qui semblent faits pour promener sur le parvis des temples leurs robes à franges d’or. Hœlderlin est de ceux-là. On retrouverait bien dans ses poésies la trace des incidens de sa vie, on y pourrait découvrir comment il a aimé et souffert : depuis les murmures enchantés de l’amour naissant jusqu’aux sanglots qui accompagnent la séparation, on pourrait suivre, toutes les phases de sa passion pour Diotime ; mais ce n’est pas là-dessus qu’il faut mesurer son génie. Malgré les orages de sa vie, son inspiration atteint d’abord la majesté, ses idées revêtent comme d’elles-mêmes la pompe des rhythmes sacrés. Il est de la famille des Pindare et des Alcée, gardiens des traditions, interprètes des pensées divines, chantres des puissances d’en haut. Ce que l’âge fabuleux des héros mêlés aux hommes sur la terre encore neuve et celui des luttes entre les générations célestes sont pour les lyriques grecs, la Grèce elle-même, j’entends la Grèce historique de Périclès, l’est pour le poète allemand ; c’est son âge d’or, là se trouve pour lui le type absolu de la vie humaine. Hœlderlin est païen comme Goethe, mais dans un sens tout autrement rigoureux. Au reste il doit être mis à part et à distance égale des deux camps qui se forment dans la littérature allemande au moment où le romantisme y fait irruption et réagit contre la grande poésie humaine de Goethe et de Schiller. Hœlderlin n’est pas un peintre de l’humanité, et la réflexion domine trop chez lui pour qu’on puisse le considérer comme un classique. D’autre part, il a bien quelques-uns des traits qui distinguent les romantiques : les préoccupations religieuses et politiques ne l’abandonnent pas ; on le voit assez à cet arrêt où il proclame la déchéance définitive de la royauté et qui est comme un écho du club de Tubingue et des discours de la convention ; on le voit aussi à l’irritation d’un patriotisme humilié qui perce chez lui presque à chaque pas. Il rêve une régénération de l’Allemagne, mais il ne la rêve pas, à l’exemple des romantiques, comme une renaissance catholique et comme un retour aux gloires évanouies du saint-empire romain, il ne la rattache pas non plus aux souvenirs, déjà réveillés par Klopstock, des victoires d’Arminius sur l’envahisseur latin, qui sont devenues dans la suite le thème des déclamateurs gallophages. Au contraire il rêverait, s’il osait, cette régénération dans une résurrection du génie hellénique. Le nom de la Grèce lui arrache les accens d’un fils qui pleure sur le tombeau maternel ; il cherche à se faire illusion et à se persuader qu’elle n’est pas morte pour toujours. « Oui, s’écrie-t-il en s’adressant à la mer d’Ionie dans une belle poésie intitulée l’Archipel, tu reposes encore à l’ombre de tes montagnes comme autrefois ; tes bras toujours jeunes embrassent encore la terre bien-aimée, et de tes filles, de tes îles fleuries, aucune n’est perdue. La Crète se dresse encore ; Salamine verdit sous ses lauriers tout illuminée de rayons ; au soleil couchant, Délos élève sa tête inspirée, et Céos et Chio sont toujours couronnées de fruits… Ces compagnes célestes, les puissances suprêmes, qui, toujours tranquilles, apportent aux mortels la clarté du jour, le doux sommeil, les pressentimens secrets, les divinités sont toujours avec toi, et souvent dans le crépuscule du soir, lorsque des monts de l’Asie la lumière sacrée de la lune descend et que les étoiles se mirent dans tes flots, tu brilles toi-même d’un éclat céleste, et le chœur de tes frères d’en haut retentit dans ton sein. » La demeure seule subsiste, le génie qui l’habitait l’a désertée pour jamais. Hœlderlin le comprend, et il courbe la tête sous la volonté du grand dieu de l’hellénisme, du destin, auquel il adresse l’hymne qui ouvre son recueil.
Si un poète qu’on pourrait appeler le dernier des païens, après s’être enivré de son rêve jusqu’au délire, est mort sans avoir jamais espéré que son Atlantide surgît un jour des profondeurs du temps, il n’est pas à croire qu’aujourd’hui les plus fervens apologistes de la civilisation hellénique nourrissent une plus sérieuse illusion. Non, ces hommes d’esprit ne veulent pas repeupler l’Olympe, ils n’ont pas la ridicule fantaisie de renouveler une tentative, dans laquelle Julien, armé de la puissance impériale, a échoué voilà quinze cents ans, quand les temples étaient encore debout. Leur zèle païen est surtout un jeu poétique, car presque tous sont poètes, et leur talent, dans lequel les inquiétudes de la pensée moderne percent sous le dilettantisme grec,
selon l’expression de l’un d’eux, montre assez ce que leur culte a de factice et d’inoffensif. Que veulent-ils donc ? Relever d’un anathème de vingt siècles une religion qui a présidé à la plus belle des civilisations, justifier le merveilleux instinct qui, revêtant des formes les plus charmantes du symbole poétique l’intuition des forces naturelles, créa cette mythologie, inspiratrice des Homère et des Phidias. Depuis deux mille ans, cette mythologie a été considérée comme un mystère d’égarement intellectuel, comme un signe éclatant de la déchéance humaine. Ce culte, dont la religion nouvelle s’appropriait les débris à son insu, était traité comme une possession démoniaque, poursuivi sans relâche, et il a fini par céder aux exorcismes. Cependant, ou il faudrait dénier à la religion toute influence sociale, ce qui est impossible, ou il faut reconnaître qu’elle fait les sociétés à son image, et alors comment ne pas en appeler de ces arrêts contre une religion qui, accompagnant l’homme à chaque pas, remplissant son esprit, sanctifiant toutes ses actions, pénétrant toute sa vie, a engendré la civilisation où il s’est développé de la manière la plus complète, dans la pleine harmonie de la pensée et de l’action, de la vie personnelle et de la vie publique ? Comment ne pas voir dans cette république de dieux, où chacun a sa fonction distincte et où l’ordre résulte de la diversité, l’image de cette république morale qui maintient dans l’individu l’équilibre de toutes les forces physiques et intellectuelles sans en sacrifier aucune et de cette autre république visible, la cité, milieu nécessaire où chacun se déploie, et qui fait de tous les citoyens des parties intégrantes d’un même corps ?
Cette justification, appuyée sur tout ce qu’une érudition de plus en plus exacte et des comparaisons de plus en plus multipliées nous ont appris, est digne de notre équité historique. Il est impossible de méconnaître ce qu’elle a de fondé ; mais le moyen de s’en tenir là, de ne pas exagérer une vérité si séduisante, de ne pas se laisser prendre aux prestiges de l’imagination, qui sans le savoir embellit toujours ce qui fut aux dépens de ce qui est ? Au temps de Corneille, de Balzac et de Mlle Scudéri, la fierté romaine s’offrait comme un idéal aux regards éblouis des romanciers et des poètes, qui ne se faisaient pas faute d’y ajouter pour dernier charme la bonne grâce et la galanterie des seigneurs de la cour. Nous avons renoncé aux Romains ; portés par une admiration moins absurde et moins dangereuse, nous prenons plaisir à remonter aujourd’hui jusqu’à la Grèce ; nous opposons notre décadence à son éclatant midi, nos misères à ses vertus, notre existence appauvrie et chagrine à sa joyeuse activité. Combien la vie, telle que les exigences d’une morale sombre nous l’ont faite, attristée par une défiance perpétuelle contre tous les mouvemens de la nature, condamnée à la plus pénible tension, pour atteindre quoi ? une perfection fictive et monacale, inutile aux autres, et qui, refoulant les passions sans les dompter, ne sert souvent qu’à couvrir toutes les faiblesses d’un voile d’hypocrisie, combien cette vie ne paraît-elle pas inférieure au libre déploiement de la nature humaine sous la discipline de l’art ! Car l’art n’était pas chez les Grecs une distraction subalterne ou un luxe corrupteur ; il n’était pas appliqué seulement à la construction des temples, à la reproduction des formes humaines, à l’expression des sentimens dans la poésie, il l’était également à la conduite de l’âme, à la discipline des passions, comme au gouvernement de l’état. Il introduisait en tout et particulièrement dans l’homme la mesure, l’harmonie et le rhythme. Chez nous au contraire, la disproportion et la lutte éclatent partout, dans l’art, dans la vie, dans l’état : les chefs-d’œuvre sont des monstres, le génie est une maladie ou une mutilation, la vertu est un tour de force, le gouvernement est un mécanisme qui maintient violemment sous le même joug des atomes épars et ennemis. L’intelligence humaine est divisée contre elle-même. L’hellénisme, en remplissant l’imagination et la vie, n’en laissait pas moins la pensée sans entraves, il ne prétendait pas guider la science. Des dogmes abstraits, devant lesquels il a succombé, se dressent comme un obstacle et comme une menace à l’entrée de toutes les avenues de l’esprit. La croyance et la science ne peuvent plus coexister dans la même pensée, il faut choisir. Cette division, passant de l’intelligence individuelle dans la société, l’a scindée en deux peuples plus éloignés l’un de l’autre que ne l’étaient les Grecs et les barbares, en deux peuples qui ont cessé d’avoir mêmes dieux et même foi, et qui, vivant dans le même siècle, appartiennent pourtant à des âges différens de l’histoire ; peuples étrangers l’un à l’autre et souvent hostiles, qui se combattraient sans trêve, si une force publique qui les domine tous les deux ne les maintenait en paix en les dispensant des devoirs et des vertus du citoyen.
Voilà les argumens qu’on fait valoir pour justifier l’enthousiasme que l’hellénisme inspire, et les nouveaux païens ne m’accuseront pas, j’espère, de les atténuer. Pourquoi au surplus nierait-on que dans le cours du temps l’humanité ait subi des pertes, et que la civilisation grecque en périssant lui ait laissé quelque chose à regretter ? L’irrésistible ascendant de la Grèce sur tous ceux qui l’ont approchée où vaincue tour à tour, sur les Lydiens, les Égyptiens, les Perses, les Romains, les rapides floraisons qui se sont partout produites au moindre contact de son génie, au VIIIe siècle chez les Arabes d’Espagne comme au XVe siècle en Italie, l’admiration que nul peuple n’a pu refuser à ses chefs-d’œuvre et à ses grands hommes, tout témoigne qu’il y eut en elle quelque chose qui n’a été ni dépassé ni remplacé. Il serait inutile de le contester ; mais hâtons-nous d’ajouter qu’il n’en serait pas moins puéril de défendre contre elle la civilisation qui lui a succédé. Cette civilisation se défend elle-même assez par ses œuvres et par sa durée. D’ailleurs on ne revient pas à la jeunesse, si sévère que soit la destinée de l’âge mûr. L’hellénisme fût-il encore mille fois plus beau, ses dieux, ses arts, sa liberté, ne renaîtront pas. Quand nous nous laissons-emporter par nos regrets vers la Grèce, nous l’abordons par ses poètes, ses artistes, ses historiens patriotes, et nous nous laissons tromper par le mensonge involontaire de tant de chefs-d’œuvre. Nous oublions l’esclavage, et nous ne voyons plus qu’une foule d’hommes choisis, qui tous participent à la beauté de leurs dieux, à la vertu de leurs héros, à l’intelligence de leurs poètes et de leurs philosophes. La vraie Grèce, avec les vulgarités et les misères qu’elle connut comme tout ce qui vit, disparaît dans les splendeurs de cette apothéose. Nous oublions malgré nous que ces cités merveilleuses ont été dans le monde une imperceptible aristocratie ; nous ne songeons pas que pour façonner cette aristocratie, pour en tirer ces types de grandeur, ces penseurs, ces artistes, ces hommes d’état, ces guerriers, il fallait que leur horizon mental et politique ne dépassât guère les limites de la cité, il fallait aussi que la partie inférieure et laborieuse de la vie fût dévolue à des races sacrifiées. Ces aristocraties ont péri ; à leur place, et formée en partie de leurs richesses, une autre civilisation s’est élevée, penchant peut-être aujourd’hui vers son déclin, qui explique assez nos tristesses. L’épanouissement de la science, l’affranchissement des masses, leur initiation à la vie morale, leur ascension vers la pensée et la liberté, leur groupement dans l’organisme de vastes sociétés fondées sur la science et le travail, tout celai commencé, par une civilisation qui semble épuisée, en recèle, une autre dont les premiers linéamens n’apparaissent pas encore d’une manière bien distincte. Cette civilisation rendra-t-elle à l’art sa prépondérance et aura-t-elle le beau pour principe en même temps que la science ? Cela est douteux. Tout porte à croire qu’avant d’aborder ces rians rivages elle aura des jours sévères à passer, la misère à réduire, la nature à connaître et à dompter, la richesse à accroître et à répartir, l’ignorance à combattre, les âmes incultes à moraliser. Dût-elle longtemps rester dans ces âpres régions avant de retrouver ce qui fait les séductions éternelles de l’hellénisme, la civilisation qui a donné à l’homme du peuple, c’est-à-dire à tous, un nom et un droit, valait la peine que l’ancienne pérît pour lui faire place.
*






